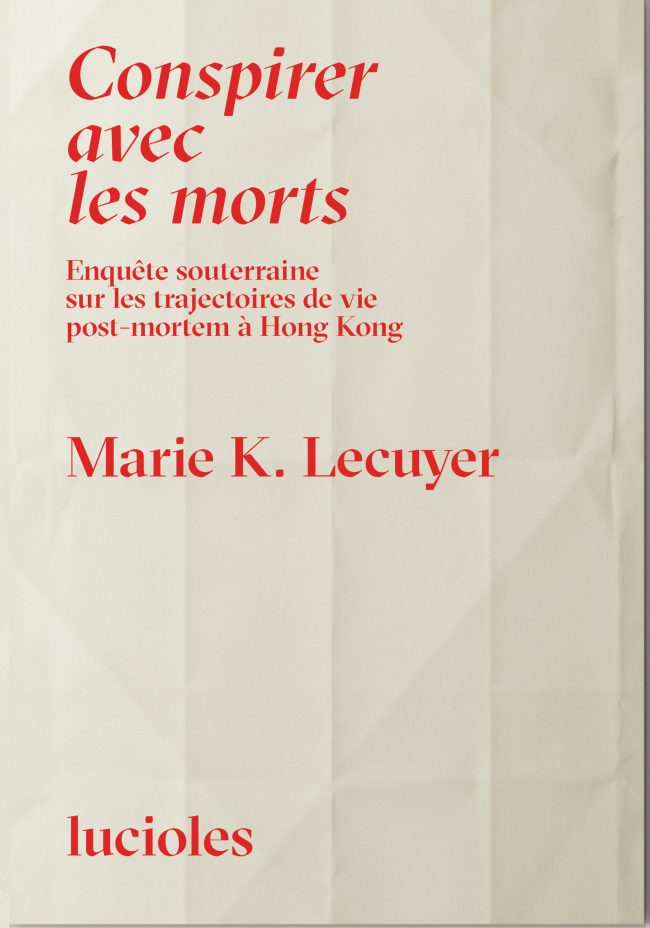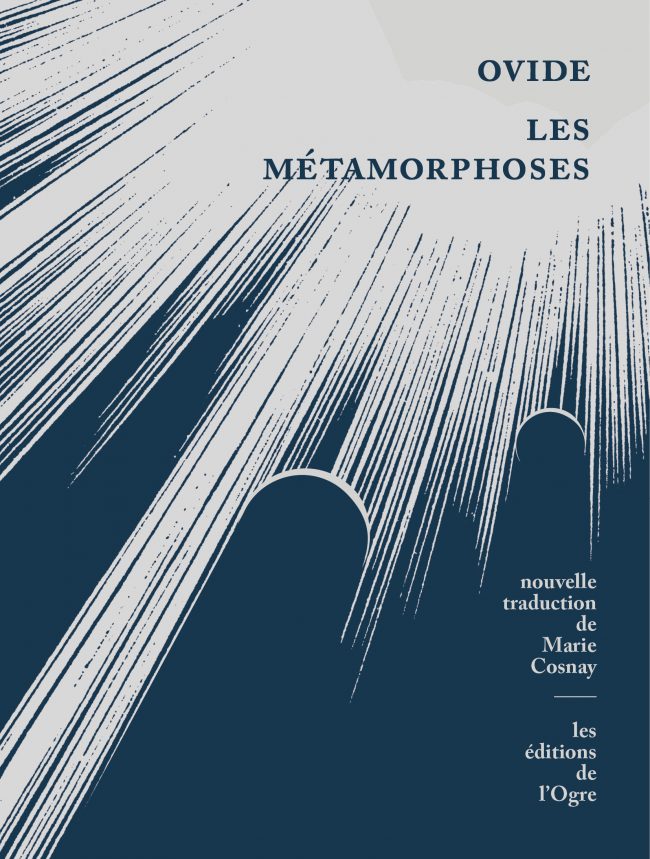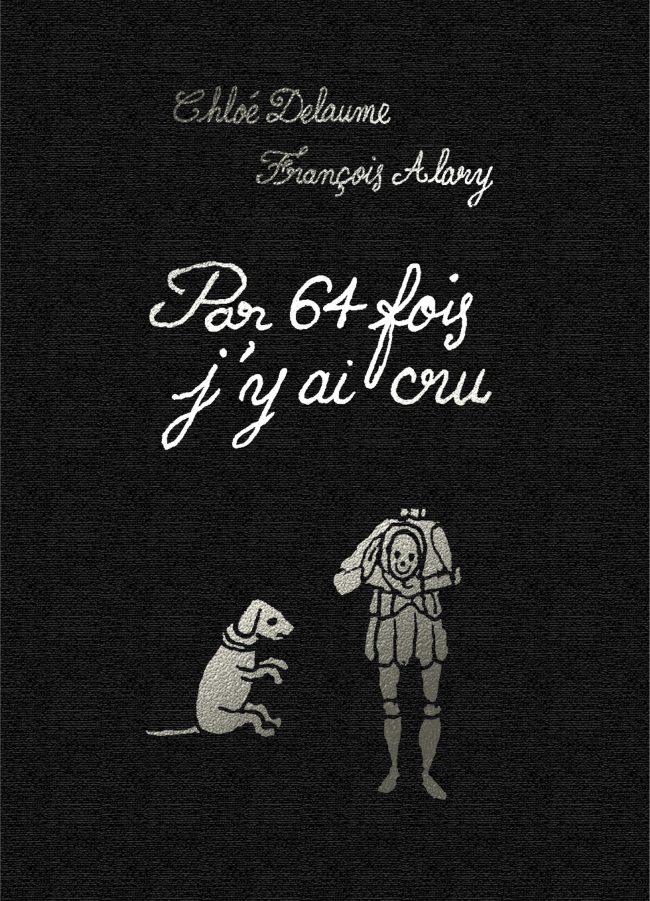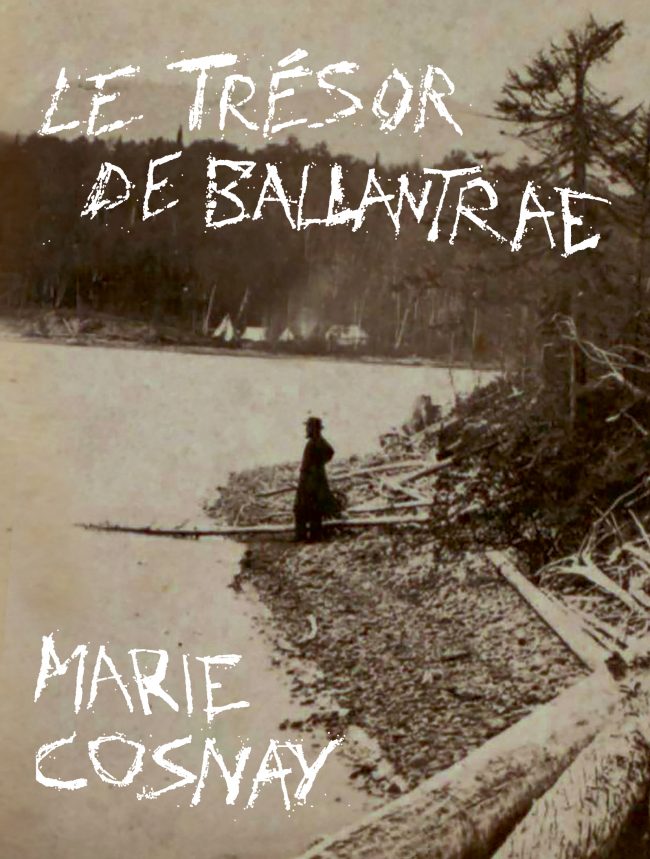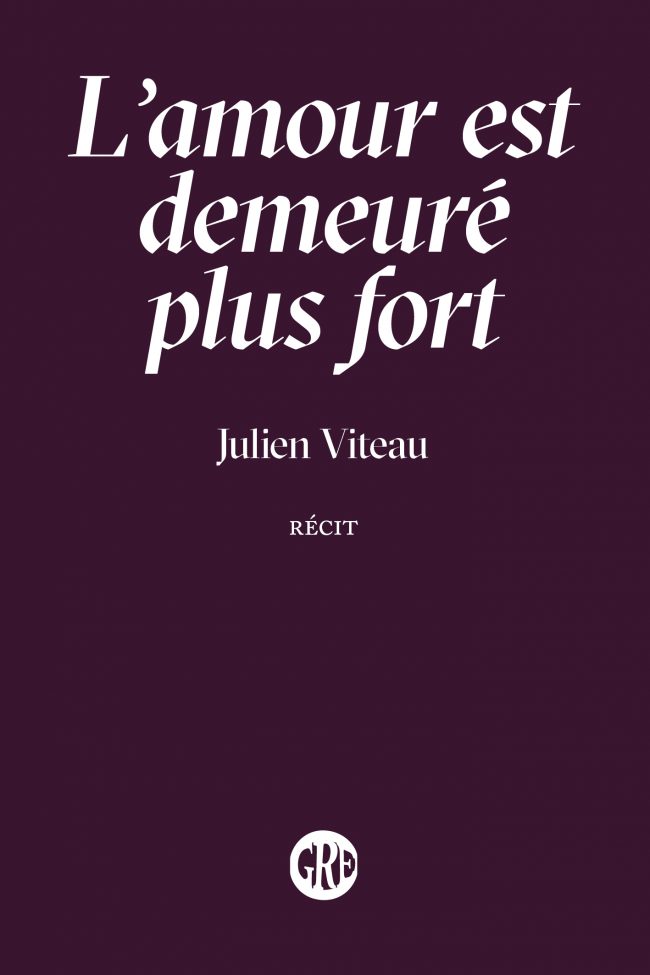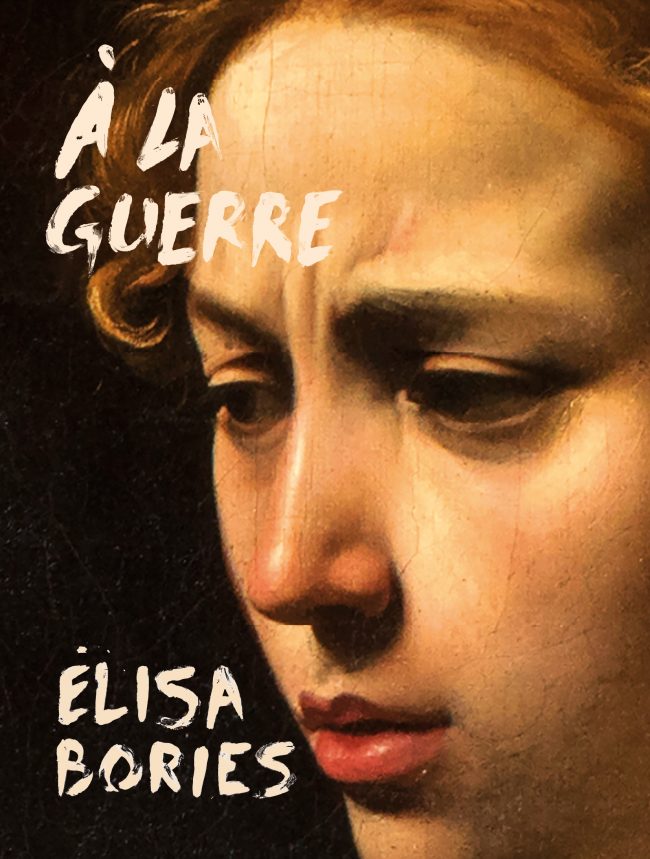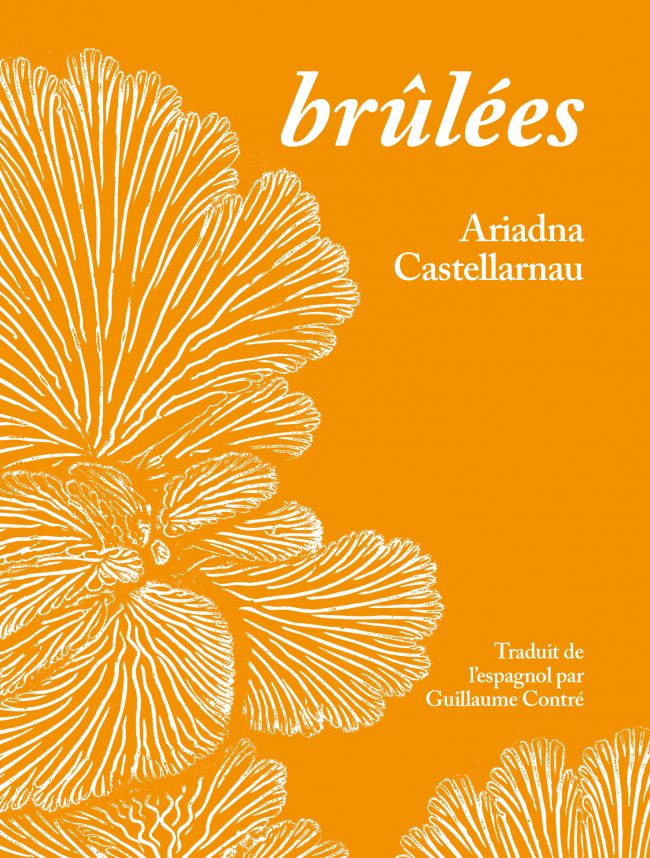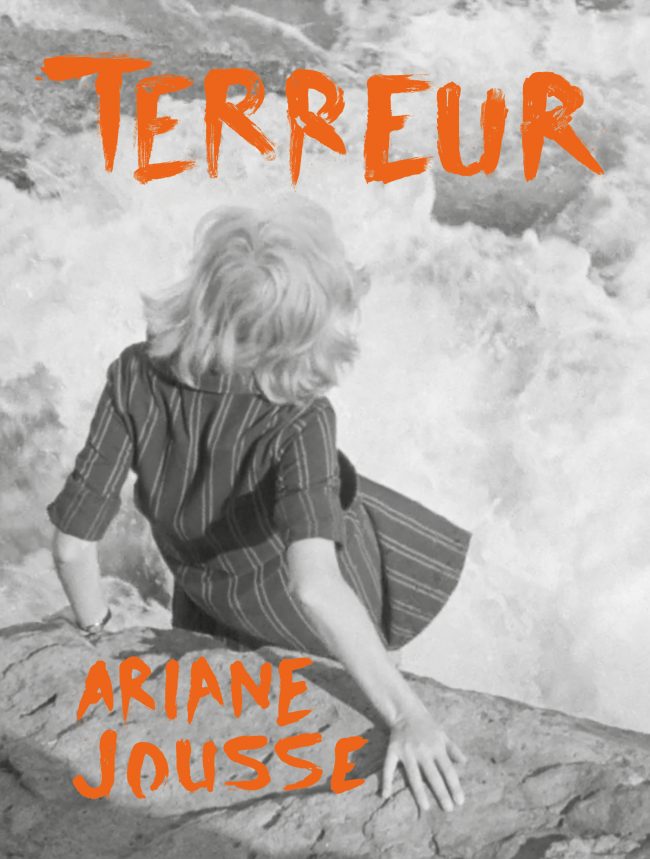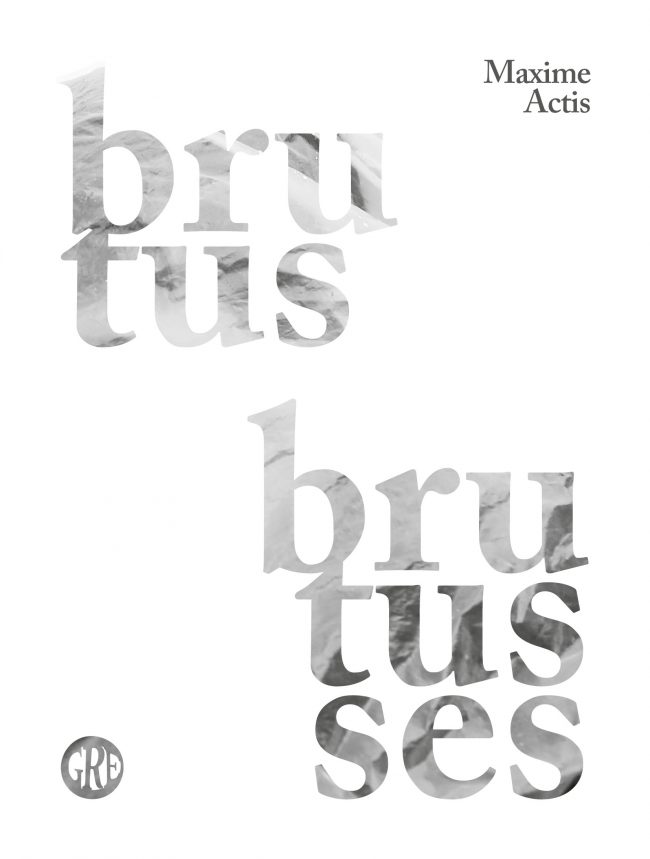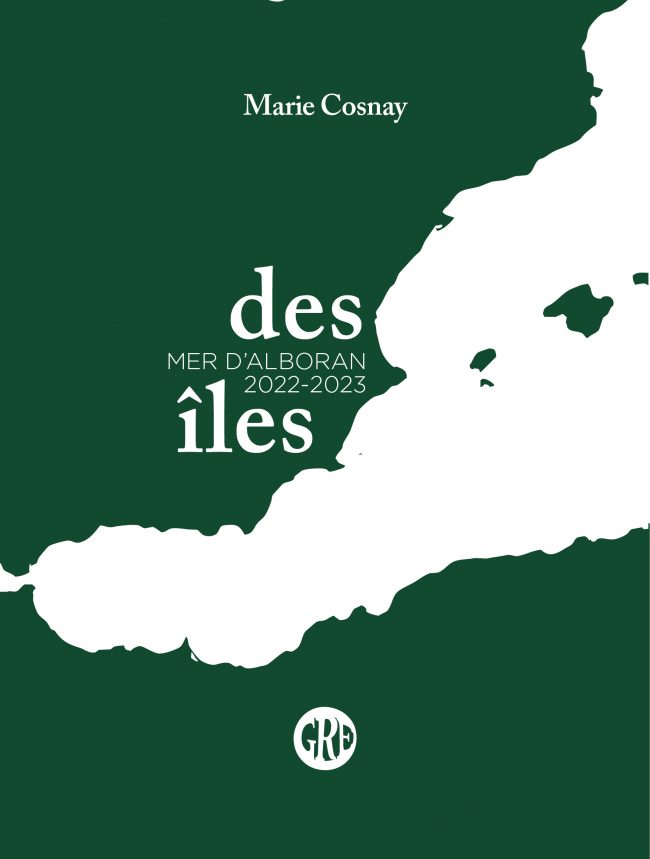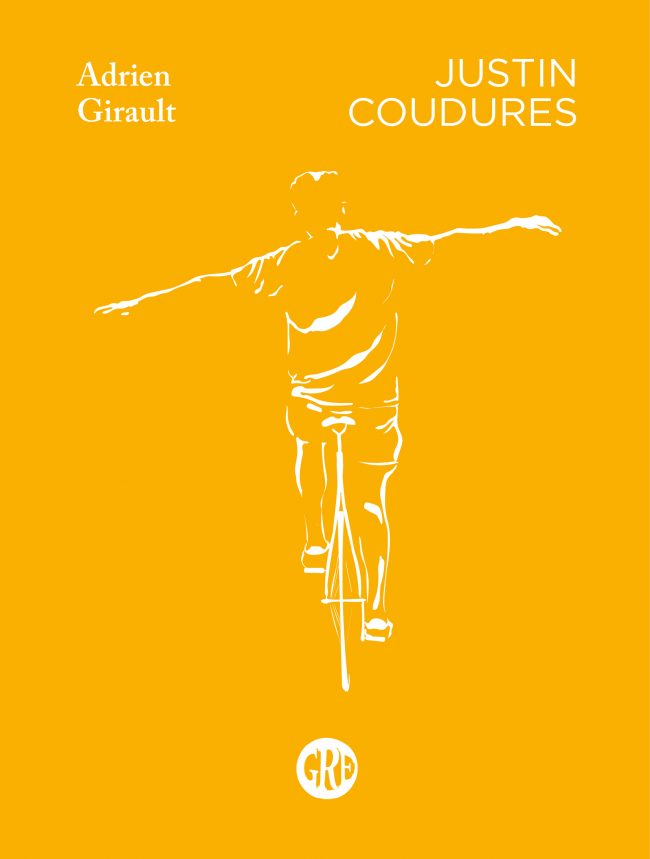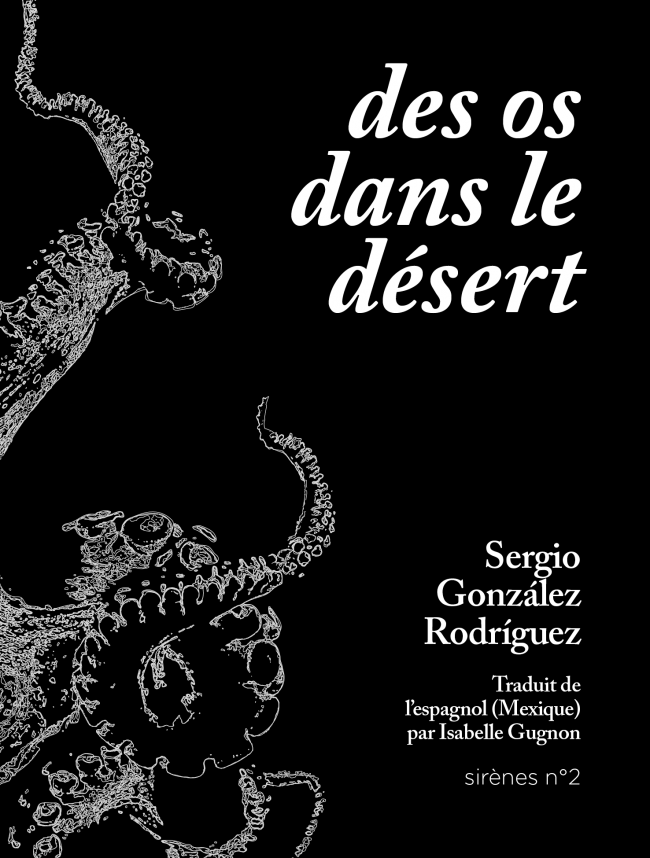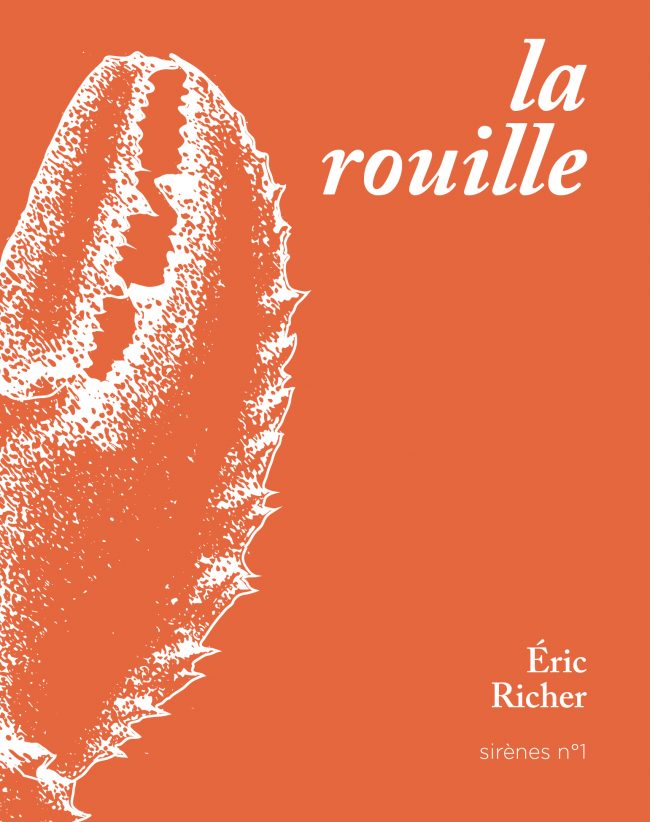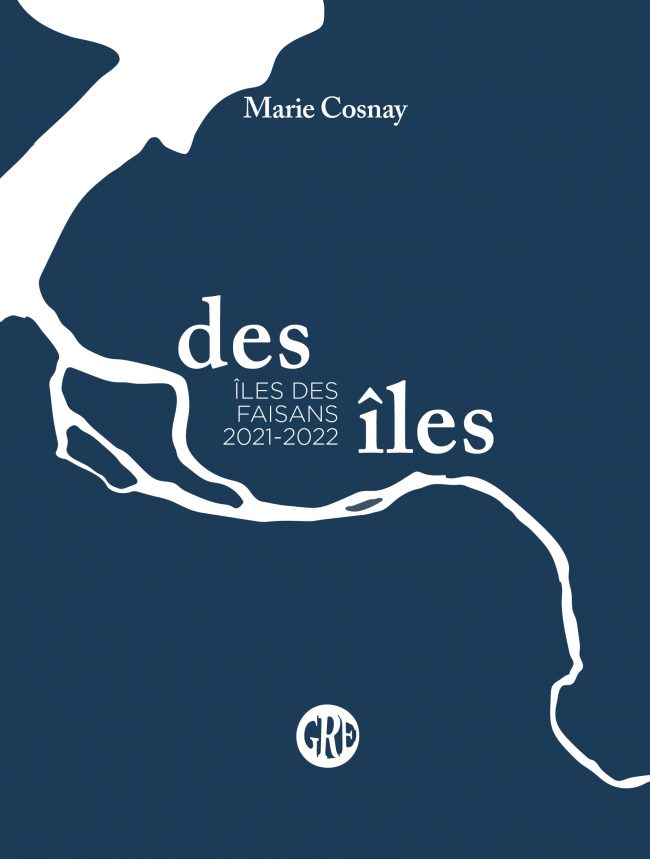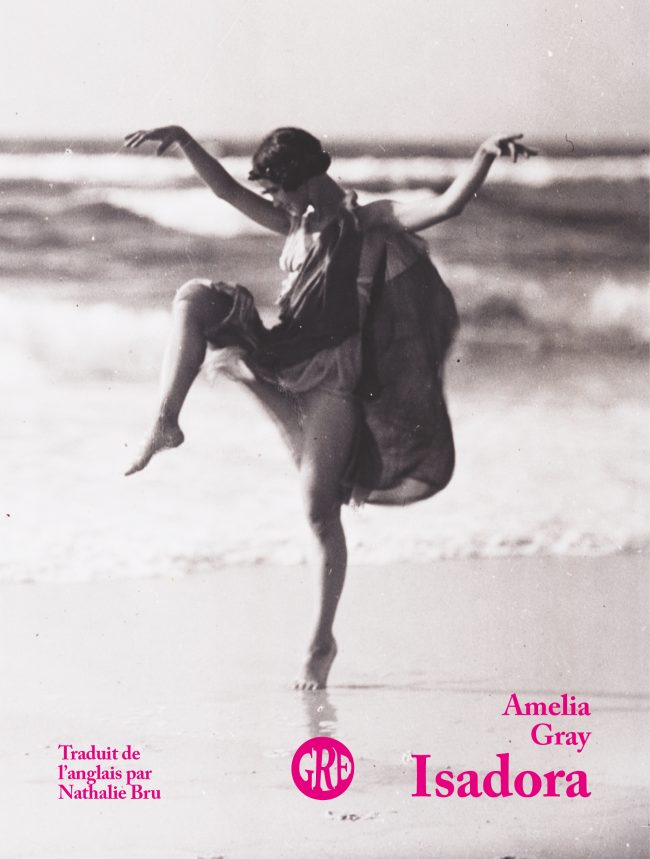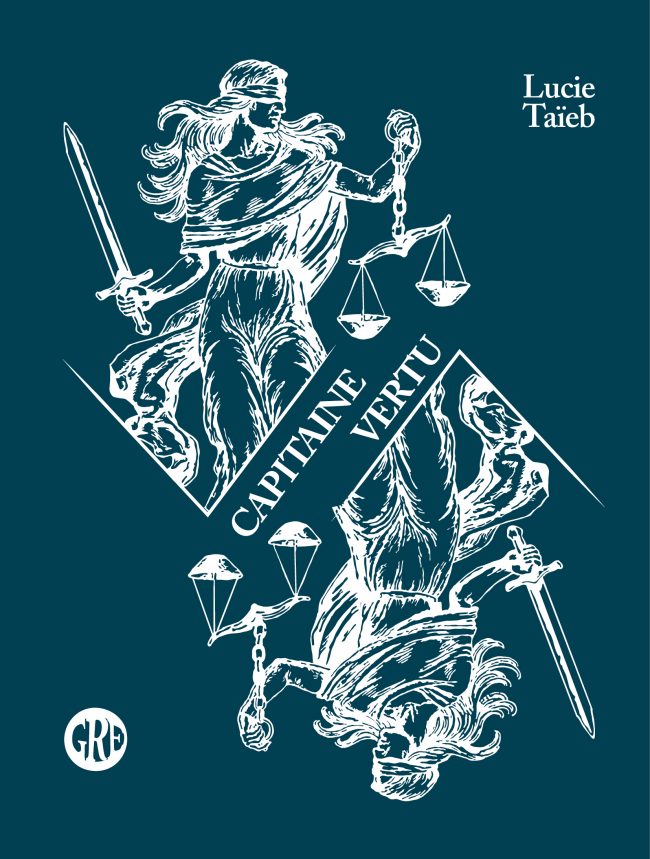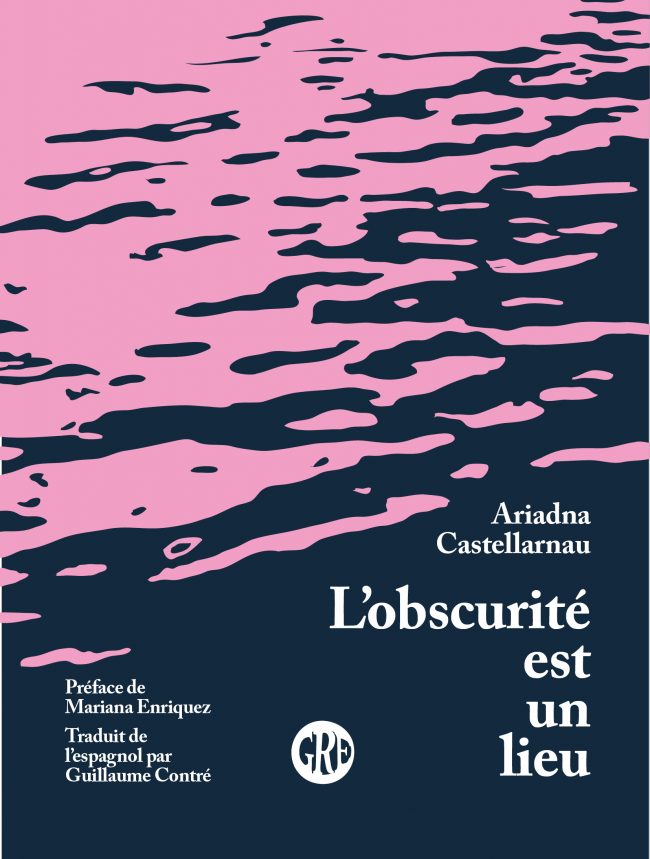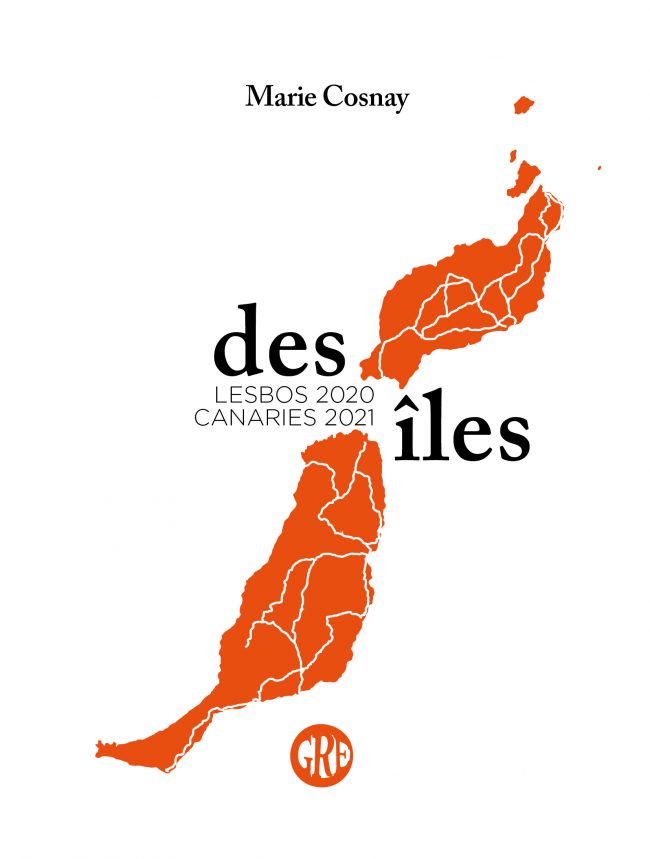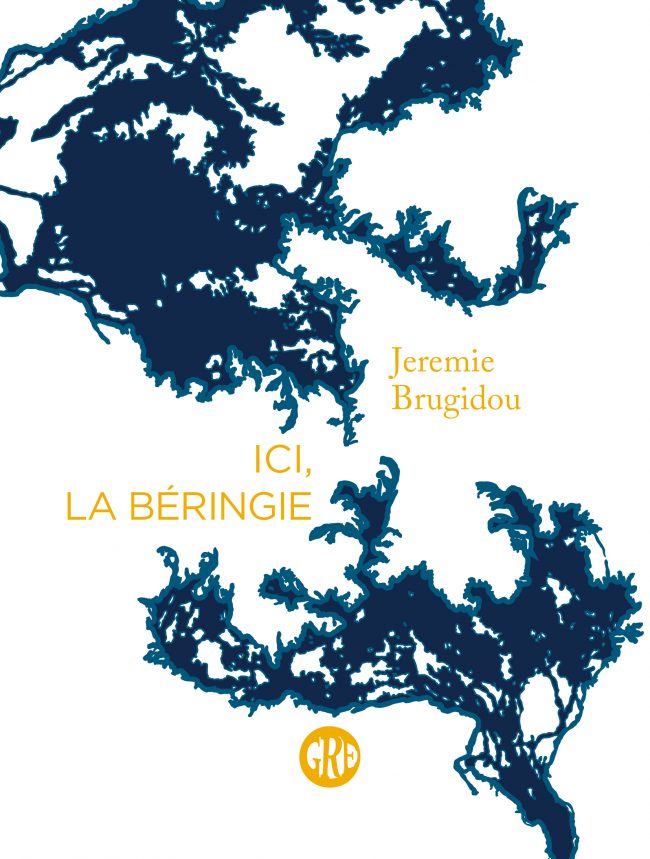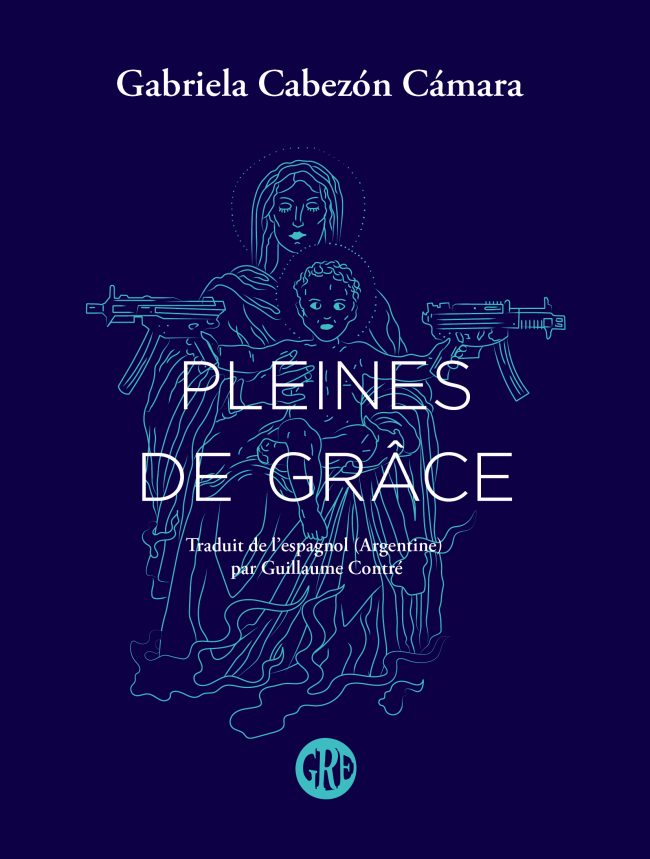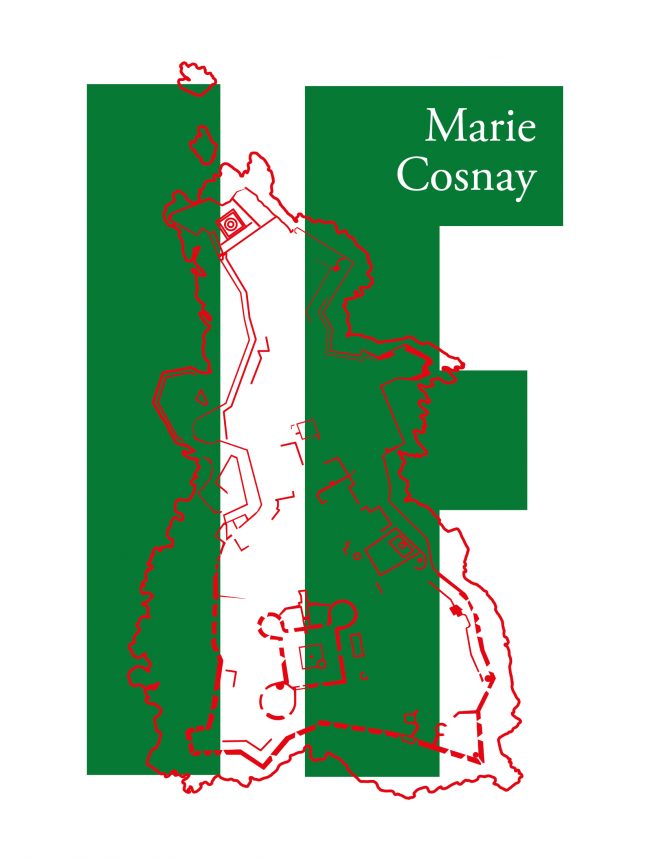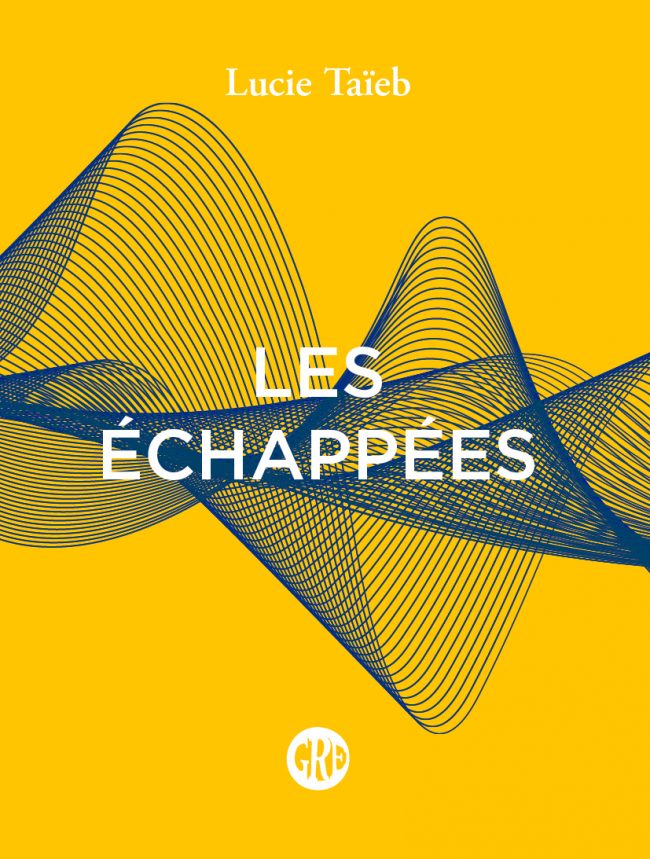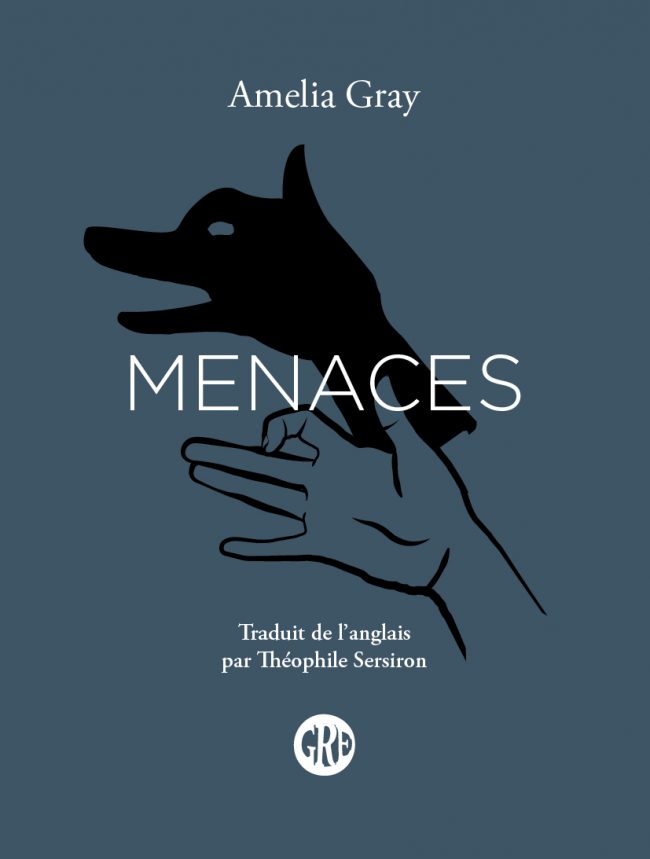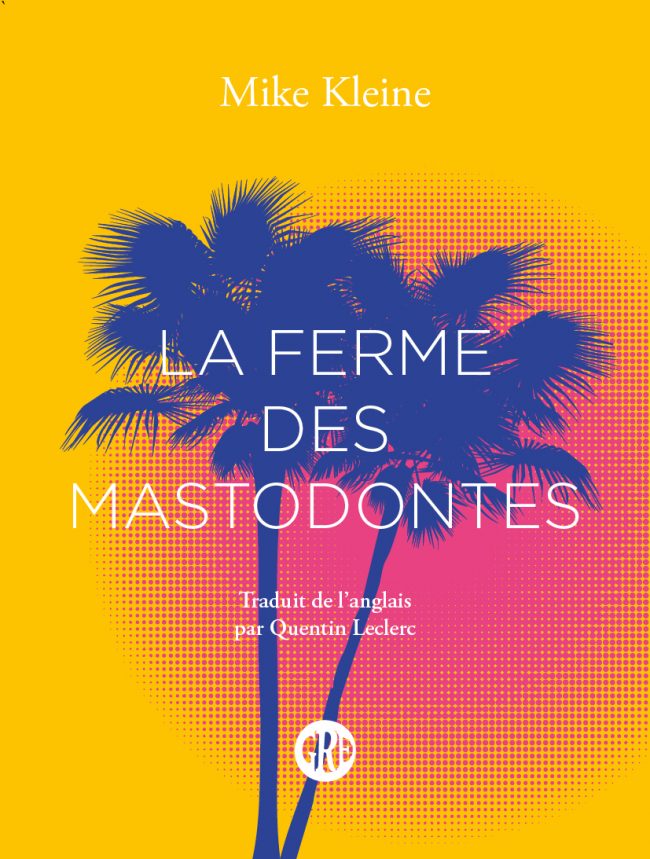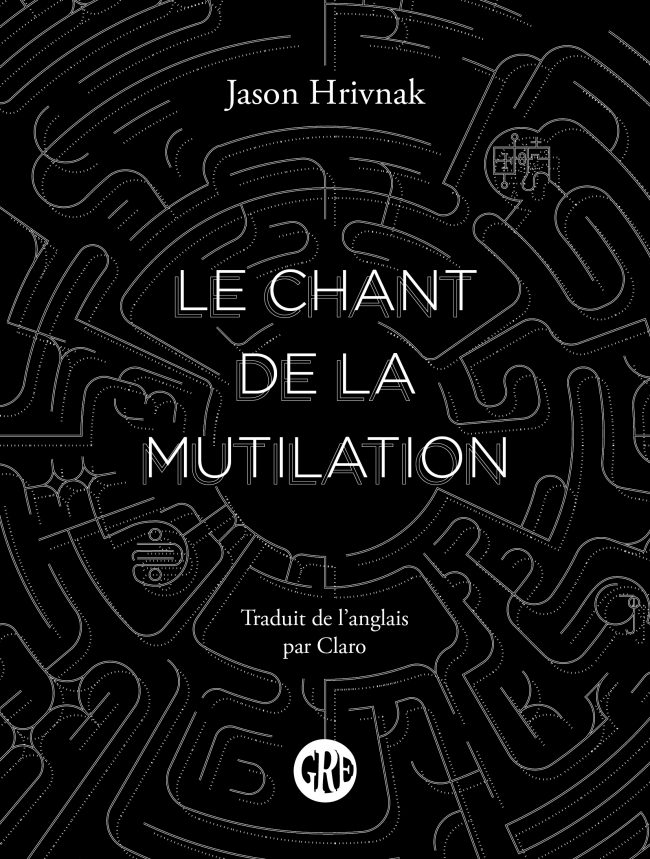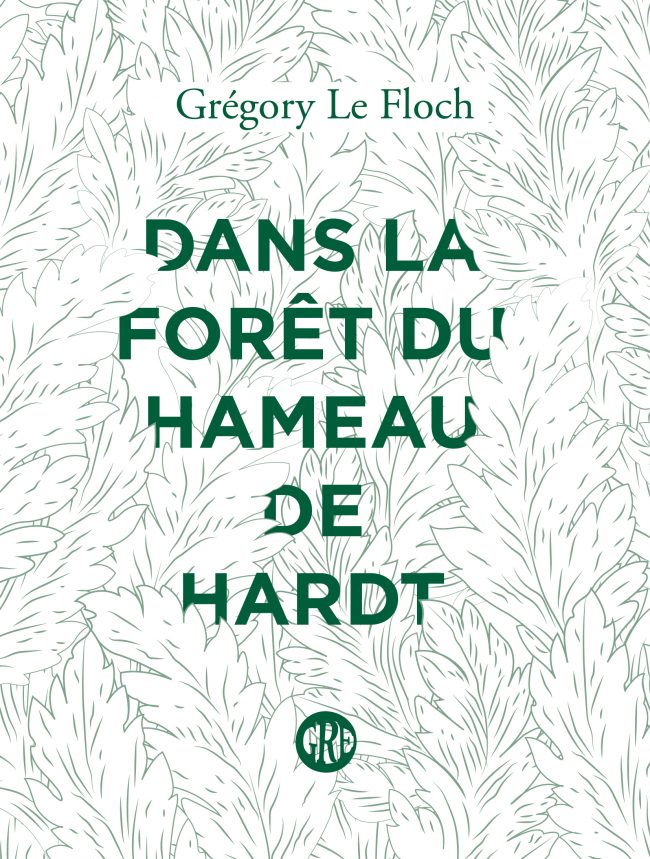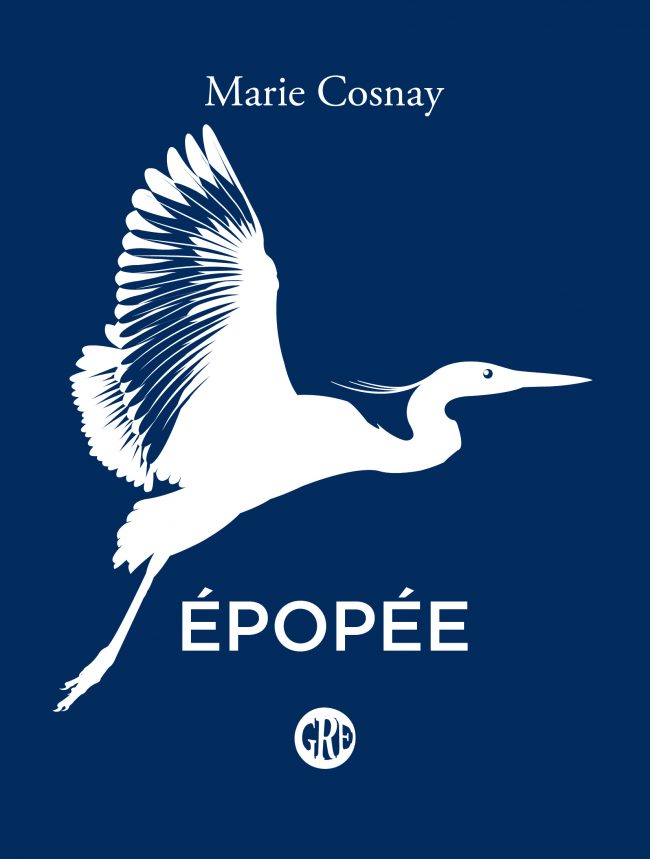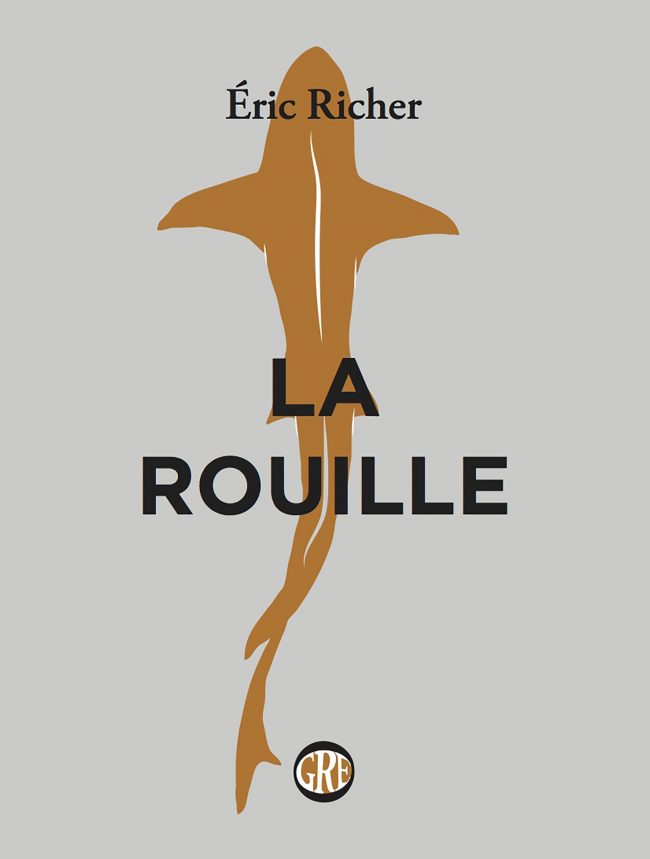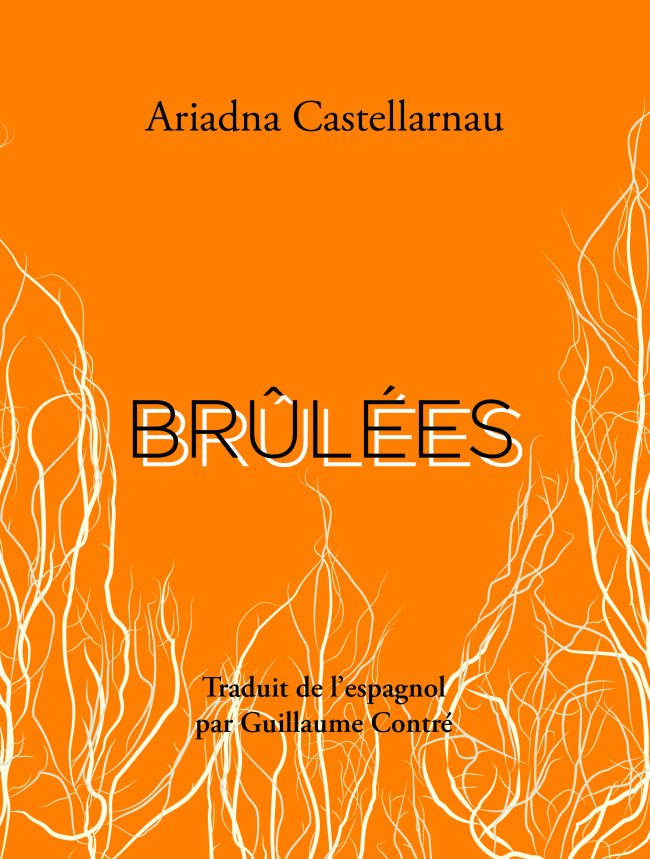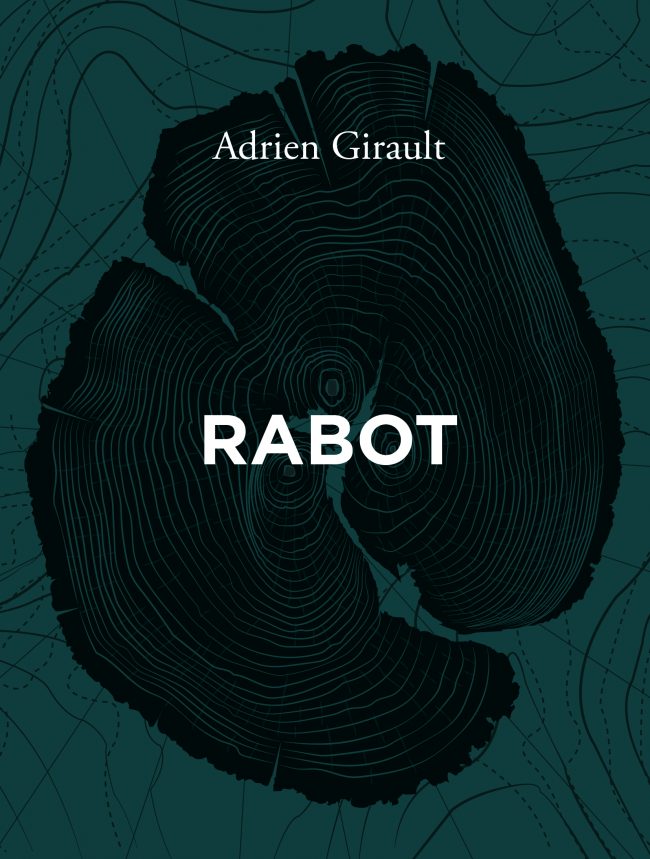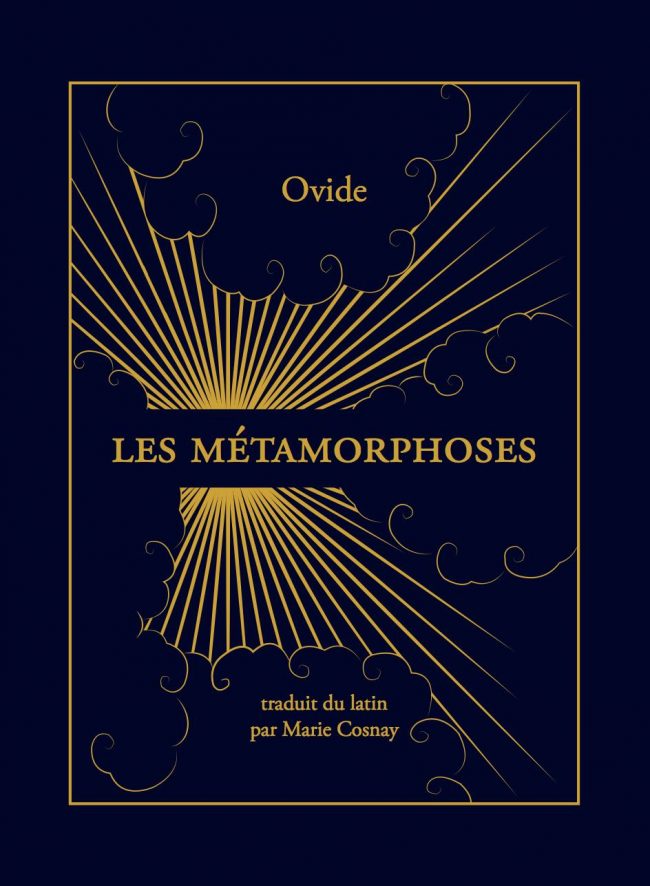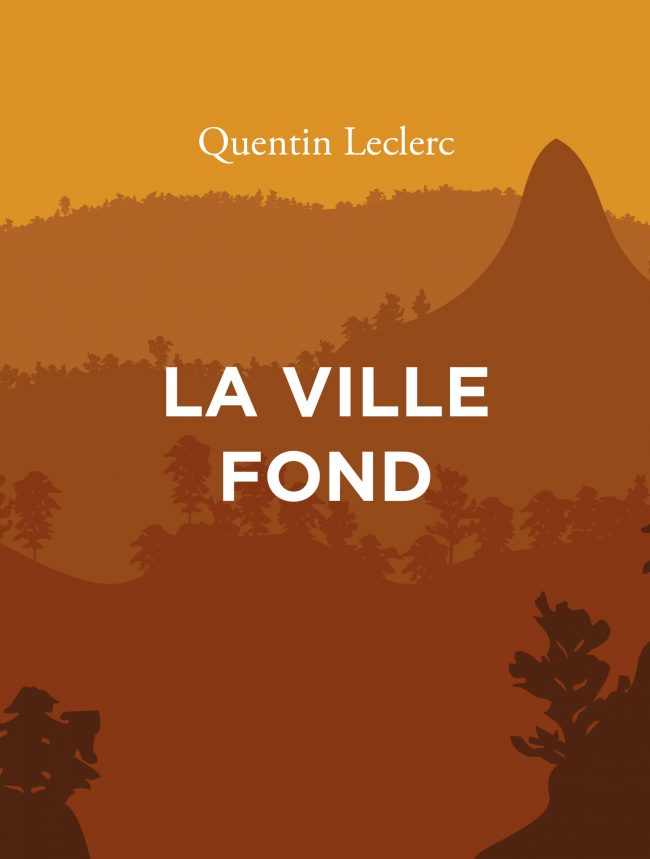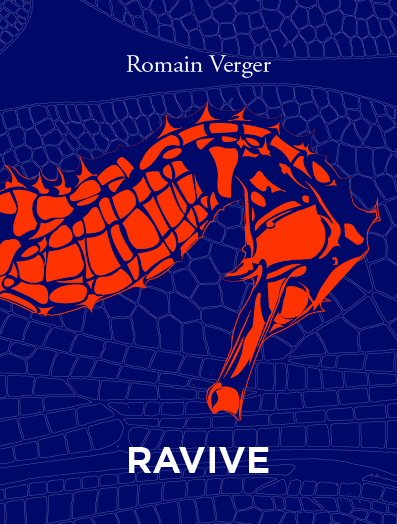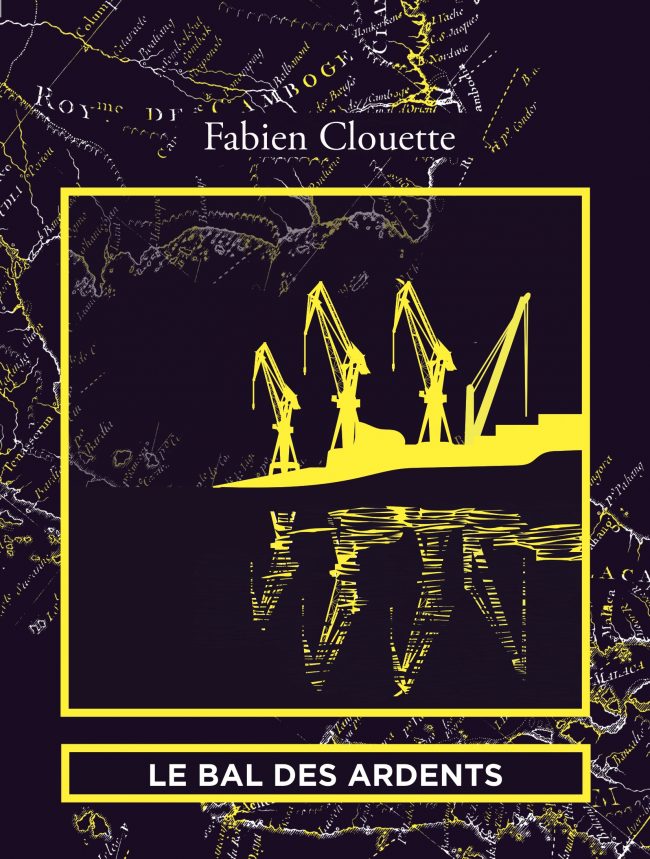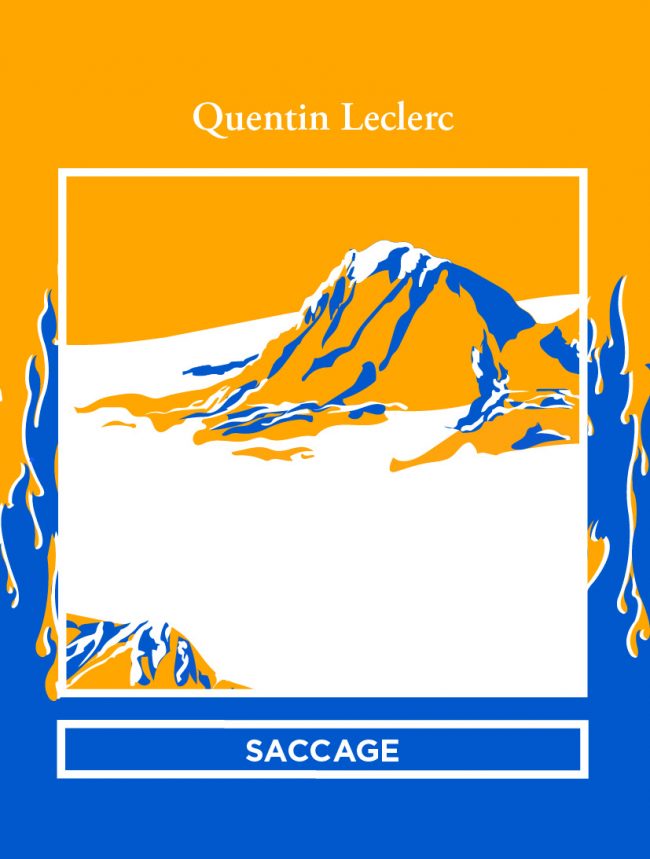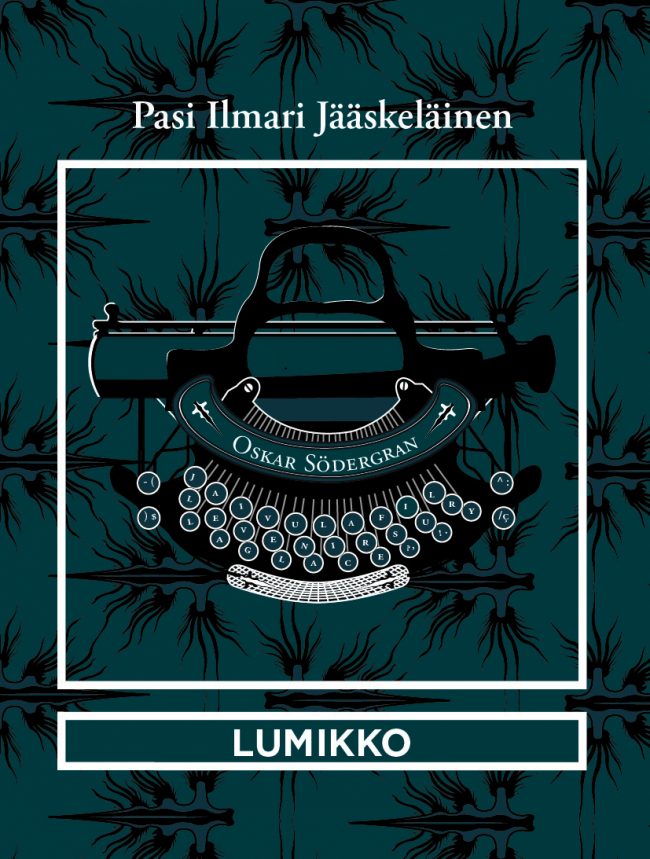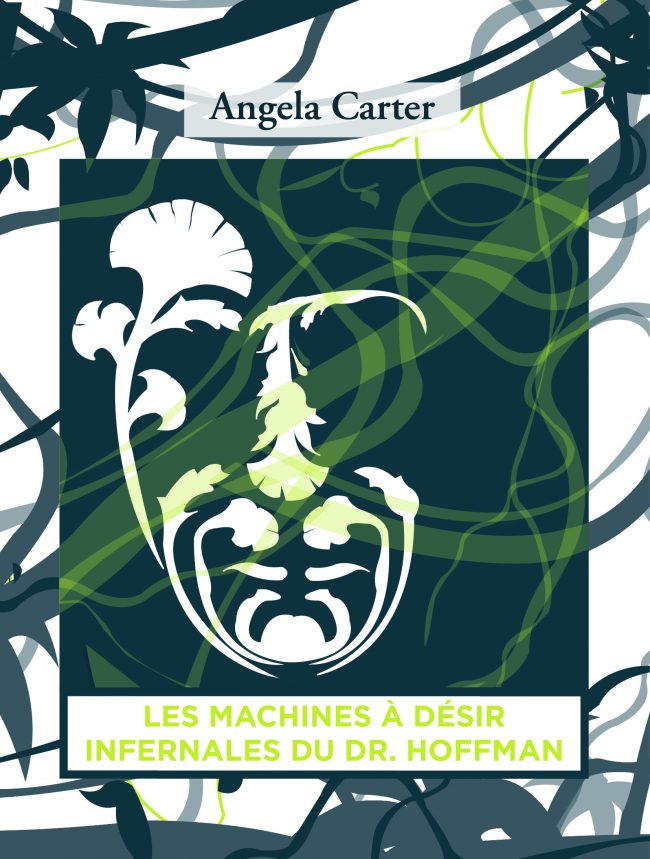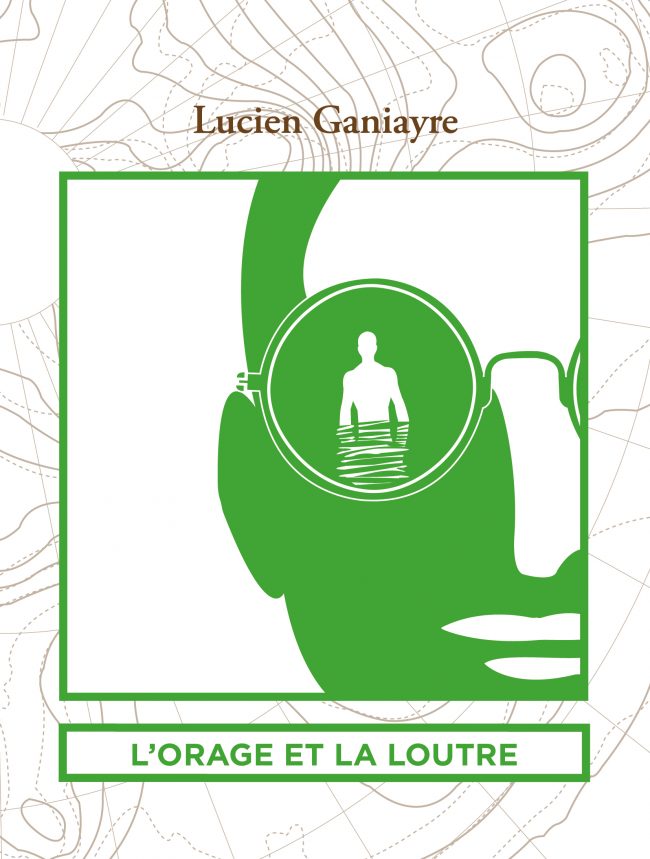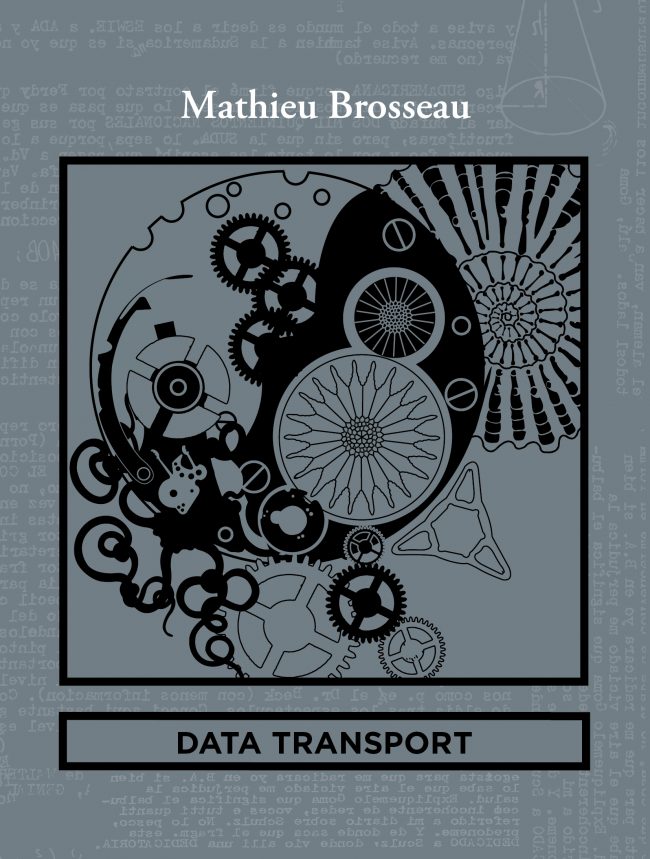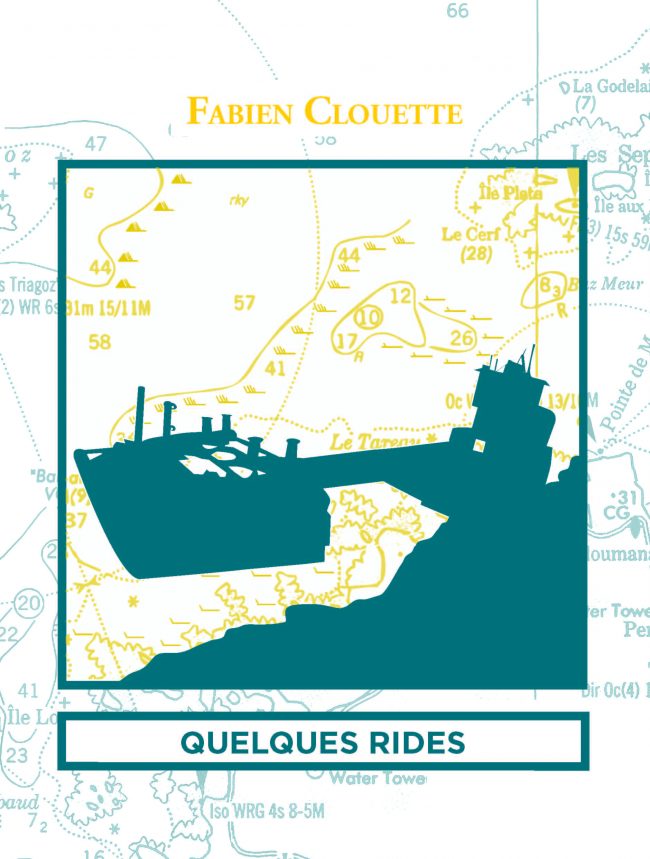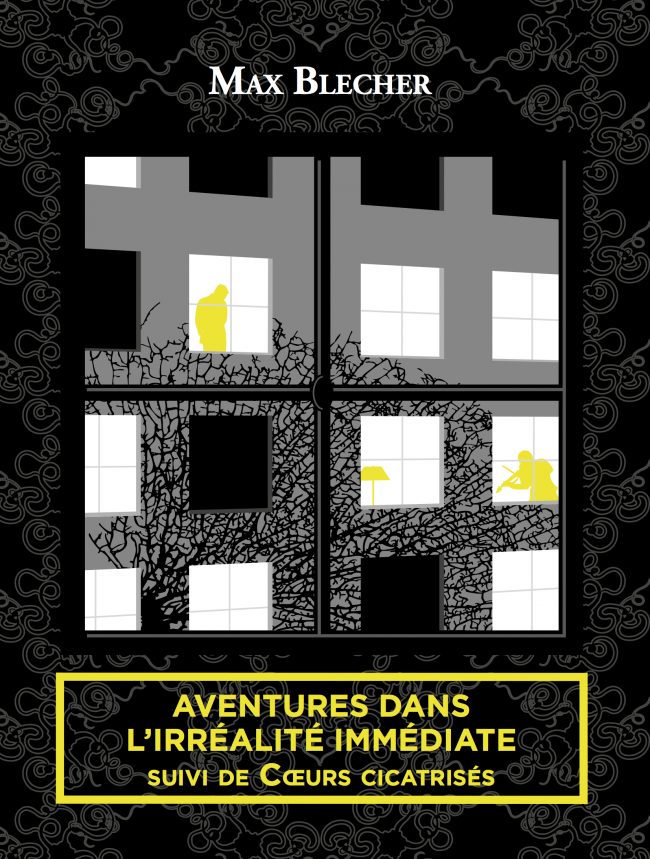J’aurais aimé vivre dans ces maisons, me pénétrer de leur intimité en laissant toutes mes rêveries et toutes mes amertumes se dissoudre dans leur atmosphère comme dans un puissant acide.
Que n’aurais-je donné pour pouvoir entrer dans telle ou telle pièce, les traversant d’un pas familier et me laissant choir, fatigué, sur un vieux divan, parmi des coussins recouverts de cretonne fleurie ? Gagner une autre intimité, respirer un autre air et devenir moi-même quelqu’un d’autre… Étendu sur le divan, contempler, de l’intérieur de la maison, de derrière ses rideaux, cette rue dans laquelle je marchais (j’essayai alors d’imaginer le plus exactement possible l’aspect de la rue vue du divan, à travers la porte ouverte), pouvoir retrouver en moi le souvenir des choses que je n’aurais pas vécues, étranger à la vie que je portais encore et toujours en moi, un souvenir appartenant à l’intimité des statuettes de bronze et du vieux globe de lampe à papillons bleus et violets.
Comme je me serais senti heureux dans les limites de ce décor bon marché et indifférent, qui ignorait tout de moi…
Devant moi, la ruelle sale étalait inlassablement sa pâte boueuse. Certaines maisons étaient dépliées comme des éventails, d’autres blanches comme des pains de sucre, d’autres encore petites, au toit baissé sur leurs yeux, serrant les maxillaires comme des boxeurs. Je rencontrais des charrettes à foin, ou apercevais, soudain, des choses extraordinaires : un homme sous la pluie portant sur son dos un candélabre aux ornements en cristal, verrerie qui sonnait comme des clochettes sur ses épaules, tandis que de lourdes gouttes d’eau dégoulinaient sur toutes ses facettes luisantes. En quoi consistait, à la fin, la gravité du monde ?
Dans les jardins, la pluie lavait les fleurs et les plantes fanées. L’automne les embrasait d’incendies cuivrés, rouges et violets, comme des flammes brillant d’un éclat plus fort avant de s’éteindre. Au marché, l’eau et la boue s’écoulaient des énormes monceaux de légumes. Des coupures des betteraves jaillissait soudainement le sang rouge et sombre de la terre. Plus loin, des pommes de terre, brunes et douces, gisaient près des monticules de têtes coupées des choux effeuillés. Dans un coin, d’une beauté exaspérée, se dressait un amas de potirons gonflés et immondes, leur peau tendue craquant de la plénitude du soleil bu pendant l’été.
Au milieu du ciel, les nuages s’amoncelaient puis se dissipaient à nouveau, laissant apparaître des espaces dégagés comme des couloirs perdus dans l’infini, ou d’immenses trous, révélant alors, mieux que n’importe quoi d’autre, le vide déchirant qui flottait au-dessus de la ville.
La pluie tombait alors de très loin, d’un ciel qui n’avait plus de limite. J’aimais la couleur nouvelle du bois mouillé, les grilles rouillées ruisselantes de pluie, devant les jardinets domestiques et sages, que le vent mêlé aux filets d’eau traversait comme une immense crinière de cheval.
Parfois je voulais être un chien, pour regarder ce monde trempé de la perspective oblique des animaux, de bas en haut, en tournant seulement la tête, et marcher au plus près de la terre, les yeux fixés au sol, me fondre dans la couleur violacée de la boue.
Ce désir, nourri en moi depuis longtemps, s’échappa frénétiquement un jour d’automne, pour dégringoler sur un terrain vague.
Ce jour-là, mes errances m’amenèrent au bout de la ville, dans le champ du marché aux bestiaux.
Le terrain détrempé s’étendait telle une immense mare de fange. Le fumier exhalait une odeur acide d’urine. Au-dessus, le soleil, pourpre et or, se couchait dans un décor loqueteux : devant moi s’étalait au loin la boue chaude et molle. Quoi de plus merveilleux que cette masse pure et sublime de boue pour me mettre le cœur en joie ?
D’abord j’hésitai. Les dernières traces d’éducation luttaient en moi avec des forces de gladiateurs moribonds. Or, en un instant elles plongèrent dans une nuit noire, opaque, et je m’oubliai.
J’entrai dans la boue, y mettant un pied d’abord, puis l’autre. Mes bottines glissèrent agréablement dans la pâte élastique et gluante. J’étais désormais un être de boue, jailli de la terre, ne faisant qu’un avec elle.
J’étais persuadé que les arbres n’étaient, eux aussi, que de la boue solidifiée, issus de l’écorce de la terre. Leur couleur en disait long. Seulement les arbres ? Et les maisons, les hommes ? Surtout les hommes. Tous les hommes. Bien entendu, il ne s’agissait pas d’une de ces légendes stupides, « poussière, tu redeviendras poussière », bien trop vague, trop abstraite, trop inconsistante face au champ de boue. Les hommes et les choses surgirent de ce fumier même, de cette urine, dans lesquels j’enfonçais des souliers très concrets.
En vain les hommes s’étaient-ils enveloppés de leur soyeuse peau blanche et vêtus d’habits en étoffe. En vain, en vain… En eux gisait, implacable et impérieuse, la boue ; une boue chaude, grasse et puante. L’ennui et la stupidité dont leur vie était remplie étaient assez éloquents.
J’étais moi-même une création spéciale de la boue, un missionnaire envoyé par elle dans le monde. En ces instants, je sentais sa mémoire me revenir et je me rappelais mes nuits d’agitation et de brûlante obscurité, lorsque ma boue essentielle prenait son élan, s’efforçant de percer à la surface. Je fermais alors les yeux, tandis qu’elle continuait de bouillir dans le noir, avec des bredouillis incompréhensibles…
Autour de moi s’étendait le champ plein de boue. Elle était ma chair authentique, dépouillée de ses habits, de sa peau, de ses muscles, écorchée jusqu’à la lie. Son humidité élastique et son odeur crue m’accueillaient jusque dans leurs tréfonds, car, foncièrement, je leur appartenais. Seules quelques apparences, purement accidentelles, les gestes que j’étais en mesure d’accomplir, les cheveux sur ma tête, fins et délicats, mes yeux, vitreux et mouillés, me séparaient de son immobilité et de son immondice ancestrale. C’était peu, bien peu face à l’immense majesté de la boue.
Je marchais dans tous les sens. Mes jambes s’enfoncèrent jusqu’aux chevilles. Il pleuvait doucement et, au loin, le soleil se couchait derrière un rideau de nuages ensanglantés et purulents.
Soudain, je me baissai et plongeai mes mains dans la boue. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? J’avais envie de hurler.
La pâte était chaude et douce, mes mains s’y promenaient sans encombre. Quand je serrais les poings, la boue s’échappait d’entre mes doigts en de belles coulées noires et luisantes.
Qu’avaient fait mes mains jusqu’alors ? Où avaient-elles perdu leur temps ? Qu’avaient-elles été si ce n’est des oiseaux prisonniers, attachés aux épaules par des chaînes de peau et de muscles ? Pauvres oiseaux faits pour voler en quelques gestes de bienséance stupides, appris et répétés comme des règles indispensables. Peu à peu, ils devinrent à nouveau sauvages et jouirent de leur liberté d’autrefois. Maintenant, ils roulaient leur tête dans le fumier, roucoulaient comme des colombes, battaient des ailes, heureux… heureux…
De joie, je me mis à les agiter au-dessus de ma tête, pour les faire voler. De grosses gouttes de boue me tombaient sur le visage et sur les vêtements.
Pourquoi les aurais-je essuyées ? Pourquoi ? Ce n’était qu’un début ; mon geste n’eut aucune conséquence grave, le ciel ne trembla pas, la terre n’en fut pas secouée. Aussitôt, je passai sur ma joue une main pleine d’immondices. Une immense gaîté me saisit, je n’avais pas été d’aussi belle humeur depuis longtemps. Je portai les deux mains à mon visage et à mon cou, puis je m’en frottai les cheveux.
La pluie se mit à tomber plus drue et plus épaisse. Le soleil continuait d’éclairer le champ, comme un immense lampadaire au fond d’une salle de marbre gris. Il pleuvait à travers la lumière du soleil, une pluie d’or, sentant le linge fraîchement lavé.
Le champ était désert. Çà et là, gisaient des tas de tiges de maïs séchées, dont on avait nourri le bétail. Je pris une tige et me mis à l’éplucher avec beaucoup d’attention. Je grelottais de froid et mes mains pleines de boue peinaient à détacher les feuilles. Mais cela me captivait. Il y avait beaucoup à voir dans une tige de maïs. Au loin, on apercevait une cabane recouverte de chaume. Je courus jusque là-bas et m’abritai sous l’auvent. Le toit était si bas que ma tête le heurtait. Près des murs, le sol était parfaitement sec. Je m’allongeai par terre, la tête appuyée contre de vieux sacs, les jambes croisées. Je pouvais maintenant me livrer à l’analyse minutieuse de la tige.
J’étais heureux de pouvoir m’adonner à cette passionnante recherche. Les canaux et les cavités de la tige me remplirent d’enthousiasme. Je la déchirai avec mes dents et trouvai à l’intérieur un duvet mou et douceâtre. Une bourre merveilleuse pour une tige : si les humains avaient les artères rembourrées de duvet aussi tendre, l’obscurité en eux serait certainement plus douce, plus supportable.
Je regardai la tige et le silence en moi riait doucement, comme si quelqu’un à l’intérieur faisait sans cesse des bulles de savon.
La pluie se mêlait au soleil et, au loin, dans la brume, la ville fumait comme un tas de déchets. Quelques toits et clochers d’églises brillaient étrangement dans ce crépuscule humide. J’étais si heureux que je ne savais pas quelle action absurde accomplir en premier : analyser la tige, m’étirer, ou regarder la ville lointaine.
Près de mes pieds, là où commençait la boue, une petite grenouille sautillait. Elle s’approcha de moi, puis, changeant d’avis, s’en alla vers le champ. « Adieu, petite grenouille ! », criai-je derrière elle. « Adieu. Tu me brises le cœur de me quitter si vite… Adieu, ma belle ! » Je me mis à improviser une longue tirade à l’adresse de la grenouille et lorsque j’eus fini de parler, je lançai la tige à sa suite, dans l’espoir de l’atteindre…
Enfin, à force de fixer les poutres au-dessus de moi, je fermai les yeux de fatigue et tombai dans un profond sommeil. Je rêvais que j’étais dans les rues d’une ville pleine de poussière, de soleil et de maisons blanches ; peut-être une ville orientale. Je marchais à côté d’une femme en noir, aux longs voiles de deuil. Curieusement, la femme n’avait pas de tête. Ses voiles étaient bien mis à l’endroit où elle devait se trouver, mais, à sa place, il n’y avait qu’un trou béant, une sphère vide jusqu’à la nuque. Nous étions tous les deux pressés et suivions côte à côte une charrue marquée de croix rouges, qui transportait le cadavre du mari de la dame en noir.
Je compris que nous étions en temps de guerre. De fait, nous arrivâmes bientôt dans une gare et descendîmes l’escalier jusqu’à un sous-sol faiblement éclairé à l’électricité. Un convoi de blessés venait d’arriver et les infirmières s’affairaient sur le quai, leurs petits paniers de cerises et de bretzels à la main, pour les distribuer aux invalides à la descente du train.
Soudain, un gros monsieur bien habillé, portant une décoration à la boutonnière, descendit d’un compartiment de première classe. Il portait un monocle et des guêtres blanches. Quelques cheveux argentés dissimulaient sa calvitie. Il tenait dans ses bras un petit pékinois blanc, aux yeux comme des billes d’agate baignant dans l’huile.
Pendant quelque temps, il marcha de-ci de-là sur le quai, semblant chercher quelqu’un. Enfin, il trouva : c’était la fleuriste. Il choisit dans la corbeille quelques petits bouquets d’œillets rouges et les paya, sortant ses billets d’un élégant portefeuille souple, à monogramme d’argent.
Puis, il remonta dans le wagon, et, à travers la vitre, je le vis installer le petit chien sur la table près de la fenêtre et lui donner à manger, l’un après l’autre, les œillets rouges que l’animal avalait avec un appétit évident…
Un violent tremblement me réveilla.
À présent, il pleuvait très fort. Les gouttes martelaient le sol tout près de moi et je dus me serrer contre le mur. Le ciel était devenu noir et, au loin, on ne voyait plus la ville.
J’avais froid et pourtant mes joues brûlaient. Je sentais leur chaleur sous la croûte de boue. Je voulus me lever mais un courant électrique me transperça les jambes. Elles étaient complètement engourdies et je dus les déplier doucement, l’une après l’autre. Mes chaussettes étaient froides et humides.
Je pensais m’abriter dans la cabane. La porte était ouverte, et il n’y avait qu’une ouverture clouée de planches en guise de fenêtre. Le vent semait la pluie de tous côtés et je ne pouvais me réfugier nulle part.
Le soir tombait. En peu de temps, le champ plongea dans l’obscurité. À sa lisière, là d’où j’étais venu, une taverne alluma ses lumières.
En quelques minutes, j’y fus. J’aurais voulu entrer, boire quelque chose, au chaud, au milieu des hommes et des mauvaises odeurs d’alcool. Je fouillai dans mes poches mais ne trouvai aucune pièce. Devant la taverne, la pluie tombait gaiement à travers le rideau de fumée et de vapeur qu’exhalait la salle.
Je devais me résoudre à quelque chose, rentrer à la maison, par exemple. Mais comment ? Dans cet état de saleté, ce n’était guère possible. De plus, je ne voulais pas renoncer à ma crasse. Une amertume indicible m’envahit l’âme, comme celle éprouvée par quelqu’un qui réalise qu’il n’a plus rien à faire, plus rien à accomplir.
Je me mis à courir dans les rues obscures, sautant par-dessus les flaques ou m’y enfonçant jusqu’aux genoux.
Le désespoir s’accrut en moi pendant un moment, j’aurais voulu hurler et me cogner la tête contre les arbres. Puis, aussitôt, la tristesse se tapit en une pensée paisible et douce.
Je savais ce que je devais faire : si rien ne pouvait continuer, il ne me restait qu’à mettre fin à tout. Que laissais-je derrière moi ? Un monde trempé et laid, où il pleuvait doucement.