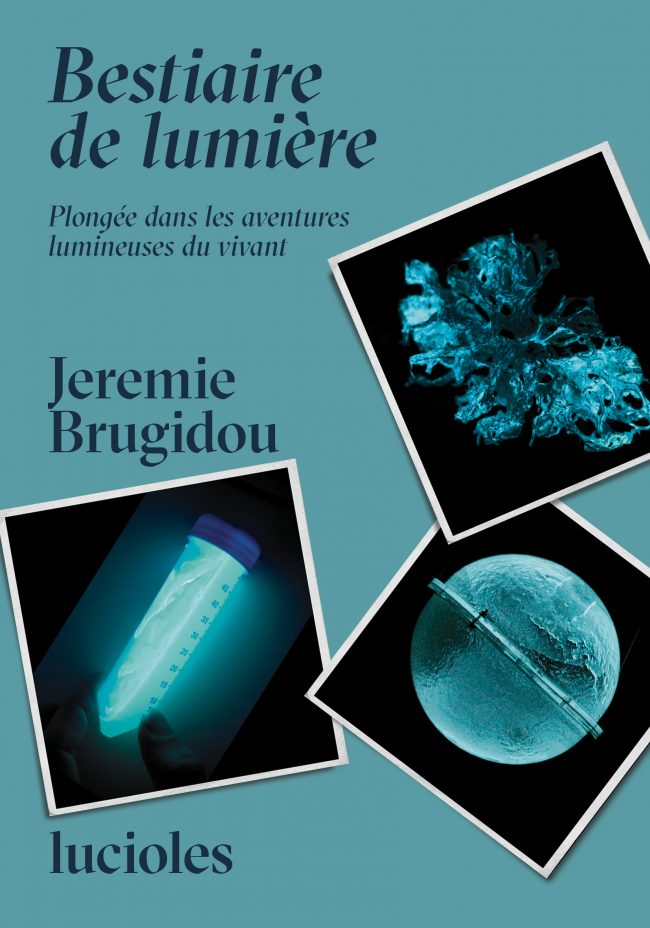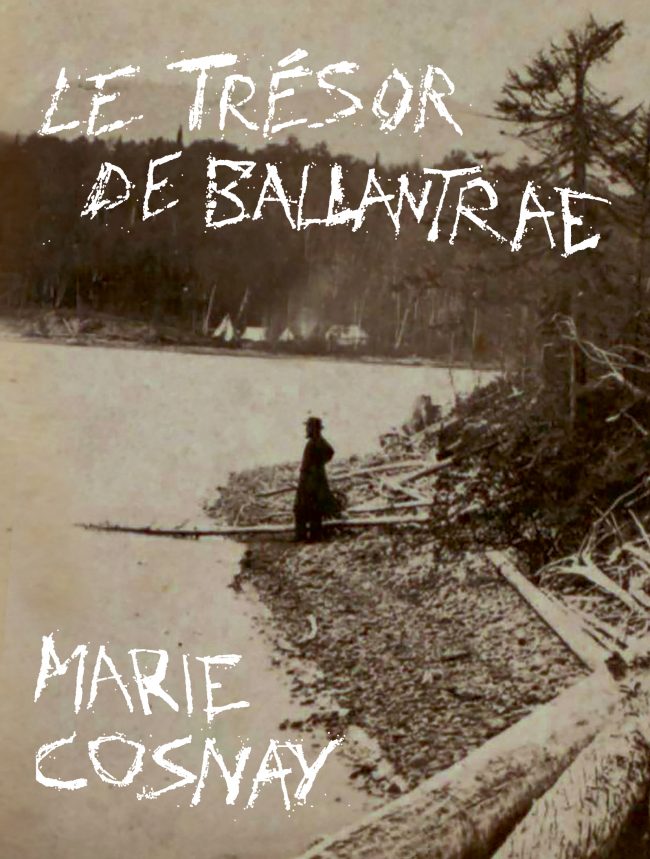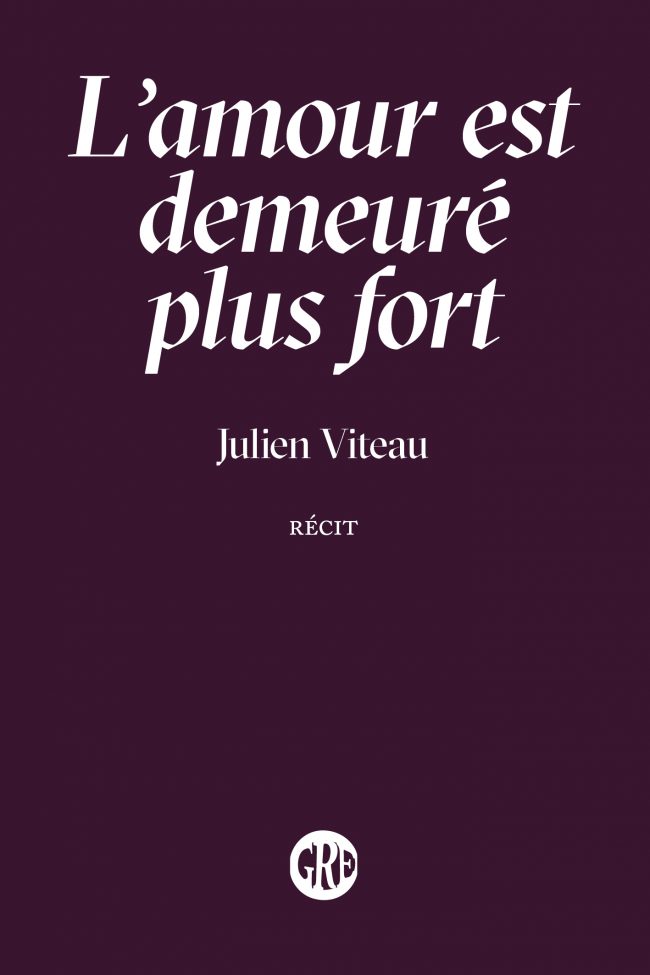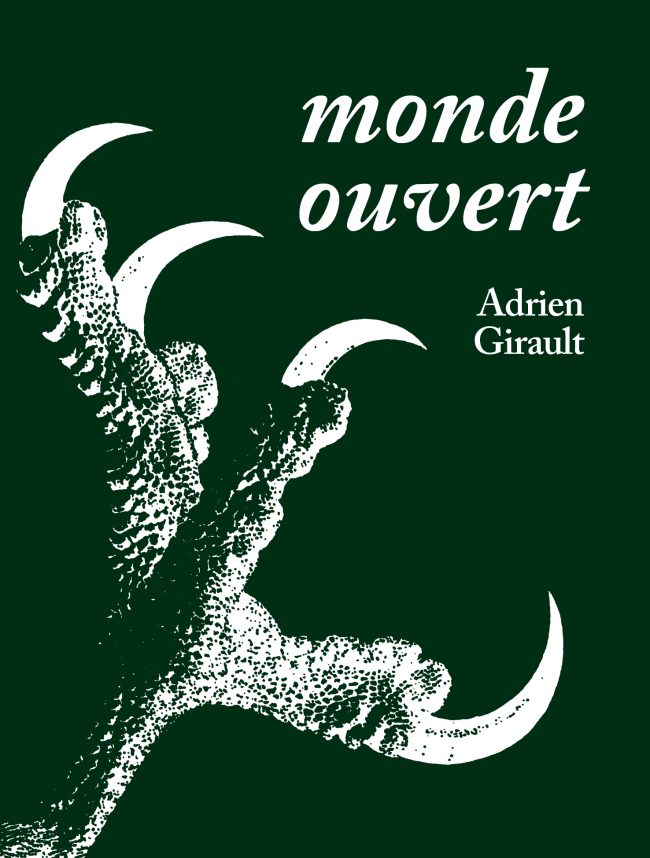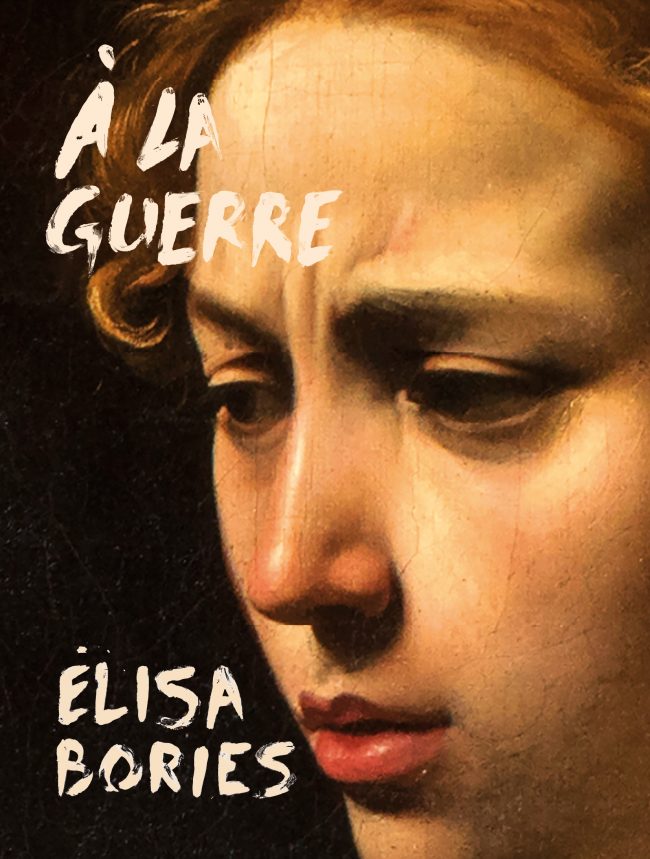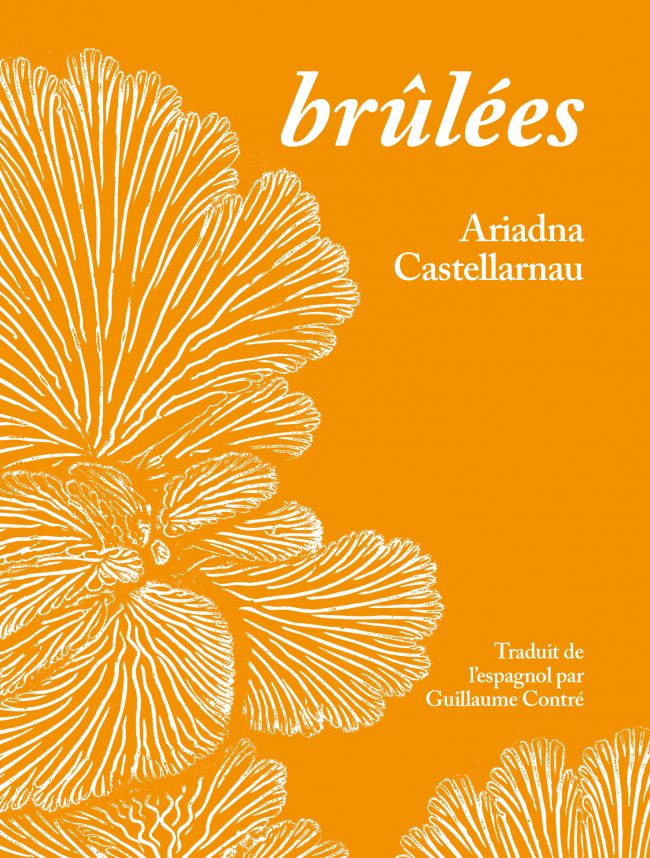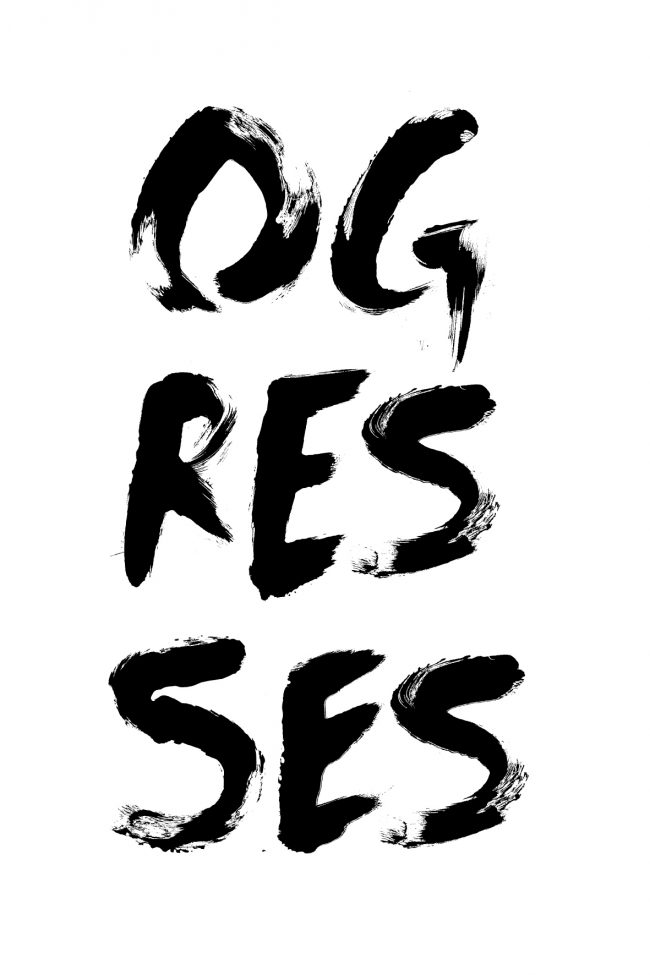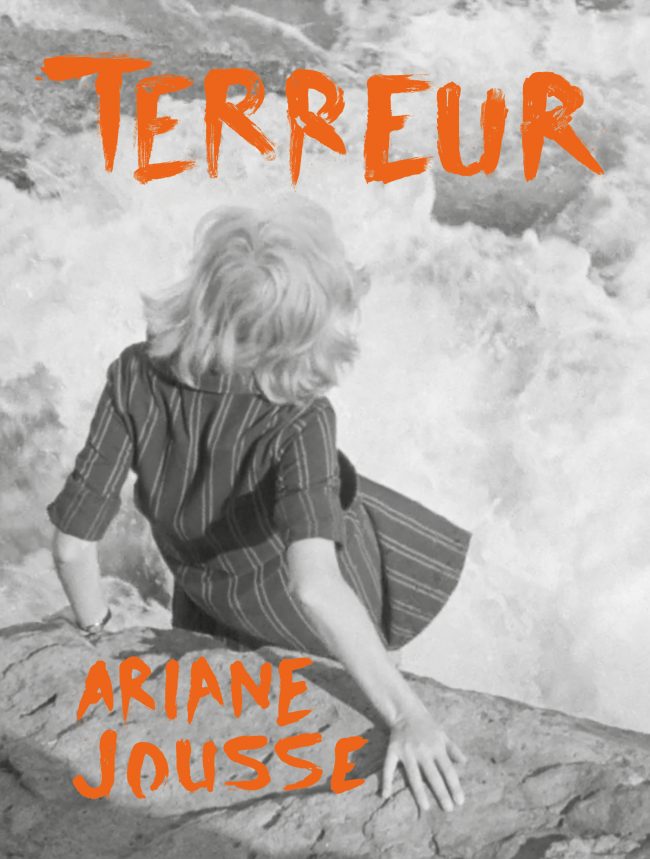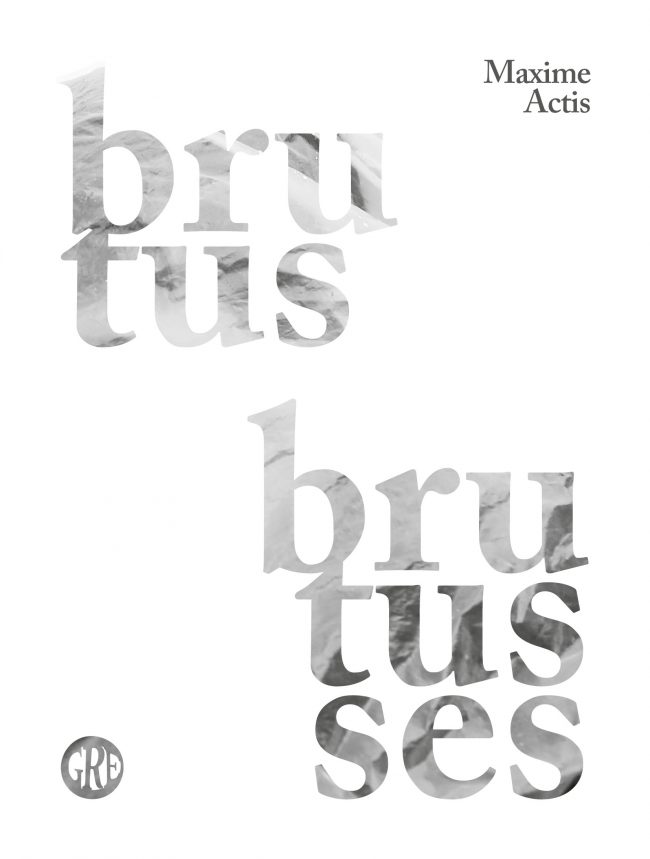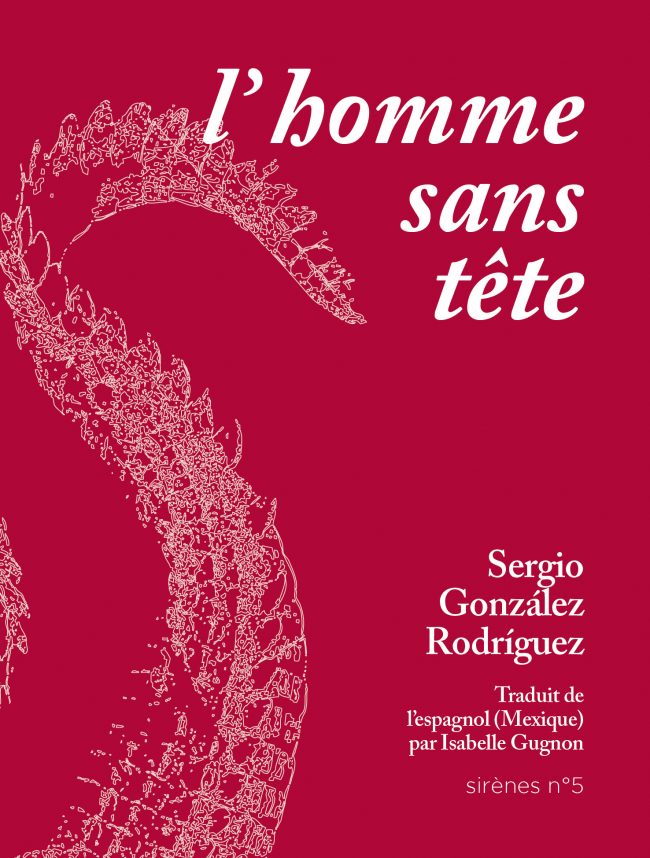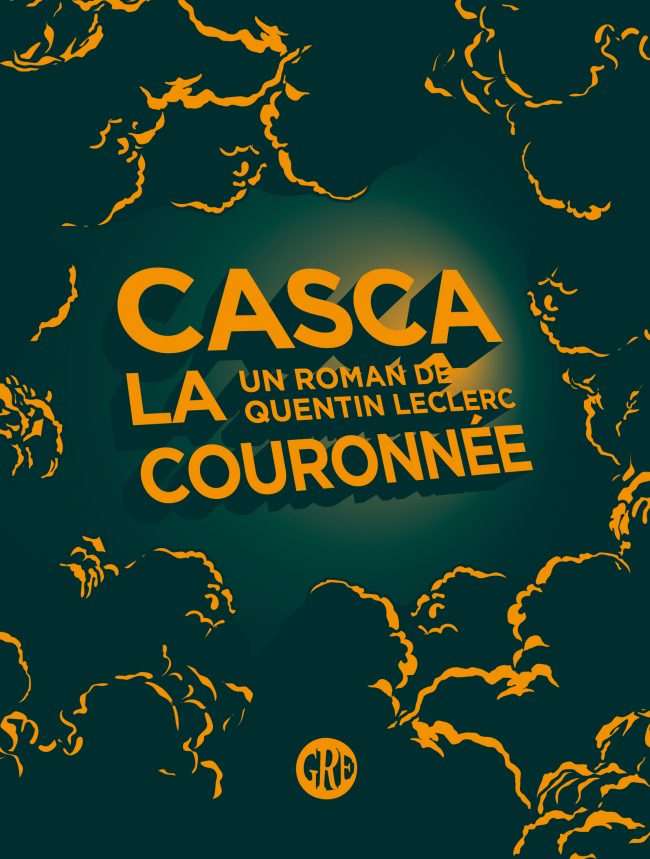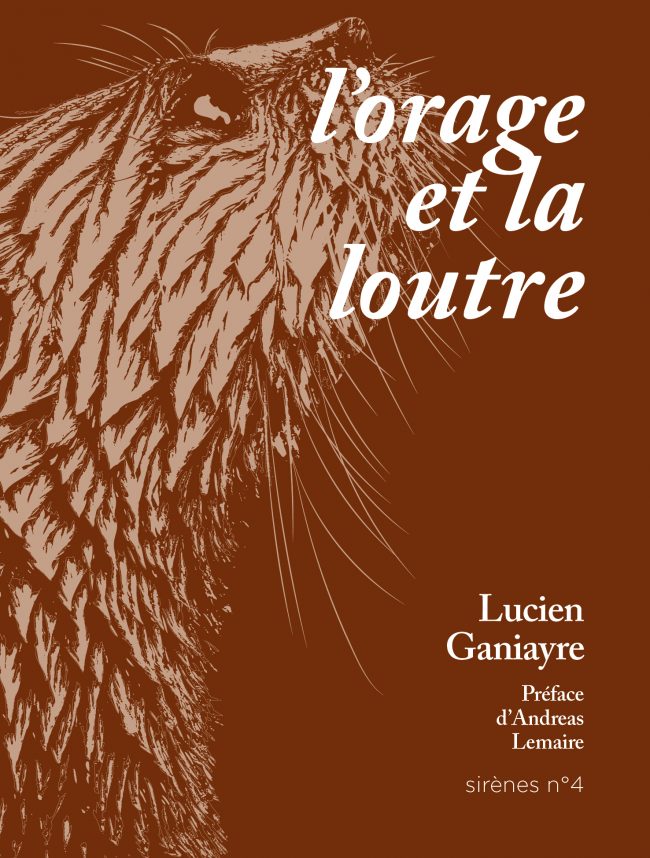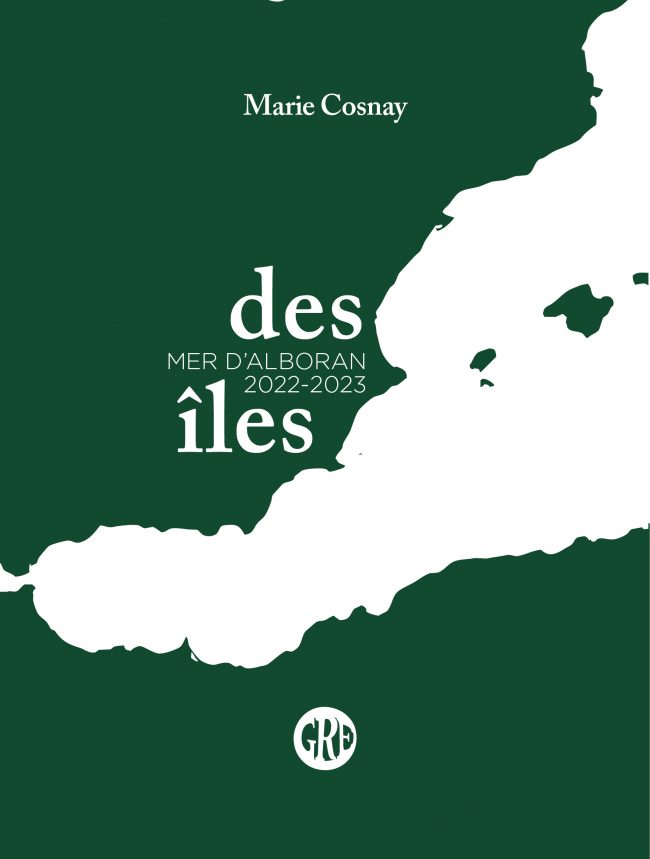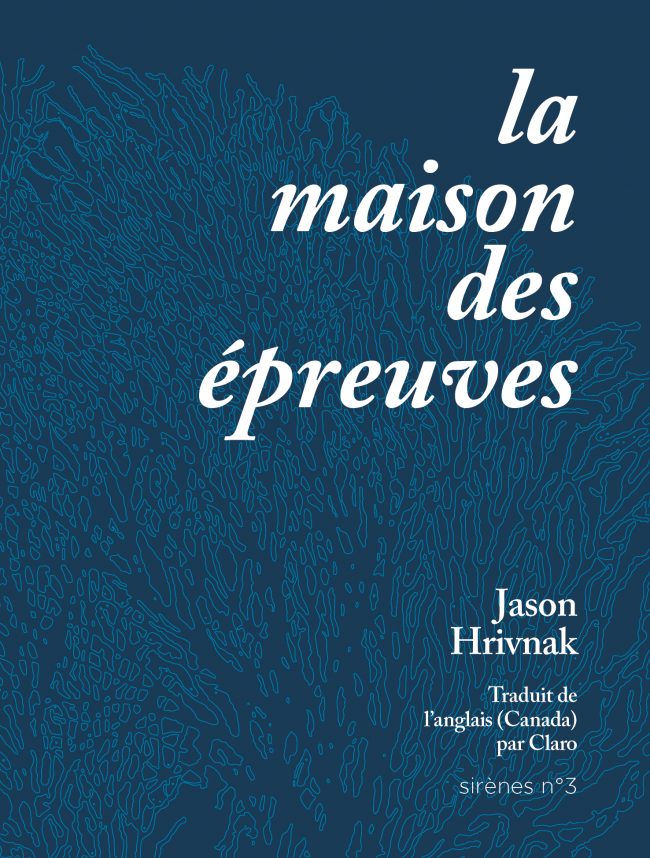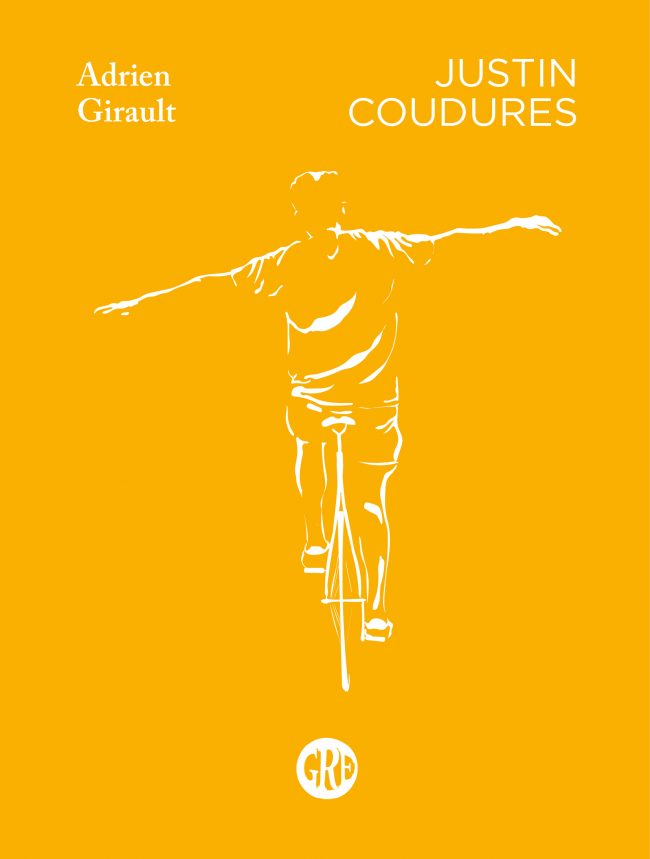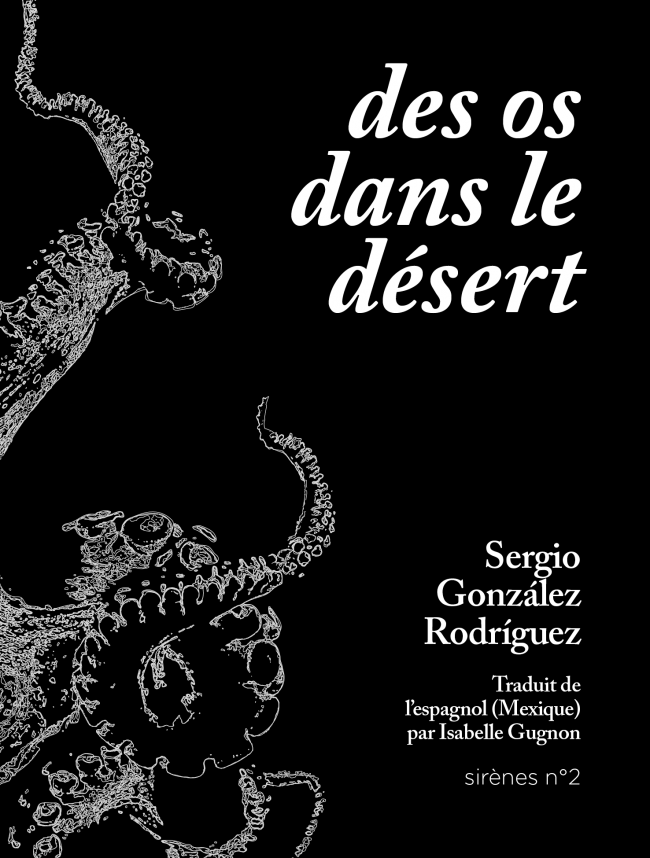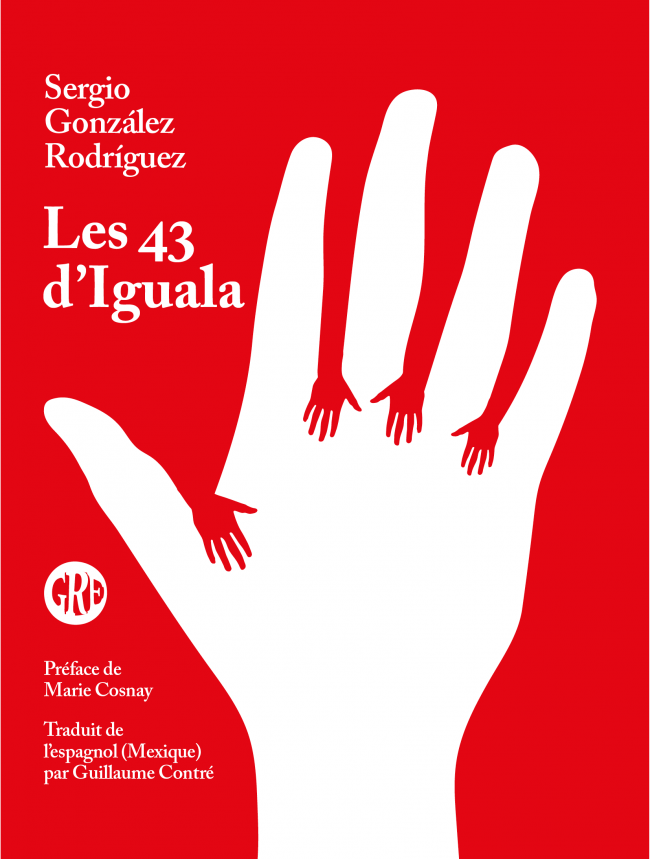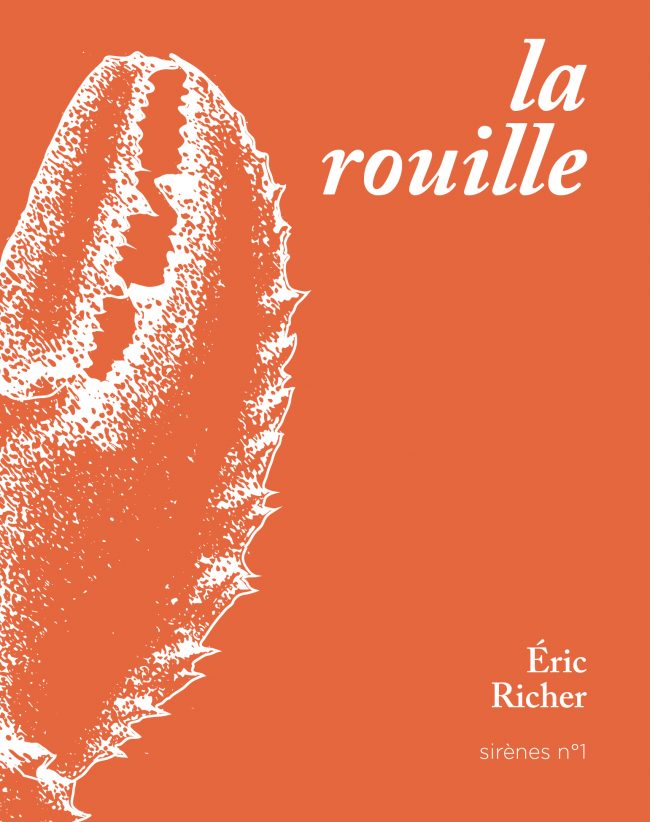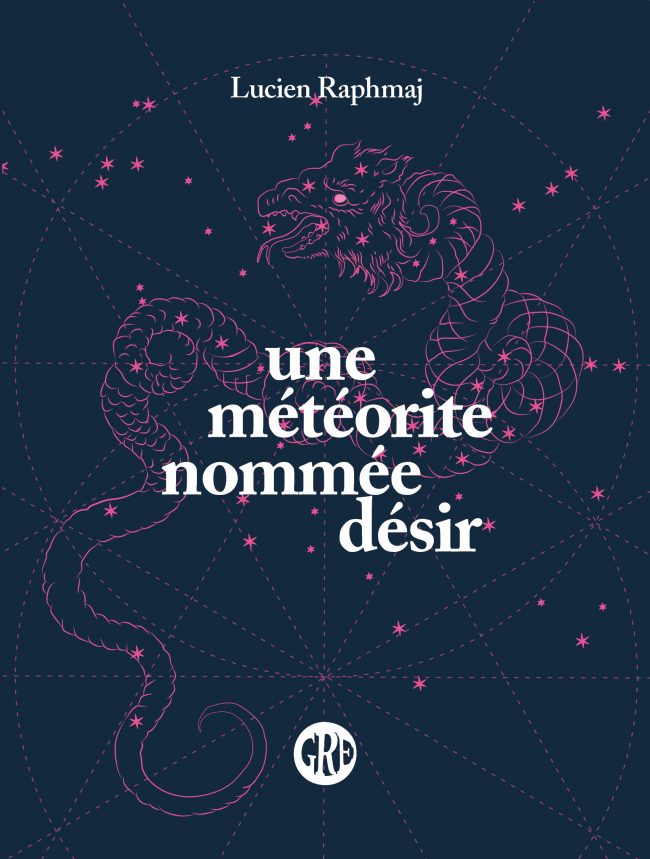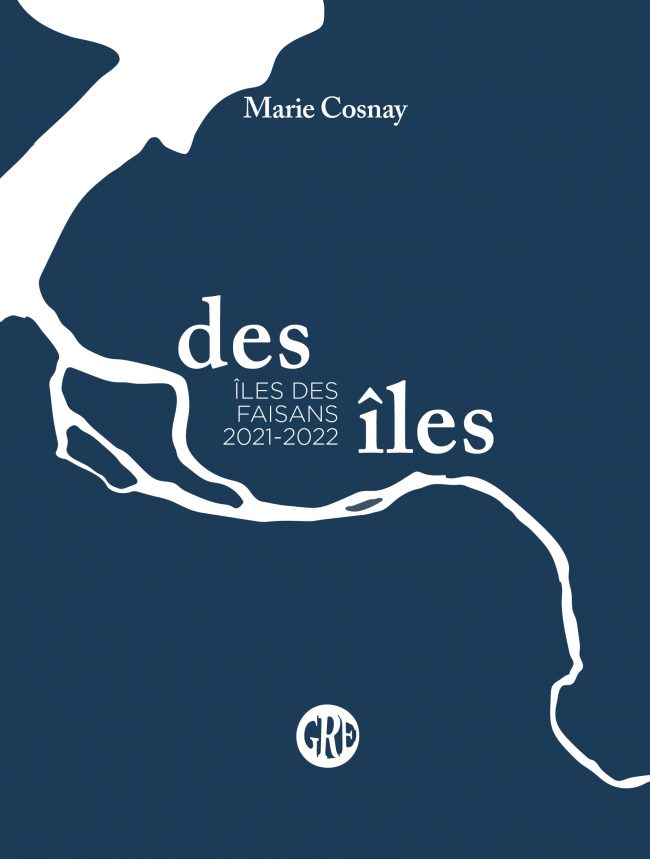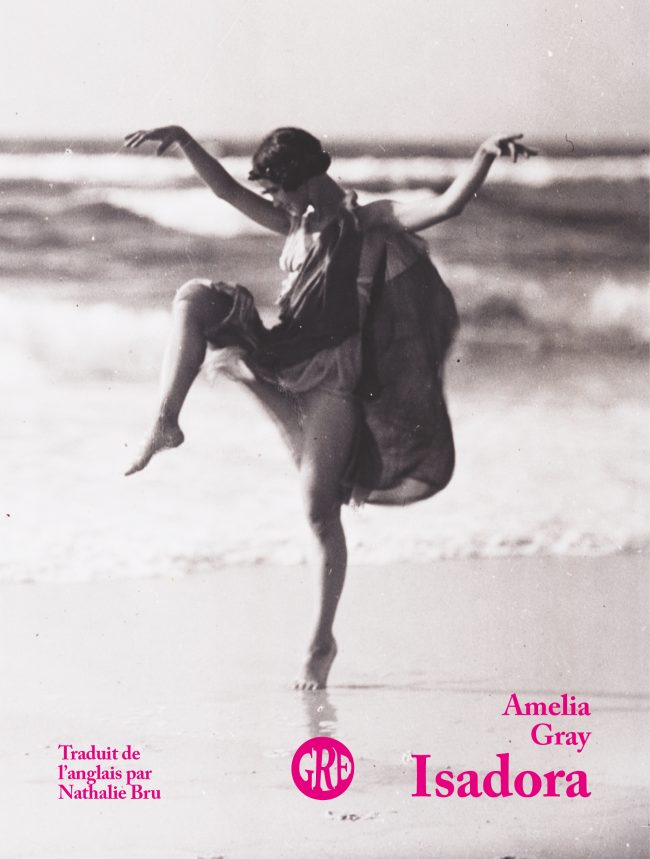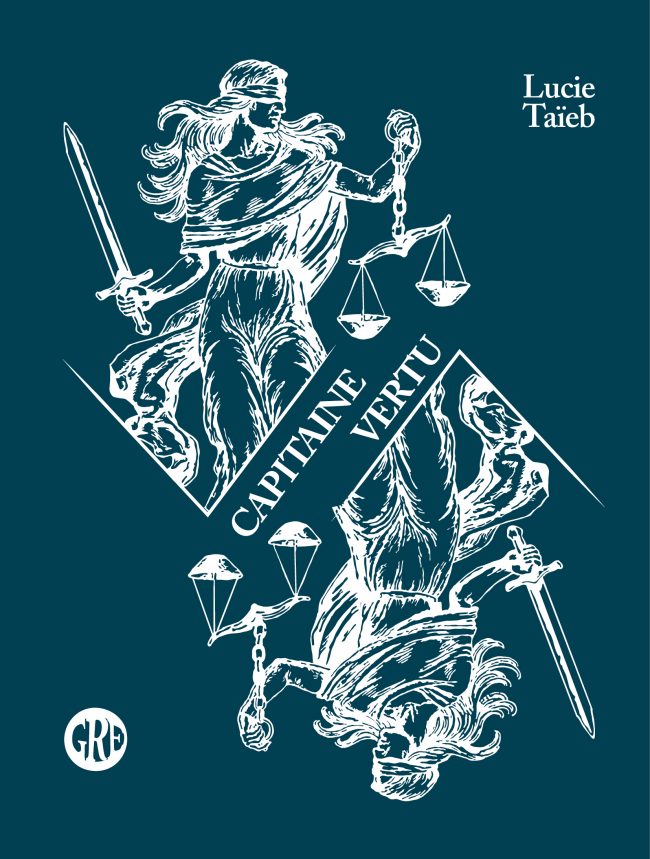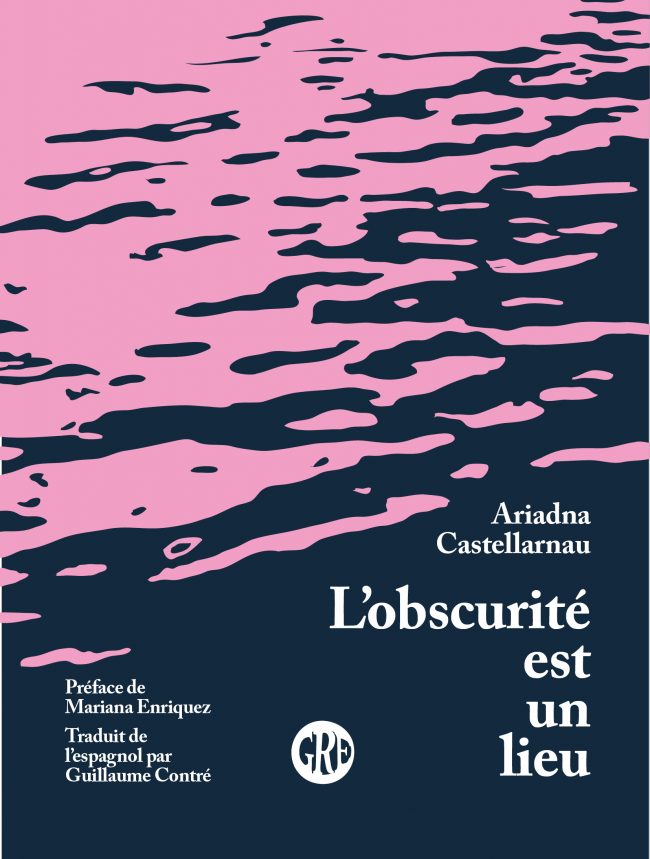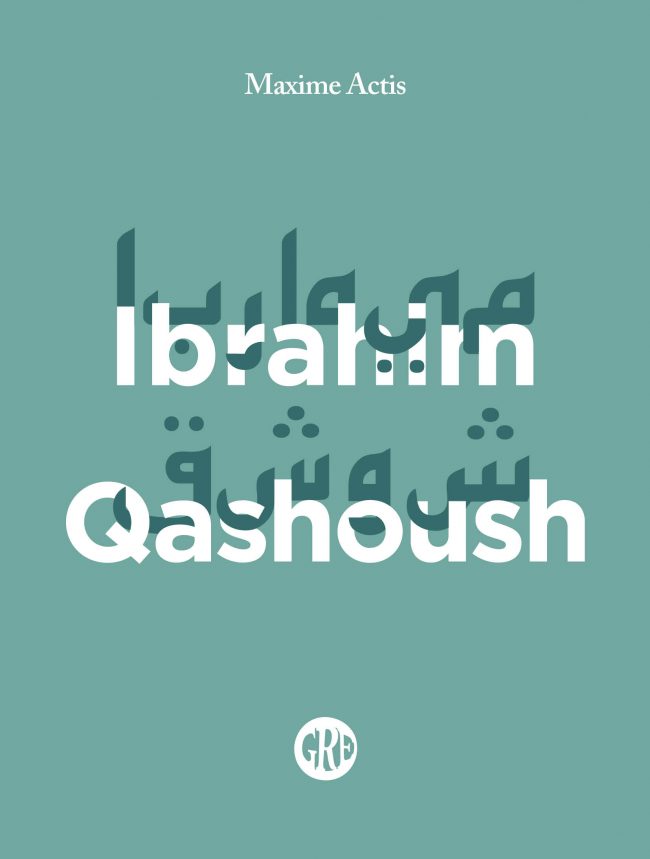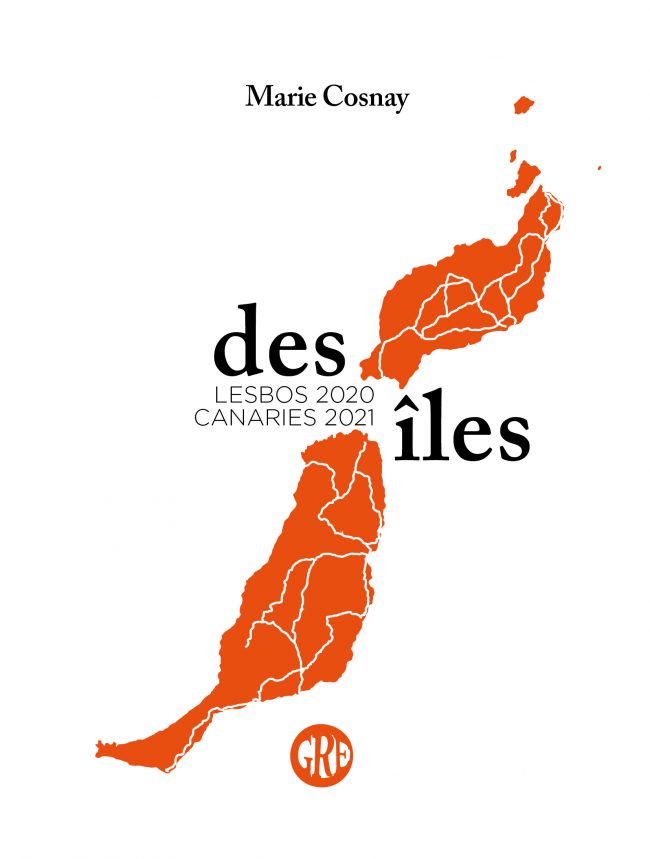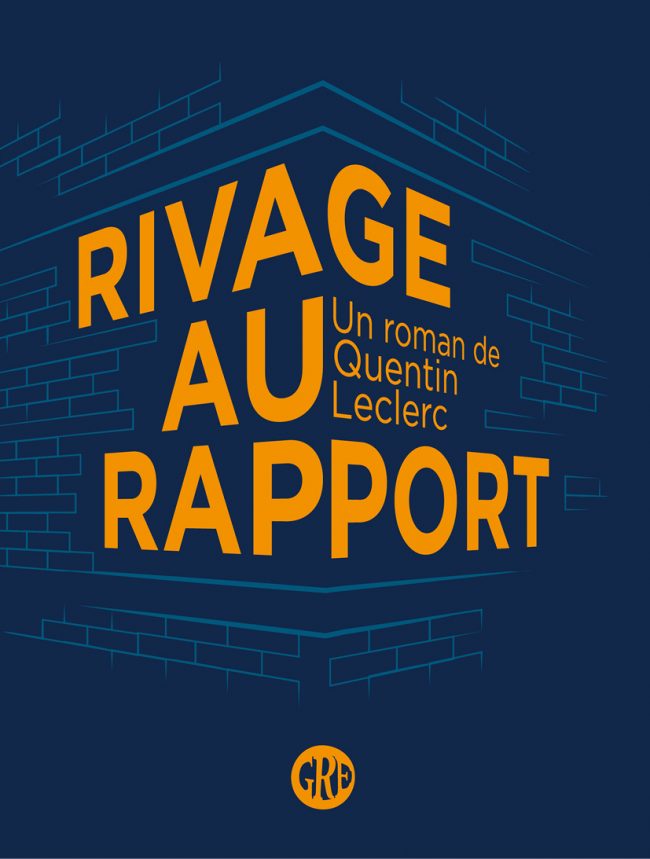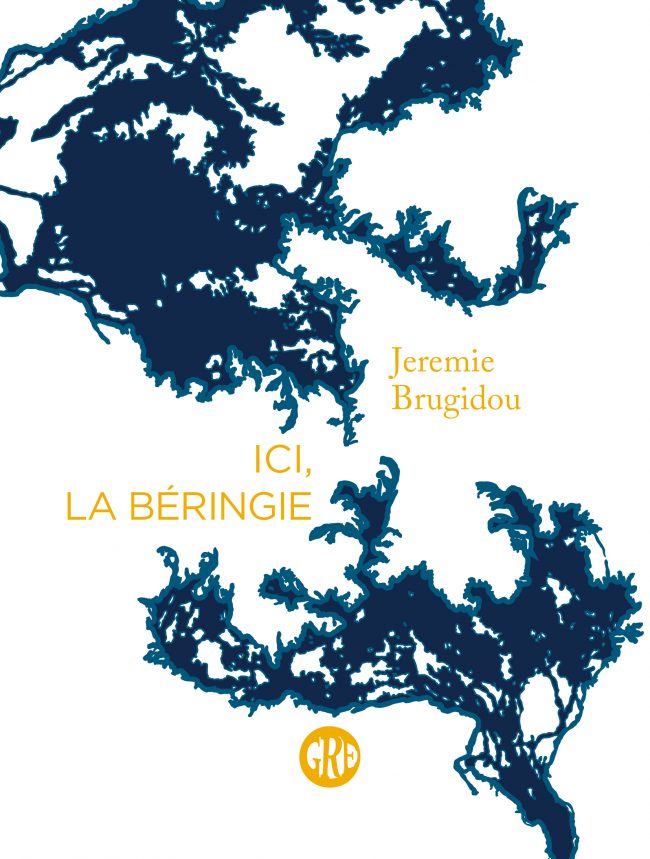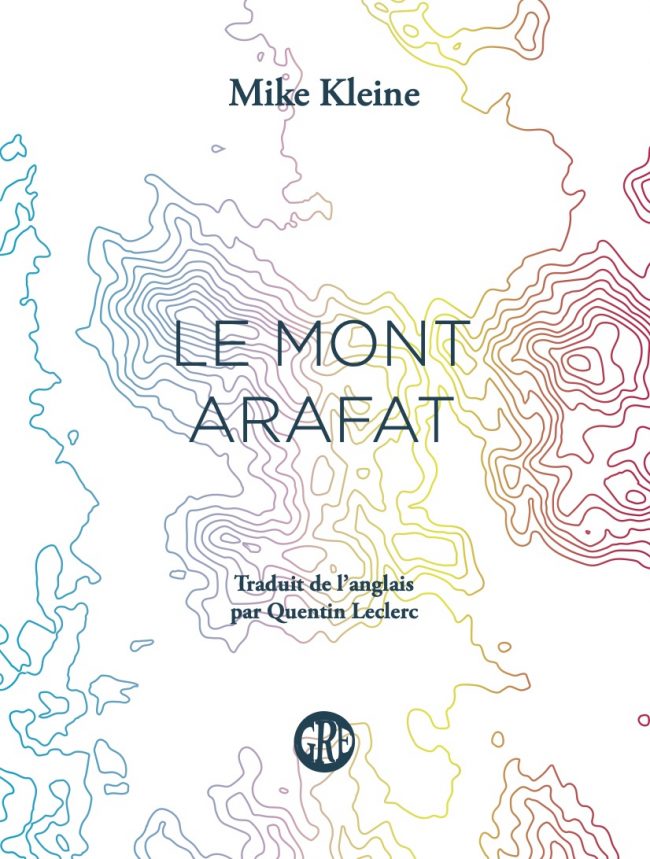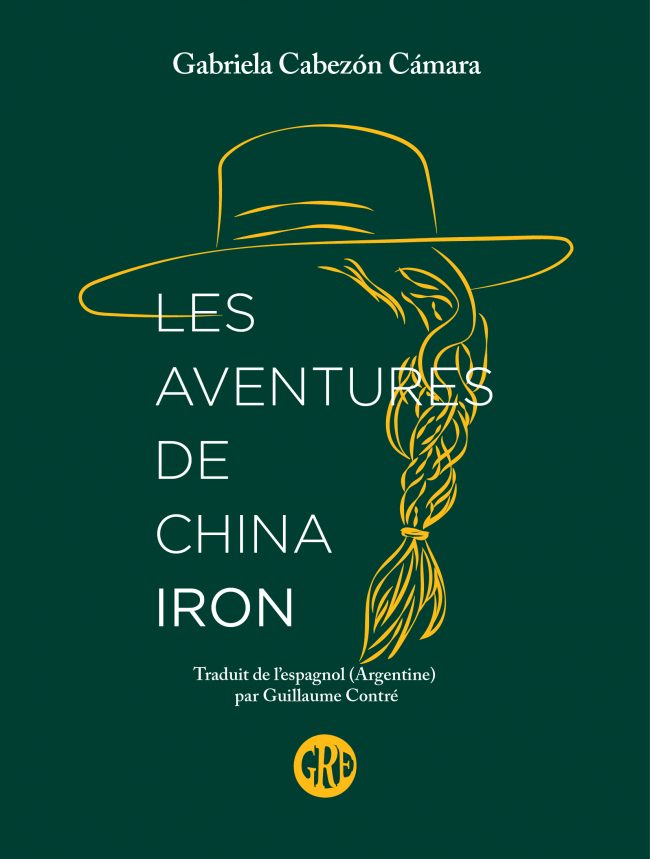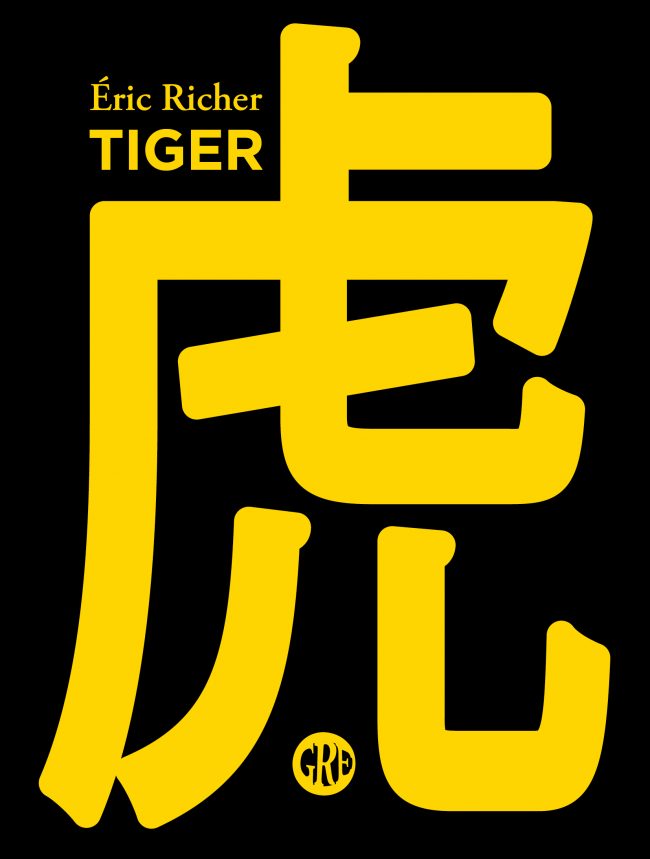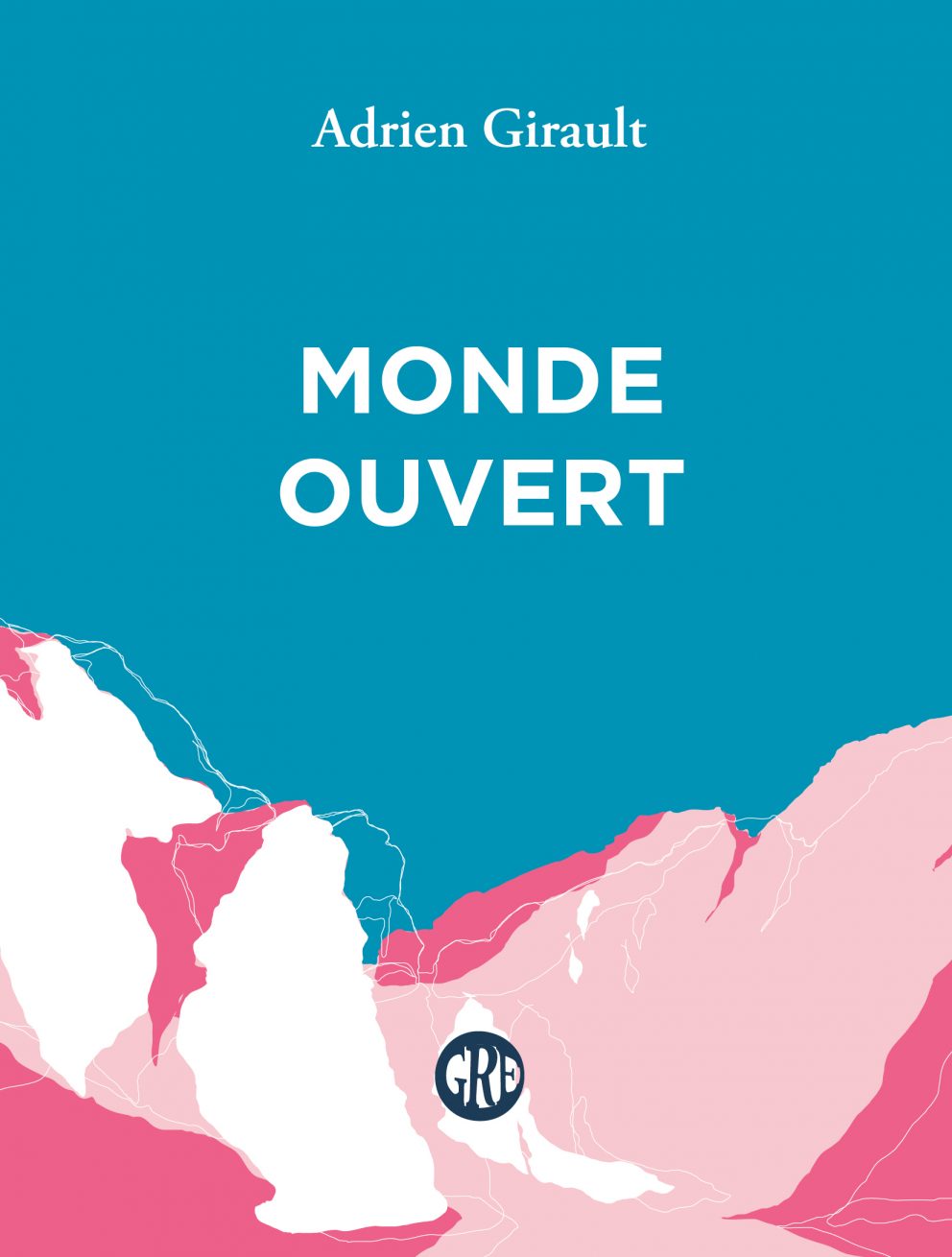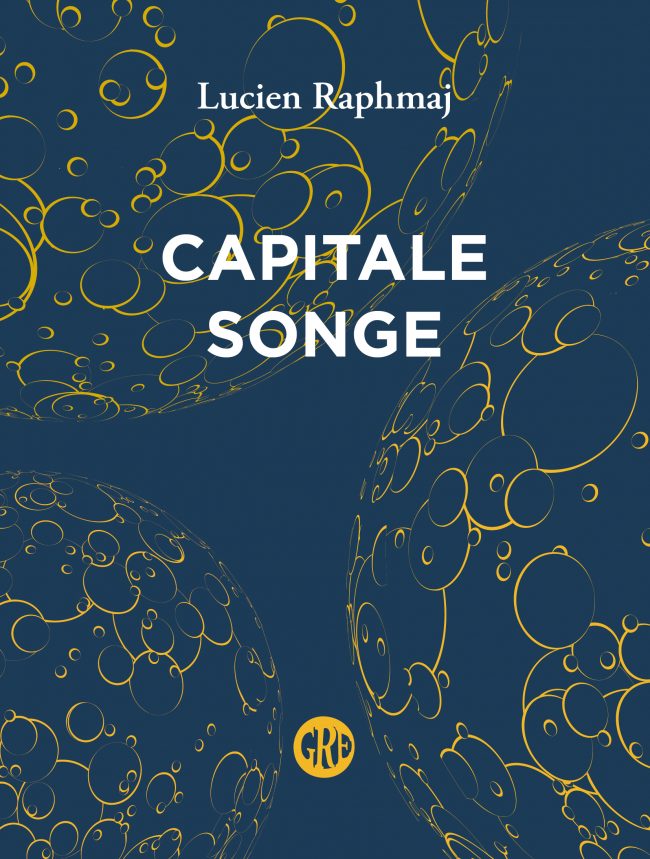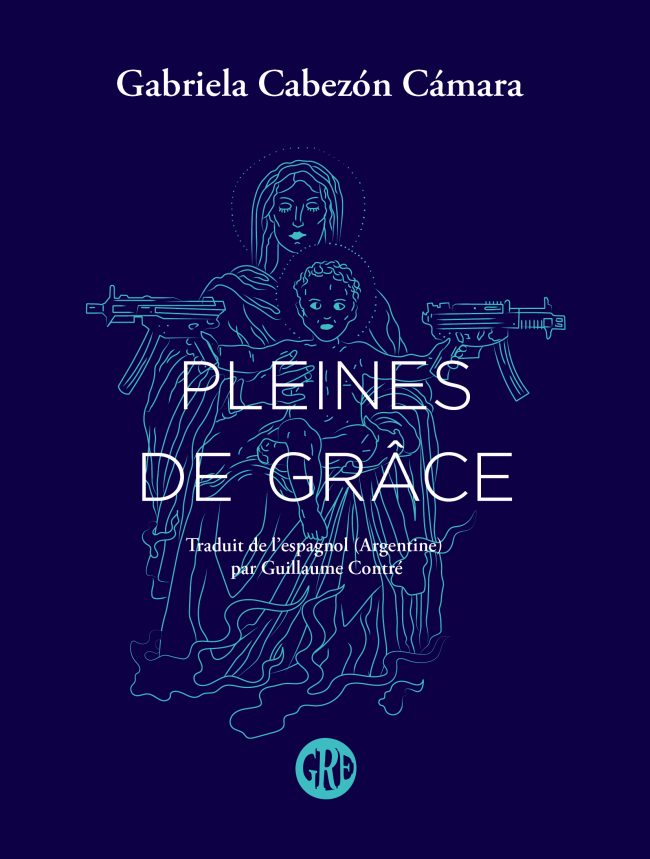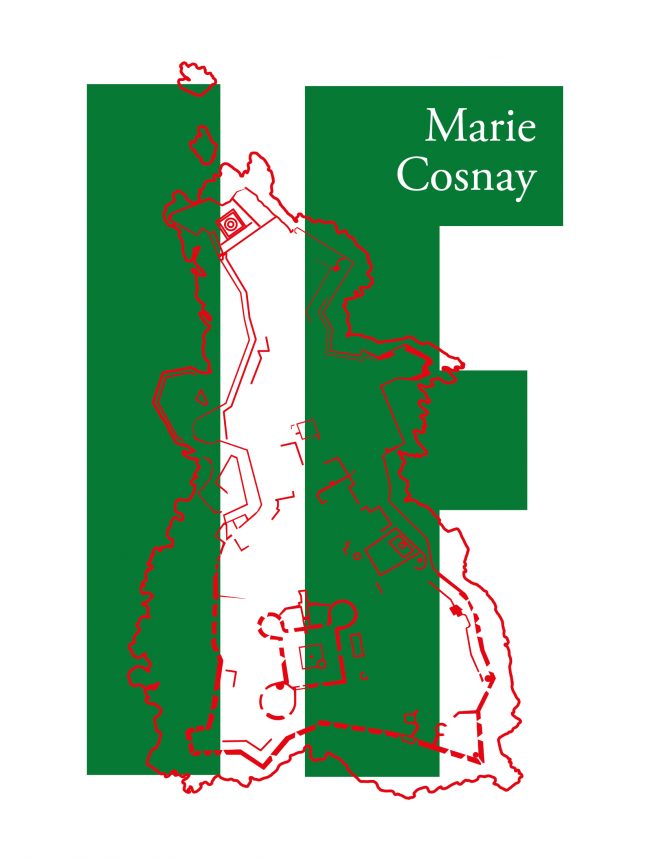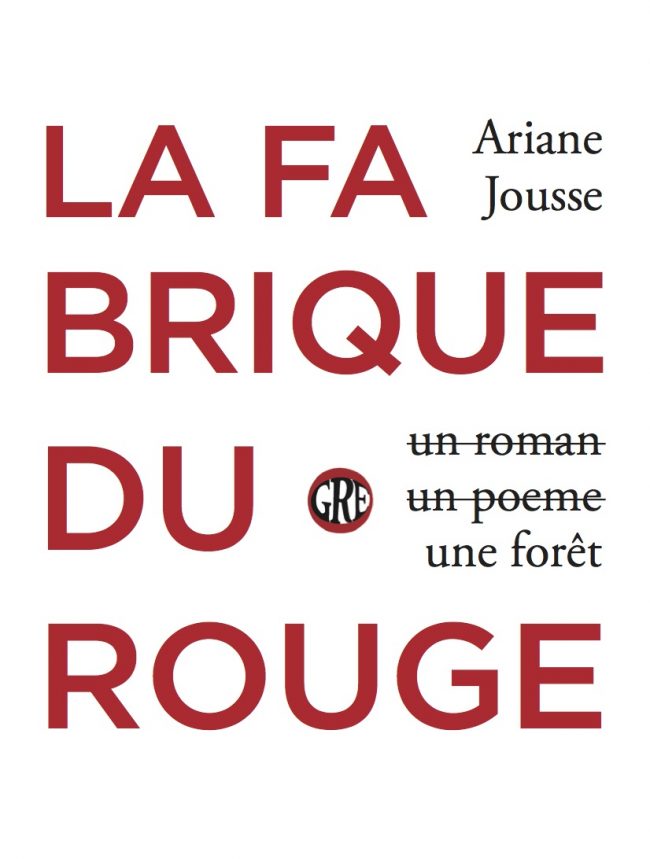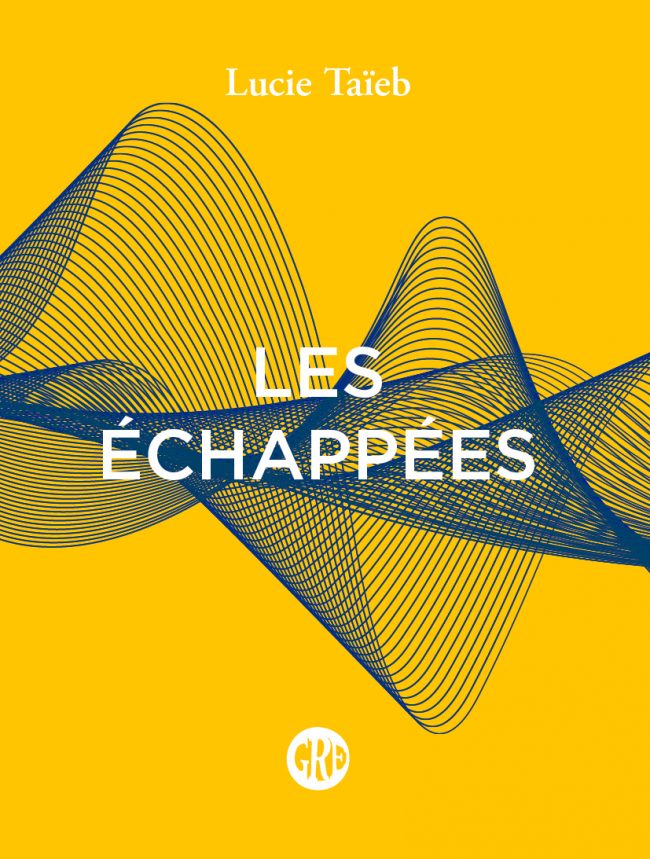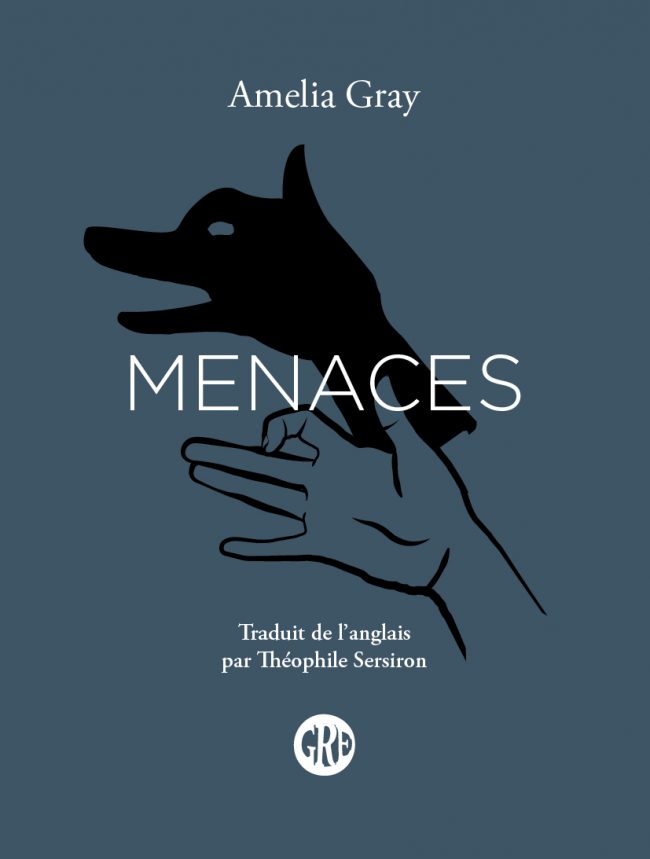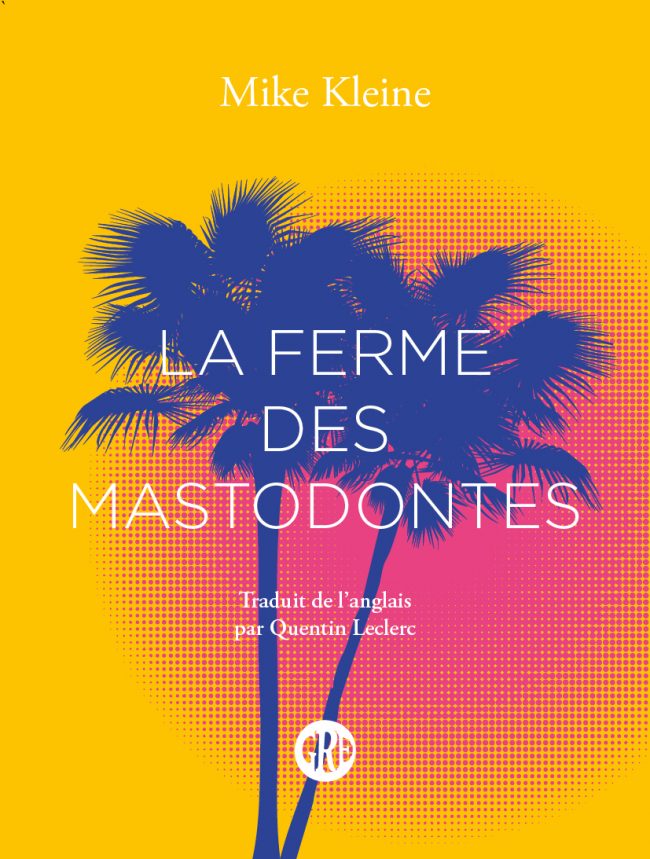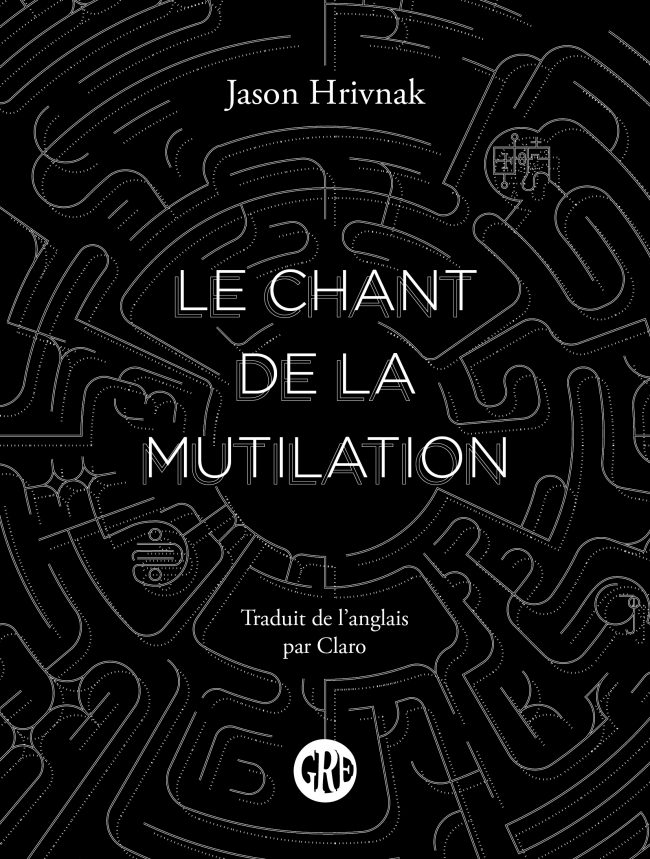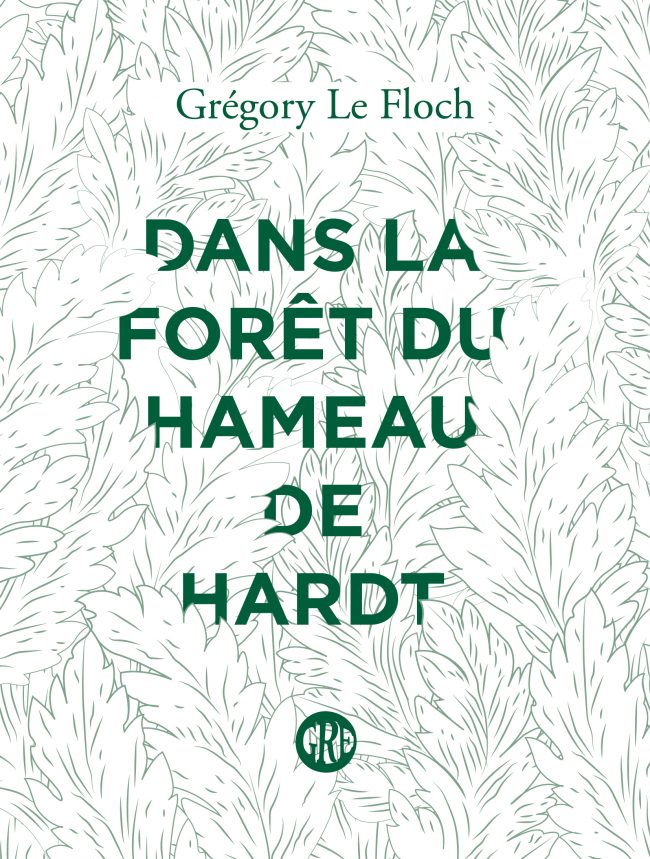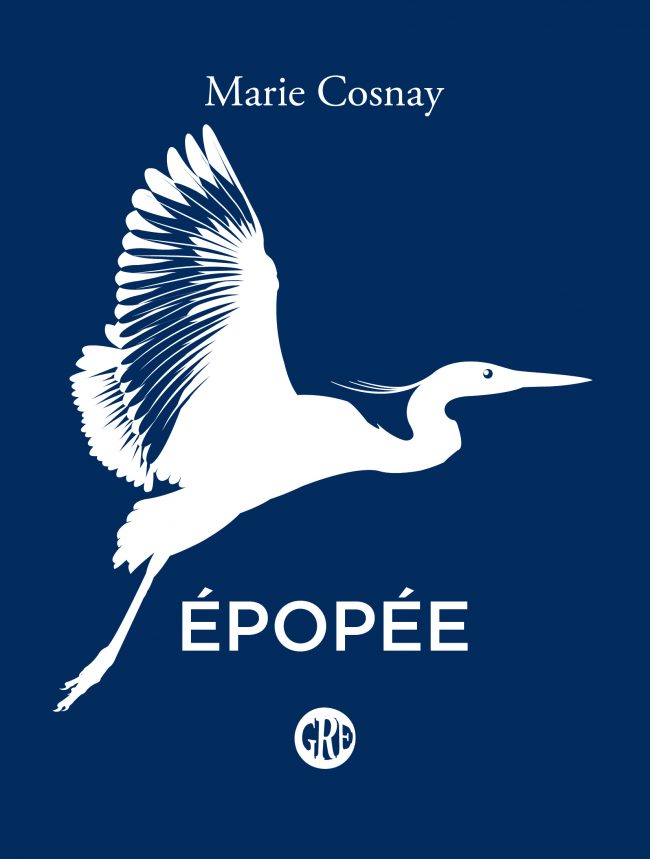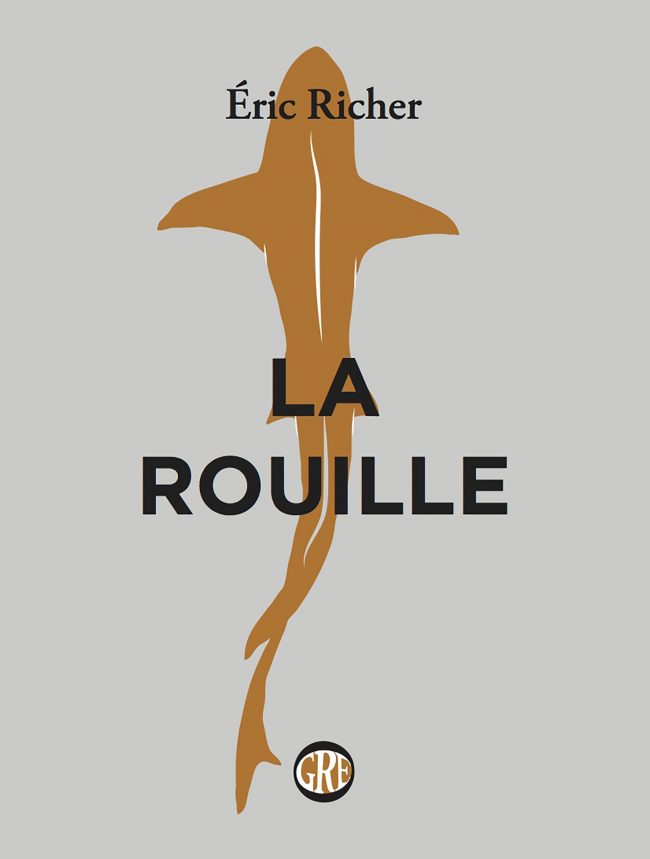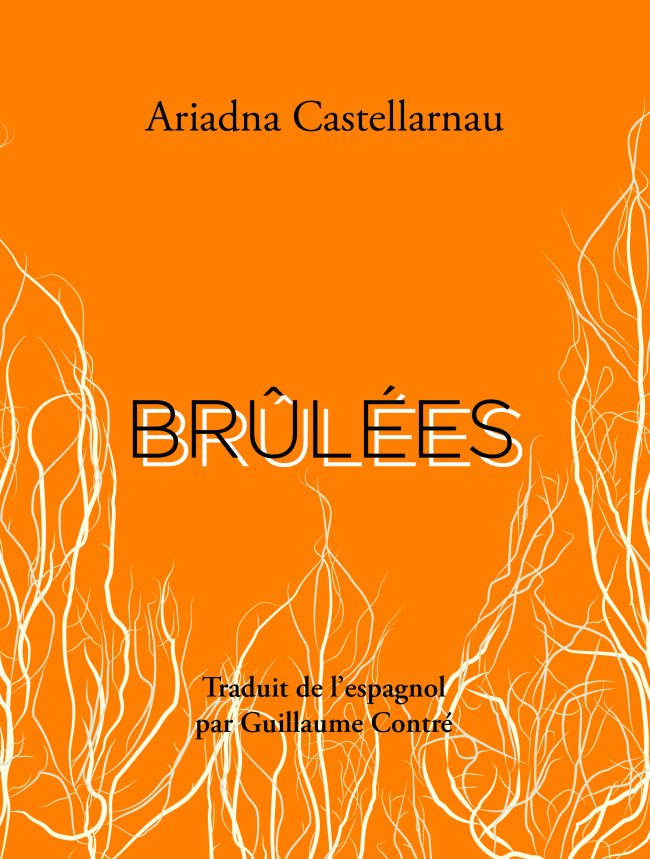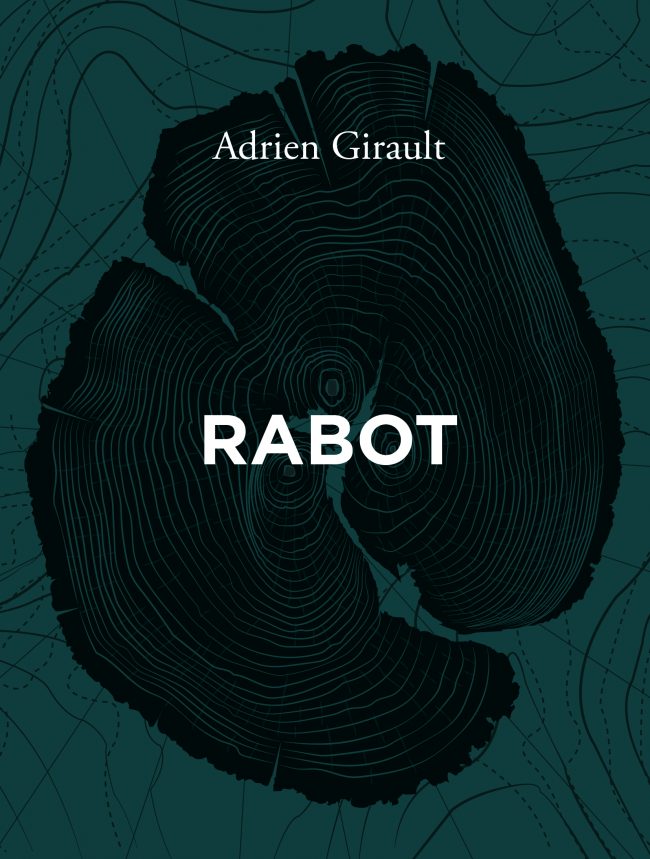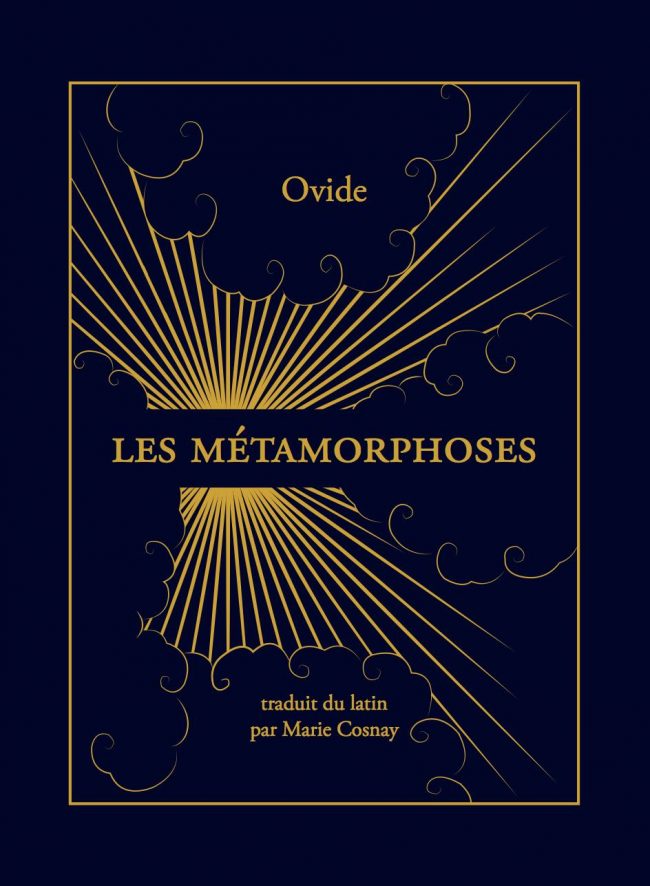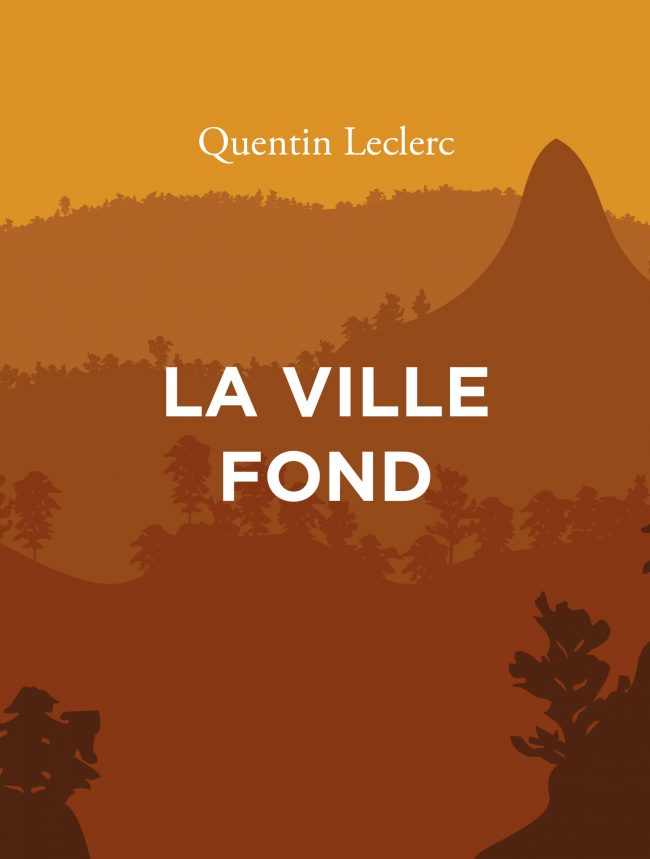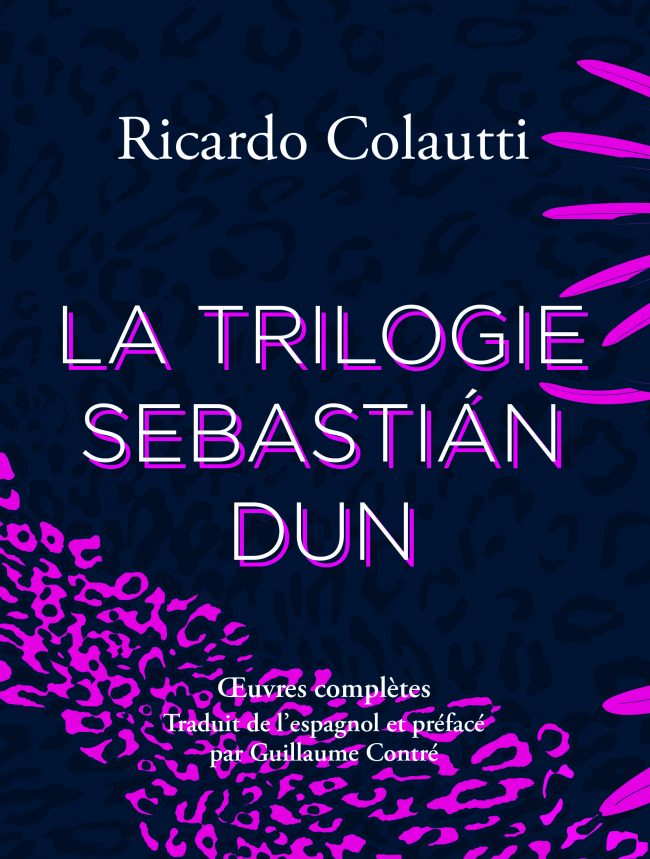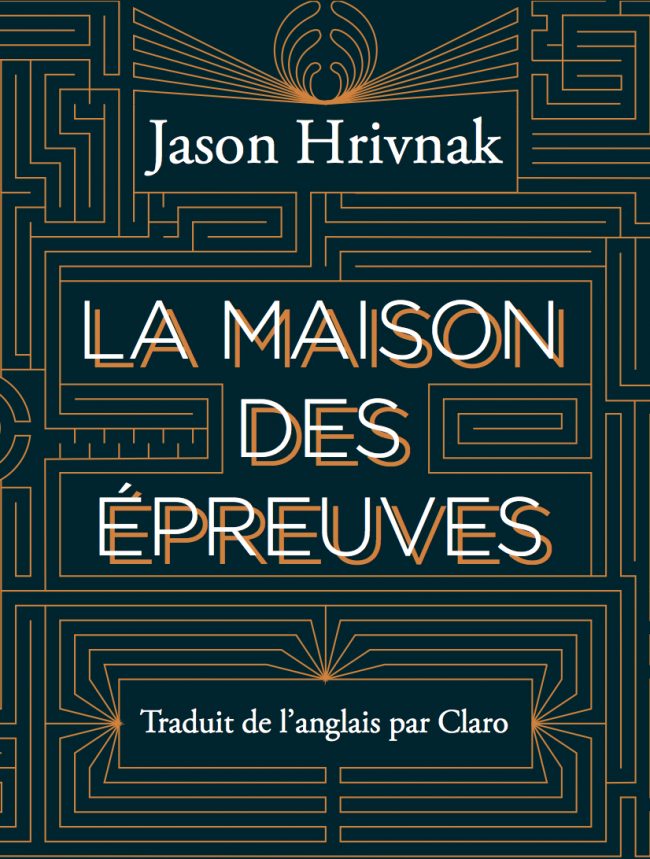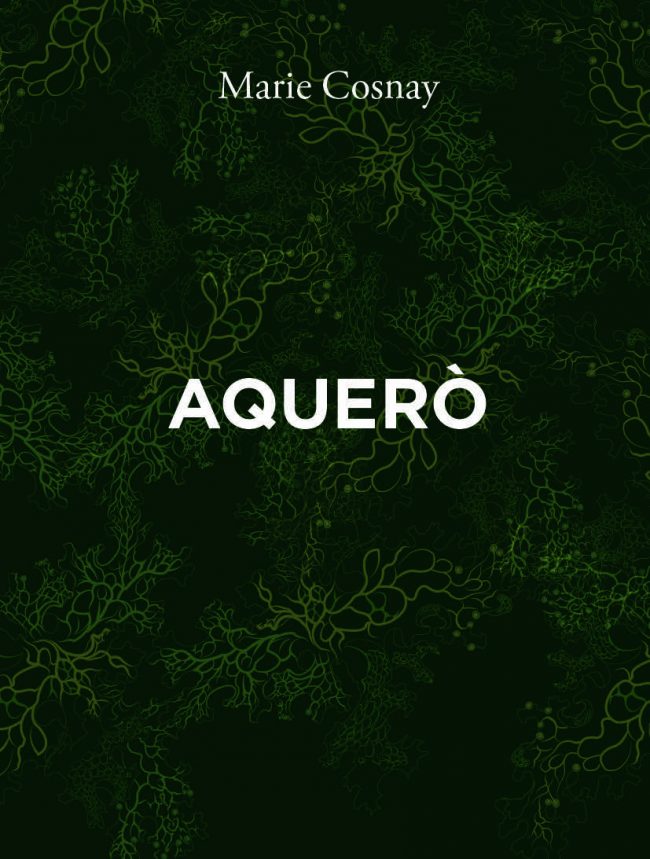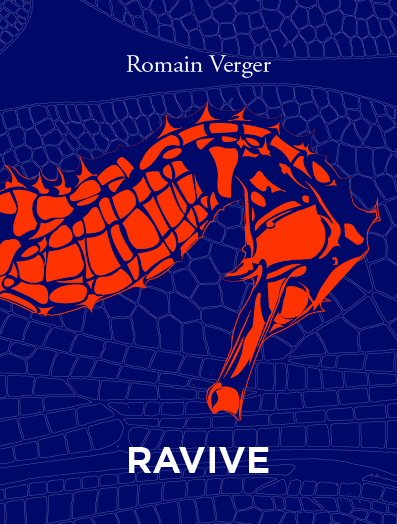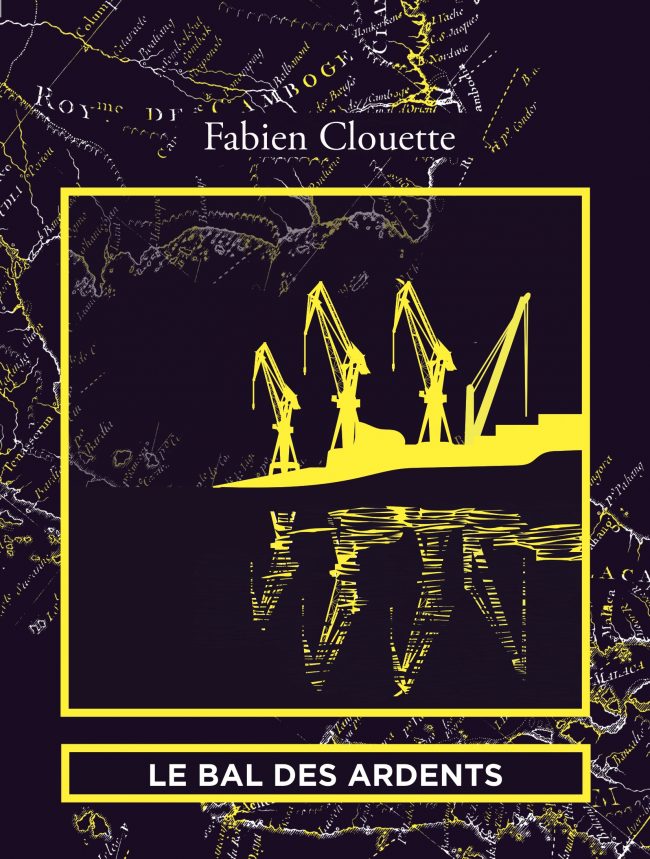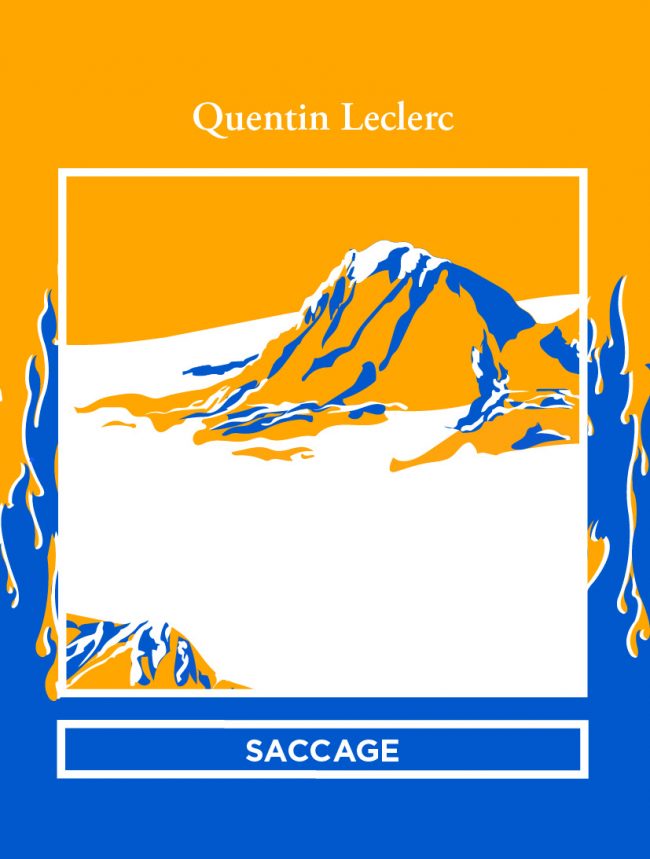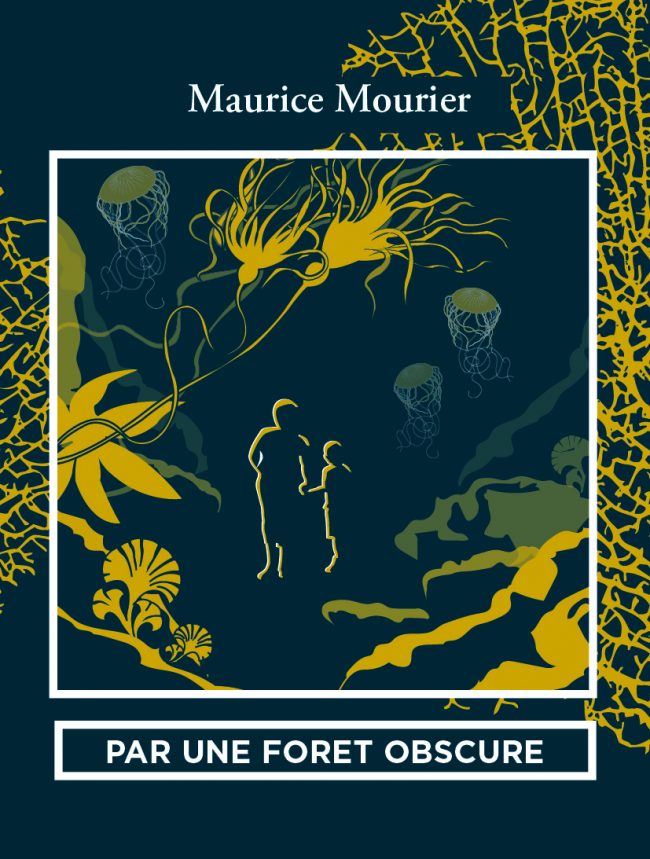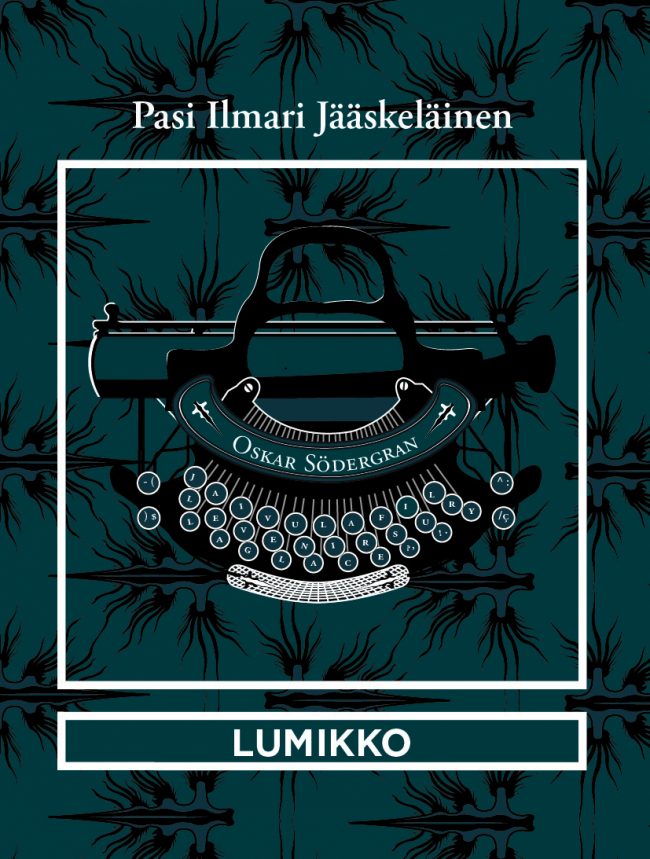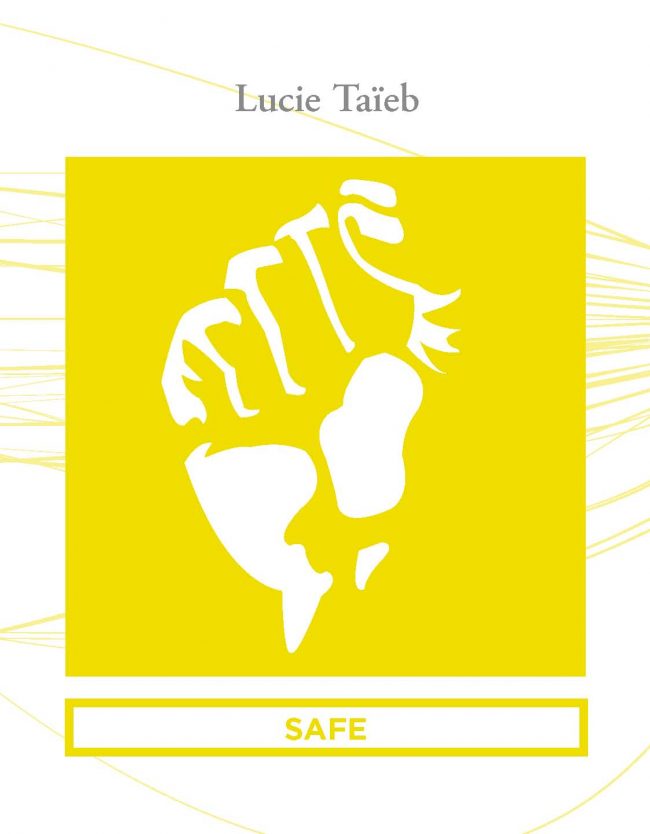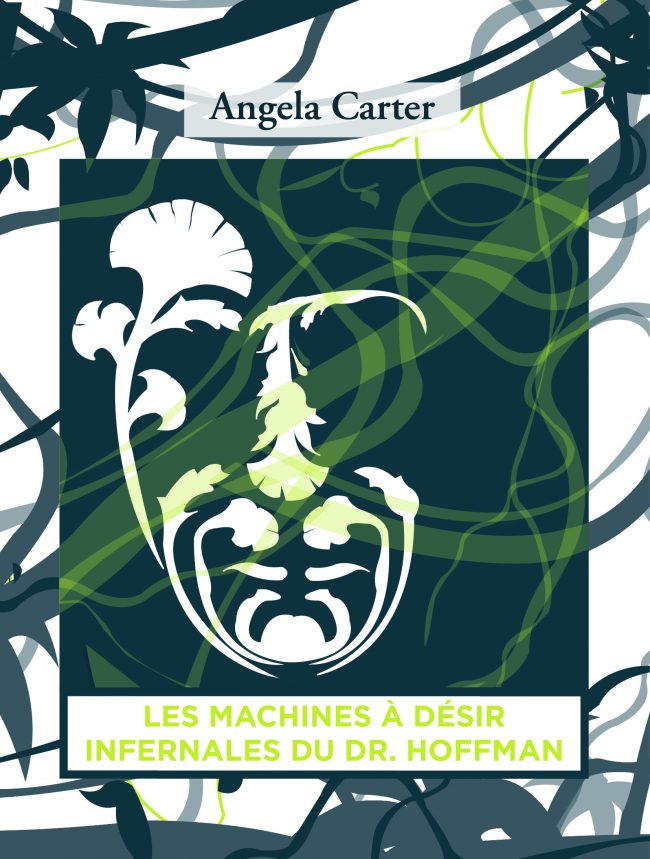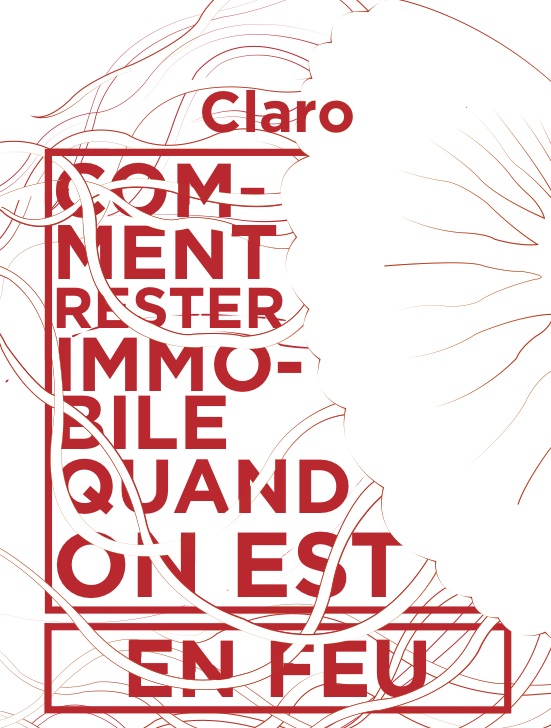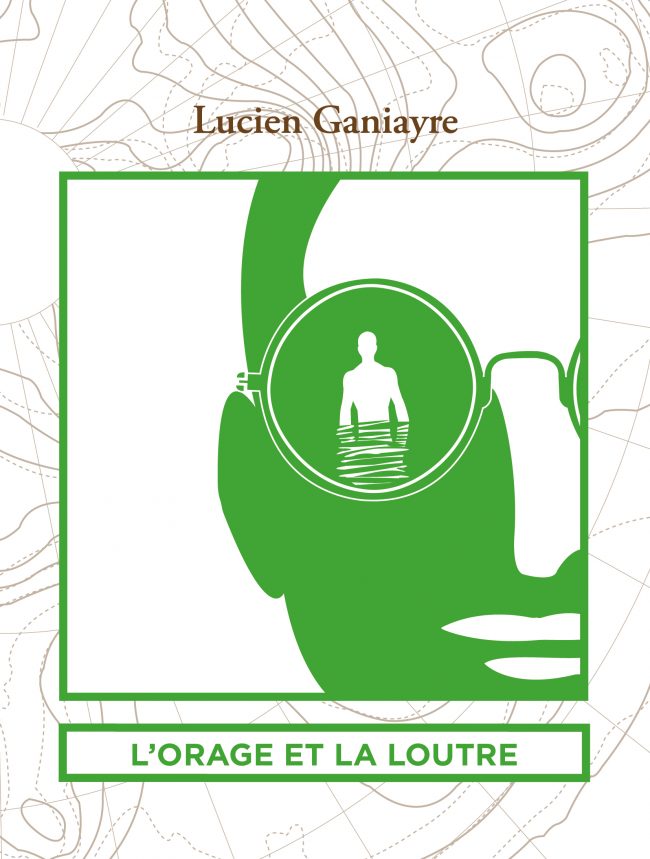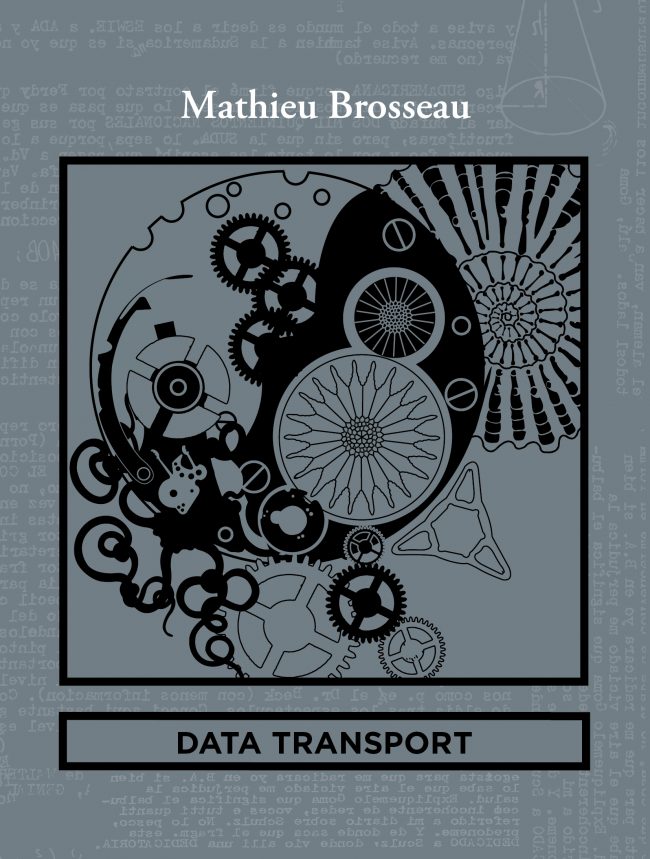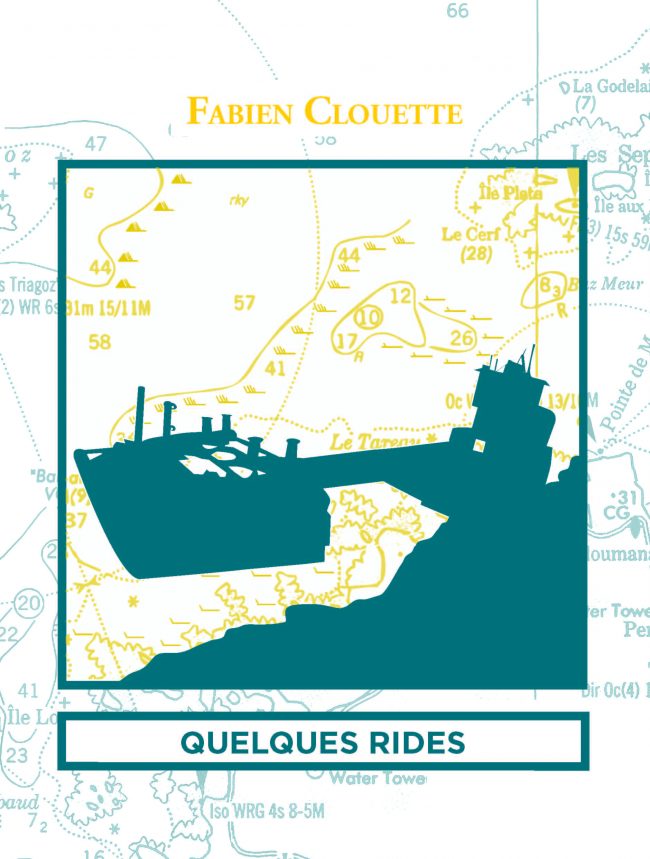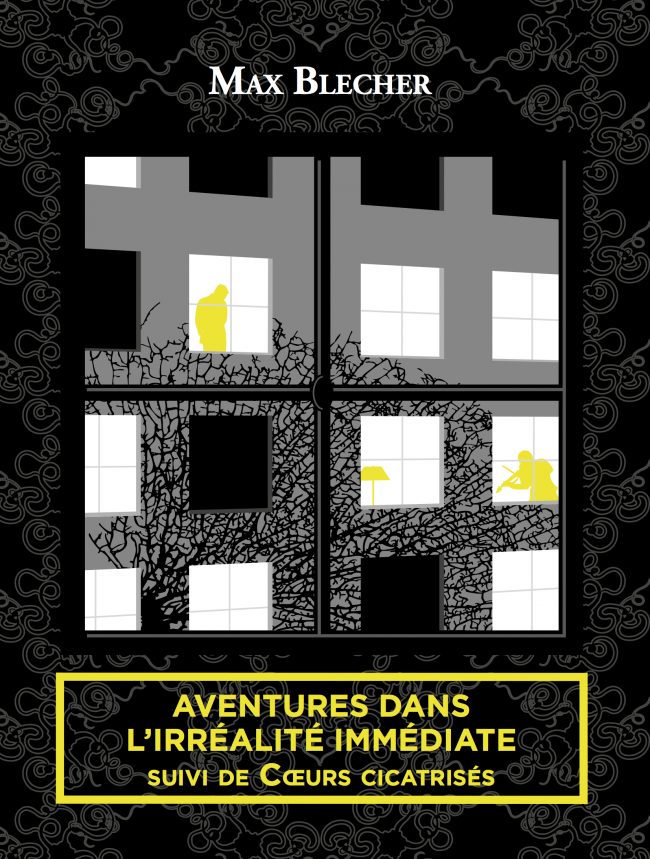Des os dans le désert
SIRENES N°2 – Sergio González Rodríguez
Sergio González Rodríguez
Des os dans le désert
Traduit par Guillaume Contré
vendredi 15 septembre 2023
Taille : 125 mm / 165 mm – 448. – 13€
ISBN : 978-2-37756-164-3
Entre 1995 et 2003, une vague de féminicides sans précédent a lieu à Ciudad Juárez au Mexique. Face à l’inaction et aux mensonges des autorités, Sergio González Rodríguez enquête au péril de sa vie pour comprendre ces meurtres et les conditions de leur réalisation.
Explorant à la fois les spécificités géographiques de la ville-frontière de Ciudad Juárez, les gangs sataniques, leurs rituels, et les relations ambiguës entre les narcos et les politiciens locaux, il montre que cette violence est avant tout la traduction d’un système global qui organise les rapports de domination.
Ce narco-récit, qui mêle journalisme, essai et poésie, se dévore comme les plus grands romans noirs.
« Je ne me souviens plus de l’année où j’ai commencé à correspondre avec Sergio González Rodríguez. Tout ce que je sais, c’est que mon affection et mon admiration pour lui n’ont fait que croître avec le temps. […] Aujourd’hui vient de paraître son livre Des os dans le désert, un livre qui plonge directement dans l’horreur et que Sergio semble, avec un calme écrasant, n’avoir vécu que comme quelqu’un qui regarde la pluie tomber.
En réalité, plus que de la pluie, c’est un ouragan que Sergio a observé, puis en quelque sorte vécu. Son livre, non seulement ne nuit en rien à l’entreprise de ces mythes du journalisme, mais même, transgresse les règles du journalisme à la première occasion pour entrer dans le non-roman, le témoignage et la blessure. Des os dans le désert est ainsi non seulement une photographie imparfaite, et il ne pourrait pas en être autrement, du mal et de la corruption, mais se transforme en une métaphore du Mexique et du passé du Mexique, et du futur incertain de toute l’Amérique latine. C’est un livre qui ne se situe pas dans la tradition des récits d’aventures, mais dans celle des récits apocalyptiques, qui sont les deux seules traditions à rester vivantes dans notre continent, peut-être parce qu’elles sont les seules à nous rapprocher de l’abîme qui nous entoure. »
Roberto Bolano
PRESSE
« “Des os dans le désert”, enquête édifiante sur les féminicides de Ciudad Juárez« , Youness Bousenna, Télérama, 12 septembre 2023 :
« Documenté par Sergio González Rodríguez, transfigurée par Roberto Bolaño, cette monstruosité devient plus qu’un “crime contre l’humanité” : Cuidad Juárez devient la scène, aussi d’un crime de l’humanité. »
Coup de coeur libraires
La librairie Coiffard (Nantes) :
« Cette enquête journalistique, très documentée, est passionnante et bouleversante. Sergio Gonzalez Rodriguez décrit l’évolution de Ciaduad Juarez et plus largement les liens entre Nord global et Sud global (sous-traitance dans les maquiladoras, exil, pauvreté…), la place des femmes dans la société et la culture mexicaine (système patriarcal) ainsi que la corruption qui fragilise ce pays. C’est une enquête hors-norme qui impressionne tant par son sujet que par son ampleur. Car parallèlement à cette enquête, Sergio Gonzalez Rodriguez décrit précisément le fonctionnement d’un narco-État. »