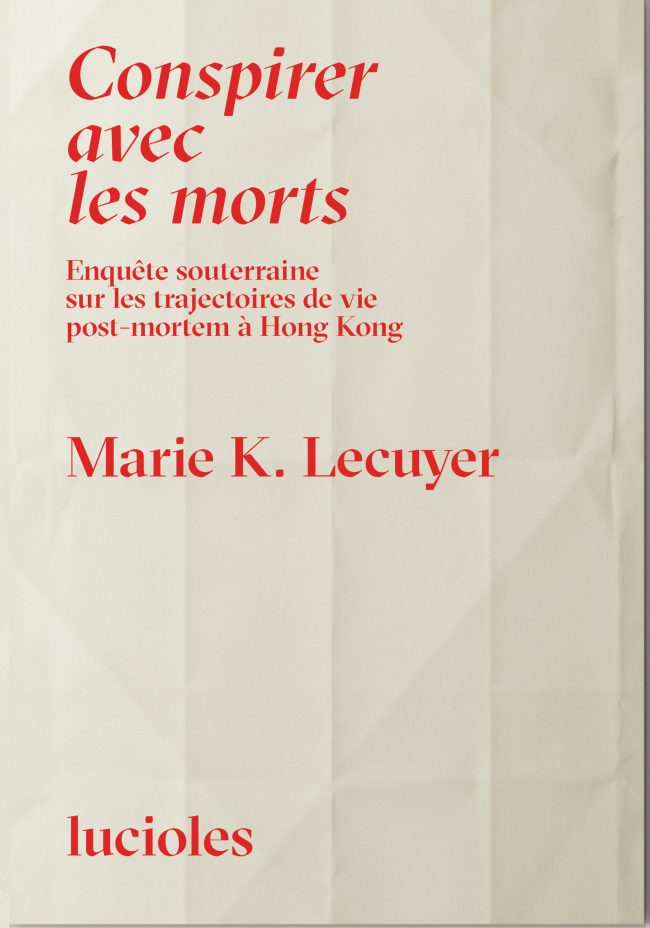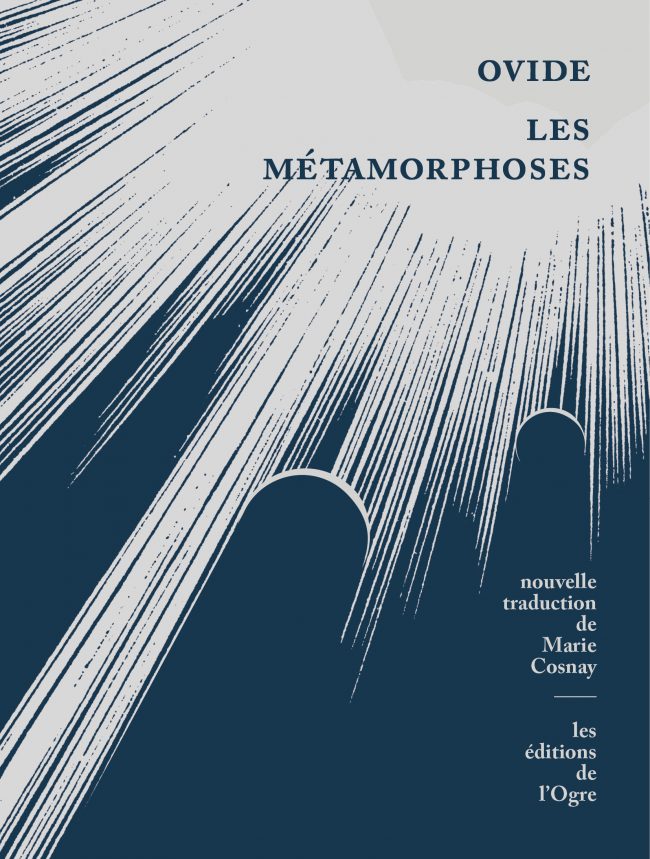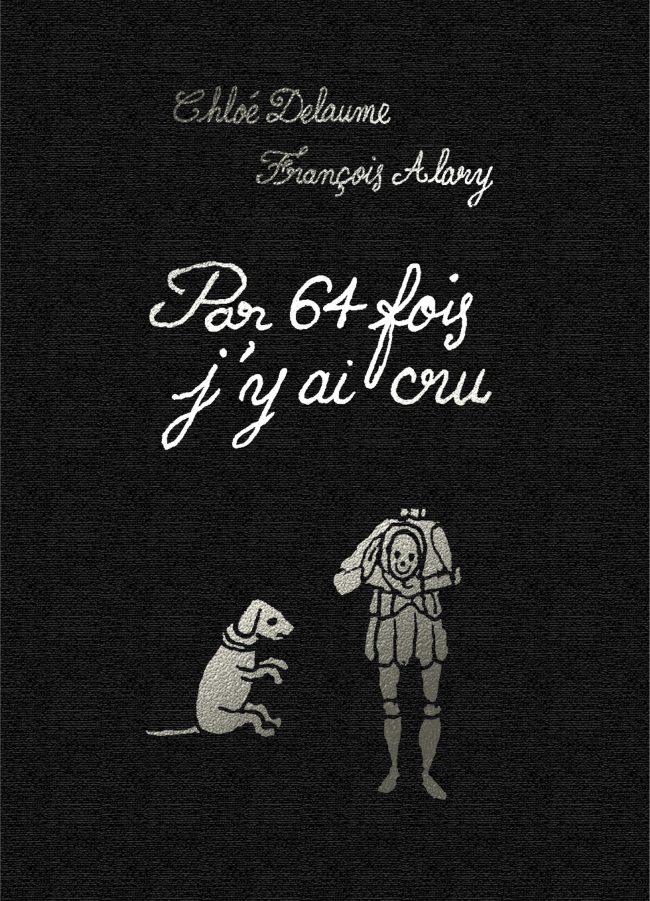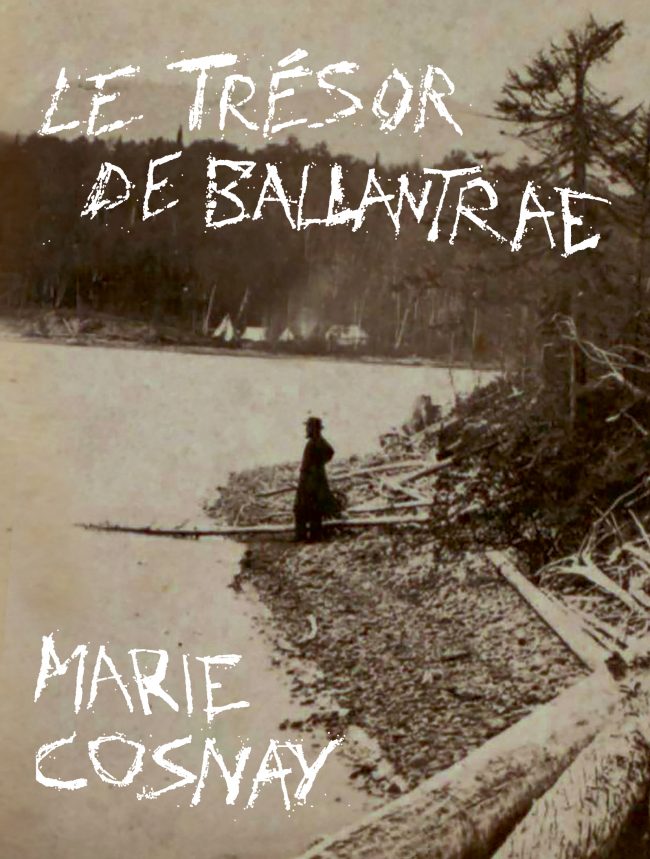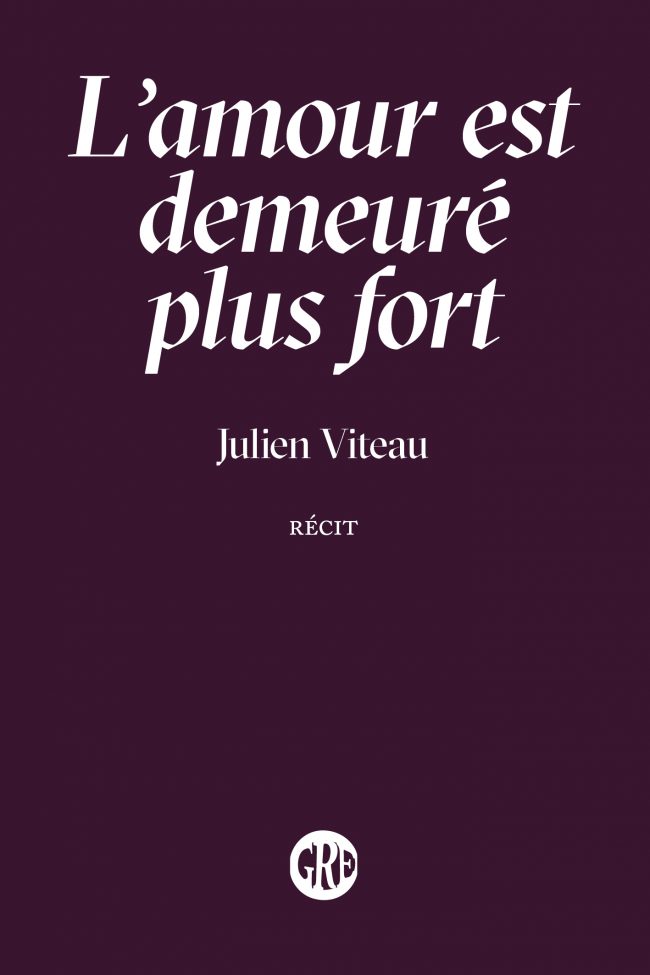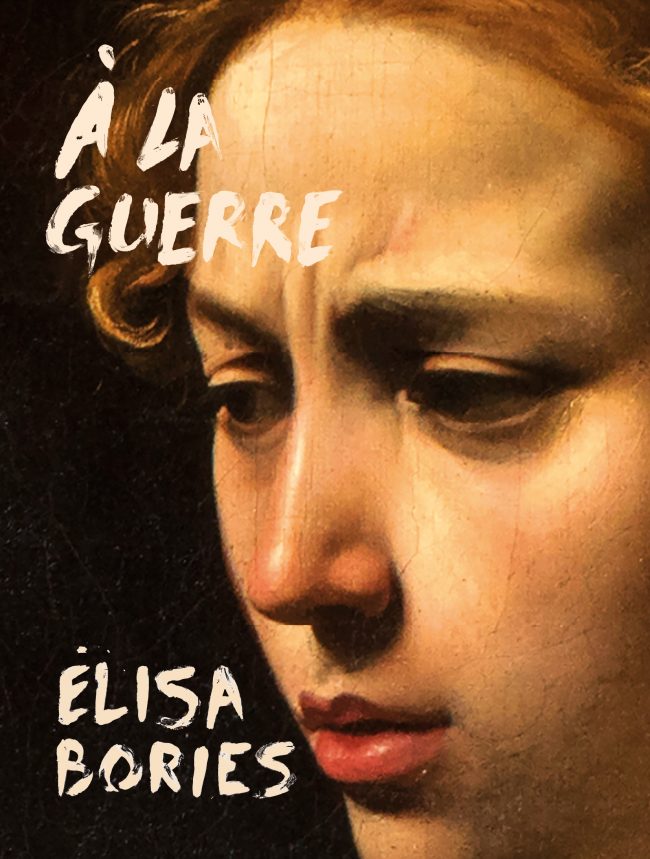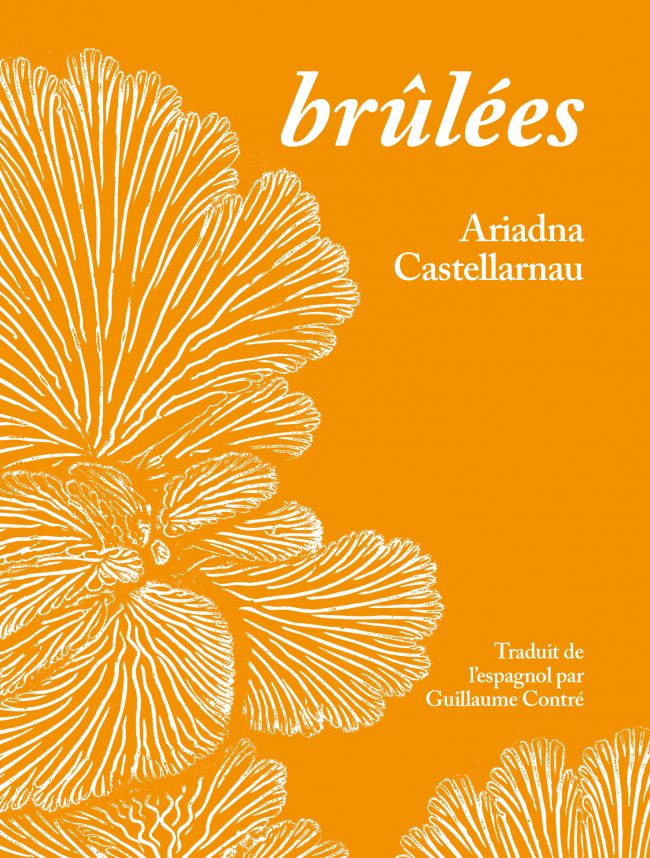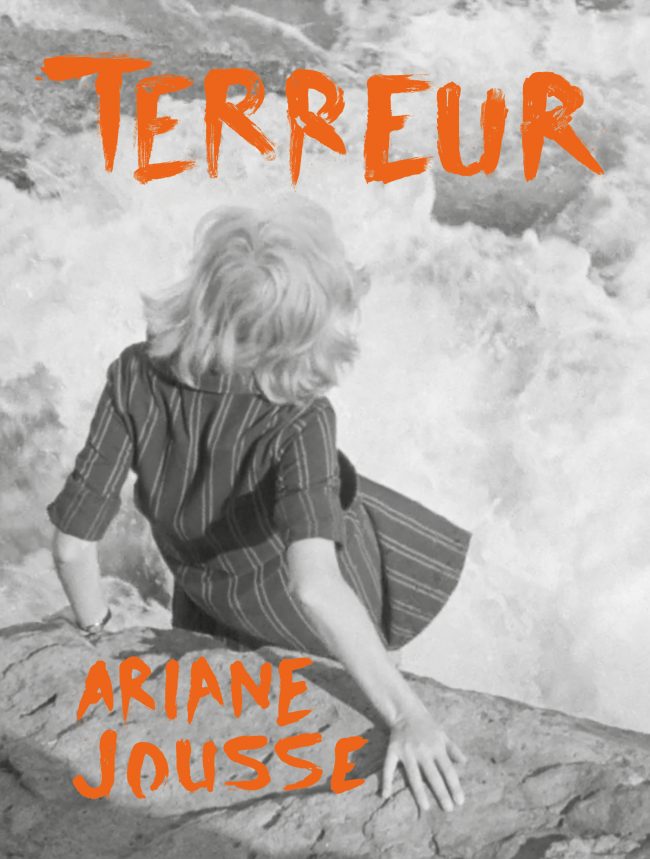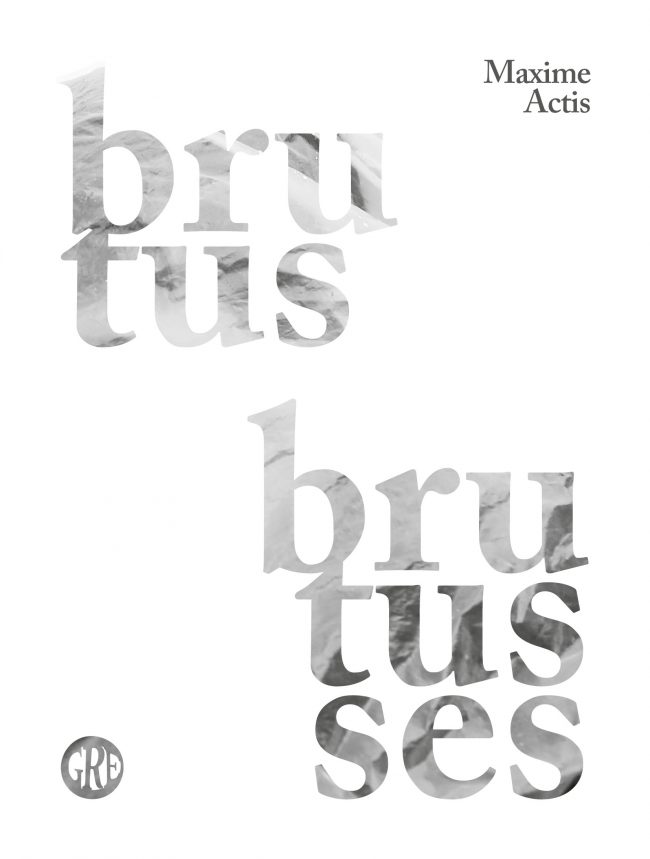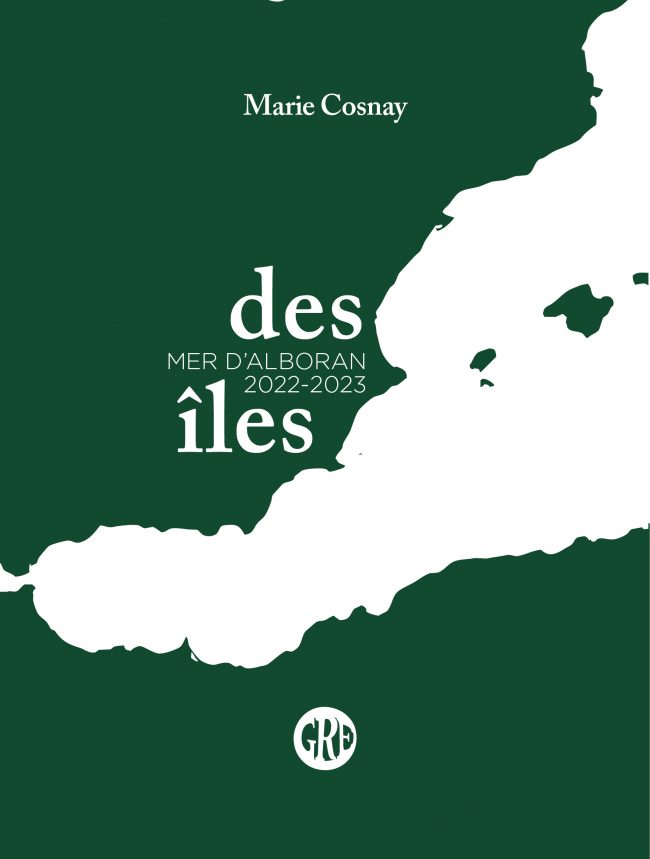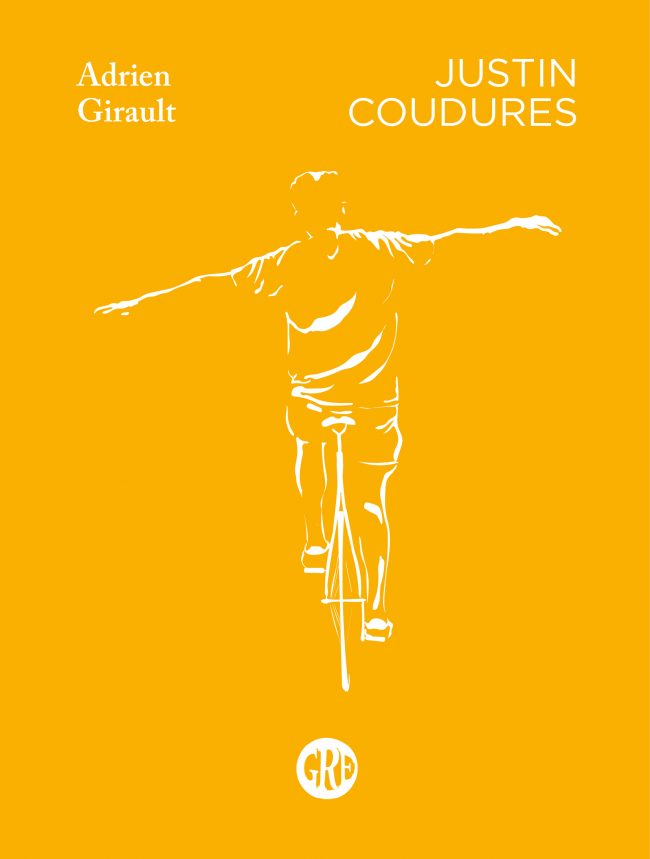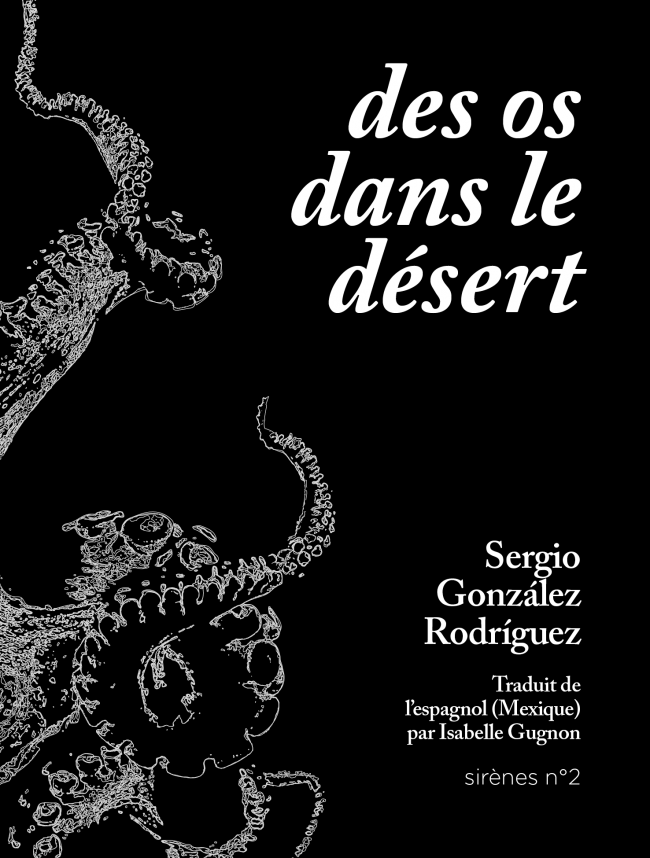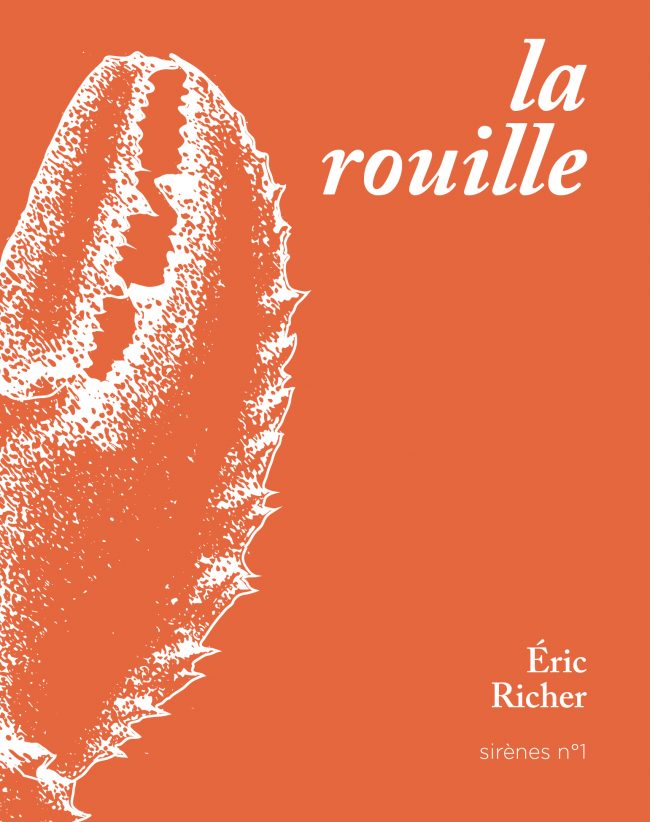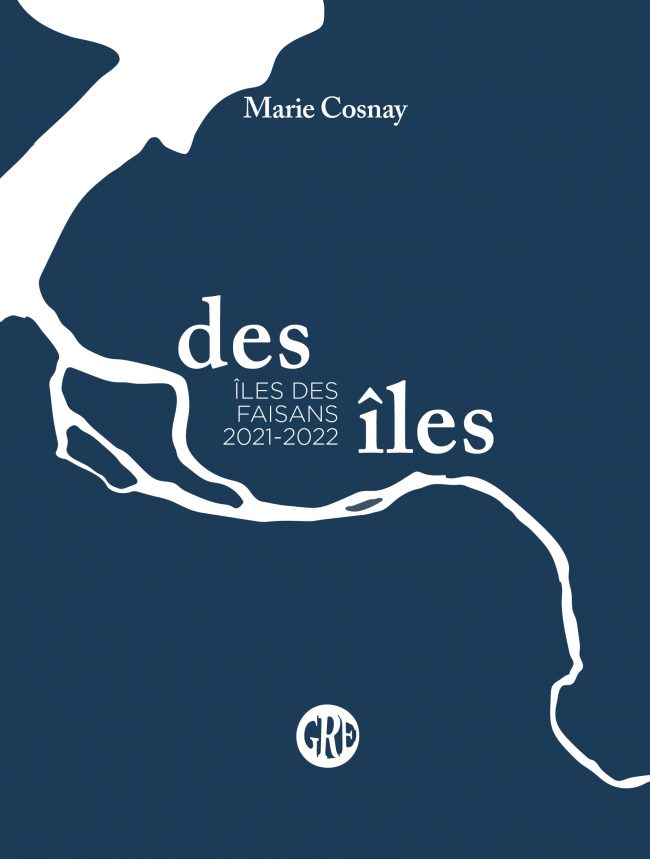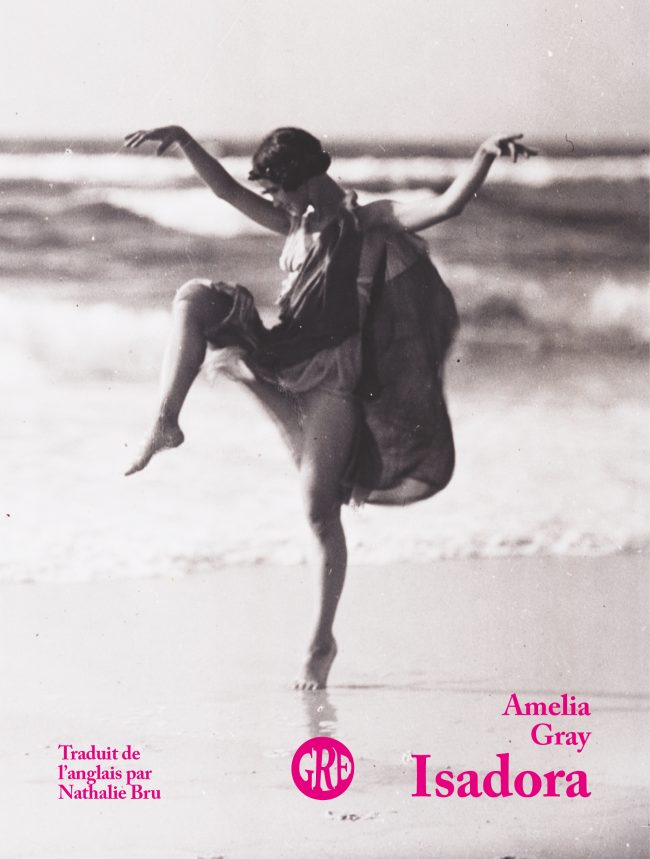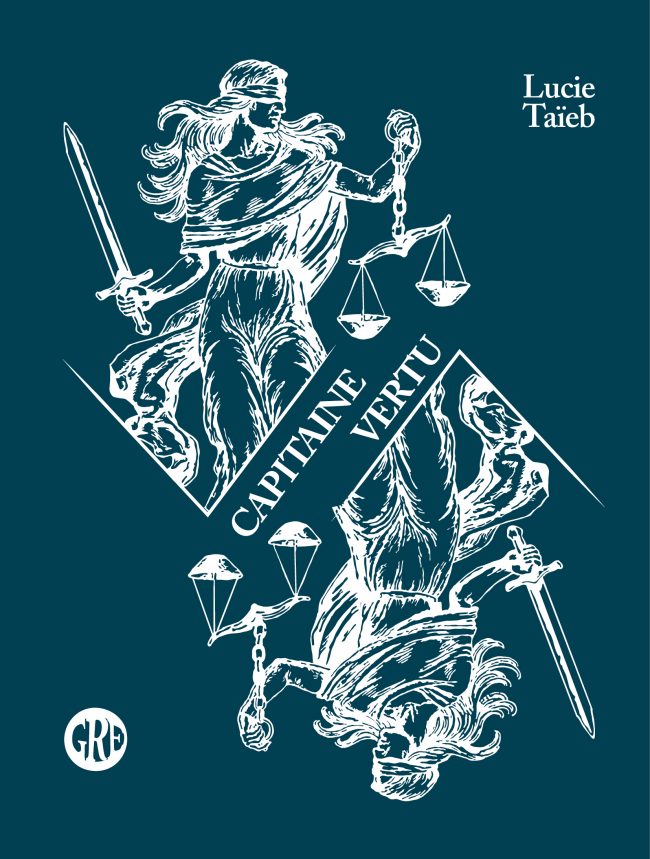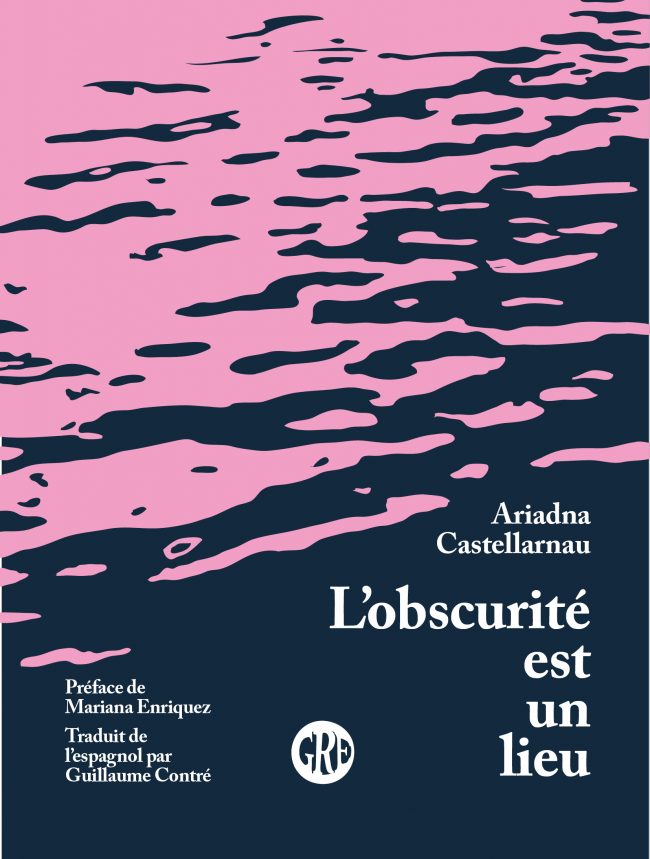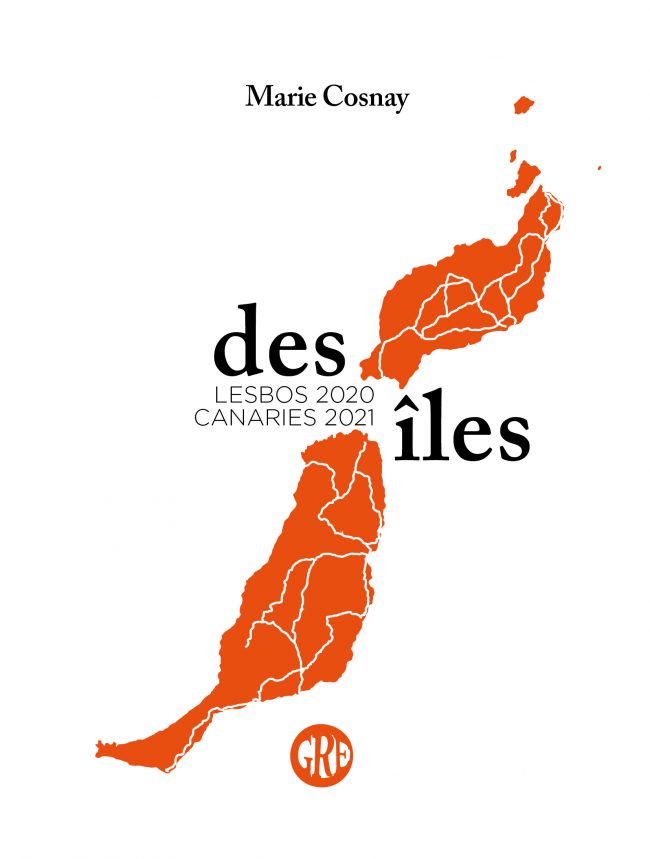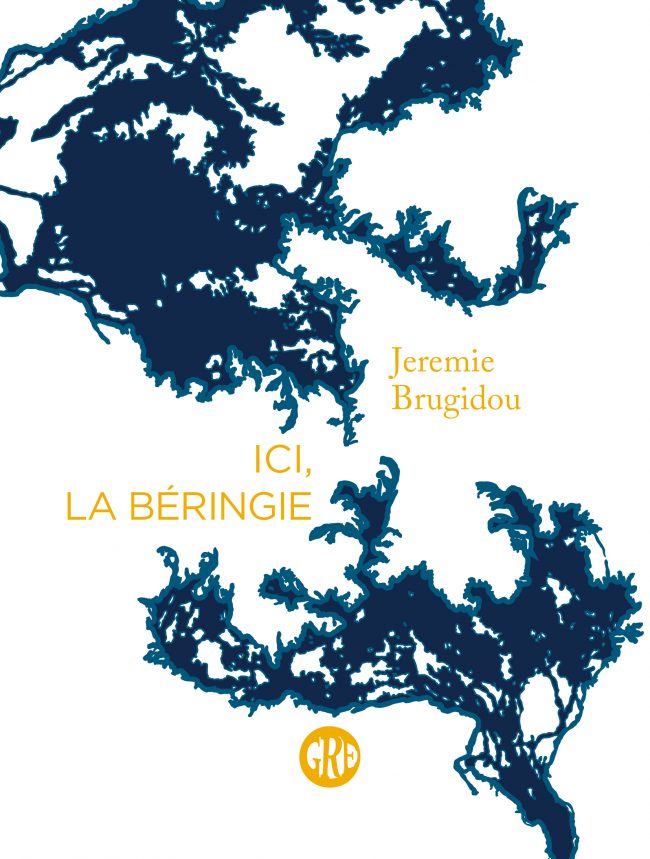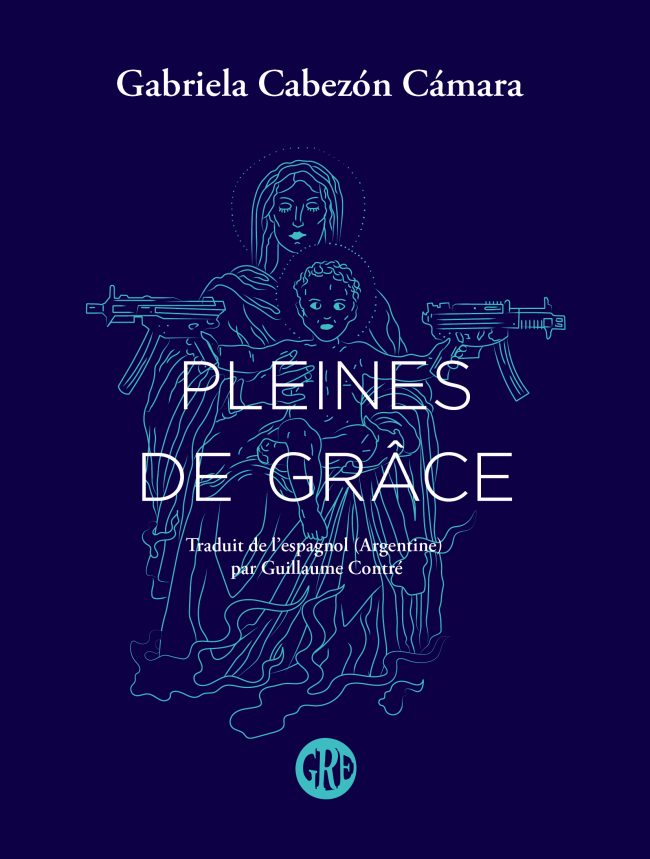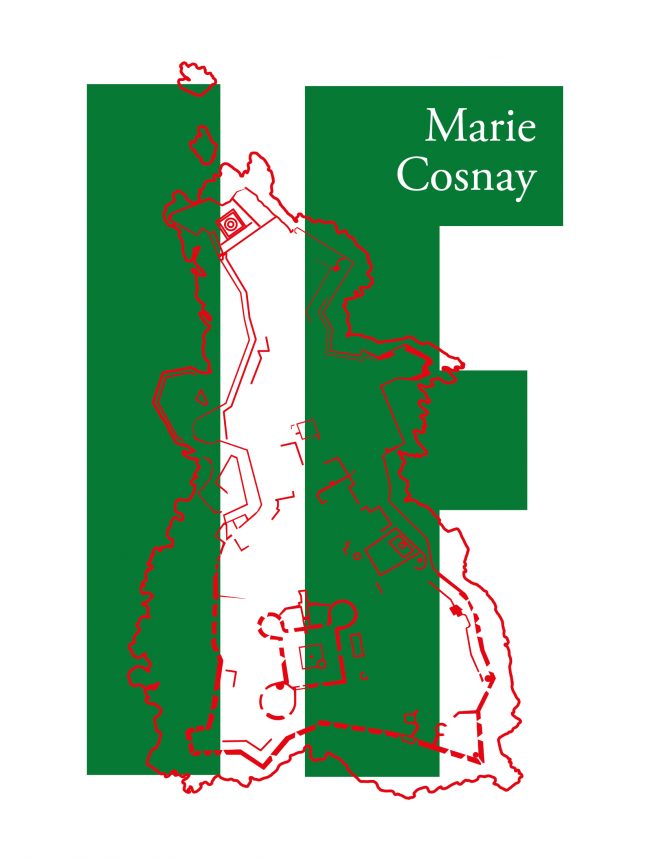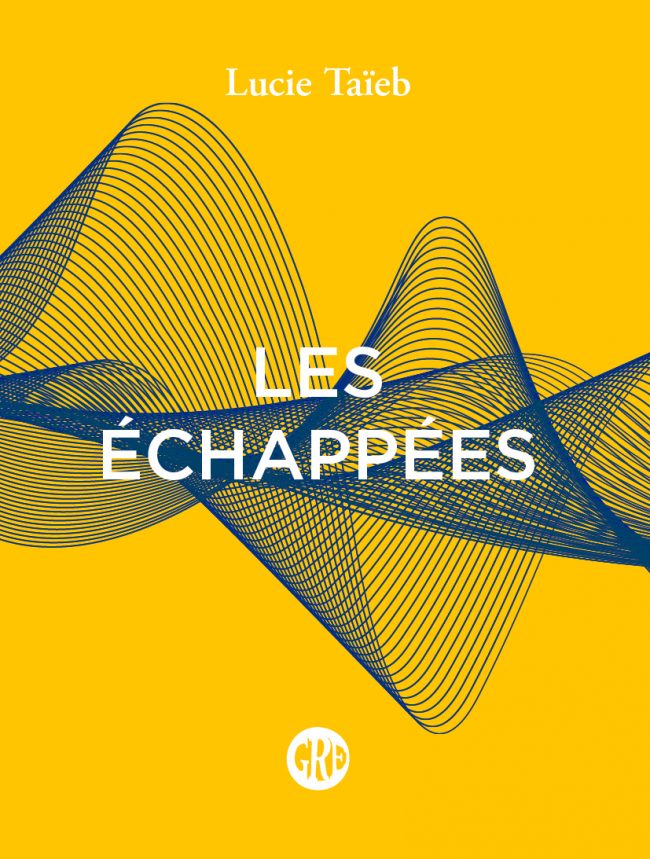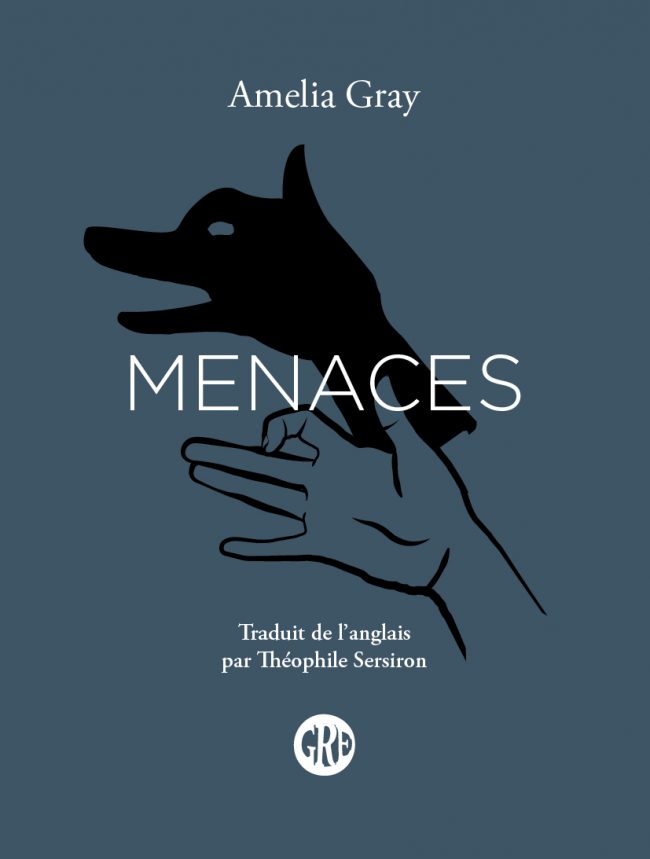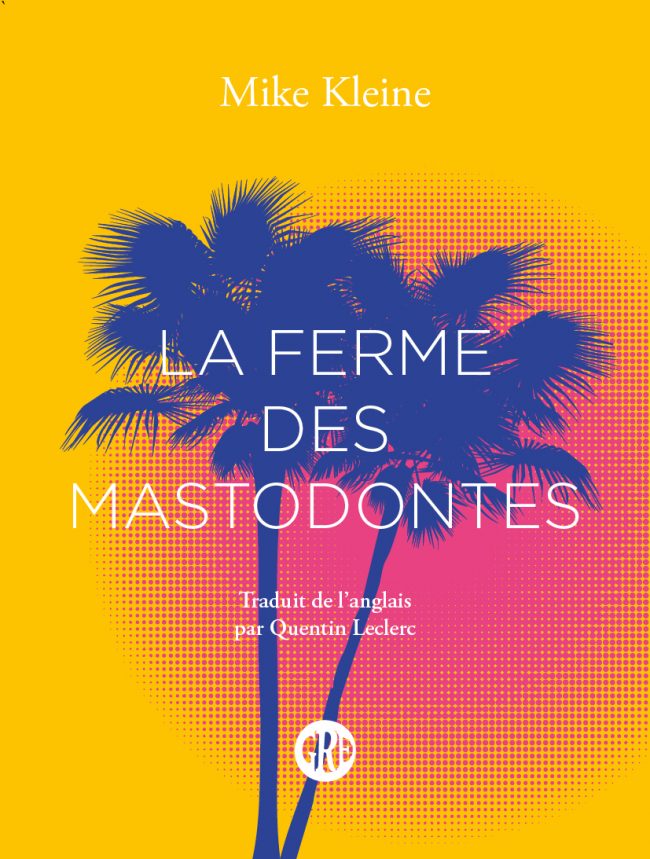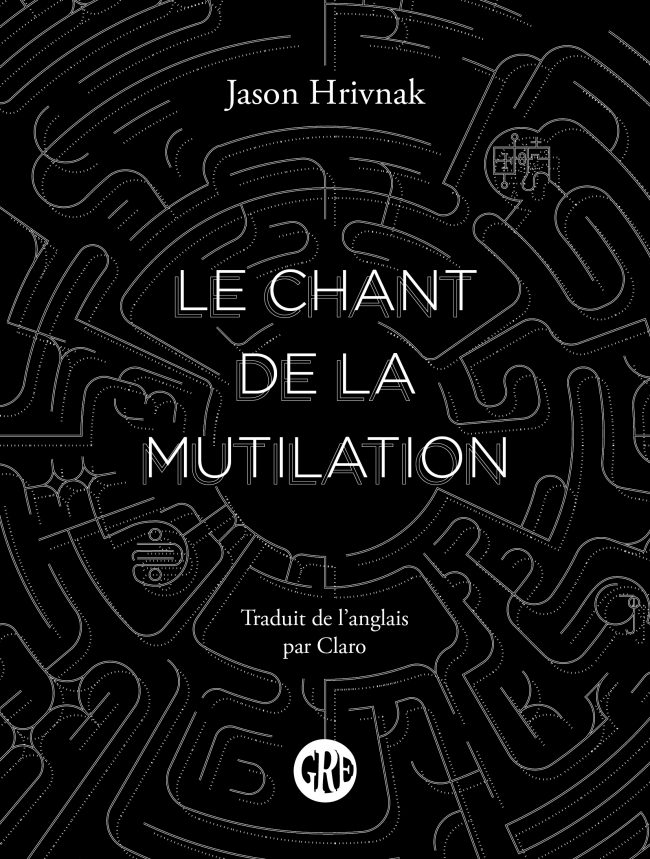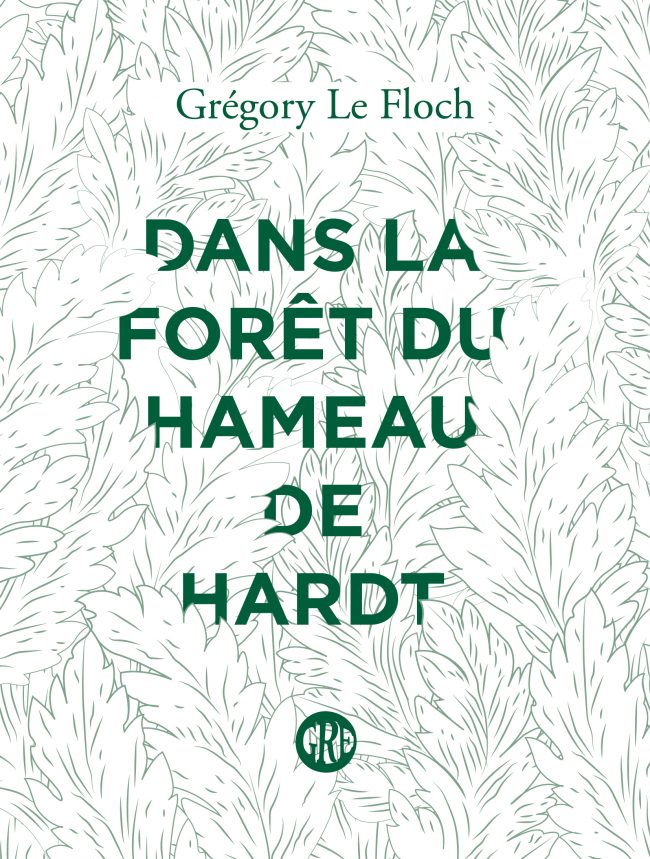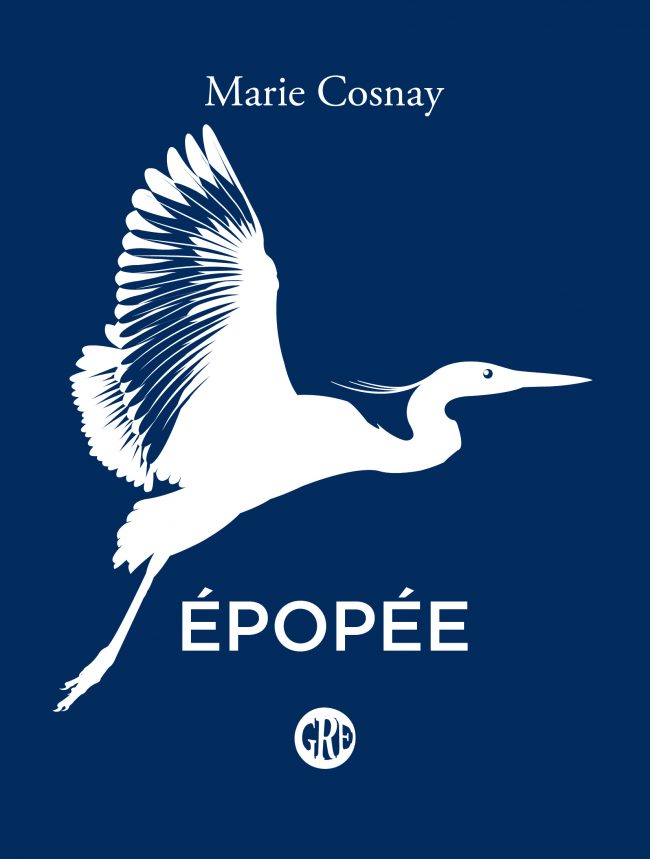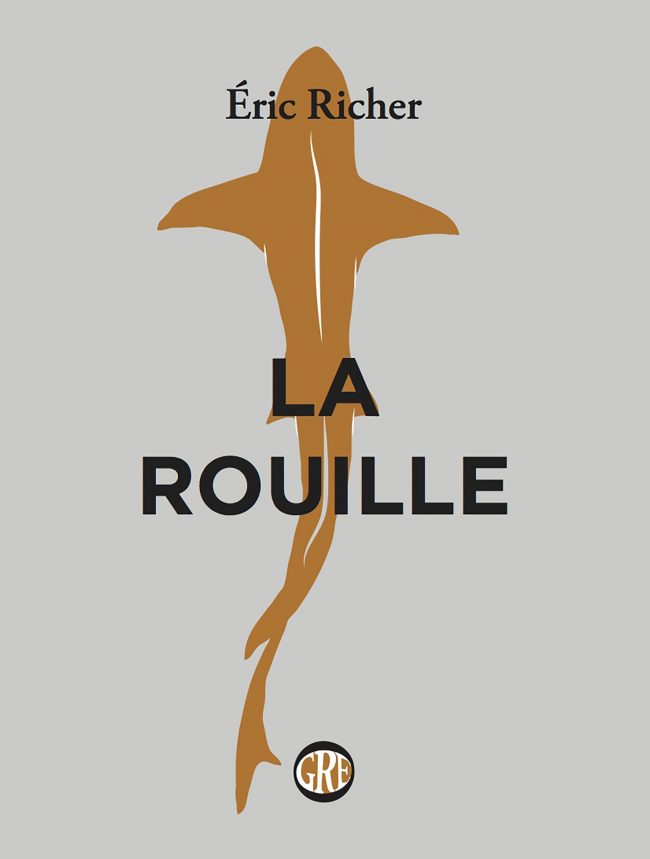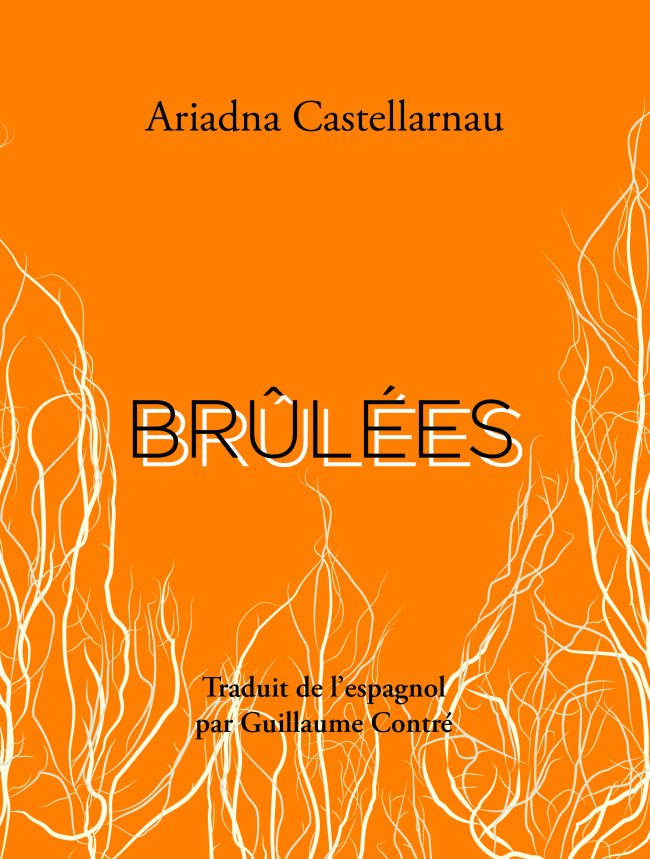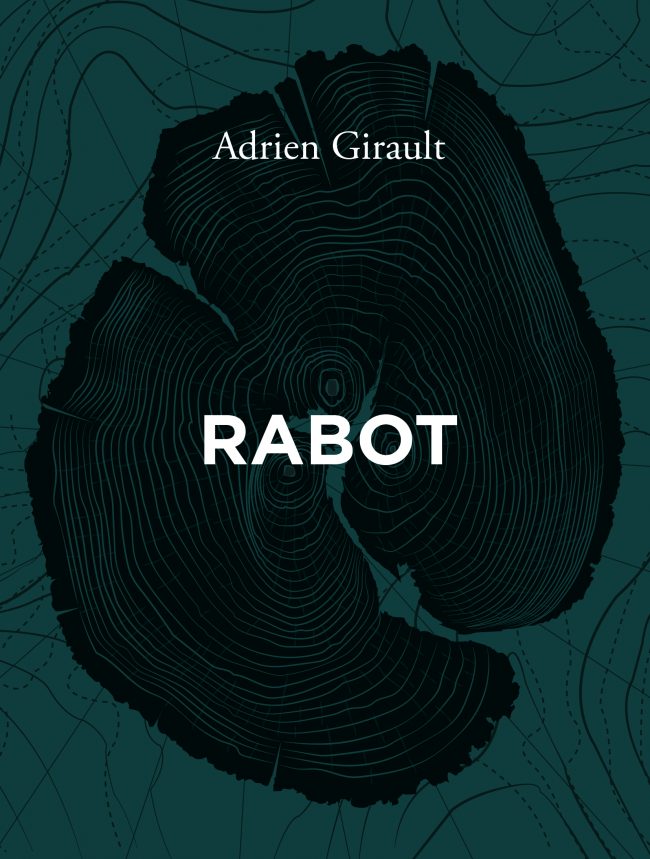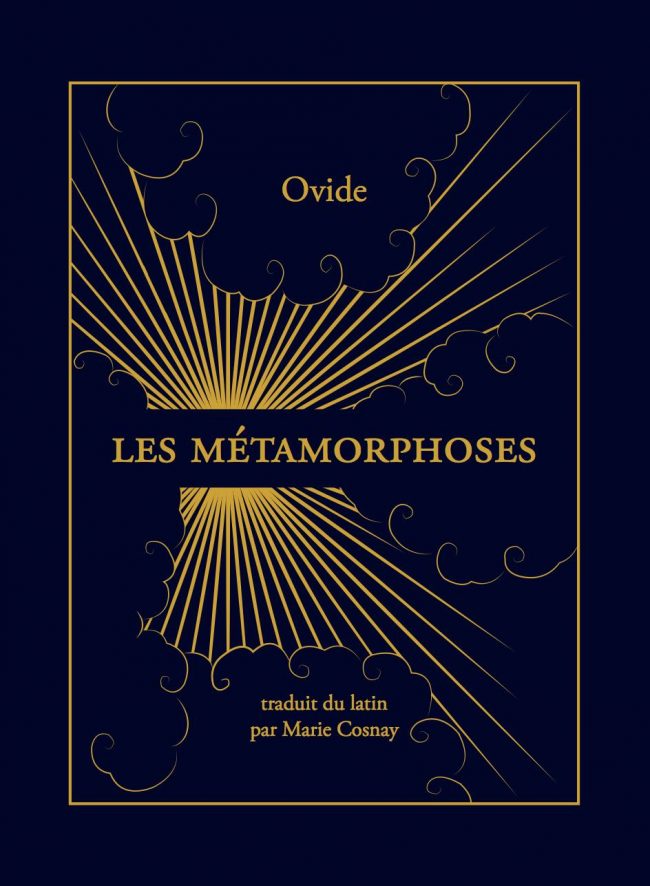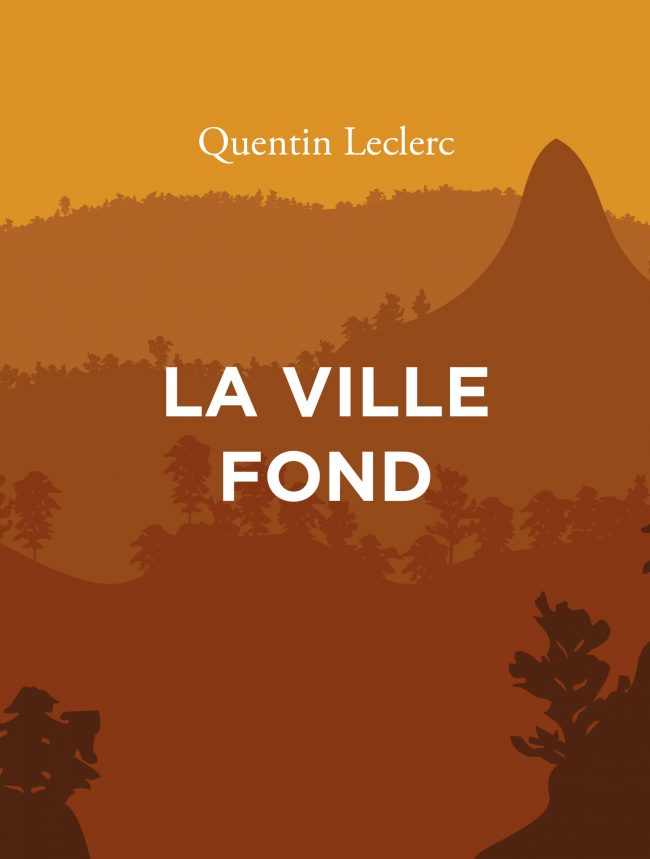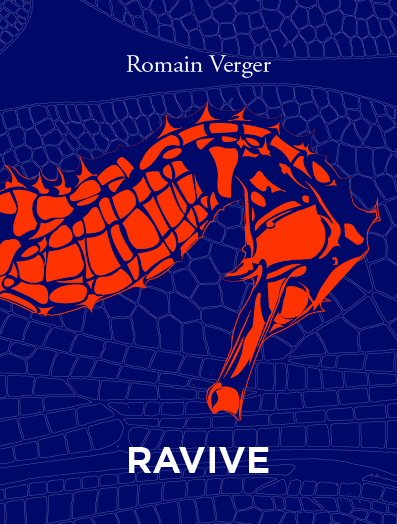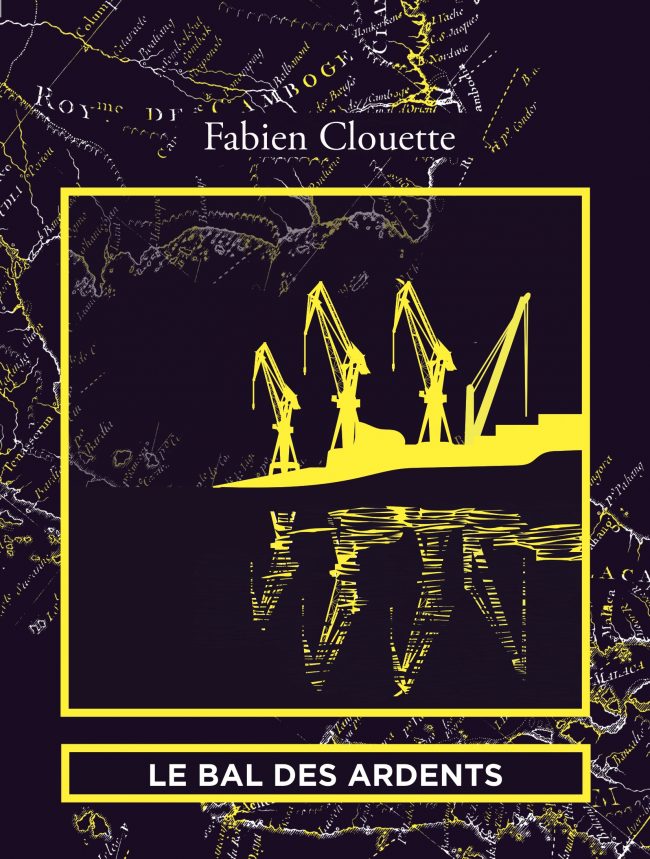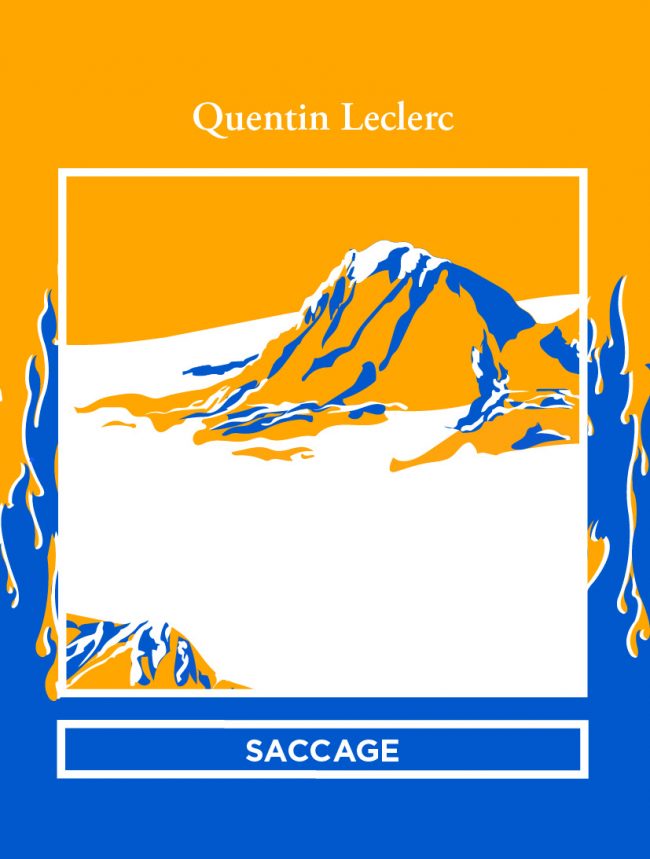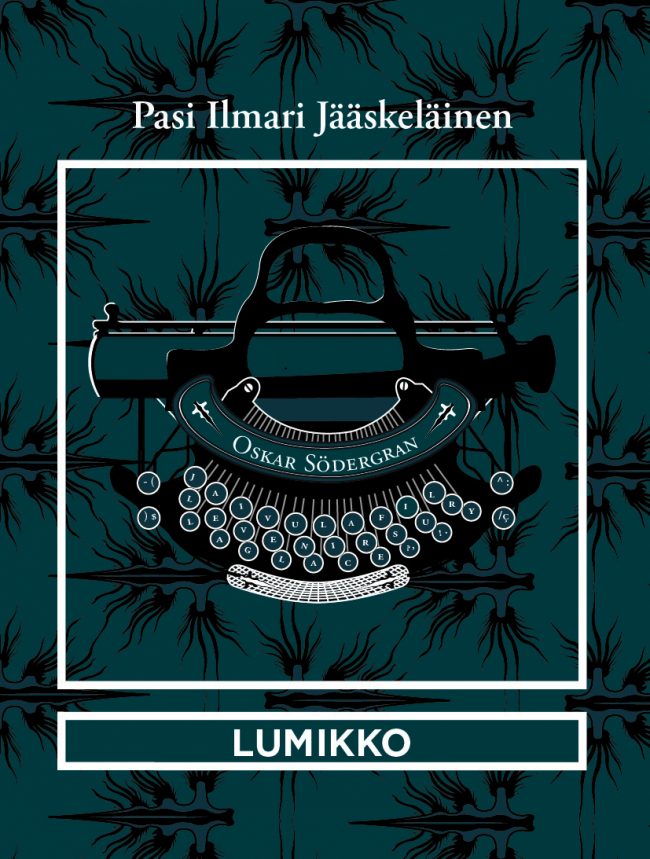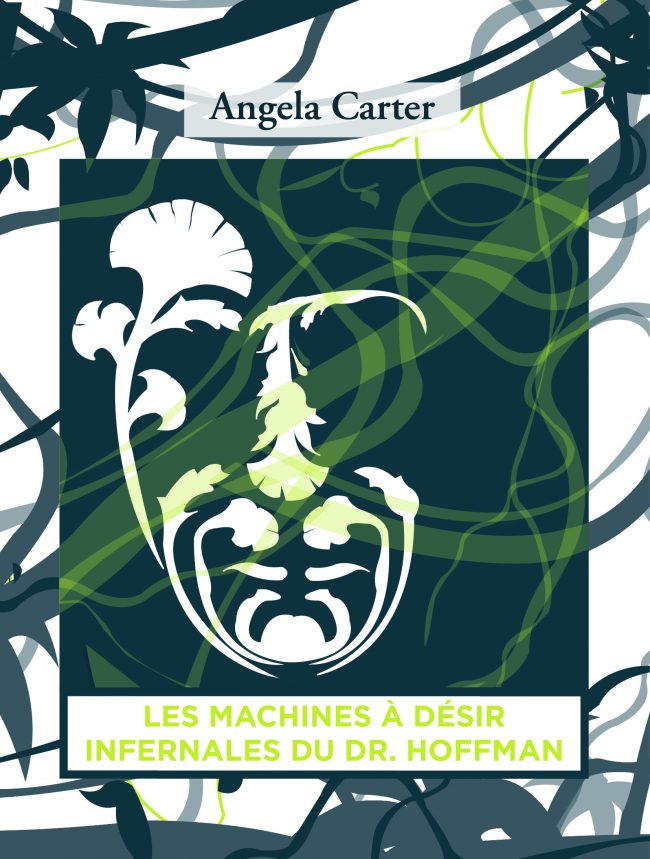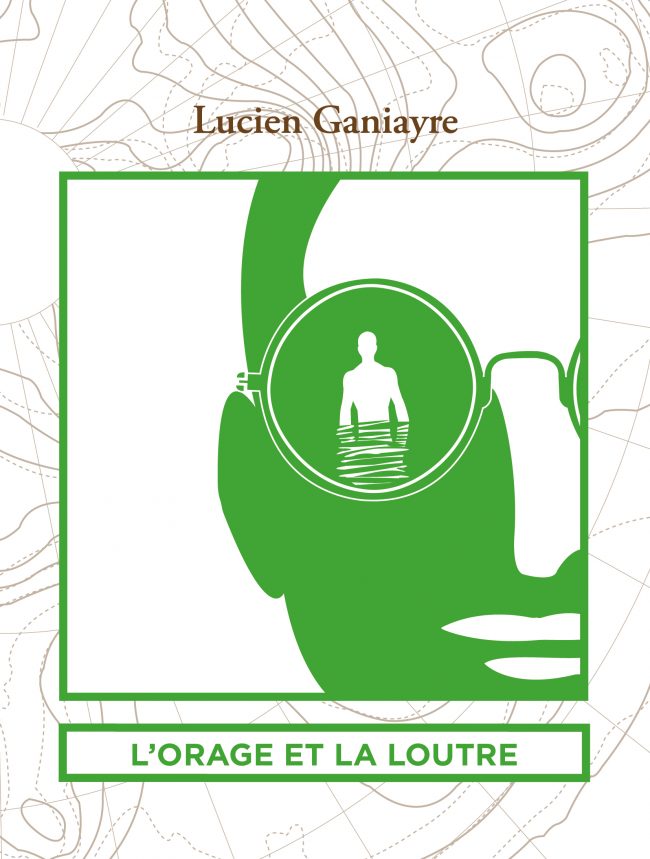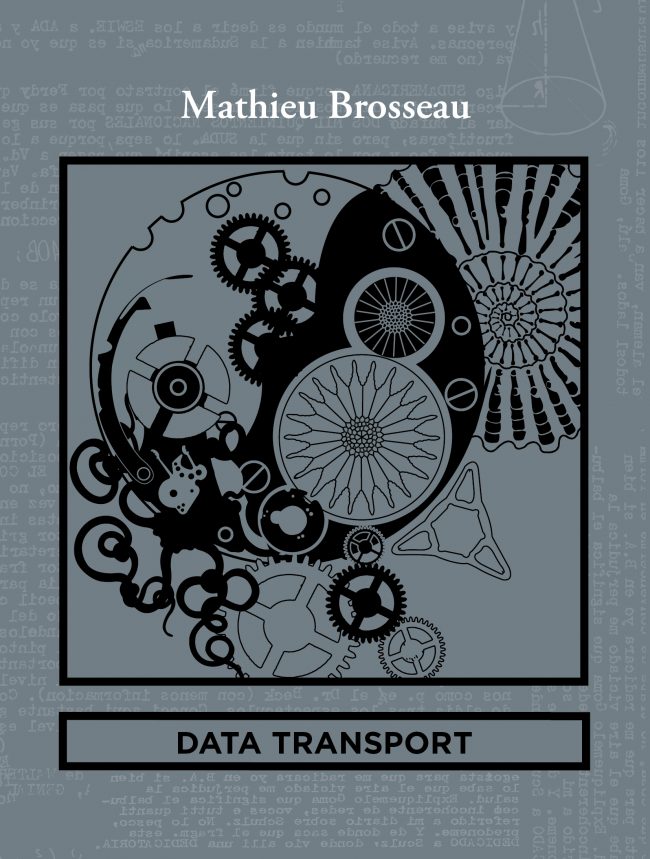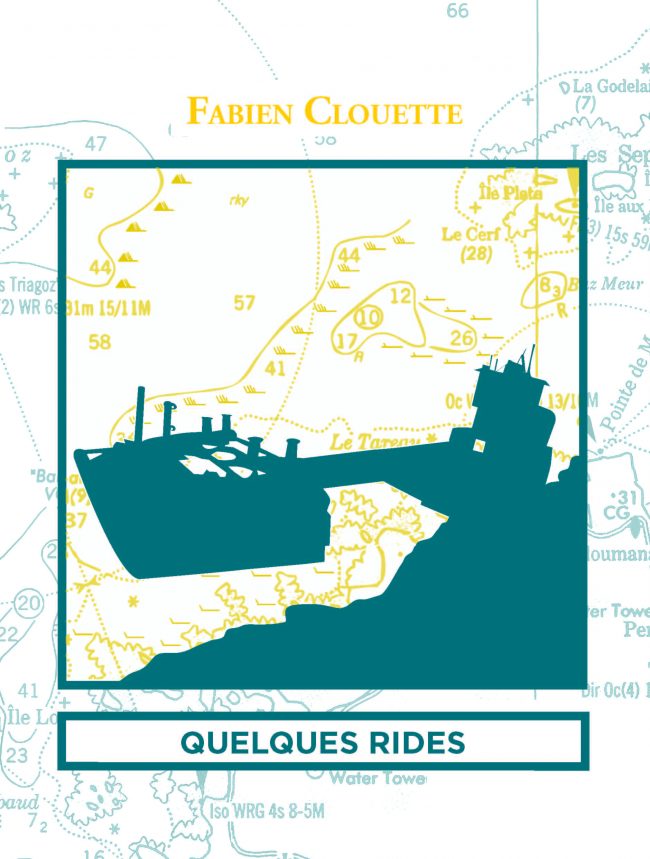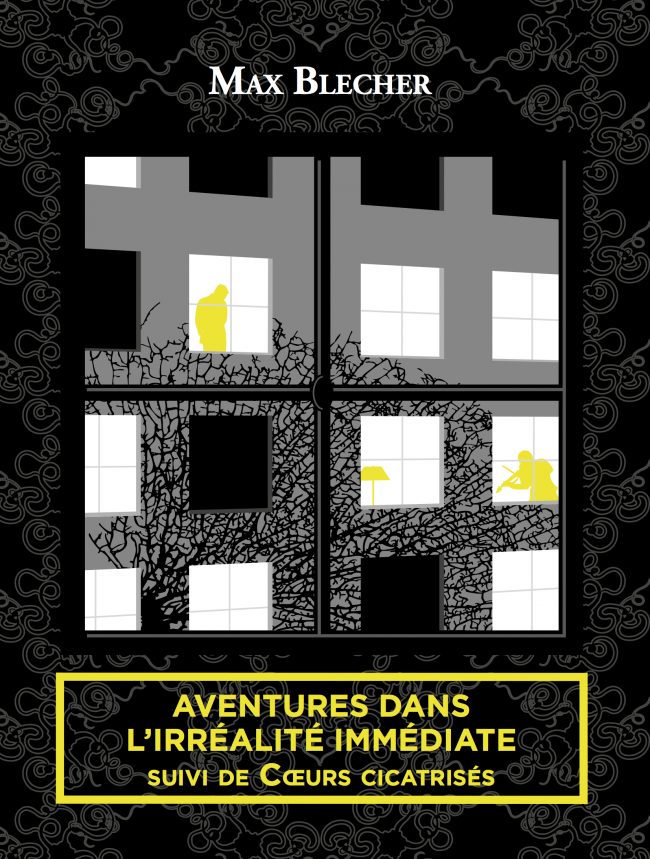Je songe à tout cela en regardant la mer. Et j’imagine l’intériorité de la décapitation comme un théâtre secret où convergent les témoignages de ceux qui ont vu des décapitations et les mots de ceux qui se sont trouvé aux portes de la mort pour finalement survivre. Comme mon frère, pendant une très courte période. Il avait un défaut de naissance au cœur qui s’était aggravé au fil des années et lui avait calcifié une artère. Un matin, alors qu’il faisait des examens cliniques, au cours d’un exercice qui réclamait des efforts, il était tombé par terre, incapable de poursuivre. On l’a ranimé, mais au réveil son regard avait changé. C’était lui sans être lui, l’homme que nous connaissions. Il avait non seulement des yeux mélancoliques et perplexes, mais ils étaient animés d’une intensité particulière évoquant la bonté pétrifiée d’un voyageur revenant de l’autre côté d’un océan monstrueux. Il se concentrait sur quelque chose qui nous échappait.
Il s’est mis à parler de manière obsessionnelle de la lumière qu’il avait vue. Dans sa retraite, il regrettait cette luminosité. Avec qui semblait-il dialoguer en silence ? Il hésitait à un carrefour difficile. Les bons petits plats, le vin qu’il appréciait tant n’avaient plus la même saveur. Il parlait de lui au passé, prenant peu à peu congé de nous. Il avait mal survécu. Ses adieux s’éternisaient et il était stupéfait de ce qui lui arrivait, suspendu entre cet éclat et sa vie déjà annulée. Pour d’autres, c’était un simple inventaire dans lequel il jouait le rôle d’un majordome discret. Le récit de sa découverte de la lumière ultime m’a poursuivi ces derniers temps. Plus de dix ans se sont écoulés depuis sa mort. Nous ne parlons qu’en rêve.
La mer afflue et j’entends le bruit obstiné des vagues sur les rochers. Je perçois la voix d’un enfant qui semble résonner dans mes pensées. Il y a longtemps, nous sommes allés dans cet hôtel avec nos parents. Il s’appelle Le Mirador et se trouve dans la baie d’Acapulco. En bas, non loin de là, s’étendent les hauts rochers qui longent le littoral jusqu’à la grande côte de la Quebrada. Quand le port d’Acapulco a connu ses premiers succès touristiques, cinquante ans plus tôt, des plongeurs au teint hâlé et à la peau luisante d’huile ont commencé à se produire dans un numéro modeste, mais risqué. En chute libre sur quarante mètres, ils se jetaient du haut d’un rocher pour tomber en piqué dans la mer perpétuellement agitée par le ressac. Le bruit joyeux de leurs corps pénétrant dans l’eau me revient à présent. Les touristes applaudissaient et les aides du plongeur qui venait de s’élancer allaient chercher les pièces qu’on leur donnait. Je me rappelle l’odeur de la mer, l’exultation qui planait dans l’air, le sel dans les narines, les poissons qui suffoquaient sur le sable fin et les ragoûts pimentés. La chaleur sur la plante des pieds, la trace des fourmis et la brûlure immédiate sur la peau. Les vieilles barques amarrées aux quais en ruine. Les filets en attente sur le bois noirci par le temps.
Les gens aimables, leur accent qui apportait de la rugosité aux mélodies, la tentation des vagues. Le cri aigu que je retrouve maintenant. Un monde d’écume et de rires, de fête et de fatigue à la fin de la journée. La couverture familière et le lait tiède dans les bungalows ou les petites maisons blanches et bleues louées aux familles pendant quelques jours. Là, l’aube s’éclaircissait.
Le Mirador est bien différent aujourd’hui. La violence s’est installée aux alentours de la Quebrada. Je sors de ma mallette quelques photographies que j’ai emportées avec moi. Je me fais mal à un doigt en touchant maladroitement un fil de métal. Mes parents et mes frères et sœurs sont assis sous cette véranda qui reprend sa place dans mes souvenirs. Aujourd’hui, l’hôtel s’est agrandi et de nombreuses chambres ont été ajoutées sur l’un des côtés. Au-dessus du bureau de la réception trônent encore les horloges murales qui affichent l’heure de New York, Londres, Buenos Aires. Tout cela a des relents d’aspirations mondaines révolues : il y a longtemps qu’Acapulco a cessé d’être la destination de prédilection des étrangers pour devenir un port fréquenté par des touristes mexicains originaires d’autres États. Ils viennent du Michoacán, de Jalisco, Colima, Nayarit, Sinaloa… là où le commerce, le vol et le trafic de drogue ont contribué à l’amélioration de l’économie locale.
Les chefs sont arrivés en premier et se sont installés temporairement dans des endroits autrefois exclusivement réservés aux banquiers, aux industriels, aux patrons d’entreprise. Ville intempestive, propice dès le départ au développement de l’immobilier et aux gros investissements, aux accords
entre pouvoirs licite et illicite, Acapulco était le lieu rêvé pour faire prospérer l’économie idéale et informelle. Un assemblage de luxe et de faim, ainsi que l’a définie un journaliste. Les investissements liés au blanchiment d’argent ont été la plate-forme d’un négoce qui, pour convaincre, laissait le choix entre « l’argent ou le plomb ». Depuis, l’expression a perdu en pertinence car dans les communautés dont les membres sont socialement inégaux, tout le monde préfère l’argent, et ce choix unanime amène la discorde qui répand le plomb et le sang.
Le restaurant du Mirador a bonne réputation. Il y a un buffet au petit déjeuner et une carte variée qui attire les hommes politiques, les chefs d’entreprise, les journalistes. Le terrain sur lequel est construit l’hôtel est tout en dénivelés, il faut descendre un escalier pour accéder à la terrasse avec vue sur la mer. Une odeur d’insecticide et de désodorisant sucré se mêle à celle des plats : œufs et haricots rouges en sauce, tortillas de maïs, lard grillé, jus de papaye et de pastèque. Des tables montent les conversations animées d’hommes en chemises blanches ou bleues et en mocassins, de femmes en chemisiers à fleurs et en jupes longues ou courtes, en sandales ou en escarpins. La musique d’ambiance incite à élever la voix. Les hommes et les femmes de pouvoir et d’argent qui règnent sur la ville portent des montres ou des bracelets en or et parlent dans un murmure, échangent des gestes amicaux, respectent les règles de la parcimonie mutuelle.
Le Mirador a été construit dans ce qu’on appelle l’Acapulco traditionnel, un quartier à l’urbanisme précaire, à mi-
chemin entre les travaux qui s’éternisent, la pauvreté et l’incurie. Il est à la fois coloré et peuplé de gens qui luttent pour survivre. Les rues escarpées et étroites sont souvent embouteillées par des voitures et des camions dont les conducteurs exaspérés, las de leur propre situation, appuient avec colère sur le Klaxon ou mettent à plein volume une musique dont l’effet apaisant est pour le moins contestable : hip-hop sur un rythme de cumbias ou de vallenatos colombiens, airs antillais retravaillés dans un style techno, ballades geignardes, musique régionale de Sinaloa avec tuba et voix de fausset en contrepoint. L’eau potable se mêle à celle des égouts pour s’infiltrer dans les trottoirs et la chaussée fendillés. Dans les boutiques s’étalent des vêtements multicolores importés de Chine et autres produits de contrebande : bijoux, copies pirates de films et de disques. Les académies et écoles de commerce ou d’informatique sont légion dans une ville à la population jeune. Les cantinas, discothèques, maisons de passe bruyantes abondent, de même que les néons rouges, la bière pour dix servie dans un seau rempli de glaçons, les fulgurances de la lumière stroboscopique, qui donnent une apparence intermittente à la rapidité et changent le monde sensible en univers narcotique. Si Acapulco a commencé par être un paradis cosmopolite réservé aux étrangers et aux Mexicains qui pouvaient se le permettre, la ville a désormais renoué contact avec la jungle au rythme de la culture de masse.
Le directeur d’un quotidien local me raconte qu’Acapulco a cessé d’être l’endroit enchanteur qu’il était un demi-siècle plus tôt, lorsque les stars hollywoodiennes comme Orson Welles,
John Huston, Rita Hayworth, Johnny Weissmuller, Ava Gardner, Frank Sinatra, l’actrice mexicaine María Félix, John et Jacqueline Kennedy ou le magnat du pétrole J. Paul Getty s’y rendaient. Elvis Presley est venu pour le tournage du film L’Idole d’Acapulco (1963). La montée du communisme à Cuba, la fermeture de l’île en tant que terre de jeu et de libertinage a permis au port mexicain de connaître un formidable essor. De grandes chaînes hôtelières, des restaurants, des boîtes de nuit et des lotissements de luxe s’y sont installés.
Pendant que nous roulions le long de l’avenue Costera, cet homme m’a montré les hôtels construits en bord de mer, où l’on ne décèle pas une grande activité. « Le taux d’occupation des chambres est quasiment nul, m’explique-t-il. La violence a tué Acapulco. C’est le trafic de drogue qui fait vivre la ville à présent. Ce sont les narcos qui investissent et sont devenus les maîtres. » Il me dit que la prostitution est une source essentielle de travail pour les jeunes les plus démunis, puis se tourne du côté des montagnes, derrière la baie, et désigne les quartiers marginaux. Je lui dis qu’on m’a décrit des lupanars ambulants dans ce type de zone. Ce sont des camions où l’on peut boire de l’alcool en regardant des danseuses nues se tortiller autour d’un poteau métallique, au son d’une musique tonitruante. C’est Bangkok en miniature, le véhicule cahoté par des coups de frein au milieu des nids-de-poule dans les rues escarpées. « Ce n’est pas ce qu’il y a de pire », me fait-il observer avant de garder le silence. Comme dans d’autres centres touristiques du pays, on exploite sexuellement des enfants. Des milliers d’enfants. Les prostituées, même mineures, sont aussi bon marché que le gramme de cocaïne (dix ou vingt dollars).
En contrebas de la cathédrale, dont le parvis fait face à la route qui longe la baie, les saints et les vierges bayent aux corneilles devant l’absence de paroissiens. Les fleurs se fanent dans les vases. Des garçons en bermuda et en tongs distribuent les tracts d’une pizzeria qui vient d’ouvrir ses portes. Je me dirige vers le Mirador et fais exprès de marcher sur une tache violacée, pratiquement effacée, qui m’évoque le sang d’un fonctionnaire du gouvernement local, assassiné devant l’hôtel quelques jours plus tôt. Il était 8 heures, il s’apprêtait comme tous les jours à prendre son petit déjeuner quand deux hommes l’ont criblé de balles de 9 mm. Plus d’une dizaine de tirs ont atteint les vitres et les portières de son véhicule. Des éclats de verre et de métal jonchaient le sol. La victime a couru, blessée, en bredouillant des appels à l’aide, et elle est morte devant la porte de l’hôtel. Je reviens sur mes pas et tente de déceler des traces de sang pour me représenter la scène du crime. Mais tout a été effacé. On meurt pour être aussitôt précipité dans l’oubli. Apparemment, c’est comme ça sur la côte. Partout.
Ce meurtre fait partie d’une série de crimes qui, jusqu’au jour d’aujourd’hui, se poursuit à Acapulco. Les victimes sont des délinquants, des policiers, des fonctionnaires, des chefs d’entreprise, un journaliste, des agents des services de renseignements. La guerre des trafiquants de drogue a atteint son point culminant avec l’apparition de décapitations et de corps découpés en morceaux. Ce qui relevait du secret entre bandes rivales s’est alors transformé en défis explicites étalés au grand jour. Il y a eu une vague de cadavres sur lesquels on laissait des mots, une autre où les corps seuls constituaient les messages. Après deux crimes sur la Costa Grande, les tueurs sont allés jusqu’à conseiller aux gens de renoncer aux vitres teintées afin d’éviter toute confusion. Intoxiqués par leurs propres ténèbres, les maîtres de la nuit sont incapables de se reconnaître entre eux.
Acapulco et tout l’État de Guerrero, qui doit son nom à un héros indépendantiste président du pays, est une terre sauvage et violente. Avant Cortés, on l’appelait Cihuatlán, « le lieu proche des femmes », en nahuatl, et différentes tribus la peuplaient, comme les Purépechas, les Chontales, les Mixtèques. Et les Yopes, toujours insoumis et presque tous exterminés par les Espagnols au xvie siècle. Quand le Mexique est devenu une colonie espagnole, Acapulco était une zone de transit du commerce en provenance de Chine et des Philippines sous domination espagnole. L’État de Guerrero est un territoire montagneux dont les zones fertiles contrastent avec les étendues chaudes et semi-désertiques du Sud. La ville coloniale de Taxco était autrefois importante. Elle a vu naître Juan Ruiz de Alarcón, écrivain de mérite qui, au Siècle d’or, fut l’objet des railleries de ses contemporains Francisco de Quevedo ou Pedro Calderón de la Barca, parce qu’il était invalide, bossu, roux, originaire de Nouvelle-Espagne. À l’époque coloniale, les esclaves africains y étaient débarqués. Au milieu des années 1920, le port d’Acapulco, qui pendant des siècles n’avait été qu’un village, devint le premier lieu du pays où se développa le tourisme à grande échelle. L’argent, la renommée, les légendes furent concomitants à l’arrivée des visiteurs.
Tout au long du xxe siècle, le littoral pacifique mexicain et sa population sont restés étrangers à l’avancée du progrès dans le reste du pays. Les États d’Oaxaca, Guerrero, Michoacán, les côtes de Colima, Jalisco, Nayarit, Sinaloa et Sonora répondent à un modèle de développement différent. Ils sont davantage tournés vers leur passé et leur milieu naturel, moins enclins à être séduits par le prestige cosmopolite, sauf pour des raisons commerciales. Ce qui fait l’objet de leur fierté nationale est quasiment resté intouché au fil des ans. Leurs habitants assument leurs origines et les arborent comme l’emblème d’une nationalité forte et personnelle, peu soucieuse des apports extérieurs. Les traditions communautaires ont à peine été transformées par les progrès techniques et les médias. La violence, dernier avatar de ce sentiment d’appartenance, a été partagée par le pouvoir central et régional, ainsi que par les puissants groupes en marge des institutions qui leur sont liés, qu’il s’agisse de la guérilla de gauche ou du crime organisé. Les guérilleros qui n’ont pas péri par balle ont été torturés jusqu’à ce que mort s’ensuive, parfois jetés d’un avion près d’une côte ou dans une lagune, à moins que leurs corps n’aient été précipités au fond d’un ravin ou d’un puits pour ne pas laisser de traces, là où personne n’entend, nul ne sait.
Il y a quarante ans, sur le littoral pacifique, l’État a déclaré sans grande véhémence les hostilités contre deux ennemis : les guérilleros en mal d’une révolution communiste et les cultivateurs de marihuana de l’État de Guerrero. Les militaires en charge des opérations ont fini par s’impliquer dans le trafic de drogue. Le littoral comme les terres montagneuses de l’intérieur sont couverts de cultures de chanvre et de pavot. Dès la première moitié du xxe siècle, l’exploitation de la gomme d’opium a servi tant à fournir l’industrie pharmaceutique que les consommateurs d’opium nord-américains.
Dans mon enfance, le pavot était cultivé dans certains jardins comme plante d’ornement. Je me rappelle avoir vu ma grand-mère maternelle s’occuper à Tlaltenango de fleurs qui poussaient à l’état sauvage, près d’une ferme, au milieu de goyaviers, de sapotiers, d’orangers et de grenadiers. Située dans la banlieue de Cuernavaca, Tlaltenango est l’une des nombreuses localités qui longent la route menant du centre du pays jusqu’à Acapulco. C’est là qu’est arrivé Hernán Cortés peu après avoir fait la conquête de Tenochtitlan, là aussi qu’a été construit le premier moulin à canne à sucre de toute l’Amérique, dont il reste une voûte et quelques ruines près desquelles se trouvait la propriété de ma grand-mère, une maison simple, de plain-pied, avec un patio s’ouvrant sur un jardin humide et chaud qui descendait jusqu’à un ravin. Les anciennes écuries, m’avait-elle dit, avaient été érigées sur les décombres de cette sucrerie. Cortés avait foulé cette terre. Dans la maison haute de plafond et peu meublée de ma grand-mère, le tic-tac d’une grosse pendule en bois rythmait sa vie silencieuse de métisse de petite taille à la peau couleur cannelle et aux cheveux divisés en deux tresses poivre et sel. Quand nous allions à Acapulco, nous nous arrêtions à Tlaltenango. Je ne cesse de retracer dans ma mémoire les trajets de mon enfance et revis tour à tour la curiosité, l’angoisse, le plaisir, la peur, les crépitements de cette route le long du Pacifique. Un soir, à Tlaltenango, mon frère m’a montré la date inscrite sur la voûte de l’ancien moulin à sucre, des chiffres romains gravés dans une pierre poreuse, volcanique, d’une teinte de sang coagulé : 1527. Telle est la date dont je me souviens. Il m’a pris par la main et nous avons gravi un escalier en bois construit contre l’un des anciens pignons, qui nous a conduits en haut de l’arche. Nous avons marché sur cette construction aux fissures remplies d’herbe. Elle ne s’élevait qu’à douze ou quinze mètres du sol, mais c’était suffisant pour me faire éprouver une première sensation de vertige – l’acrophobie ou appel du vide –, un nœud dans la gorge mêlant panique et fascination devant l’abîme.
Ma grand-mère, Andrea Rodríguez Villalpando, se chargeait de l’entretien de la chapelle de Tlaltenango, qui date elle aussi de l’époque de la conquête. Elle nous laissait monter sur la terrasse d’où l’on voyait les créneaux et la tour ramassée du clocher. Ma vue se perdait dans les montagnes, l’orographie accidentée et verdoyante. Dans le style des églises bâties sur le Nouveau Continent à l’époque de Cortés, la chapelle a été conçue comme un lieu de prière familial. Sur le demi-niveau réservé au chœur trônait un orgue à soufflet hors d’usage qui somnolait dans la poussière et les toiles d’araignée. Un Christ qui sentait l’encens et les broussailles dominait l’autel. Mon grand-père cultivait des fleurs, des légumes et des fruits qu’il allait parfois vendre dans la capitale. Pendant les années de lutte armée des indigènes contre le gouvernement, au début du xxe siècle, il avait été enrôlé dans les rangs des insurgés commandés par Emiliano Zapata, qui lui avaient pris les dizaines de pièces d’or et d’argent qu’il conservait dans des boîtes de conserve, sous son lit. La sœur aînée de ma mère, alors âgée de cinq ans, était morte de frayeur devant la violence de la soldatesque. Elle est la tante que je n’ai jamais eue. Une photographie sépia montre les quatre membres de la famille avant la tragédie. La petite morte s’appelait Leónidas, le même prénom que deux héros décapités : l’un spartiate, l’autre chrétien. Sur ce cliché, elle est recroquevillée et touche la dentelle de sa robe blanche, éloignant à jamais son regard du monde des vivants. J’ignore combien de temps a passé mon grand-père dans cette armée de fortune. Ni lui ni ma grand-mère n’évoquaient jamais ces années, dont il ne reste que quelques échos dispersés au cours d’une conversation. Elle nous parlait d’une époque plus lointaine qui remontait à son enfance, ou de ses séjours dans la capitale, de la silhouette du président de la République vainqueur de l’armée française, qu’elle avait vue lors d’un défilé. Elle préférait se remémorer l’ordre et la sérénité, évitait de mentionner des faits de sang ou des abus en présence d’enfants. Elle nous racontait des histoires légendaires d’apparitions à cheval dans les rues pavées, en quête d’une vengeance, après minuit. Ma mère assise à ses côtés, elle pleurait, serrant son mouchoir dans sa main, et parlait dans un murmure. Ses larmes m’ont toujours intrigué. J’ignore pourquoi elle pleurait. Seul résonne à mes oreilles le soupçon d’une douleur profonde, tellurique, sauvage. Chaque fois que j’entends une femme sangloter, c’est ma grand-mère qui pleure.
Les lamentations liées à la perte ou à l’offense précèdent la voix du pleureur. La main droite de mon grand-père était privée d’une partie de son annulaire. Dans notre petit cercle d’enfants, nous croyions à l’explication que nous avait donnée un adulte : cette blessure datait de la guerre civile. Une balle lui avait amputé le doigt. De nombreuses années s’écoulèrent avant qu’une autre histoire me soit révélée : les insurgés qui l’avaient emmené avaient l’habitude de trancher un doigt à ceux qui leur résistaient.
À la mort de ma grand-mère, nous avons cessé d’aller à Tlaltenango. Le petit village sur la route de Cuernavaca et du Pacifique a été absorbé par la ville. La maison de ma grand-mère a été prise d’assaut par des membres de la famille. Je suis parfois allé dans la région pour rendre visite à des amis, mais je ne suis plus jamais retourné à Tlaltenango.
Il y a quelques années, une amie qui habitait Cuernavaca a épousé un médecin proche du gouverneur de l’époque, dont le fils passait son temps à s’amuser et séduisait les jeunes filles qui fréquentaient ses fêtes, véritables orgies d’alcool, de marihuana et de cocaïne. Un soir, il s’est enfermé dans la salle de bains avec une fille qui a été retrouvée morte le lendemain. On a contacté de toute urgence le médecin de confiance du gouverneur – le mari de mon amie – pour qu’il constate le décès. La famille de la victime a dénoncé une manœuvre mensongère visant à épargner la prison au violeur et à l’assassin de leur fille. La police a couvert le délit, les autorités ministérielles ont fait obstacle à la justice.
La famille du gouverneur est intouchable. La ville accueillait alors les plus gros trafiquants de drogue du pays ; l’un d’eux possédait même une maison juste à côté de celle du gouverneur ! L’arrivée de ces criminels s’est généralisée et, avec elle, la consommation de cocaïne et de marihuana, les affaires louches et autres commerces illicites, les enlèvements, l’extorsion, la corruption. Le mari de mon amie a été assassiné dans les jours qui ont suivi le meurtre par un tueur qui lui a tiré dessus alors qu’il attendait dans sa voiture une personne avec qui il avait rendez-vous. Il était de toute évidence tombé dans un piège qu’on lui avait tendu afin de se débarrasser d’un témoin gênant. La police a maquillé le meurtre en règlement de comptes, diffamant l’image de cet homme. L’assassin court toujours. À Cuernavaca, les concerts, les représentations de théâtre ou de danse, les conférences littéraires se sont multipliés. L’ancien gouverneur et son fils s’affichent encore aujourd’hui, tout sourire, dans les restaurants de la capitale. Parfois, le père écrit dans les journaux des articles sur l’importance du respect de la loi.
La route qui relie la capitale à la côte pacifique est celle que préfèrent les militaires, les policiers et les délinquants pour y abandonner les corps de leurs victimes, laissés à découvert pour que les vautours et les chiens se chargent de les faire disparaître, ou glissés dans des barils remplis de ciment. Il y a plusieurs dizaines d’années, des opposants politiques ont été assassinés là. Aujourd’hui, des croix de fer honorent leur mémoire. Le chemin qui mène au Pacifique est lourd de mauvais présages.
Ces vingt dernières années, au Mexique, les activités des trafiquants de drogue devenant plus visibles qu’auparavant, l’utilisation des corps comme messages s’est développée. Avant, ce commerce illégal demeurait silencieux et obscur, mais de nos jours, sa violence a donné naissance à des usages et même à des rites utilisant le sang des victimes. Des femmes à qui on arrache un téton en les mordant ou dont on découpe un bout de peau en forme de triangle. Des cadavres jetés dans une fosse, aspergés d’un mélange de chaux et d’acide qui accélère la décomposition. Des gens assassinés d’une balle dans le front, l’oreille ou la bouche, pour désigner respectivement un traître, un témoin indiscret ou un mouchard. Depuis peu, on inscrit sur le front des victimes la lettre « Z », signature d’une bande de délinquants qui ouvrent la trachée du mort pour en faire apparaître la langue et pratiquent ainsi une forme d’exécution appelée « cravate colombienne ». Il y a aussi le « four », qui consiste à dépecer les corps et à jeter les restes dans un récipient rempli de pétrole auquel on met le feu. On peut également « fumer le mort » après avoir bourré une pipe de cocaïne et de cendres de la victime. On profite par ailleurs d’Internet pour y faire circuler des menaces entre bandes rivales qui se lancent des défis, vantent leur virilité ou raillent celle de leurs adversaires. Sur Internet, on expose des vidéos de meurtres et de décapitations sauvages. C’est la panique extensive.