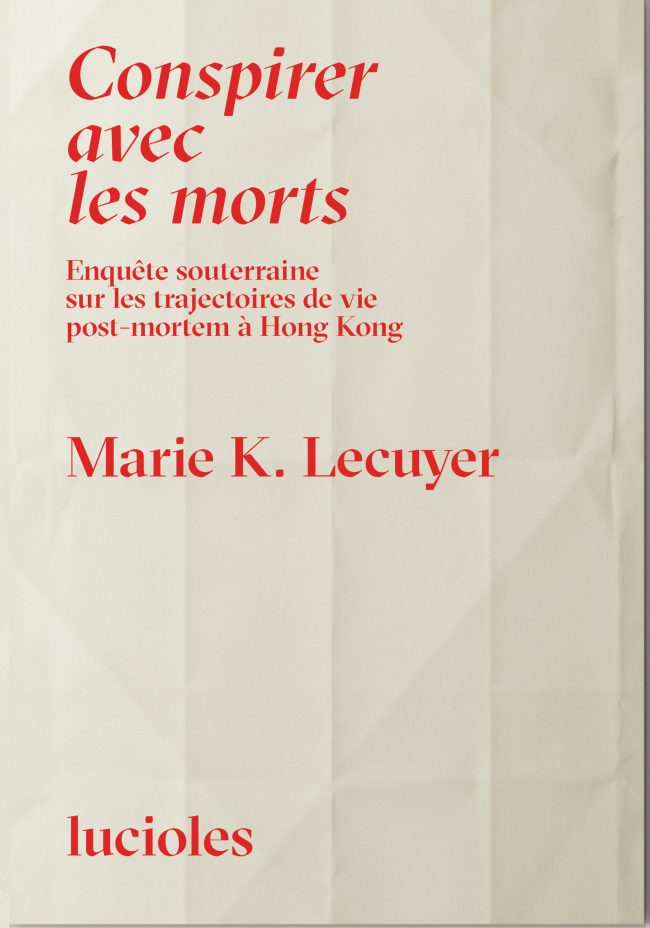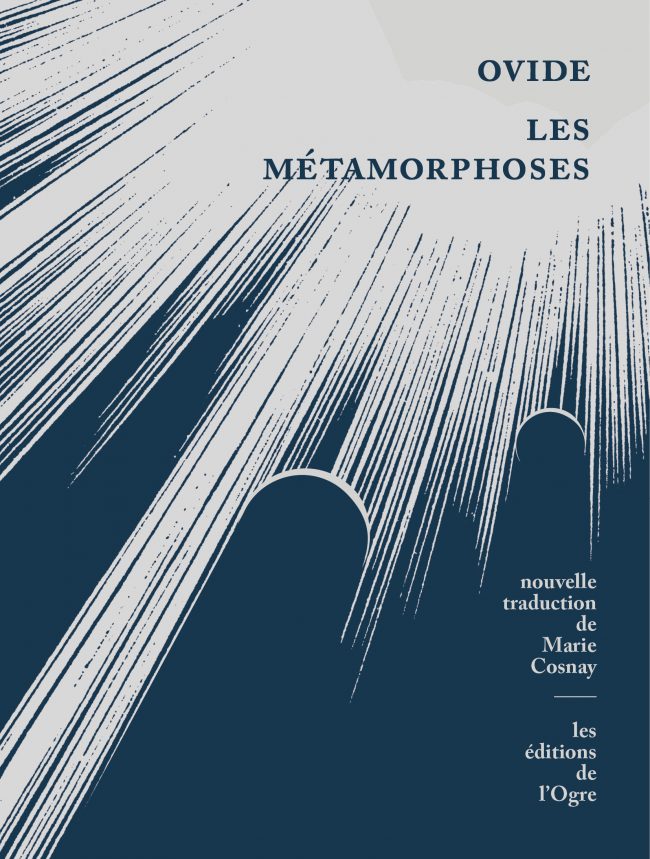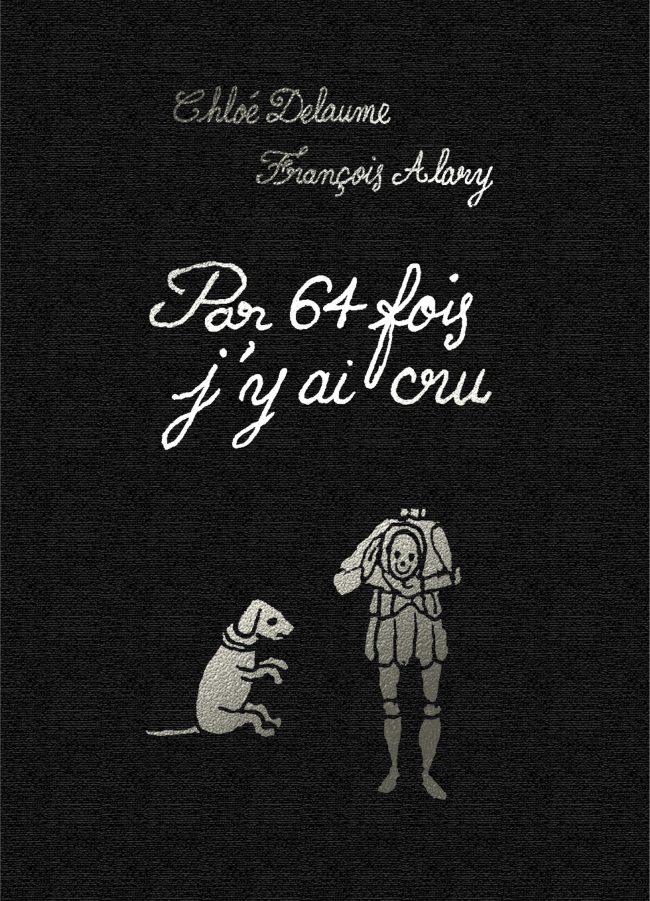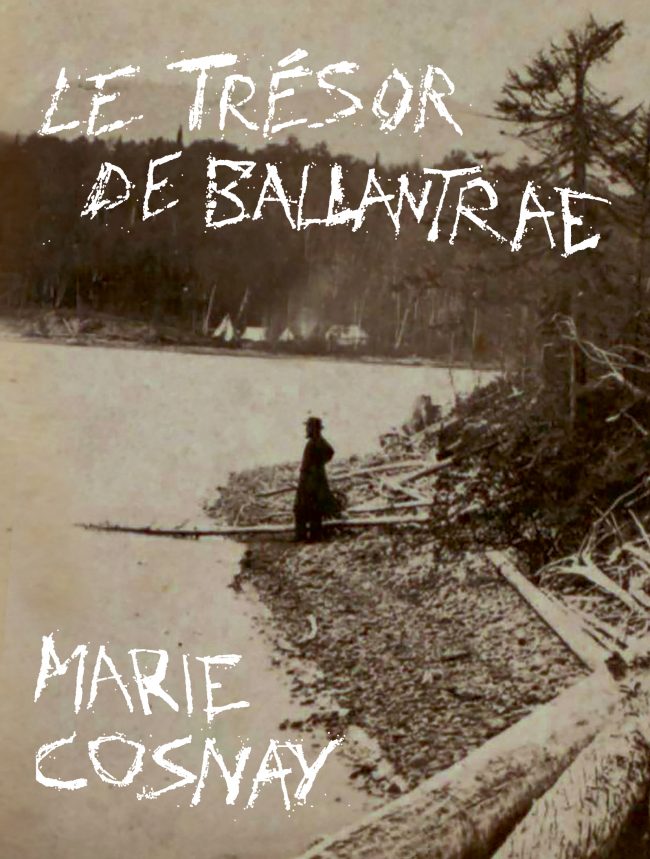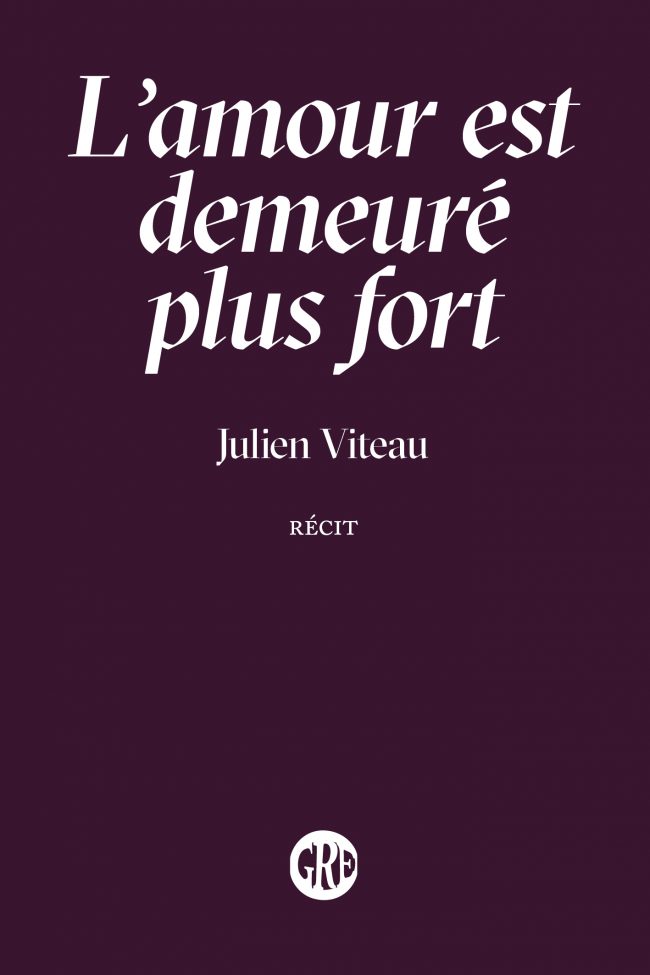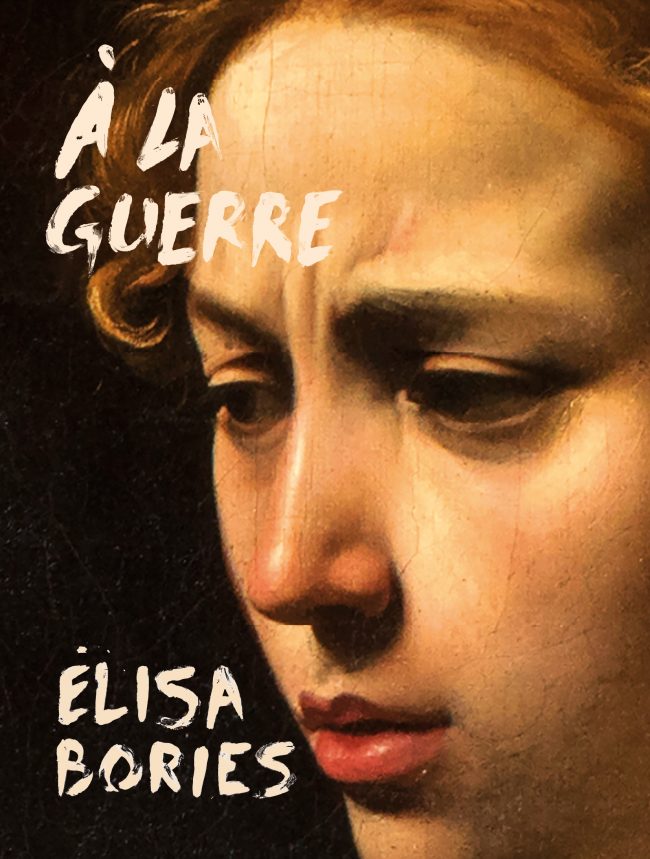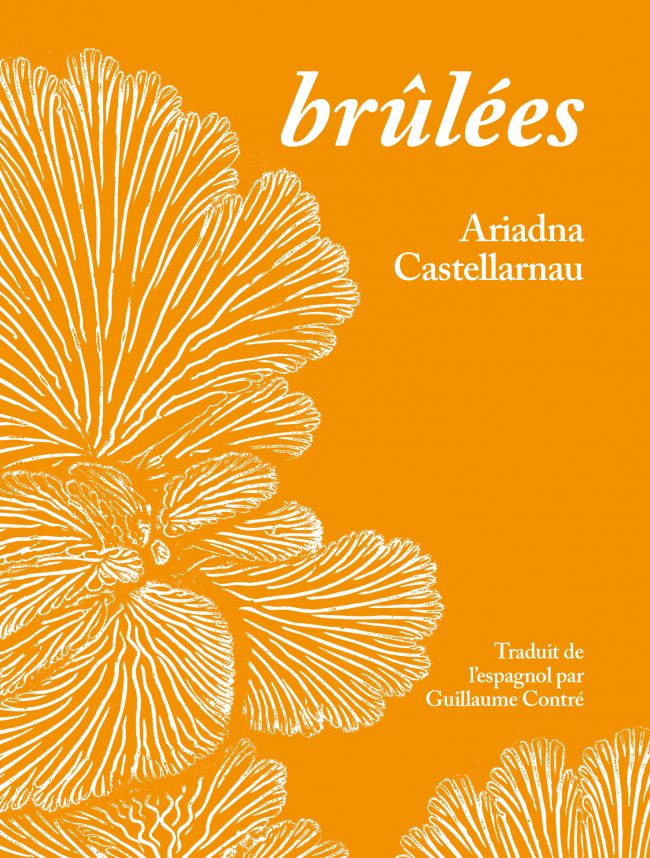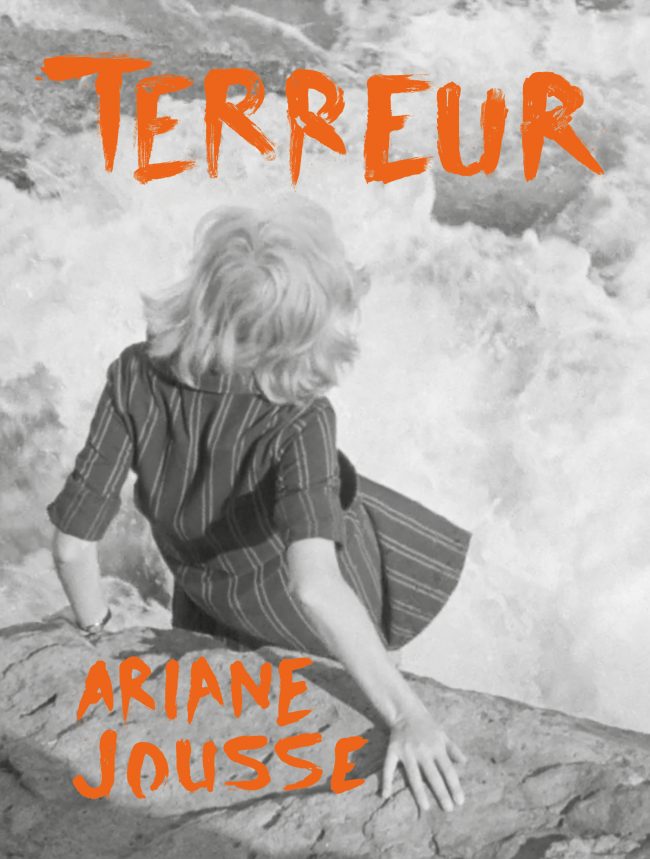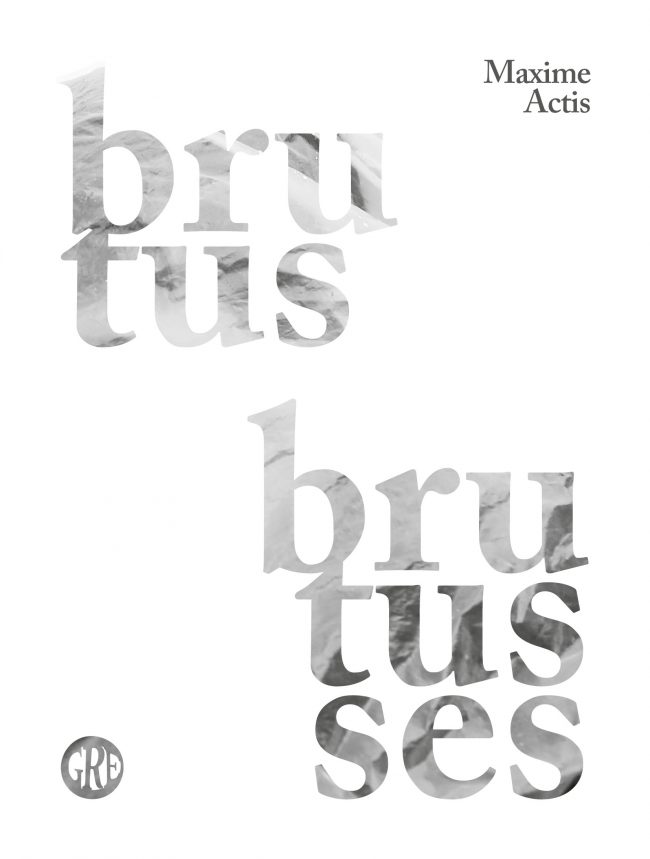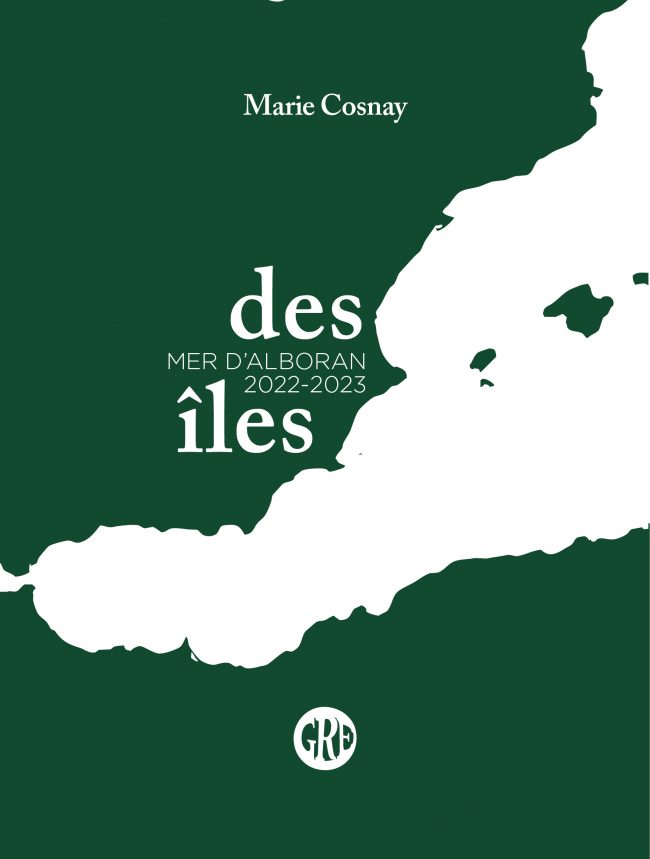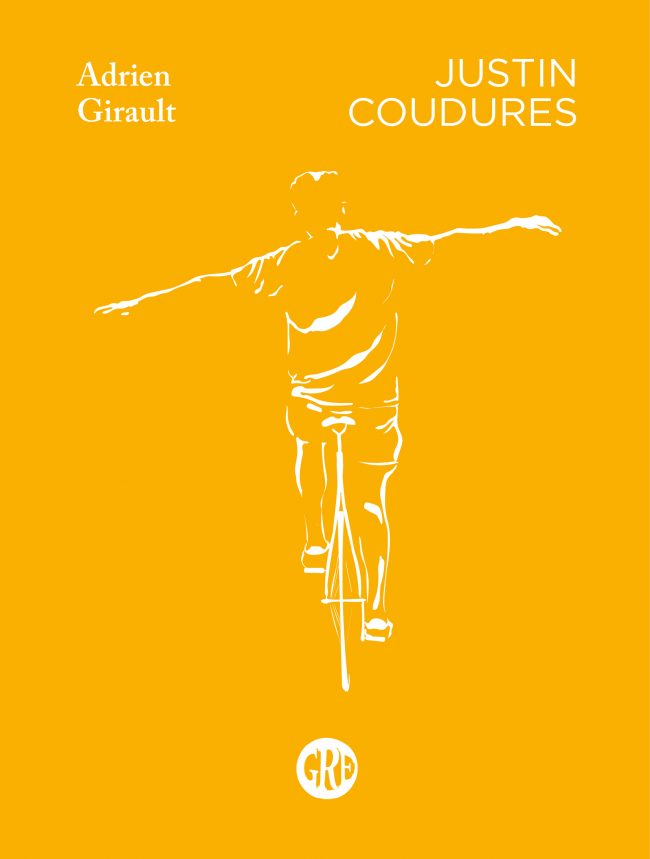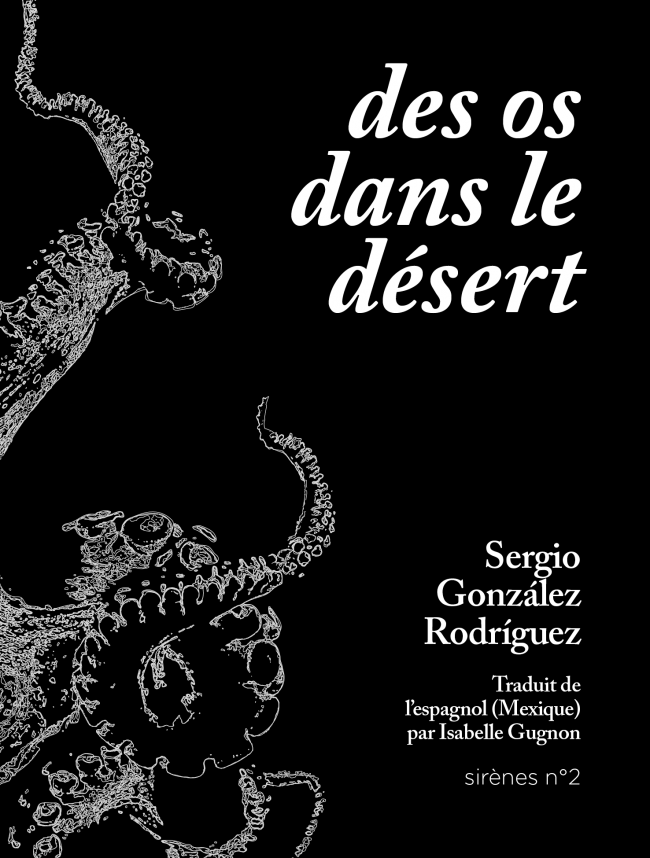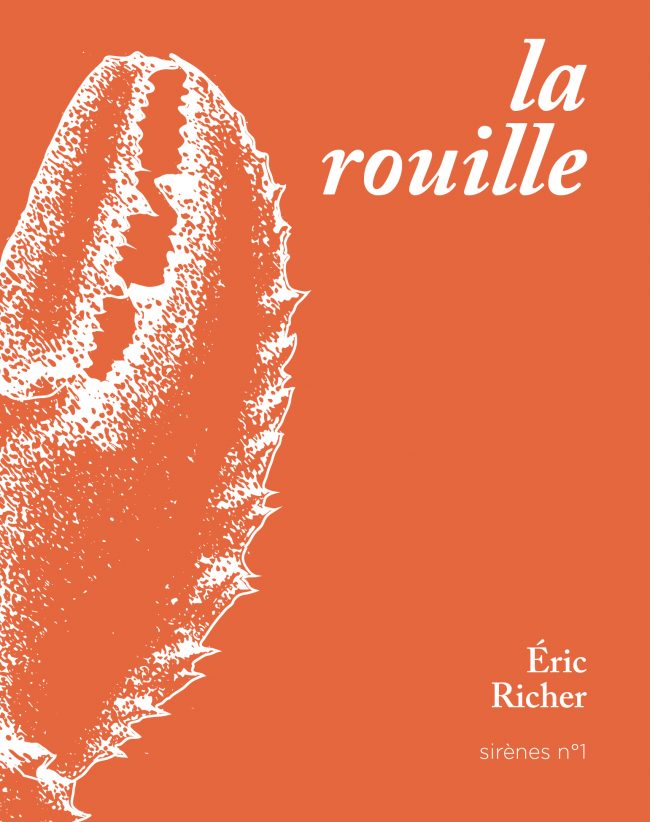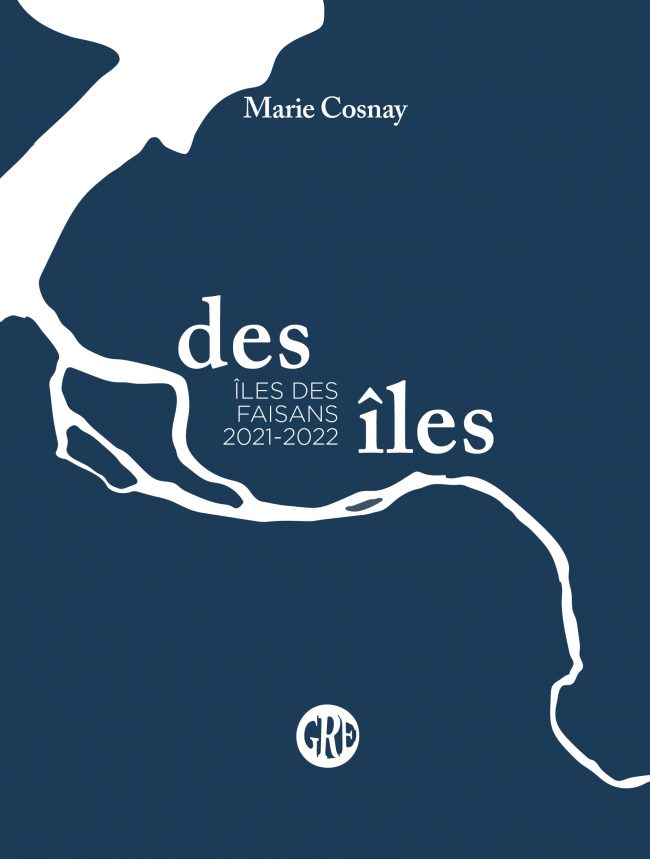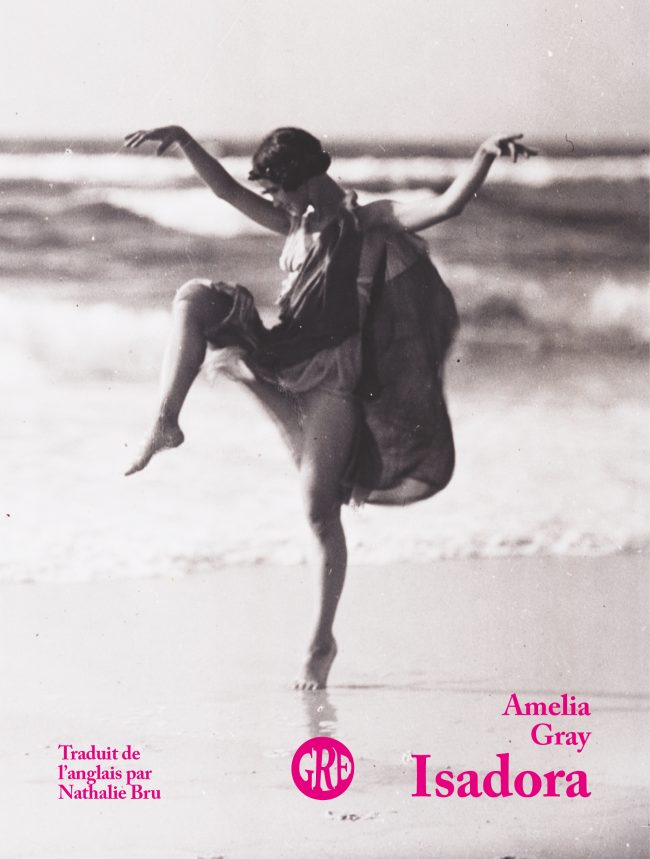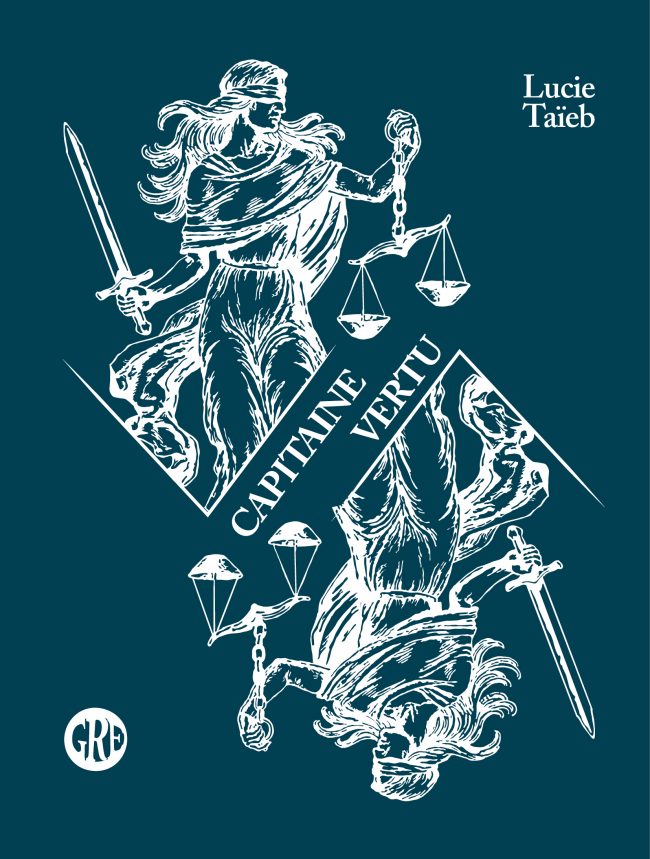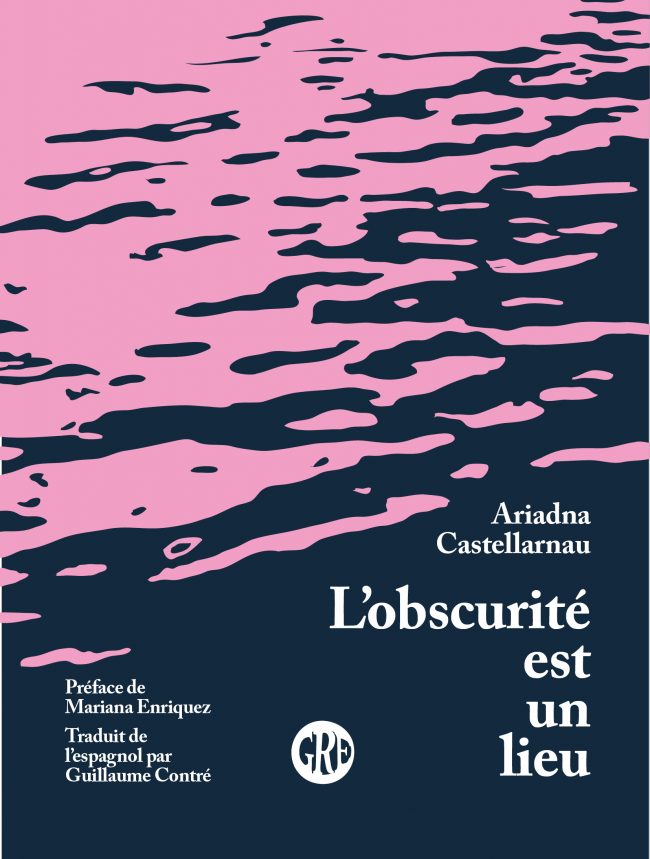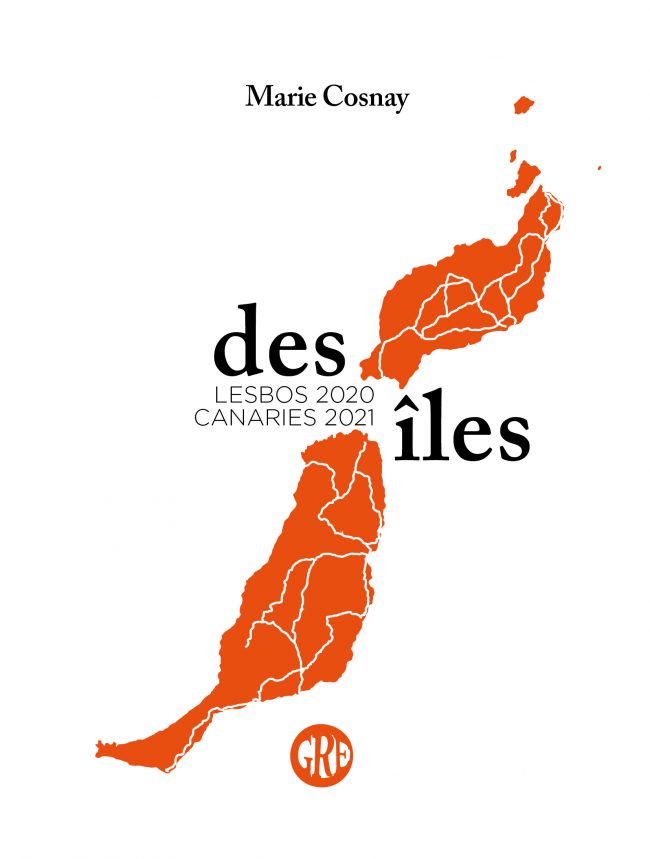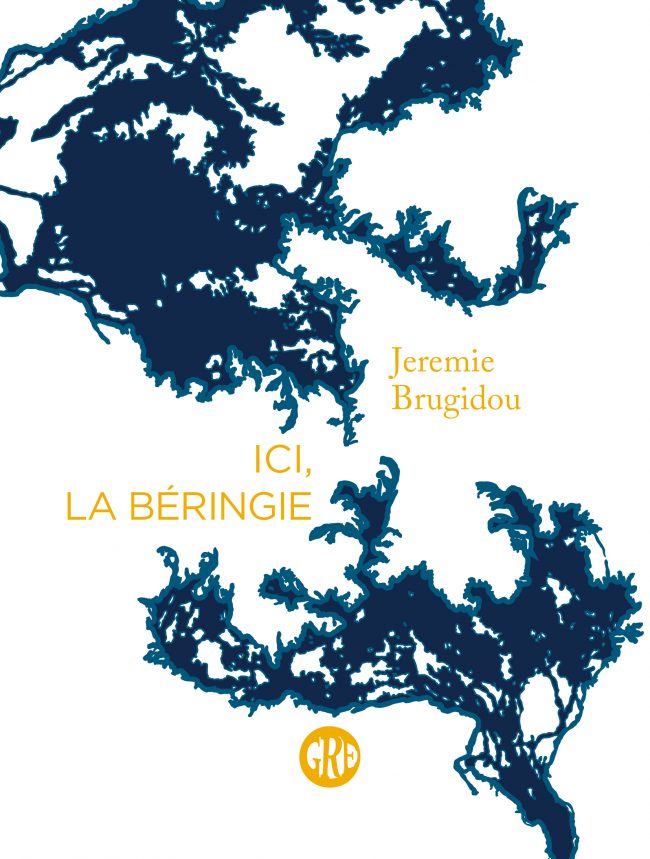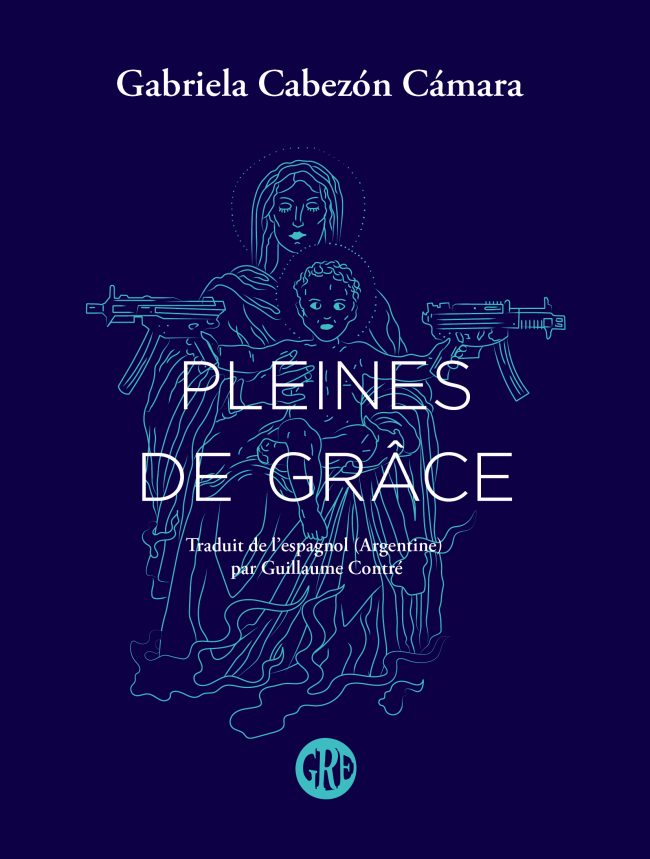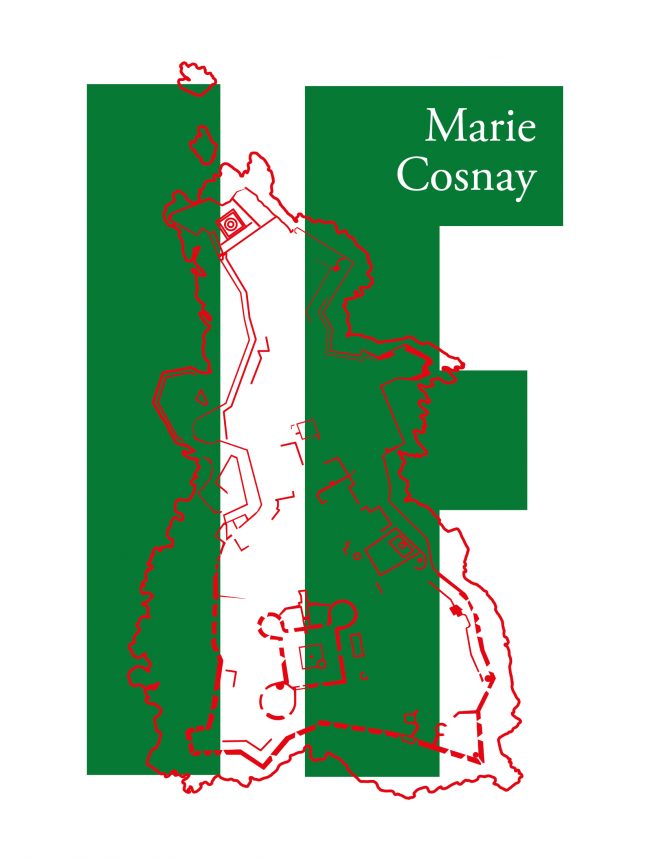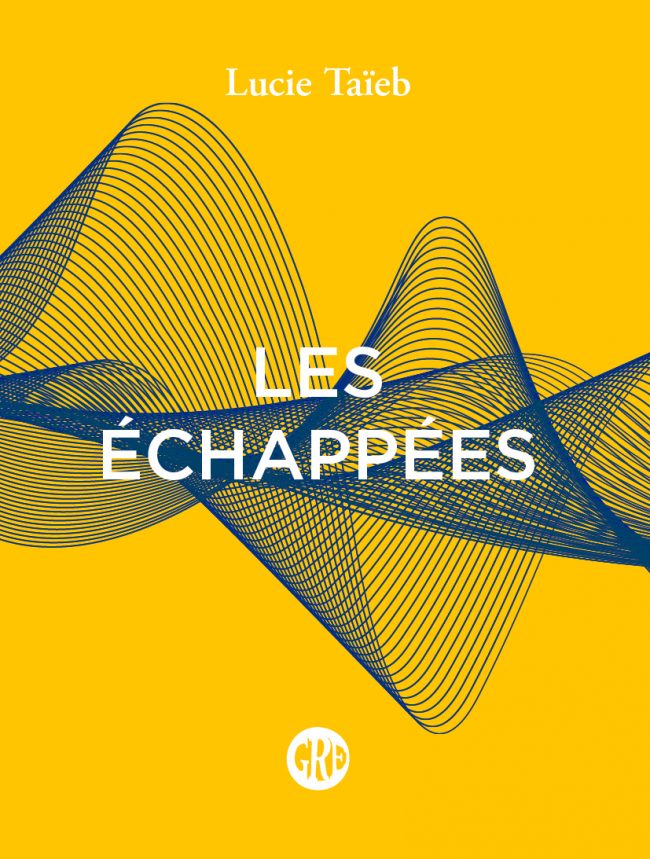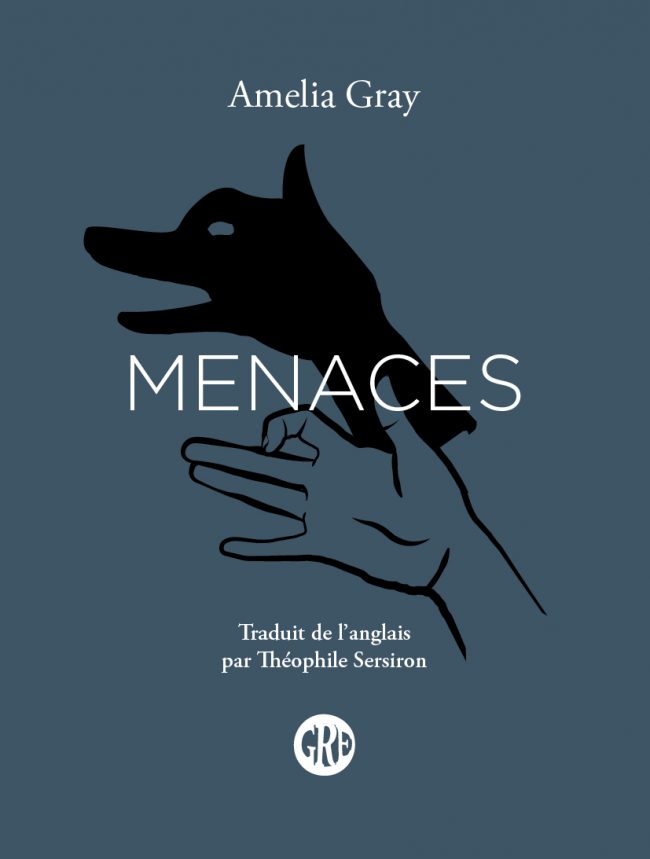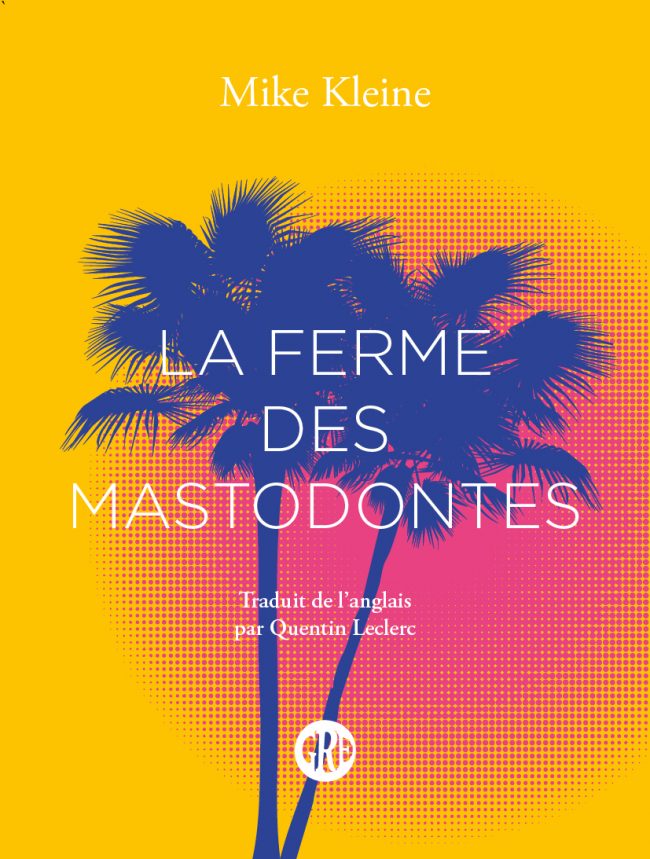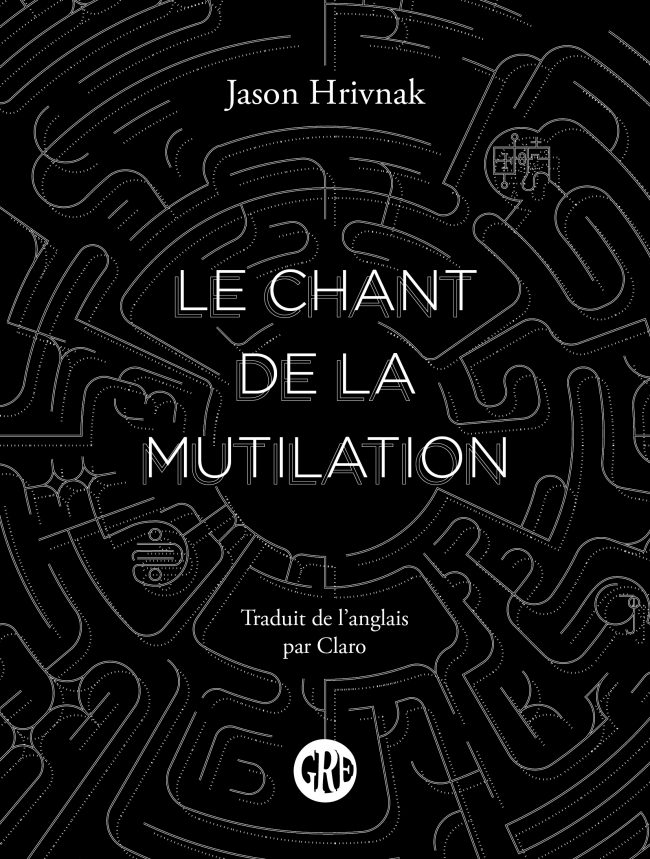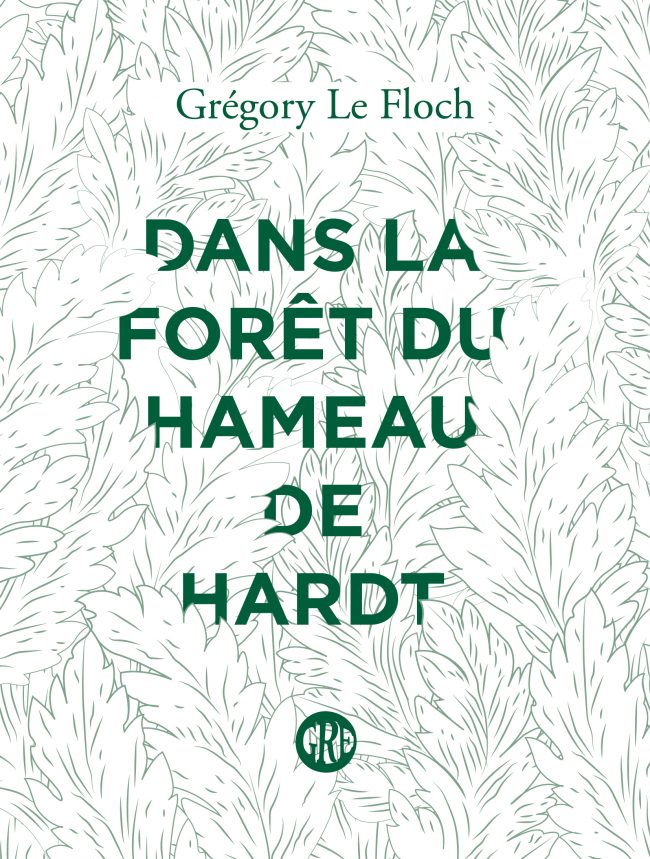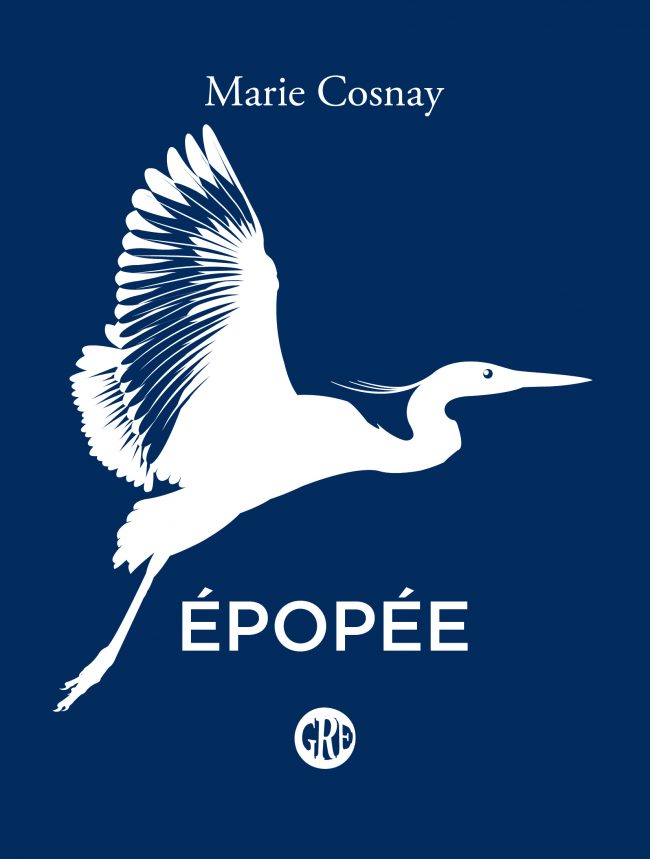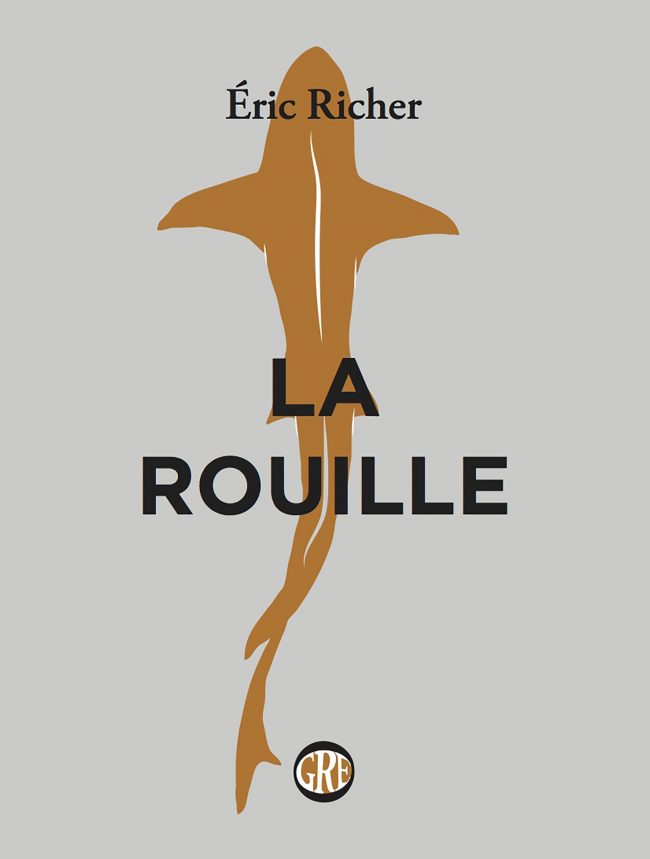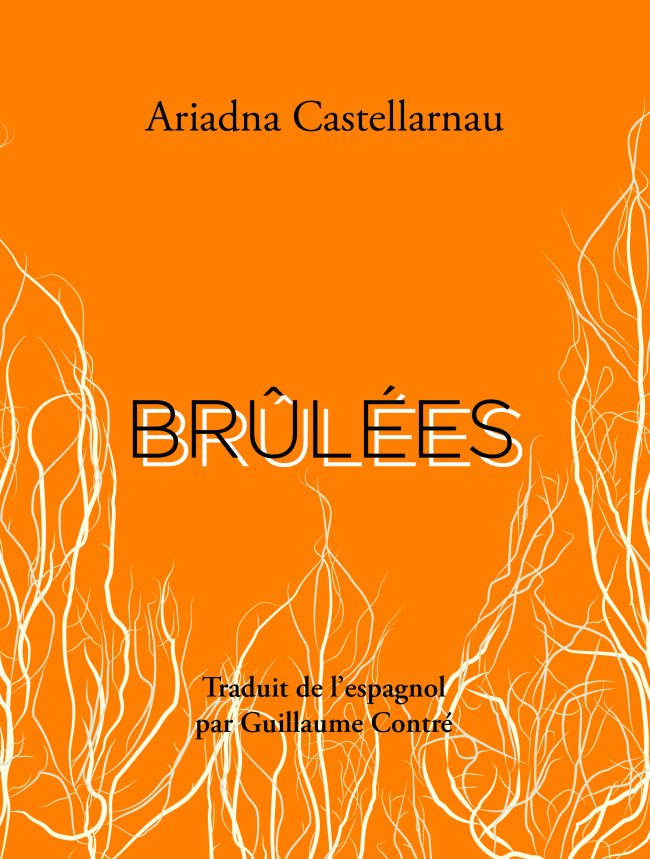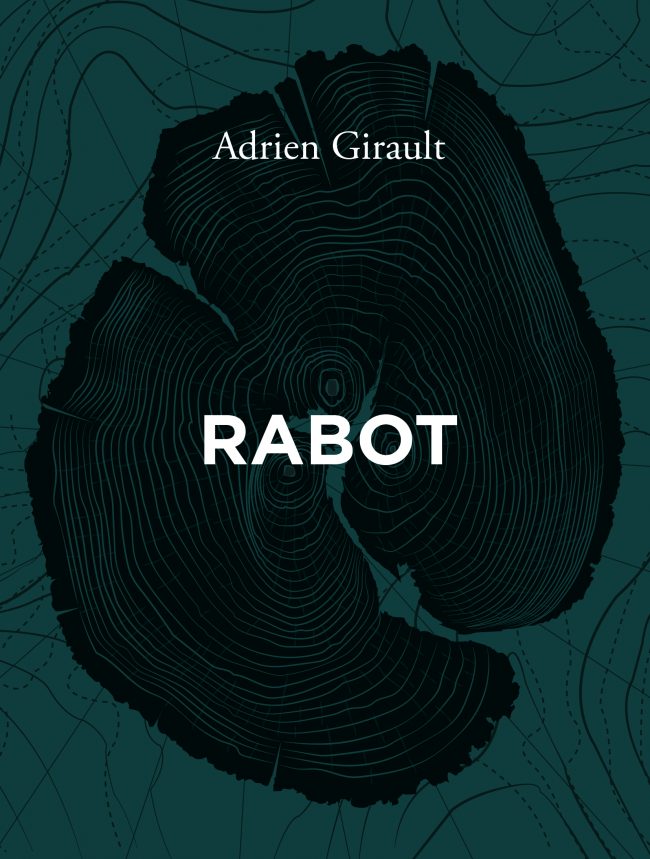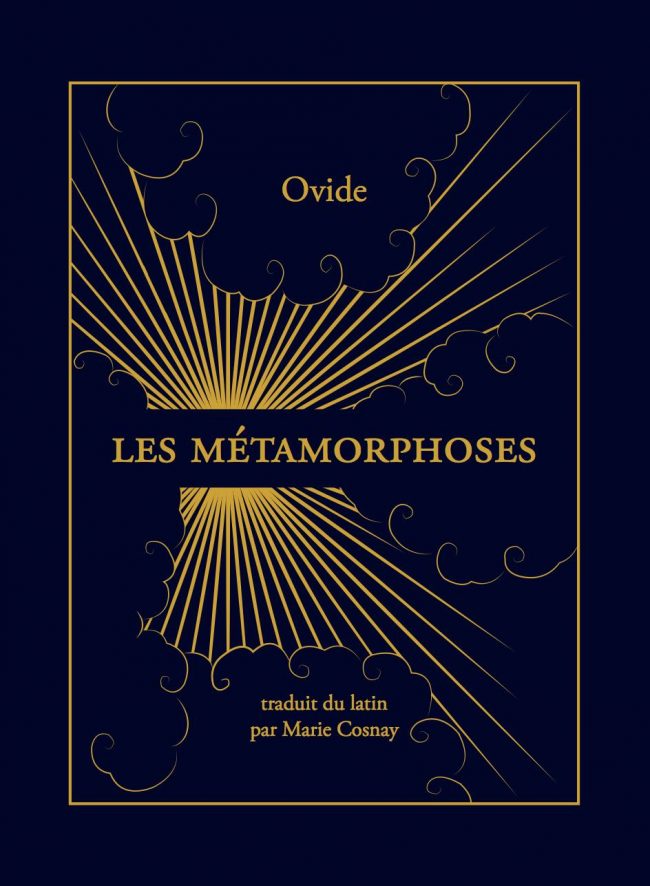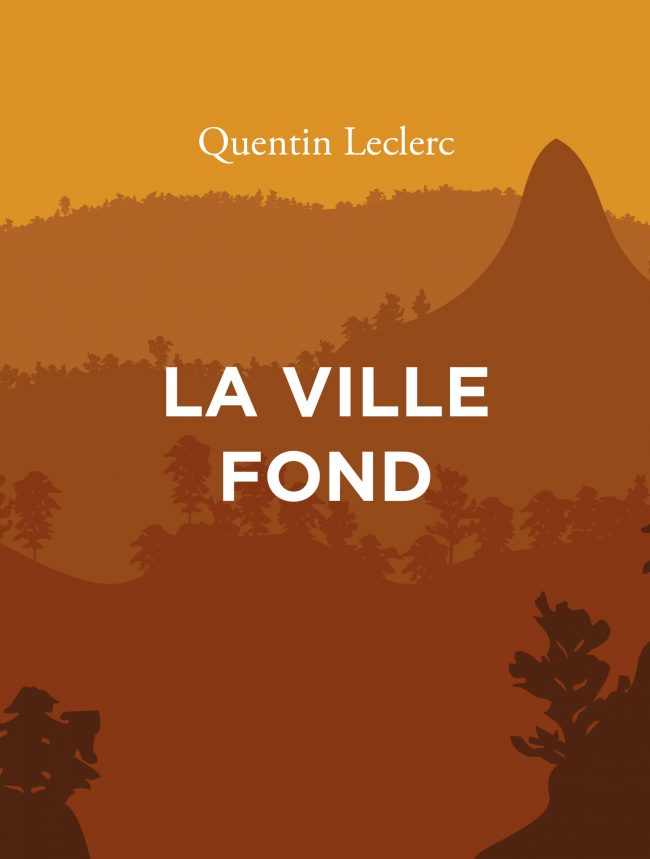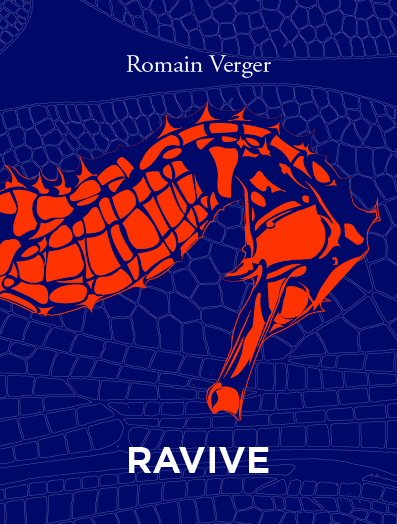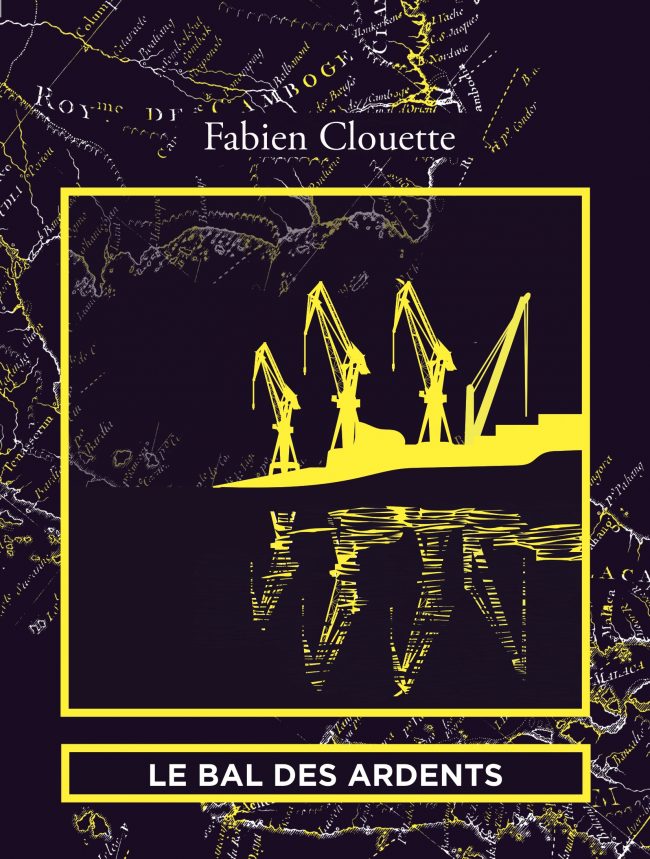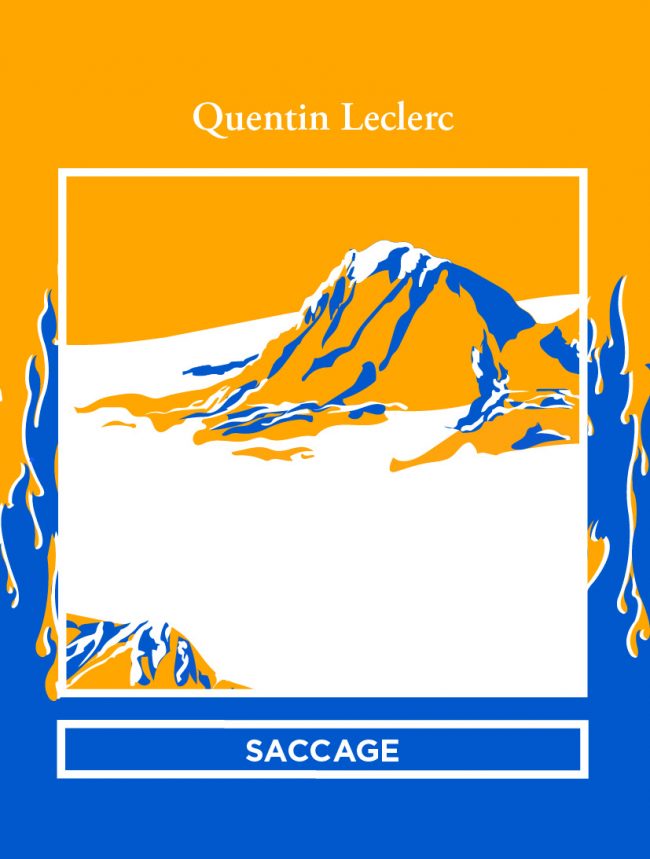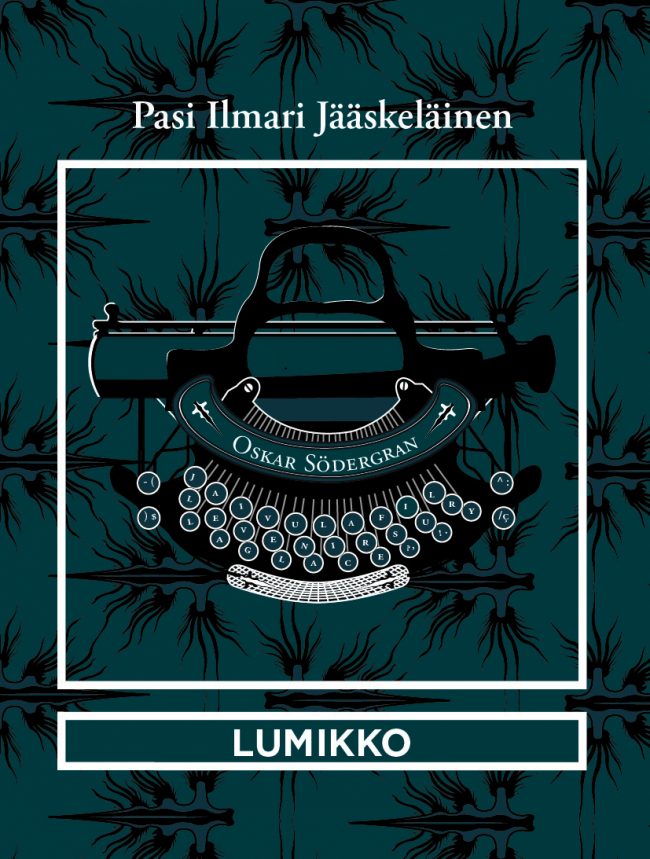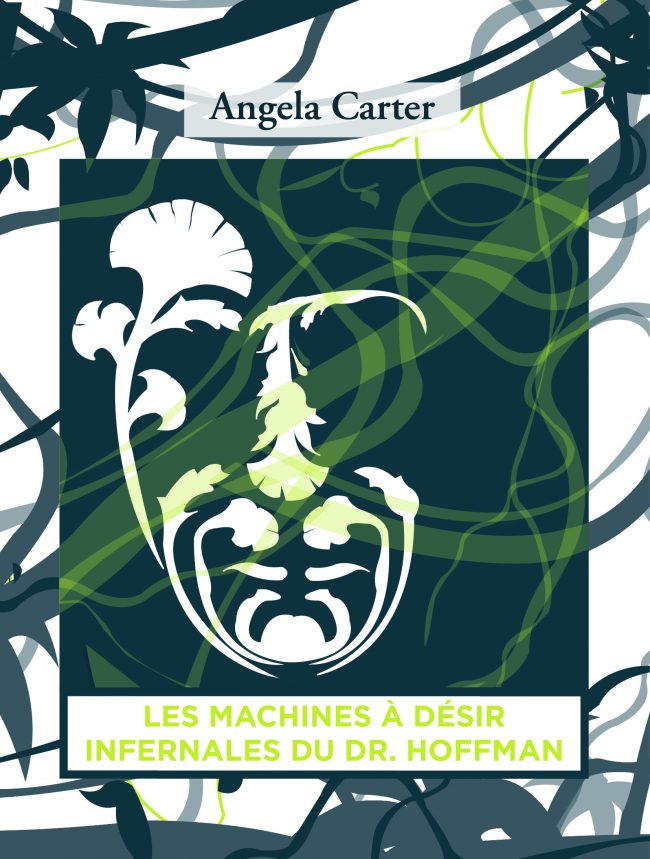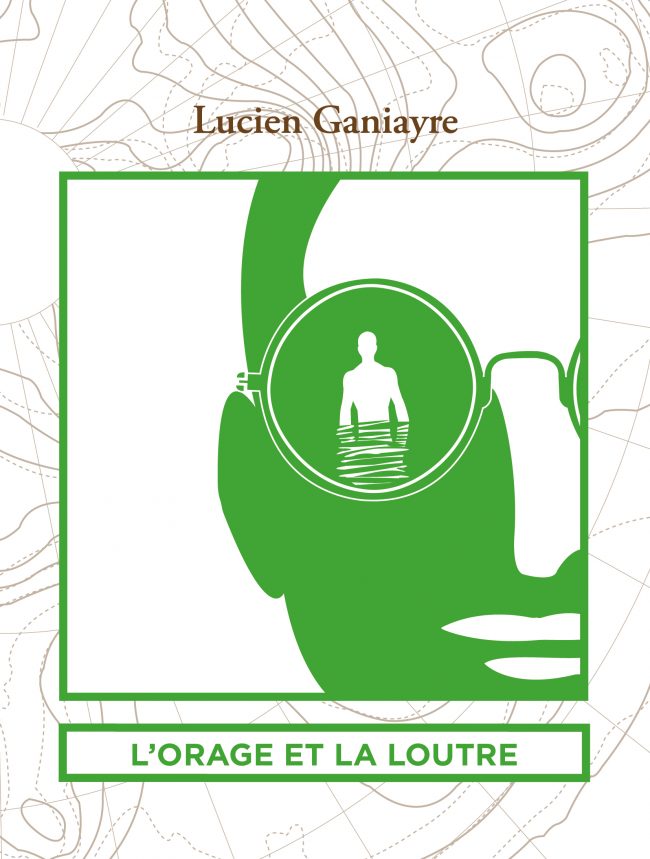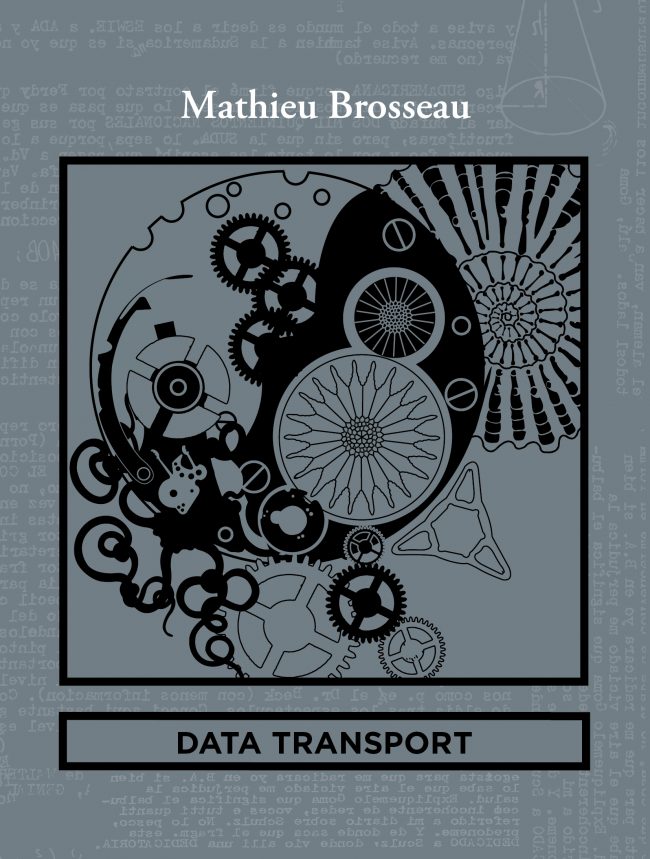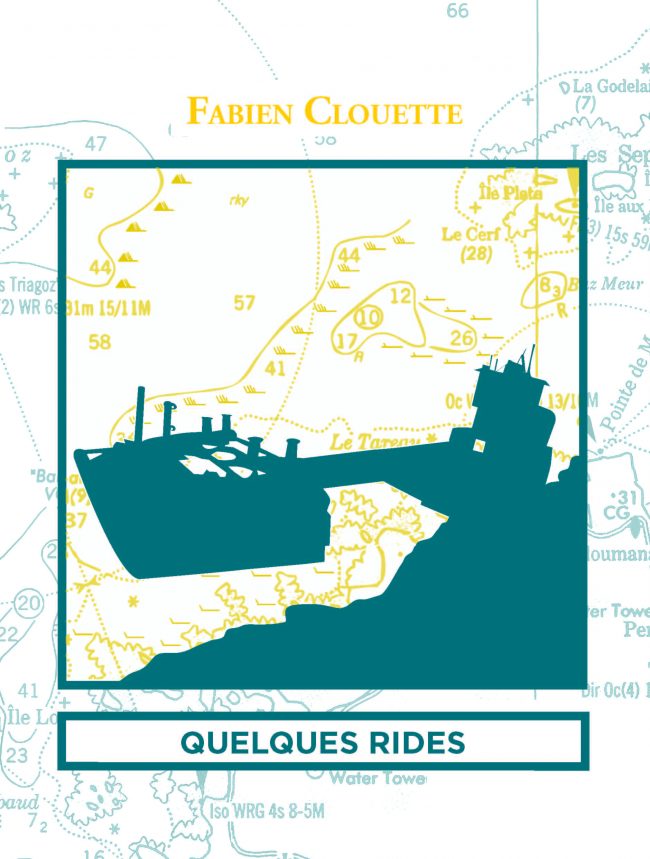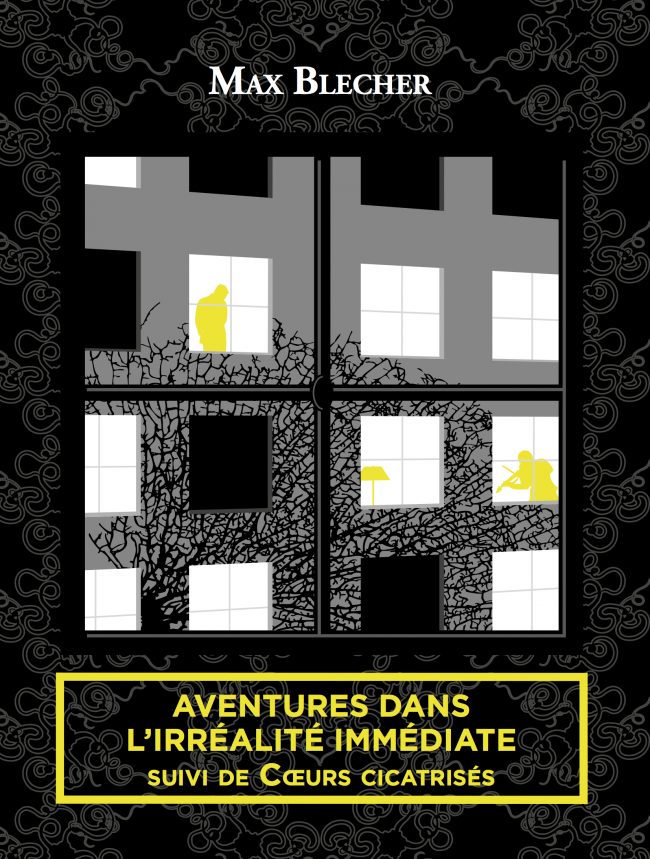L’orage et la loutre
SIRÈNES N°4 – Lucien Ganiayre
Lucien Ganiayre
L’orage et la loutre
Préface d’Andreas Lemaire
vendredi 16 février 2024
Taille : 125 mm / 165 mm – 264p. – 12€
ISBN : 978-2-37756-189-6
Dans un village du Périgord, après un violent orage, un instituteur découvre que le monde qui l’entoure, ainsi que tous les êtres vivants, sont figés,ce comme si le temps s’était définitivement arrêté. Livré à lui-même, l’instituteur tente, tant bien que mal, de mener une vie normale dans son village et de survivre à la folie qui le guette. Il décide finalement de rejoindre Paris à pied pour tenter d’y retrouver son seul ami d’enfance. C’est en chemin qu’il rencontrera un autre être mouvant, une loutre, qu’il tentera d’apprivoiser…
L’Orage et la loutre est le récit halluciné d’un voyage à travers une France immobile. L’impossibilité de contact humain que connaît le narrateur nous transporte dans l’enfer de la solitude et dans l’ambiguïté des relations humaines. Si le narrateur frôle plusieurs fois la folie, enfermé dans sa chambre et lors de son long voyage, c’est bien le souvenir d’une amitié fusionnelle, presque charnelle, qui le pousse à avancer. Derrière ce qui pourrait être un sombre cauchemar, se cache aussi un roman écologique qui questionne notre rapport à la nature et au vivant, et qui nous met face à notre incapacité à préserver ce qui nous est essentiel.
PRESSE
« L’Orage et la loutre est un roman fantastique, où le surnaturel perd incidemment son préfixe quasiment à chaque ligne. Surtout dans ces scènes stupéfiantes, qui sont comme des arrêts sur image, des tableaux de rues, de paysages, d’intérieurs, remplis de silhouettes pétrifiées, saisies exactement à mi-chemin entre la vie et la mort, le mouvement et l’immobilité, où le style arrive à un tel point d’équilibre entre la banalité la plus triviale et l’étrangeté la plus absolue qu’il devient impossible de discerner, du monde, de l’auteur ou du lecteur, lequel des trois est le plus fêlé. Pour le reste (la loutre, etc.), disons juste qu’est balayé ce vieil adage selon lequel l’amitié est une base arrière imprenable et l’amour un perpétuel champ de bataille. Qui ne sait qu’une grande amitié est infiniment plus cruelle, ne serait-ce que parce qu’elle porte fatalement en elle le poids d’un amour interdit ? »
« Lucien Ganiayre, comme Keats, érige en héros un élément éphémère et insaisissable, réputé immortel et pourtant qu’il dompte par sa plume : le temps. »
« Arrêt sur image » par Dider Garcia, Le matricule des anges, le 12 juillet 2015
« [L]e tour de force de Ganiayre est de faire admettre l’inadmissible (…). S’il a l’art d’enfermer son lecteur à l’intérieur d’un monde improbable, dans une langue que rehaussent volontiers de subtiles colorations poétiques, Ganiayre a aussi celui de créer une intrigue oppressante (qui pousse à aller de l’avant) : à chaque page on espère que Jean va s’en sortir et que le sortilège qui régente sa vie va s’effacer de lui-même. »
COUPS DE CŒUR LIBRAIRES
Quentin, librairie La Comédie humaine (Avignon) : « L’une des lectures les plus éblouissantes et stimulantes que j’ai eu depuis très longtemps, ce petit bijou de littérature, seul roman de Lucien Ganiayre, qu’il ne verra jamais édité car c’est à titre posthume que les éditions du Seuil décide de le sortir au milieu des années 1970 et enfin ressorti cette année grâce aux merveilleuses éditions de l’Ogre.
Ce roman ambitieux mêle avec une extrême intelligence le roman rural d’enfance, le parcours initiatique digne des plus grands auteurs américains et le roman de fin du monde. L’action se passe entre les deux guerres, notre personnage se retrouve, lors d’une ballade en forêt, à être le seul rescapé d’une étrange fin du monde : l’ensemble des être vivants sur Terre semble être figé, complètement bloqué dans le temps. Plus un seul bruit, plus un seul mouvement. Passé le choc, notre unique survivant décide de monter jusqu’à Paris pour tenter de retrouver le seul être qu’il ait jamais chéri.
Écriture d’une puissance évocatrice folle, objet littéraire rare au style très sensitif et sensible… Un véritable chef d’œuvre ! »
Librairie L’usage du papier (Trouville-sur-Mer) : « Redécouverte d’un roman exceptionnel dans un nouveau format ! Bouleversante réflexion sur la solitude et la douleur de l’homme qui détruit tout ce qu’il voudrait aimer, L’orage et la loutre nous fait basculer dans l’étrange folie du monde. A lire d’urgence ! »
Librairie Petite Egypte (Paris) : « Un homme chemine seul dans un monde mystérieusement pétrifié, aux confins de la vie et de la mort. Un voyage fantastique dans loutre tombe qui interroge avec grâce et poésie notre rapport à la nature, au vivant et à la solitude. De toute beauté ! »
Librairie Le Monte en l’air (Paris) : « Ce roman découvert seulement maintenant -publié la première fois en 1976- est un bijou d’une beauté inouïe, à chaque page on tremble et on est ébloui. Un roman fantastique d’une terrifiante beauté avec cette écriture de l’équilibre pour nous donner les plus beaux tableaux naturalistes et tout à la fois nous plonger dans le désespoir d’un homme seul dans un monde figé. On pense Au mur invisible de Marlen Haushoffer.
Librairie Vent de Soleil (Auray) : « Un homme se promène. Il trouve une source, s’y désaltère et décide de s’y baigner. Un orage éclate. Quand il en ressort, le temps s’est arrêté. Pour tous, sauf pour lui. Quels sont alors les possibles ? La fuite ? Le refuge d’une maison ? Celui des livres ? Ce récit postapocalyptique mais d’un très grand réalisme est une plongée dans la solitude extrême. Etrange et poignant, ce texte écrit en 1976, ne fut publié pour la 1re fois qu’en 1973, après la mort de son auteur. Redécouverte passionnante. »
Librairie Durance (Nantes): « Un voyage au cœur de l’immobilité où pourtant tout palpite… Troublant, hallucinant, sublime ! »
Lucie, Librairie Les Nouveautés (Paris): « Publié pour la première fois en 1973, 30 ans après sa date de création, L’Orage et la Loutre est un petit OLNI dans la veine de Ravage de Barjavel. Un homme seul traverse la France dans un monde immobilisé, dans un temps suspendu à la recherche de son meilleur ami… Oppressant, haletant, une dystopie savamment menée glissant vers la fable écologique ! »
Andreas, librairie Myriagone (Angers): « Texte post-apocalyptique où l’on suit les tentatives désespérées du dernier homme sur terre de trouver quelque part un cœur qui bat, l’ensemble est porté par de grands tableaux naturalistes et une mélancolie profonde et destructrice. Il y a chez Ganiayre une puissance littéraire marquée par une manière très ouvragée et délicate, et une réflexion quasi philosophique sur le poids de l’existence. »
Christelle, librairie Elkar (Bayonne): « Ecrit dans les années 1940, ce roman postapocalyptique nous surprend par la surreprésentation des sens dans ce monde à l’arrêt. Le héros nous entraine avec fièvre dans sa recherche d’issue, une aventure aussi dangereuse que tendue. »
Librairie L’Astragale (Lyon): « Un texte précieux, rare et puissant… qui met le cœur à vif et l’âme à nu (et oui, j’avoue, j’ai presque pleuré…) MAGNIFIQUE »
La Baignoire d’Archimède (Brive-la-Gaillarde) : « Rédigé en 1935, il fut publié à titre posthume et les éditions de l’Ogre nous offre la possibilité de le découvrir et le transmettre au plus grand nombre dans le format poche de la collection Sirène.
Car il est de ces romans qu’il nous tarde de retrouver à chaque interruption obligée. Une écriture extrêmement sensuelle et sensorielle pour ce roman aux atours dystopiques dans lequel on découvre un jeune instituteur qui se retrouvera seul être vivant et en mouvement dans un monde étrangement figé. Cet arrêt du temps et des vies en cours décuple chaque perception du personnage et procure une expérience de lecture fascinante, impliquant vos sens et vous maintenant en haleine jusqu’à une fin réussie. La qualité descriptive et la tenue du récit se mettent au service d’un texte abordant les thèmes de l’altérité et du besoin de l’autre. »
Le Square (Grenoble) : « Dordogne, 1935. Quand Jean de Bories s’extrait d’une source rafraîchissante, l’orage est immobile, les gens pétrifiés. Dans ce cataclysme, il part pour Paris. La langue d’une sensualité tragique déambule, enfièvre ce réel dément, rivalise avec le silence et bouleverse tout. Surtout le lecteur. »
EXTRAIT
PRÉFACE D’ANDREAS LEMAIRE,
LIBRAIRIE À MYRIAGONE (ANGERS)
Écrire dans le bruit et la fureur de l’automne 2023 une préface à propos d’un livre qui a germé dans le temps de la Seconde Guerre Mondiale et qui relate l’histoire du dernier homme vivant sur terre a quelque chose de troublant. Car on ne peut qu’être troublé, fatigué, désabusé face au constat d’un cycle éternel de l’horreur, d’un mouvement autoritaire et guerrier produit par une humanité – ou une partie tout du moins – qui se fait un enfer d’être ensemble, comme incapable de contourner la violence qui l’anime, et qui semble systématiquement appeler à elle, en guise d’échappatoire paradoxale, des scénarios de fin du monde, de survivalisme brutal, des robinsonnades post-apocalyptiques.
L’Orage et la loutre, seul roman publié de Lucien Ganiayre, pourrait appartenir à cette dernière catégorie : genre de robinsonnade ultime et désespérée dans un monde brutalement figé, à mi-chemin entre la vie et la mort. Mais où réside aussi une puissante sensation de paix tapie derrière l’angoisse existentielle. De la paix que l’on peut ressentir campé·e sur le flanc d’une falaise alors que la tempête fait rage, face à la mer déchaînée, quand on est saisi·e de ce sentiment d’humilité profonde, d’insignifiance béante en regard de la puissance de l’univers. Où l’on se dit que tout passera.
Même si l’écriture de ce texte surnaturel et impressionniste s’est déroulée essentiellement sur les années d’Occupation, de 1940 à 1946, nulle évocation de la guerre ici puisque l’auteur place l’action en 1935. Habile manière de manipuler le temps, d’y ouvrir une brèche, une dérivation, alors même qu’on est au cœur des ténèbres. Rédigé à la première personne, L’Orage et la loutre, présenté comme les mémoires du personnage central Jean Des Bories, procède à une véritable mise en pause du temps de l’Histoire puisqu’y est fait le récit d’une étrange et inexplicable biostase du monde. Un cataclysme muet auquel le narrateur échappe par hasard en s’immergeant dans une source naturelle cachée. Désormais seul dans un univers qui ne semble décidé ni à vivre ni à mourir mais pourtant bel et bien fragilisé par cet état d’animation suspendue, coincé dans une parenthèse qui ne veut pas se refermer, Jean Des Bories côtoie la folie puis cherche à survivre en se créant un but, qui devient obsession : retrouver la trace de l’ami de toujours, Marescot. La pérégrination vers Paris peut alors commencer. De la province charentaise vers la capitale, le cheminement appuie la solitude du protagoniste, aussi immense et éclatante que l’orage figé au-dessus de sa tête, muant son obsession en désir. Car s’il est un élément notable dans cette œuvre saisissante, c’est la présence prépondérante d’une sensualité à la lisière de l’érotisme fichée au centre du désespoir. Jean se languit de vivre sans pouvoir toucher et ressentir. Tout contact avec une existence pétrifiée étant interdit sous peine de mort certaine pour celle-ci, la rencontre – car il y en aura quelques-unes –
avec une vie palpitante donne lieu à de sincères moments d’extases. Épanchements fébriles, chaque fois petite mort décrite avec poids et volupté. Tout comme le souvenir et la recherche éperdue de l’ami met à jour un homoérotisme patent assez rare pour l’époque en littérature, porté pourtant avec un naturel savoureux dans une sorte de ritournelle charnelle.
Ainsi Lucien Ganiayre met en scène un personnage en tension extrême entre Éros et Thanatos, pris au piège d’un monde grandiose esquissé par de longues touches impressionnistes, où paysages, lumières, mouvements et sons se trouvent amplifiés, hypertrophiés dans le corps du récit, mais avec lequel il ne peut jamais atteindre la communion, condamné à sacrifier la vie s’il veut l’étreindre.
Une distance irrémédiable entre l’homme et la nature empêche dans L’Orage et la loutre tout repos de l’âme. Mais est-ce véritablement une distance irrémédiable ou, à l’heure des pensées perspectivistes et des réflexions écologiques, ne peut-on pas plutôt voir dans cet écart persistant entre Jean et son environnement, ainsi que dans son affliction parfois cruelle et meurtrière, une dynamique autodestructrice toute occidentale et masculine ? Un regard qui même habité par un élan contemplatif, pacifiste et désintéressé reste conditionné par le besoin d’appartenance et de possession ? Un désespoir d’autant plus grand qu’il se sait esclave de ses pulsions morbides ? La solitude est impossible mais la relation à l’autre, humain ou animal, tout autant vouée à l’échec. Dans l’isolement ou la communauté, la ligne de partage des turpitudes est chez Ganiayre une tempête rageuse au cœur de laquelle l’âme s’enfonce sans aucun guide. Alors dans l’entre-deux suspendu, dans le no man’s land temporel, dans l’indétermination perpétuelle au moins peut surgir parfois une forme d’apaisement mélancolique.
Les textes mémorables mettant en scène des individus isolés sur une terre désertée ne manquent pas ; Le Nuage pourpre de Matthew Phipps Shiel (1901), Le Mur invisible de Marlen Aushofer (1963) ou encore Le Dernier Monde de Céline Minard (2007) constituent, entre autres, d’intenses compagnons de l’ouvrage de Lucien Ganyaire, publié de façon posthume en 1973. Tous ont en commun de sonder un territoire mental où l’écriture, dernier geste quand il ne reste plus rien, devient un prétexte (« un prêt au texte » comme l’écrit si bien le personnage de C. Minard) à se maintenir debout, compose un testament, peut-être seul vestige capable d’être édifié d’une seule main, et de faire acte conjoint de mémoire, de création et de mise en garde.
On retiendra longtemps de cette œuvre son écriture délicatement ouvragée au service d’une narration fiévreuse, ses images terrassantes de beauté, sa sensitivité magnifique, et le déséquilibre permanent au cœur de l’homme, qui sourd comme une aiguille prête à crever le nuage, quitte à voir déferler l’orage.
« Parfois, une ombre rapide passe sur le pré et je me rappelle alors qu’il y a sur le monde paisible, sur le monde qui va dans sa tiédeur quotidienne, une épouvante. »
CHAPITRE 1
C’était le 20 septembre 1935, après midi. Je chassais sur Artigalas. J’avais tué deux perdreaux gris, sous bois, dans les châtaigniers de la Borie-Haute. La chaleur était très forte, exceptionnelle pour le mois de septembre. Près de moi, Rita, ma chienne setter, essoufflée, tirait la langue. Elle avait bien chassé et moi j’étais heureux.
En descendant vers Faugeas, à travers les ratouils, je flairais ma dernière cartouche tirée. Sur mes reins, je sentais le poids des deux perdreaux tout chauds qui ballottaient dans la descente. Comme j’abordais les vergnes du ruisseau, le tonnerre s’est fait entendre à une grande distance et j’ai senti que l’orage approchait. La chaleur devenait presque insupportable. J’ai regretté que le ruisseau de Saint-Martin fût à sec, car j’avais grand soif. Rita a gratté les pierres sous les vergnes, croyant trouver de l’eau. J’ai suivi la haie qui va vers la combe de Faugeas. Beaucoup de merles s’envolaient. J’espérais trouver quelque fraîcheur dans cette combe. C’est un endroit que j’aime bien. Je me suis assis dans la menthe et j’ai observé un moment ces petits insectes bleu vif dont j’ignore le nom et qui sont toujours à l’envers des feuilles d’ormes. J’ai regardé aussi le toit de la Borie-Basse qui apparaît entre les peupliers. Et, de l’endroit où j’étais assis, on peut voir, à droite, quand on a l’habitude, la girouette du château au-dessus des deux grands sapins. Rita était allongée près de moi et haletait, langue pendante. J’ai écrasé une tige de menthe grasse et je lui ai fait flairer mes doigts. Elle a éternué avec un air si offensé que j’ai ri tout seul. C’est un tour que je lui jouais souvent. J’avais déboutonné ma vareuse. J’étais content. J’ai pensé à Marescot. Je me demandais ce qu’il pouvait bien faire à cette heure, dans Paris. Je ne l’avais pas vu depuis un an et je retournais dans ma tête sa promesse de venir chasser avec moi aux premiers jours d’octobre. Et j’étais sûr qu’il ne me ferait pas défaut, comme les années précédentes. Il me tardait bien d’être au 2 octobre. Je me voyais déjà l’attendant à la gare de Saint-Martin avec une carriole et je me demandais avec un peu d’inquiétude s’il ne me trouverait pas trop « paysan ».
Le tonnerre a grondé un peu plus fort. Les nuages noirs s’avançaient au-dessus de la Borie, tenant tout le ciel. J’étais tranquille. La maisonnette abandonnée est juste à l’entrée de la combe. En dix pas, je pouvais être à l’abri de la pluie. J’avais soif. Tellement soif que je me suis demandé un moment si je ne grimperais pas jusqu’au puits écroulé qui servait jadis les deux Bories. Son eau n’est pas potable, mais j’avais sur moi mon flacon d’alcool de menthe et mon gobelet pliant.
Tout à coup, Rita s’est dressée. Elle a marché lentement vers le grand hallier qui s’élève au bas de la descente abrupte et qui remplit la moitié du vallon. C’est un amas de ronces entremêlées de clématites, un très grand buisson difficilement pénétrable. Quand j’étais enfant, j’avais réussi un jour à me frayer un passage à travers ce hallier pour atteindre un figuier sauvage qui se dresse au-dessus des épines. Mais cette expédition m’avait laissé si écorché et griffé que je ne m’étais plus jamais avisé de recommencer. Et j’avais abandonné les figues de septembre aux merles et aux trides.
Rita était campée devant le buisson et reniflait longuement. Couché dans l’herbe, je jouais avec une tige de prêle en observant ma bonne chienne. Je crus qu’elle sentait un passage de lapin, mais elle n’était pas en posture d’arrêt et je la vis s’avancer à petits pas prudents, puis s’enfoncer dans le buisson, écartant les ronces souplement et sans bruit. Bientôt elle disparut. Deux gros merles s’envolèrent et filèrent dans la combe en sifflant. J’ai appelé doucement Rita et je lui ai demandé ce qu’elle cherchait dans ce fourré.
« Pour une chienne d’arrêt, lui ai-je dit à voix basse, tu es bien hardie, ma fille, d’entrer dans ces épines. »
Je me suis mis sur mon séant et j’ai chargé mon canon gauche de plomb numéro 2. J’ai refermé mon fusil sans bruit et je l’ai tenu sur mes genoux, guettant le haut du buisson. J’avais tué un blaireau dans ces parages l’hiver précédent et le manège de Rita m’avait fait supposer qu’une grosse bête pouvait être baugée dans le hallier. J’ai entendu craquer doucement des feuilles sèches sous les pattes de ma chienne. À ce moment, la cloche de Vignolles a sonné quatre coups lents dans le lointain. C’était pour la mort du vieux Frechou, l’ancien boulanger. Le tonnerre a grondé sourdement et longuement. Le doigt sur la détente, je guettais toujours la grosse bête, sans trop y croire, et je me demandais ce que faisait Rita au milieu de ces épines. Soudain j’ai entendu, dans le fourré, un bruit de langue, des petits claquements rapides et sonores, comme si Rita buvait. Je savais qu’il n’y avait pas d’eau à cet endroit. Pourtant, le bruit d’un chien qui boit ne ressemble à aucun autre, et j’entendais Rita haleter de plaisir, à pleine gorge. J’ai appelé ma chienne. Les claquements se sont arrêtés, puis ont repris. J’ai écarté les ronces du bout de mon fusil, et, me protégeant le visage du coude, je me suis enfoncé dans le buisson. J’ai avancé autant que j’ai pu. Les épines griffaient ma veste et tiraient mes cheveux. À tâtons, sans lever la tête, j’ai mis le cran d’arrêt à mon fusil. Puis j’ai avancé encore un peu. Il faisait si chaud que la sueur coulait sur mon front et dans mon dos. Ma chienne, sans doute repue, cessa de boire et j’ai entendu un léger bruit de gouttelettes, tandis qu’elle s’ébrouait en faisant claquer ses oreilles. J’ai appelé doucement : « Rita ! Rita ! » Elle est venue vers moi, et c’est à ce moment que j’ai vu luire de l’eau à travers les ronces. À grands coups d’épaules, j’ai encore avancé. Une épine m’a pris la nuque et m’a arrêté net. J’étais penché en avant, les jambes fléchies, ne bougeant pas, car l’épine me soulevait la peau au moindre mouvement. Alors, j’ai vu devant moi une source.
À cet endroit où je passais depuis vingt-cinq ans et dont je connaissais chaque brin d’herbe, je découvrais, avec une grande surprise, une source débordante d’eau claire. C’était une espèce de puits régulier et circulaire d’un mètre de diamètre environ. Une nappe de glaise crue en faisait le tour et semblait avoir coulé de la paroi verticale, à l’endroit où s’élevait le figuier sauvage. Les racines du figuier étaient à nu. La glaise rouge avait recouvert ou repoussé la végétation à l’entour, de sorte que les bords du puits étaient nets et dégagés comme ceux d’un bassin artificiel. Les pattes de ma chienne avaient creusé dans l’argile une dizaine de petites fleurs. Au-dessus de ce bassin rond, les clématites et le tronc surplombant du figuier formaient une voûte, assez haute pour qu’un homme de ma taille pût s’y tenir debout. J’ai dégagé une de mes mains et j’ai soulevé doucement la ronce qui me mordait le cou. J’ai écarté avec le canon de mon fusil une branche de prunellier et j’ai posé le pied au bord de la fontaine. L’argile était glissante, mais résistante sous mes semelles. Rita s’était éloignée en suivant le passage que j’avais ouvert. Je me suis penché sur l’eau pour en évaluer la profondeur. C’était une eau parfaitement limpide. Mais, dans la pénombre de la voûte, je voyais mal le fond, qui me semblait bouger doucement. J’ai posé mon fusil à un endroit sec et je me suis débarrassé de mon carnier. Je me suis allongé à plat ventre, la tête au bord de l’eau, les mains enfoncées dans la glaise. Au bout d’un moment, j’ai pu distinguer le fond qui était très propre et de couleur blanchâtre. Des bulles s’y formaient çà et là, montaient en chapelets et éclataient silencieusement à la surface. J’étais étonné que cette source n’eût pas formé un ruisselet pour l’écoulement du trop-plein. L’eau affleurait le bord. J’ai supposé qu’il y avait une fissure dans la paroi et que l’eau, bien que sourdant en abondance, s’équilibrait juste au niveau du sol. J’ai approché mon visage et, tendant les lèvres, j’ai pris une gorgée d’eau. Je l’ai goûtée attentivement. Elle était fraîche, mais presque insipide. Je suis amateur de fontaines et je connais le goût de toutes les eaux du pays. Celle-ci avait une saveur plate, morte,
un peu comme de l’eau bouillie. J’ai avalé cette première gorgée, puis j’ai bu à petits coups, heureux d’étancher ma soif. J’ai ensuite retroussé les manches de ma veste et j’ai plongé mes bras dans la source. Une fraîcheur délicieuse montait jusqu’à mes épaules et j’ai ri de plaisir. J’étais fier de ma trouvaille. Jamais mon père ni mon grand-père n’avaient parlé d’une source dans la combe de Faugeas ou sur les coteaux voisins. J’ai pensé que je montrerais ça à Marescot. J’ai doucement brassé l’eau un moment. Il n’y avait dans la fontaine aucun insecte ni aucune herbe. Elle avait dû se former depuis peu. Elle semblait toute neuve. En agitant mes bras, j’ai éprouvé une sensation bizarre. Je ne sentais pas l’eau appuyer sur ma peau. Je ne la sentais pas résister dans mes doigts lorsque je les enfonçais. L’eau semblait être sans poids. Et, en fermant les yeux, j’avais l’impression d’agiter mes bras nus dans un vent très doux et très frais. Un long coup de tonnerre est passé sur tout le pays, lentement, avec des hésitations et des reprises dures, comme une grosse bille roulant sur une pente irrégulière. Puis j’ai entendu, près du buisson, un bâillement de Rita. J’ai tiré mes bras hors de l’eau ; sous cette voûte de ronces et de clématites, il régnait une chaleur de four. Je transpirais tellement que mes lèvres étaient salées par la sueur qui coulait sur mon visage.
Alors, j’ai eu l’envie un peu folle de me baigner. Je me suis vite mis nu, complètement. Je souriais en pensant que si les bonnes gens m’avaient vu, ils m’auraient cru innocent. Surtout dans notre vieux pays, où l’on est plus propre de cœur que de corps et où on se lave sans trop se déshabiller. Je songeais aussi que Marescot devait avoir à Paris une belle salle de bains et qu’il s’amuserait bien de me voir tout nu dans les buissons. Je me suis assis sur le bord de glaise fraîche et j’ai plongé mes jambes dans la source, jusqu’aux genoux. J’ai éprouvé la même sensation de non-résistance. La fraîcheur me faisait du bien, mais j’hésitais encore à me laisser glisser jusqu’au fond de cette source inconnue.
À ce moment est tombée sur l’eau une de ces boules brunes, creuses, très légères, que l’on appelle noix de galle et qui poussent en parasites sur les chênes. Une noix de galle est si peu pesante qu’on ne la sent pas dans le creux de la main et qu’on la chasserait en soufflant dessus. Cette boule brune a touché la surface de l’eau, et déjà je tendais la main pour la saisir, quand je l’ai vue s’enfoncer lourdement et disparaître au profond de la fontaine. Cela m’a donné un coup au cœur et j’ai vite retiré mes jambes de l’eau. Je suis resté bouche bée un moment. Enfin, je me suis mis à rire de ma frousse. Penché au-dessus de la fontaine, j’ai pu voir la petite boule sombre posée délicatement sur le fond clair. Une telle légèreté de l’eau n’était pas vraisemblable et j’ai supposé qu’un invisible courant vertical devait entraîner vers le bas les objets immergés. Toutefois, je me promis de venir chercher un litre de cette eau et de la peser avec la balance de l’école. Impatient de savoir si le fond était résistant et quelle était sa composition, j’ai étendu mes bras, j’ai calé mes deux mains sur le rebord glissant, et avec un frisson aigu, je me suis laissé couler dans l’eau froide. Me retenant sur mes coudes raidis, j’ai allongé les jambes, tâté de l’orteil le fond que j’ai senti un peu fuyant, et enfin, sans lâcher toutefois la bordure de glaise, j’ai pris pied carrément.
Seule ma tête et mes avant-bras émergeaient. Mes pieds s’étaient enfoncés de quelques centimètres dans un sol gluant qui pénétrait entre mes orteils. Un épais nuage de bulles enveloppait tout mon corps et crevait à la surface de l’eau avec un friselis rapide. J’ai ressenti un bien-être total. Lâchant le rebord, j’ai plongé mes mains dans cette eau légère et j’ai caressé la paroi lisse, tâtant la glaise douce, à la recherche d’une cavité. Mes mouvements étaient d’une souplesse parfaite, nullement ralentis par l’épaisseur de l’eau, et je ne sentais sur tout le corps qu’une fraîcheur égale et sans poids. Je n’avais pas trouvé de fissure et je ne percevais aucun courant, aucun remous. Seules, les bulles rapides chatouillaient mes jambes et mon ventre, dès que je bougeais. J’étais détendu et enfoncé dans l’eau jusqu’au menton. Mes yeux étaient au niveau du rebord d’argile et je voyais, à ras de terre, le pied des buissons et de grandes herbes jaunes. Un de ces petits oiseaux que l’on nomme ici des « rébeînits » est venu se poser tout près de moi, hochant la queue et poussant son petit cri rapide. Il a dû me voir tout à coup, car il a disparu avec un brusque ronflement d’ailes. Une bande d’ajasses a criaillé dans les bois du château, sans doute contre le grand lièvre que je gardais depuis longtemps pour le fusil de Marescot.
« Tu ne te déroberas plus longtemps, ma vieille lèbre… », ai-je murmuré. Et j’ai souri en pensant à sa cabriole et à la joie du Parisien. J’ai entendu la trompe de l’autobus Rougier au tournant du moulin. Puis, un large coup de vent a fait frémir le buisson.
Sentant l’orage proche et jugeant qu’il valait mieux ne pas m’attarder, j’ai décidé de sortir de l’eau, de me sécher avec des bouchons d’herbe et de me rhabiller. Mais avant, pour bien profiter de mon bain, je me suis accroupi, plongeant ma tête sous l’eau. La fraîcheur de la source m’est entrée dans les oreilles, dans le nez, caressant mon crâne sous mes cheveux qui se soulevaient doucement. J’ai ouvert les yeux et j’ai regardé mes jambes pâles et les petites bulles qui restaient prises, comiquement, dans mes poils. Je pouvais, sans aucun effort, dans cette eau légère, chasser l’air de mes poumons par la bouche et le nez. J’ai barboté ainsi quelques secondes, puis j’ai levé la tête hors de l’eau.
J’ai alors éprouvé une sorte d’étourdissement violent, comme si je m’étais heurté le front. J’ai aspiré une longue bouffée d’air et cet air m’a glacé la gorge et les poumons. Je me suis agrippé des deux mains au rebord de glaise. Je me suis soulevé de toute la force de mes poignets. En rampant, j’ai réussi à m’arracher à la source qui tout à coup paraissait aspirer mon corps avec une force extraordinaire. Je me suis allongé contre les buissons. J’avais un voile de sang devant les yeux. J’entendais un grand battement sourd, régulier, comme le bruit d’une pompe géante. Je me suis mis à trembler de froid. Il me semblait que l’air, soudainement, était devenu glacé. Un éternuement m’a secoué tout entier, puis un autre, puis un autre encore. C’était comme un spasme violent qui tordait ma poitrine, montait à ma gorge, à mon nez, sous mon front, puis se défaisait dans une détente brutale. Tout mon corps était soulevé, puis jeté durement contre le sol. Un sang chaud a coulé de mes narines.
En même temps, j’ai entendu des cris dans le vallon à des distances différentes. C’était comme si de grands animaux, postés dans les bois environnants, aboyaient et rugissaient. Et sans cesse retentissaient des coups, espacés deux à deux, qui sonnaient comme une cloche ou une pompe. Je me sentais faible comme un mourant et j’ai cru que j’allais mourir. Cependant, ma pensée était restée claire et me parlait très calmement, très nettement. « C’est cette eau, sans doute, qui m’a fait mal. Une congestion… ou un empoisonnement… Je saigne du nez, on dit que c’est bon signe… Je vais aller mieux… Il faut que je me rhabille, vite… Quels sont ces bruits ? Quel est ce grand bruit régulier ? On dirait un bélier d’eau ou un cœur énorme, gros comme une maison… Il fait froid… » Je me suis soulevé sans trop de peine et, avançant sur les mains et les genoux, j’ai atteint mes habits que j’avais jetés en tas, au pied du figuier. J’ai respiré deux ou trois fois à pleins poumons. Ce qui surtout m’effrayait, c’étaient ces bruits violents que j’entendais de tous côtés. Et j’étais transi de froid. Je claquais des dents. J’ai saisi mon pantalon de velours. Avec effort, je l’ai plié et roulé en un gros tampon et je me suis frotté la poitrine et le ventre à deux mains, aussi fort et aussi vite que j’ai pu. Mes doigts étaient rouges comme en hiver et mes poings tout gercés. J’ai levé la tête pour essayer d’apercevoir le ciel à travers la voûte de broussailles. Je n’ai vu qu’une lueur jaunâtre.
Je tremblais violemment, sans arrêt. Je me suis habillé aussi vite que j’ai pu et j’ai boutonné ma vareuse en remontant mon col, comme en plein hiver. Aussitôt après, mon malaise a diminué. Mais j’avais encore si froid que j’ai plongé mes mains dans mes poches. J’ai senti sous mes doigts mon flacon d’alcool de menthe. Mes doigts étaient si gourds que j’ai brisé le bouchon de verre en l’ôtant. J’ai bu une gorgée de cet alcool puissant qui m’a brûlé la langue et le palais et j’ai ressenti une agréable chaleur à la poitrine.
J’étais assis, adossé au tronc du figuier. Je suis resté un moment sans bouger. J’avais peur de mourir tout seul dans cette combe. Les bruits effrayants avaient cessé, sauf celui du cœur immense qui battait dans le vallon. En même temps, je sentais autour de moi un silence vertigineux. Et, dans ce silence, j’ai entendu une voix claire, une voix de femme ou de jeune garçon parlant avec un accent monotone, rapide et sans les inflexions de chez nous. Elle disait : « Si tu meurs aujourd’hui, tu ne reverras pas Marescot…
Si tu meurs aujourd’hui, tu ne reverras pas ton ami… »
Je reconnaissais peu à peu cette voix. J’ai fermé les yeux, et sans bouger, pour la première fois de ma vie, avec attention, j’ai écouté ma pensée, surpris par cet accent si neutre et si rapide. Il me semblait entendre un étranger. « Il arrivera le 2… Ne sois pas malade, Jean… Jean Des Bories, ne sois pas malade pour le 2… Ne m’écoute pas… Écoute-moi… Ne m’écoute pas… Écoute. » Et la voix claire a dit tout à coup, très vite et très bas : « Rita… Où est Rita ? » Je me suis alors penché vers le buisson, à l’endroit où se voyaient les marques fraîches de son passage. J’ai appelé Rita, deux fois… J’ai seulement cru l’appeler, car c’était encore la voix claire qui avait crié pour moi, deux fois. Et je n’avais pas ouvert la bouche. Alors, j’ai arrangé ma langue, mes lèvres, mes dents et mon souffle, pour lancer le nom de ma chienne. Et soudain, j’ai entendu, devant moi, une voix énorme prononcer le nom de Rita avec une telle puissance que j’en fus assourdi. Ce cri gigantesque vint tout droit sur moi, me heurta, m’enveloppa de tous côtés, s’éloigna, revint encore et me parut se déchiqueter lentement avant de se dissiper dans le silence. Il me semblait que le monde entier, d’une seule voix, avait crié mille et mille fois ce petit nom de bête. Et je n’ai plus rien entendu que le bruit inlassable de ce bélier sonnant dans le vallon et la voix claire que j’écoutais à peine et qui disait, très vite : « Appelle au secours, Jean… Appelle au secours… » Ce qui me stupéfiait, surtout, c’était l’absence de soleil et de chaleur. Alors que peu de minutes avant je suffoquais dans le feu de l’orage approchant, maintenant je croyais vivre une matinée glacée de décembre. J’ai senti de nouveau le sang chatouiller mon nez et me couler chaudement dans la gorge. J’ai craché et je me suis essuyé la bouche d’un revers de main. Une violente odeur de chair et de sel m’est montée à la tête. J’ai reconnu l’odeur de mon sang. Mais cette odeur était puissante, comme si j’avais enfoui mon visage dans le ventre d’un renard ou d’un lièvre fraîchement dépouillés. Et en même temps, je me suis aperçu que je ne sentais pas l’odeur de l’air, ni l’odeur des buissons, ni celle de la terre, ni celle de mes habits encore trempés de sueur. Ou plutôt, ce que j’ai compris, d’un seul coup, tandis que le goût de mon propre sang m’étourdissait, c’est que plus rien autour de moi n’avait d’odeur. C’était comme si les feuilles vertes, les touffes de clématites, le terreau noir et toutes les choses vivantes qui m’entouraient avaient été brusquement stérilisées.
Cette certitude m’a fait si mal que j’ai fermé les yeux et que mes deux mains se sont serrées contre ma poitrine.
J’ai regardé autour de moi et j’ai arraché vivement deux ou trois baies de prunellier. J’ai porté à ma bouche ces petits fruits bleus, si âcres que le seul souvenir de leur âcreté me fit grimacer lorsqu’ils touchèrent mes lèvres. Je les ai fait craquer sous mes dents pour sentir, ce que je savais d’avance, qu’ils avaient perdu toute saveur. Et je n’eus dans la bouche qu’une pulpe morte et insipide que je crachai en frissonnant de dégoût et de peur. Et ce fut de peur aussi que je sursautai en rencontrant soudain, juste à hauteur de mes yeux, le regard brillant d’un gros merle noir posé à toucher mon visage sur une tige de clématite. J’ai reculé d’un pas et j’ai fixé cet oiseau vivant qui gardait une immobilité de mort. Ses pattes étaient repliées sous son ventre, ses ailes étaient ouvertes à demi, sa tête était tendue vers moi. Ses yeux luisants étaient d’une fixité absolue. Il me fit penser d’abord à un oiseau fasciné par le serpent, mais ses plumes vivantes n’avaient aucun frémissement. J’ai approché ma main, lentement, de cette petite bête dont l’immobilité m’épouvantait. Comme mon doigt l’effleurait, il bascula sur la mince tige où il était posé. Je le saisis délicatement.
Il était lourd et froid comme un oiseau mort. Et cependant tout son petit corps contenait de la vie. Je ne sentais pas cette vie sous mes doigts qui le palpaient, mais mes yeux la voyaient. Inerte et raidi comme un oiseau empaillé, il était pourtant tout enduit du brillant et de l’humidité d’une vie intense. J’enfonçai mes doigts avec précaution sous son plumage dru et résistant. Je ne sentis aucun battement, aucun frémissement sous sa peau froide. Et voyant que ses petites serres étaient non pas molles et détendues comme celles d’un oiseau mort, mais fermes et à demi recourbées comme celles d’un oiseau perché solidement sur sa branche, j’ai ressenti une horreur soudaine à le tenir dans mes mains et je l’ai lâché brusquement. L’oiseau tomba à mes pieds, exactement sur mes pieds, heurtant le bout d’une de mes chaussures de chasse. J’ai eu un mouvement nerveux de la jambe pour l’écarter et il a roulé sous ma semelle. À ce moment, il m’a semblé entendre un cri. Mais je n’ai pas cherché d’où provenait ce cri, car il s’était confondu avec de grands bruits éclatant de toutes parts. Je suis resté immobile. Les bruits se sont affaiblis et se sont tus ; sauf celui du grand bélier qui battait toujours dans le silence.
J’étais debout dans cette espèce d’étroite cage que formait l’entrelacs des buissons. « Sors de cette cage, a dit la voix claire. Va… échappe-toi, Jean… Allons, va… va… voir plus loin… » Mais j’avais peur de me retrouver à l’air libre.
J’ai pourtant écarté doucement les épines. Je me suis courbé pour me faufiler dans le buisson. À cet instant, j’ai entendu dans le vallon une série de détonations sèches. J’ai cru à des coups de feu. Mais ce bruit était à la fois plus aigu et plus prolongé. La voix claire a dit : « On casse des troncs d’arbres, Jean… Entends… Ce sont de gros arbres brisés d’un seul coup… Des troncs d’arbres cassés… » Je me suis immobilisé dans le roncier, écoutant de toutes mes forces. Le silence est revenu. J’ai bougé de nouveau. Et de nouveau le vallon s’est rempli de détonations. Je suis resté accroupi, essayant de voir à travers les ronces ce qui se passait dans la combe.
Et je suis resté ainsi bien longtemps avant de comprendre, de comprendre que c’était moi qui provoquais ces bruits immenses et que ces détonations éclatantes étaient le craquement des brindilles sous mon pied et que le cœur gigantesque sonnant dans le vallon était mon propre cœur. Et en même temps j’ai pris conscience d’un silence absolu autour de moi, d’un silence énorme, s’étendant à dix kilomètres, à cent kilomètres, à toute la terre et à tout le ciel. Et je me rendais bien compte que ce n’était pas une déformation de mon ouïe, comme lorsqu’on a la fièvre, que mes oreilles ne bourdonnaient pas, que mon cerveau était net et que c’était ce silence infini qui emportait chacun de mes gestes dans un bruit longuement répété par l’écho des collines, vers Artigalas et la vallée du Bandiat. Je me suis mis à trembler, la voix claire parlait derrière moi, très vite, sans crier. Mais je n’écoutais pas les mots pressés et monotones qu’elle me disait. Je ne comprenais pas ces mots. Je regardais mes doigts trembler sur ma vareuse et j’écoutais le tintement mat que faisait l’ongle de mon pouce en heurtant un de mes boutons de cuivre à tête de sanglier. Et j’ai vu que ce bouton de cuivre se fendillait, se défaisait en petits éclats. Je regardais la tête de sanglier et, sans bien comprendre, je l’ai vue s’estomper, s’effacer, disparaître. Puis le bouton s’est détaché de ma vareuse, il est tombé en miettes brillantes, dont quelques-unes restèrent accrochées à ma jambe, dans les grosses côtes de velours.
J’ai fermé les yeux. Je suis resté longtemps, longtemps, les paupières serrées, écoutant le bruit de mon cœur qui pompait durement la chaleur de ma poitrine et dont les coups s’élançaient hors de moi et montaient dans le taillis au-dessus des arbres, jusqu’au ciel. Puis j’ai entendu la voix claire articuler lentement : « N’aie pas peur, Jean… N’aie pas peur… Il ne faut pas trembler comme cela… Tu es un homme… Ouvre les yeux et ne tremble plus, Jean… » Elle me disait de me lever, de me réchauffer en marchant et d’avoir confiance, d’entendre ce cœur solide qui sonnait dans toute la vallée. Ah ! ce qui m’est arrivé est extraordinaire et terrible. Pourquoi est-ce tombé sur moi entre tous les hommes ? Sur moi qui ne demandais rien de merveilleux à la vie.
En serrant très fort mes mains l’une dans l’autre, j’ai calmé peu à peu le tremblement qui me secouait tout le corps. J’ai ouvert les yeux. J’ai respiré profondément plusieurs fois. Je me suis levé, écartant les broussailles. Lorsqu’une épine griffait ma vareuse, on aurait dit qu’une immense pièce de toile se déchirait depuis la terre jusqu’au ciel. J’ai avisé mon fusil et mon carnier posés sur le sol. J’ai mis mon carnier sur mon épaule, après avoir tâté machinalement les deux perdreaux gris qu’il contenait. Il me sembla que des jours et des jours avaient passé depuis que je les avais tirés sous bois, dans les châtaigniers de la Borie-Haute. Je ramassai mon fusil, en l’empoignant par le canon. Il se brisa comme du verre. Plus justement, il se brisa comme un de ces morceaux de bois pourris, d’aspect lisse et solide, qui se défont dans la main qui les saisit et s’effritent soudain en mille miettes poudreuses. Je tenais un double tronçon d’acier déchiqueté d’une légèreté qui me souleva le cœur, un double tronçon lisse, brillant, mais que je sentais s’écraser sous mes doigts. Et mes doigts, dans une sorte de frénésie, indépendante de ma volonté, se sont durcis, crispés sur cette matière fuyante. Avec une volupté stupide, j’ai broyé longuement le canon de mon fusil. J’avais la sensation d’écraser entre mes doigts une espèce de croûte légère et friable, comme du biscuit. À mes pieds tombaient des paillettes brillantes, sans poids, qui ne courbaient même pas les herbes en les heurtant. Mes doigts étaient enduits d’une poudre collante et luisante. Lorsque j’ai essayé de l’ôter en frottant, cette poudre impalpable est devenue visqueuse, s’est accrochée à ma peau, comme de l’huile. J’ai saisi la crosse et la culasse qui étaient restées sur le sol. La crosse m’a paru lourde. Son bois restait ferme dans ma main. Mais, au moindre contact, tout ce qui était métallique se défaisait et se déchiquetait. Les gâchettes se sont pulvérisées sous mon doigt. De la culasse croulante et fuyante comme du sable ont glissé les deux cartouches que j’ai ramassées. Leur culot de cuivre s’est défait. La charge de poudre a coulé. J’avais dans la main les deux tubes de carton aux couleurs brillantes. Bien que la bourre grasse fût intacte et solide, ainsi que les cartons du dessus qui restaient sertis, les cartouches semblaient vides. Elles ne pesaient pas. Je les ai desserties avec mes dents. Les plombs, aussi bien le 2 que le 8, sont tombés lentement, en deux petits nuages, comme une espèce de fumée lourde qui s’est perdue dans l’herbe. J’ai tiré de mes poches toutes les cartouches que je portais et je les ai jetées. Mes yeux papillotaient en voyant ces morceaux de cuivre s’évanouir en touchant le sol. Et les tubes de carton, en s’entrechoquant, ont fait un grand bruit clair et musical.
À ce moment, j’ai constaté que tout ce qui était métal sur mes habits s’était défait. Les boutons de ma veste avaient disparu. Ma ceinture pendait et ne gardait que l’empreinte de sa boucle d’acier. Les petits œillets de métal où passaient les lacets de mes chaussures étaient détachés. Dans une touffe d’herbe, à mes pieds, j’ai aperçu ma chaîne de montre en métal doré qui formait un serpent brillant, cassé en cent endroits, mais qui avait gardé un dessin suivi, comme une ligne pointillée. Doucement, j’ai plongé trois doigts dans la poche où était ma montre. En l’effleurant à peine, j’ai réussi à la faire glisser sur la paume de ma main. Elle était arrêtée et marquait quatre heures. C’était une vieille montre en argent qui avait appartenu à mon père. J’ai fermé mes doigts et je l’ai broyée. Seuls, le verre et le cadran sont restés intacts. J’ai tout jeté. J’ai regretté mon fusil. Il m’avait coûté 2600 francs, toutes mes économies. C’était une arme parfaite. Aujourd’hui encore, même après ce que j’ai vécu, je ne puis m’empêcher de le regretter. J’ai noué autour de mes reins sa bretelle de cuir fin et j’ai mis dans ma poche ma ceinture qui était aussi en bon cuir tressé.
Je m’habituais un peu à la puissance des bruits que je provoquais. Déjà je ne tressaillais plus lorsqu’une brindille claquait comme un coup de feu sous mes chaussures. Mais le martèlement de mes pieds sur le sol faisait un bruit sourd qui m’était insupportable et qui me secouait tout le corps. J’avais très froid. Ma bouche était desséchée et j’avais mal à la gorge. J’essayai en vain d’avaler ma salive. Je me suis penché sur la source et j’ai bu dans le creux de ma main.
L’eau m’a paru tiède, presque chaude. Machinalement, j’ai plongé ma main dans ma poche pour atteindre le gobelet pliant que m’avait donné Marescot. Je n’ai retiré qu’une poignée d’éclats et d’écailles sans poids. Alors, pour la première fois depuis mon enfance, je me suis mis à pleurer. Ma gorge s’est serrée très douloureusement et des larmes ont coulé sur mes joues. La voix claire qui ne cessait de parler derrière moi, sans que je prenne garde à ses paroles, a crié tout à coup le prénom de Marescot. Et lorsque je l’ai entendue répéter sur un ton aigu et plaintif : « Georges… Georges », je me suis mis à sangloter comme un gamin, car jamais je n’avais osé appeler Marès par son prénom. Et c’était infiniment doux et infiniment terrible d’entendre chanter ce petit nom tout contre moi. J’ai jeté les débris cendreux du gobelet au milieu de la source. Je me suis levé et, écartant les branches et les épines, j’ai foncé à travers le buisson. Dans le fracas des branches cassées et le griffement des ronces, j’ai atteint le pré et je me suis trouvé sous le ciel. Le ciel était mort.
Immobile, la tête levée, je suis resté comme paralysé de surprise et de peur. Je respirais à petits coups rapides, comme un homme à bout de souffle. Le ciel était mort. De grands nuages noirs le couvraient complètement. Leurs volutes énormes semblaient pétrifiées. Ces nuages ne bougeaient pas. Ils étaient absolument immobiles et solides comme des marbres suspendus. On eût dit un amoncellement de rochers prêts à s’écrouler sur la terre au moindre choc. C’était un ciel d’orage, un ciel de grand orage, mais immobilisé en pleine furie. Je voyais au-dessus de moi, jusqu’à l’horizon, des vagues, des croupes, des ventres, des montagnes de nuages entassés dans le ciel, posés bout à bout et très bas. L’un d’eux paraissait toucher le haut d’Artigalas. Il pendait à moins de cent mètres au-dessus du plus haut sapin. À sa base pointait un lambeau régulier en forme de soc de charrue. Aux endroits où se joignaient les amoncellements noirs des nuages, il y avait des stries lumineuses, des bandes jaunes et pourpres. Une lueur d’un jaune cuivré baignait le vallon. C’était une lumière faible et diffuse qui ne marquait aucune ombre. Cependant, tous les objets étaient éclairés avec une extrême netteté. Je pouvais distinguer chaque feuille d’un arbre situé à cinq cents mètres de moi et j’aurais pu compter les tuiles du moulin Pagnoux, habituellement effacé par son rideau de peupliers. Il n’y avait pas un souffle d’air et il faisait très froid. J’étais noyé dans un silence d’une profondeur et d’une étendue infinies. Les battements de mon cœur sonnaient à tous les échos du vallon. Soudain, j’ai vu Rita couchée près de moi et qui me regardait. Elle était allongée dans l’herbe, levant sa bonne tête et me fixant de ses yeux brillants. J’ai fait deux pas vers elle. Mais son regard ne suivait pas mon regard, ses yeux restaient immobiles, attachés à un point de l’espace, où je n’étais plus. J’ai voulu l’appeler, mais la peur du grand silence m’empêcha de parler. Je me suis agenouillé près d’elle. J’ai posé doucement ma main sur sa tête. Son poil était glacé. J’ai glissé mon index dans sa gueule entrouverte et j’ai touché sa langue humide. J’ai ressenti un froid de mort. Et pourtant, ma brave chienne était là, allongée sans raideur dans une posture familière, la tête haute, le regard vivant, le poil luisant, prête à bondir. Une envie m’a pris de la secouer, de la frictionner pour la réchauffer et la rendre vivante.
Un sentiment mêlé d’horreur et de tendresse m’a retenu. J’ai seulement passé ma main sur sa tête et son échine, dans une caresse très légère. Mes doigts ont effleuré son collier de cuir. La petite plaque de fer où étaient gravés mon nom et mon adresse s’est brisée en deux, ou plutôt s’est déchirée comme une feuille de papier. Une des lamelles a glissé dans le poil de la bête, tandis que l’autre est restée fixée au collier.
Je me suis éloigné à grands pas, me dirigeant vers la route de Vignolles. Je marchais le visage levé, cherchant en vain à apercevoir le ciel entre les masses noires d’aspect minéral qui se voûtaient comme une coupole au-dessus de moi. Le bruit que faisaient mes genoux en se frôlant dans le gros pantalon de velours et le bruit de mes pieds fendant l’herbe formaient une rumeur sifflante et rythmée, comme la chanson d’une faux prodigieuse.
En abordant la route de Vignolles, j’ai hésité un moment sur la direction que j’allais prendre. Je me suis tourné vers Angoulême. Derrière les vergnes, j’apercevais la gare de Saint-Martin, au-delà du petit pont sur le Bandiat. C’est à cette gare que l’on descend lorsqu’on vient de Paris en changeant à Angoulême. C’est sur ce petit pont que j’avais attendu Marescot si souvent et en vain. J’ai marché vers la gare, puis j’ai rebroussé chemin avant d’atteindre le carrefour et je me suis dirigé vers Vignolles.
De ces moments-là, je n’ai gardé qu’un souvenir confus. J’étais encore effrayé par l’immobilité du ciel et assourdi par le claquement de mon pas sur la route. Les échos de la vallée me heurtaient de toutes parts. Je cherchais désespérément autour de moi un vol d’oiseau, un cri d’insecte, une odeur d’herbe ou de poussière. Lorsque je heurtais un caillou, les coteaux et le ciel hurlaient avec des prolongements rauques, des murmures qui ne finissaient pas de s’éteindre. Je croyais marcher dans une cathédrale immense, éclairée par des vitraux jaunes.
Que suis-je devenu, entre Faugeas et le viaduc ? Ici, mes souvenirs se perdent, se confondent dans la terreur retrouvée de mon premier contact avec le monde mort. J’allais sur la route familière, la petite route sèche et dure où j’ai fendu mes premiers sabots d’écolier, sous le coteau de Saint-Martin où j’ai tué mon premier lièvre. J’allais d’un pas hésitant, aveugle, trébuchant. La route semblait s’élargir et s’allonger à l’infini. Le coteau m’écrasait comme une montagne. Et je marchais, je marchais comme en rêve, ne sachant pas si mes jambes parcouraient des lieues et des lieues de pays étranges, ou si je piétinais lentement, sur place, le vieux sol limousin. Était-ce moi, ce pauvre bougre hagard, suffocant comme un nageur à bout de souffle, cherchant avidement l’odeur de l’air natal, étouffé par l’odeur de son propre corps ? Pourquoi ne suis-je pas mort à ce moment terrible ? Suis-je resté un jour ou un an sur la route de Vignolles ? Sous le coteau de Saint-Martin, ai-je marché cent pas ou cent mille pas ?