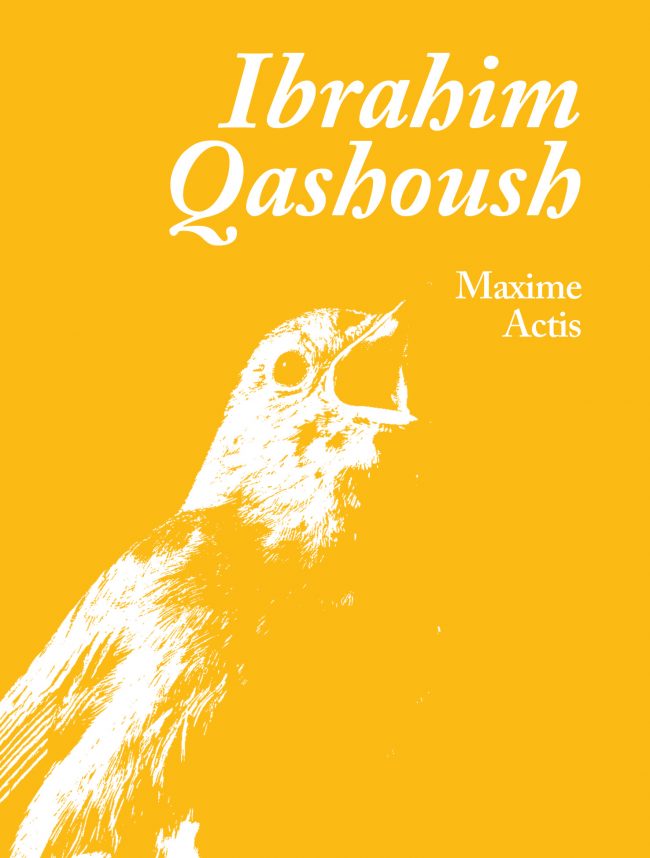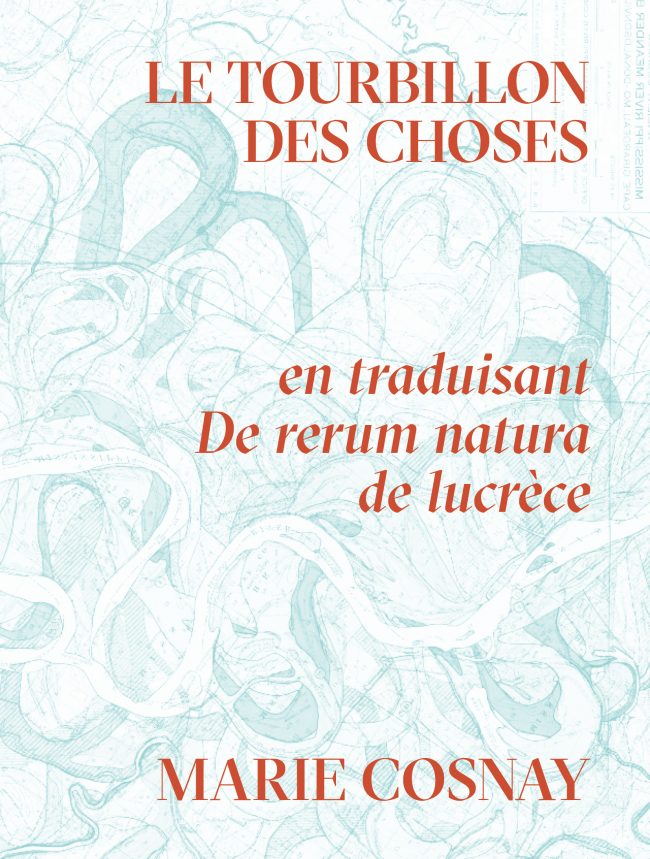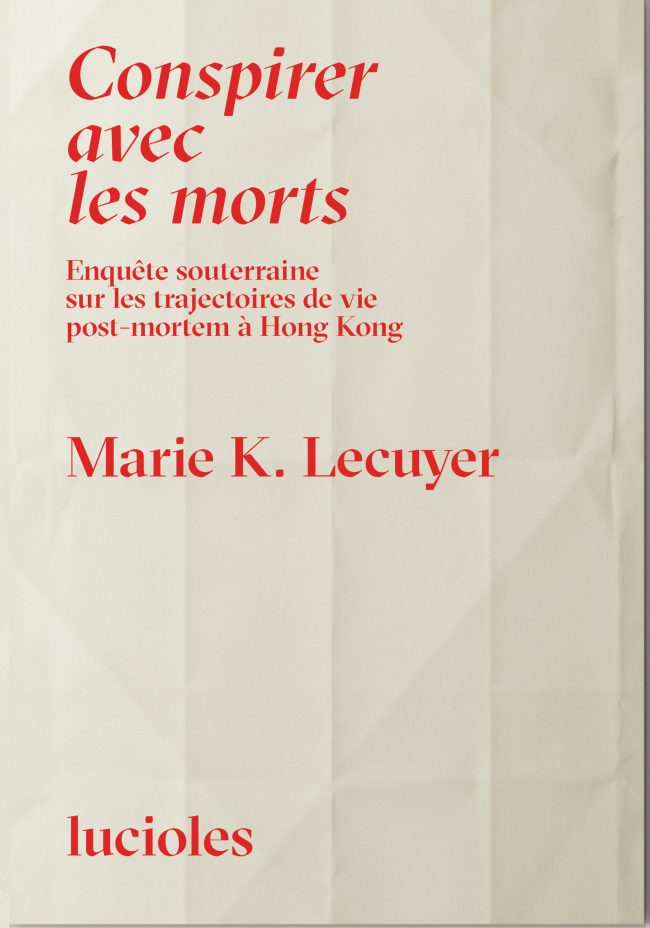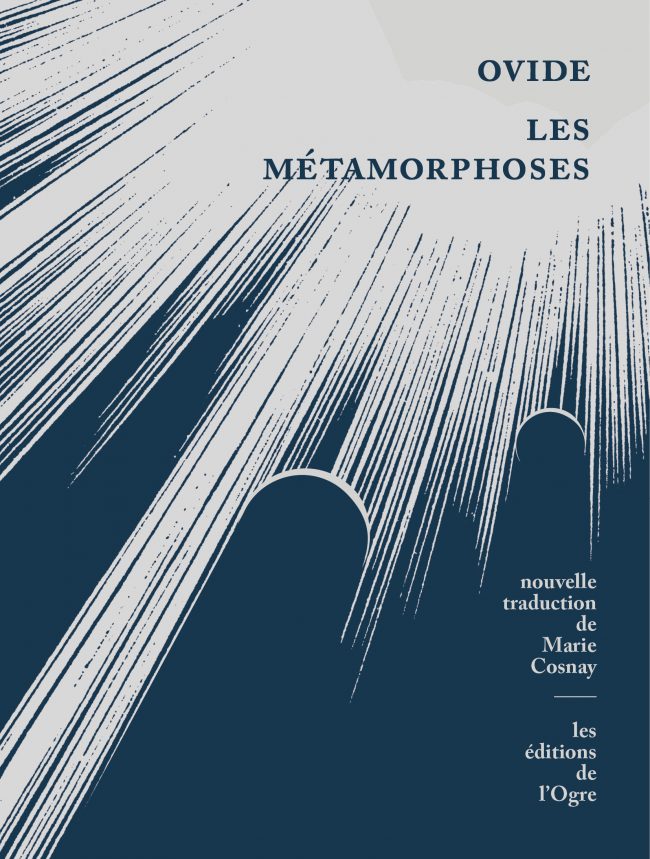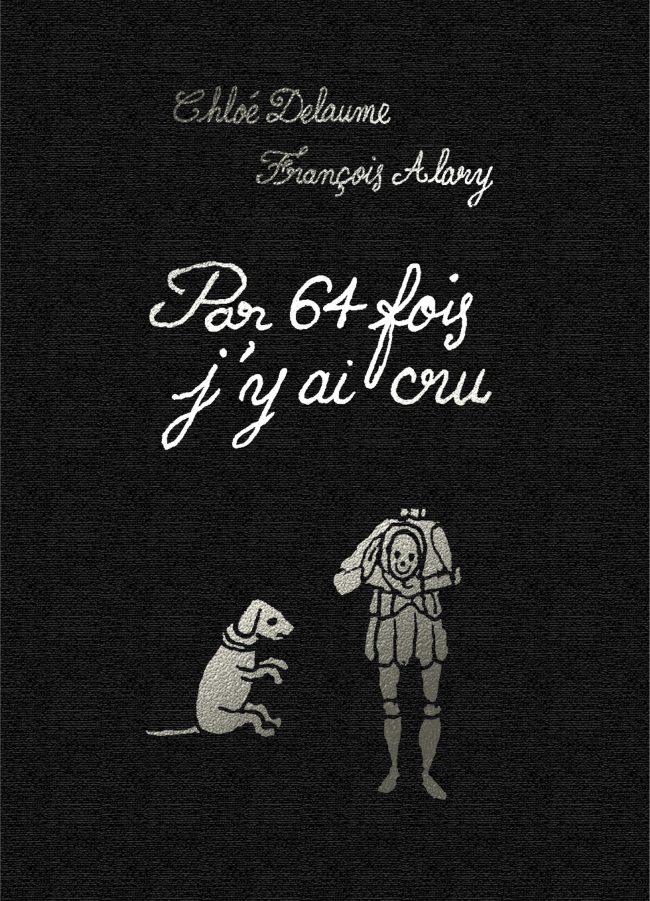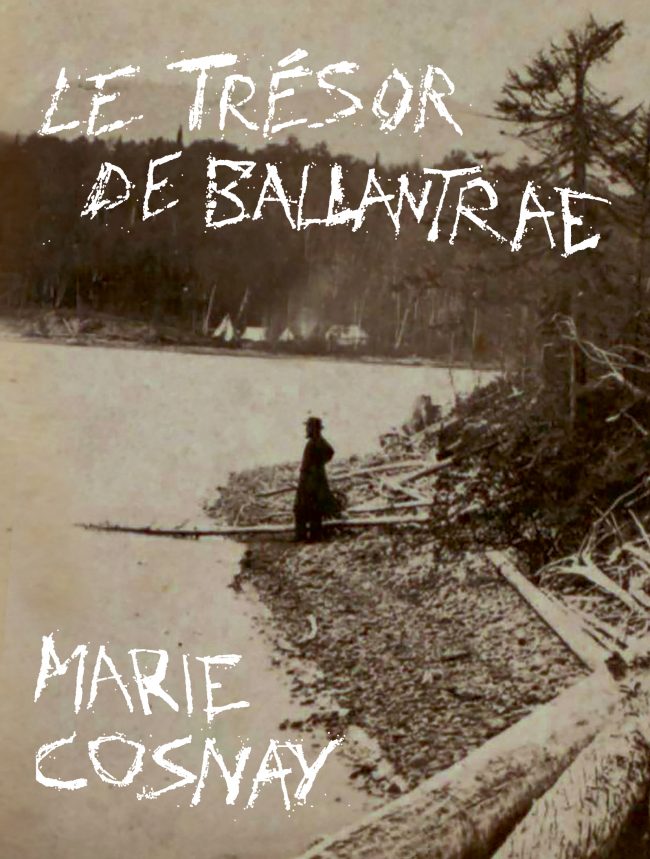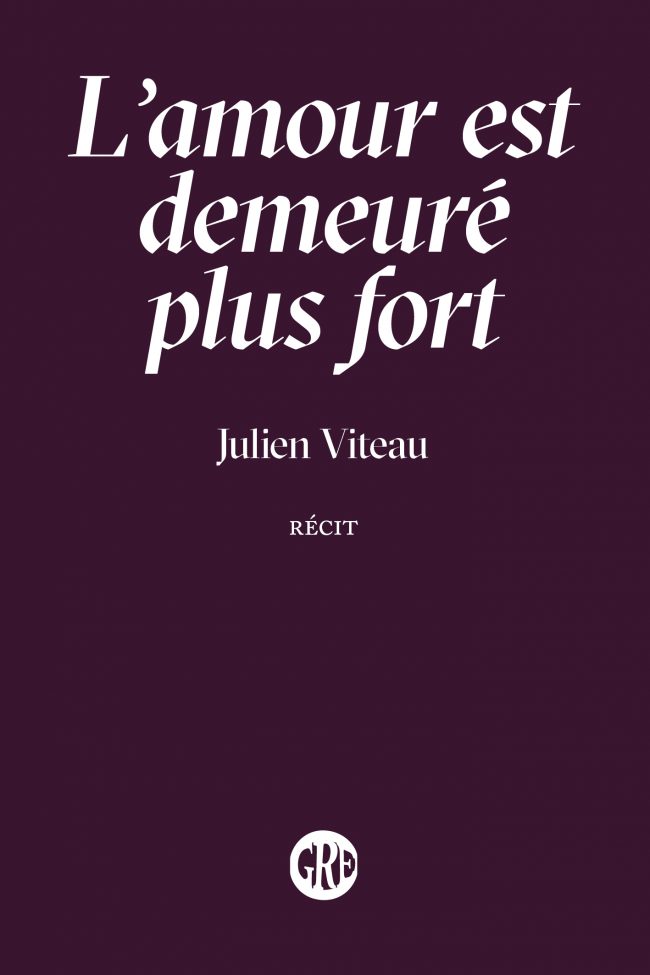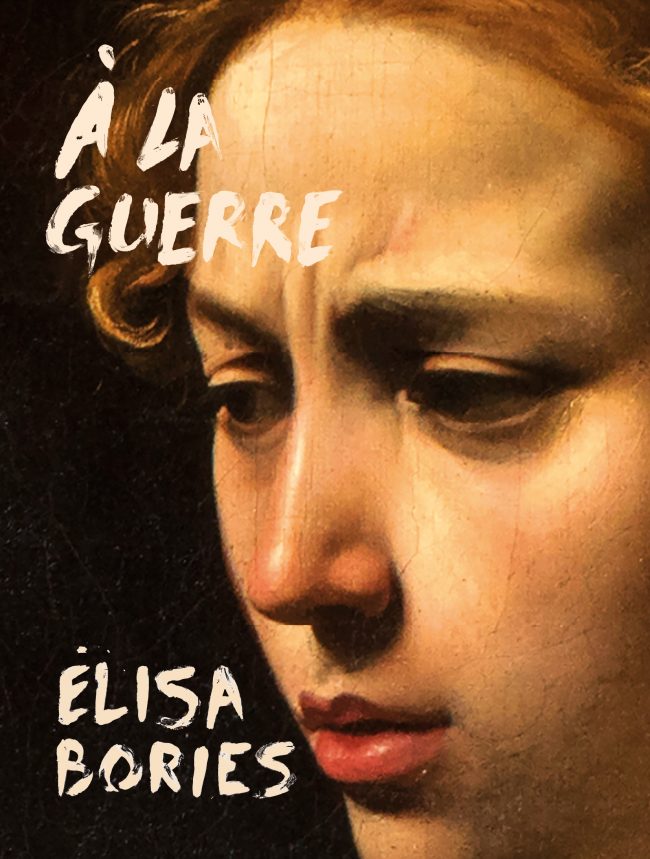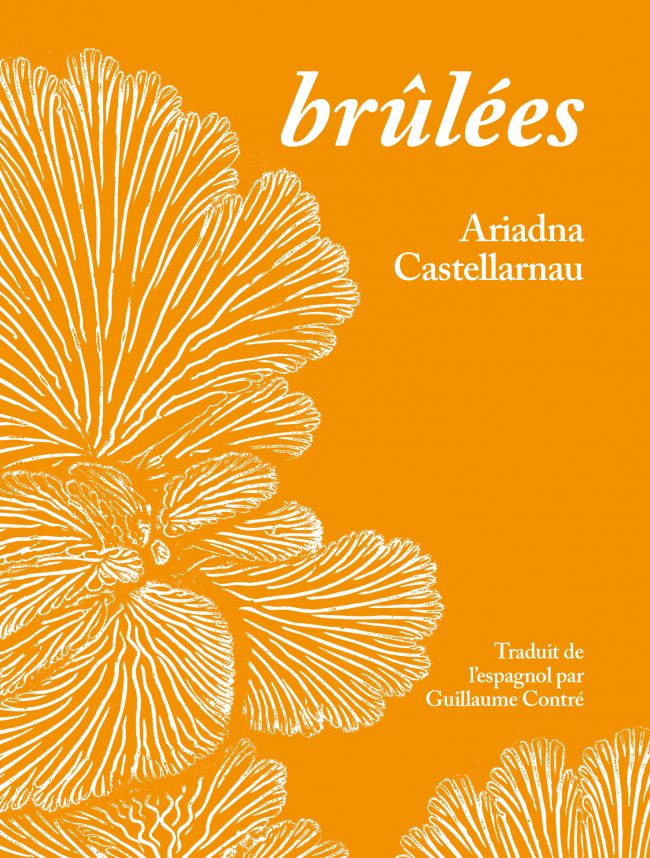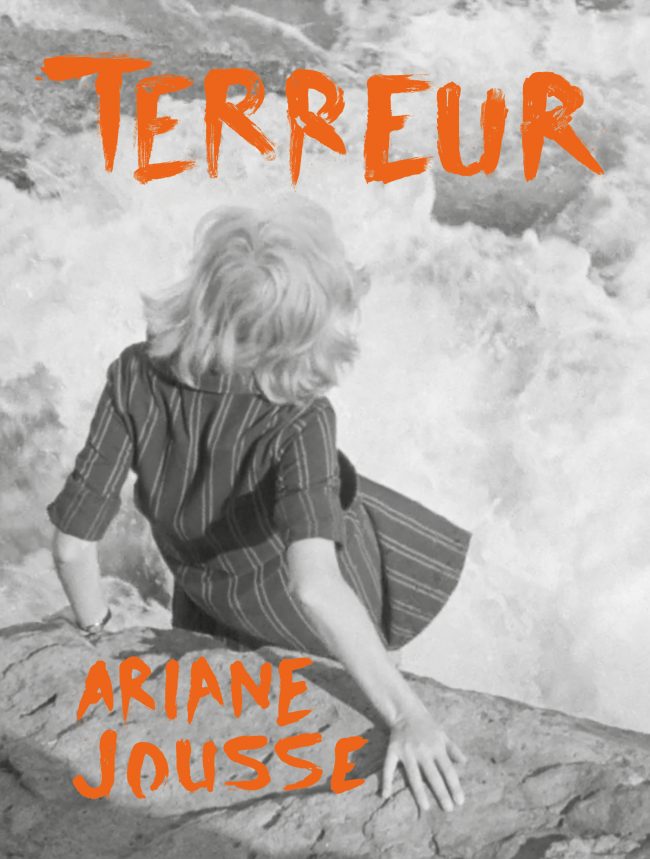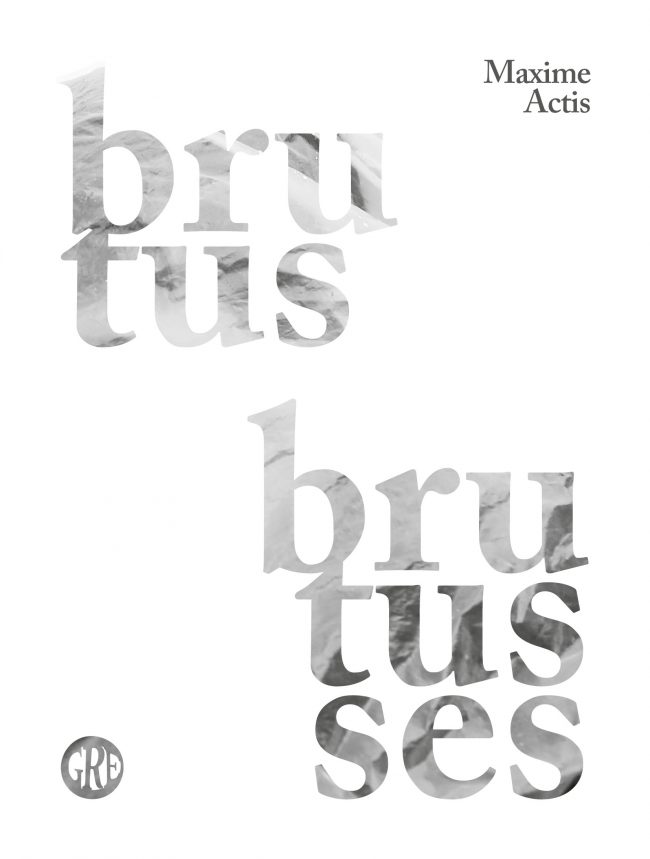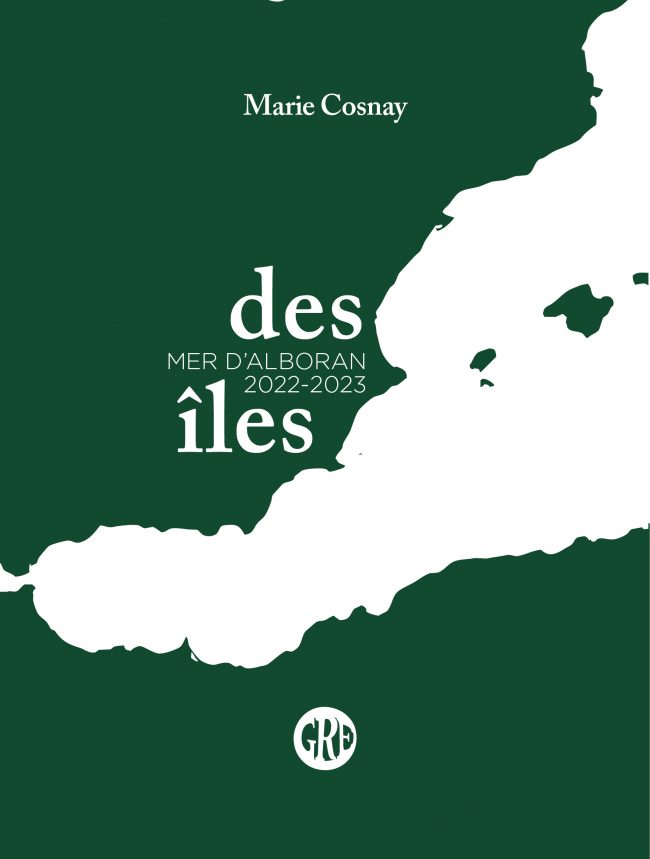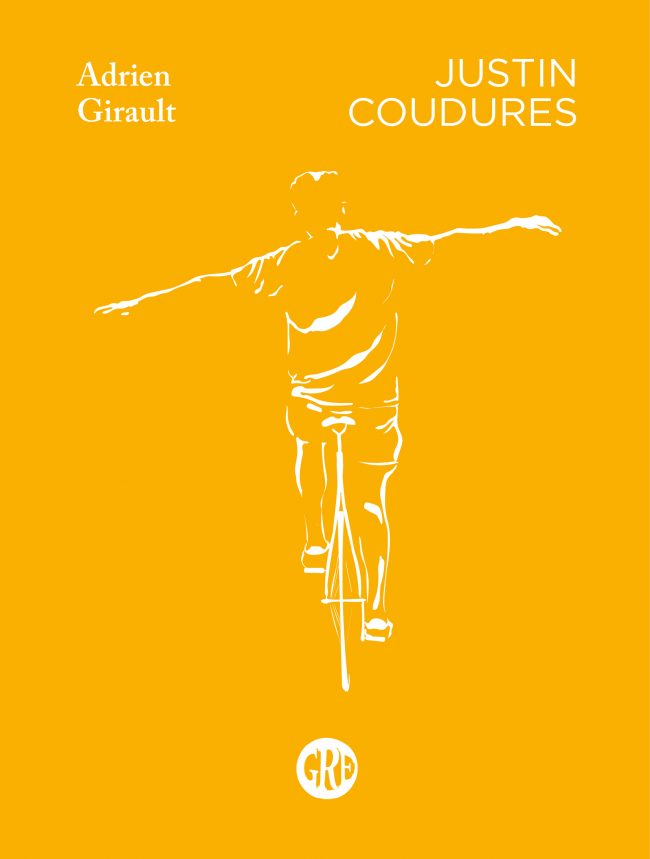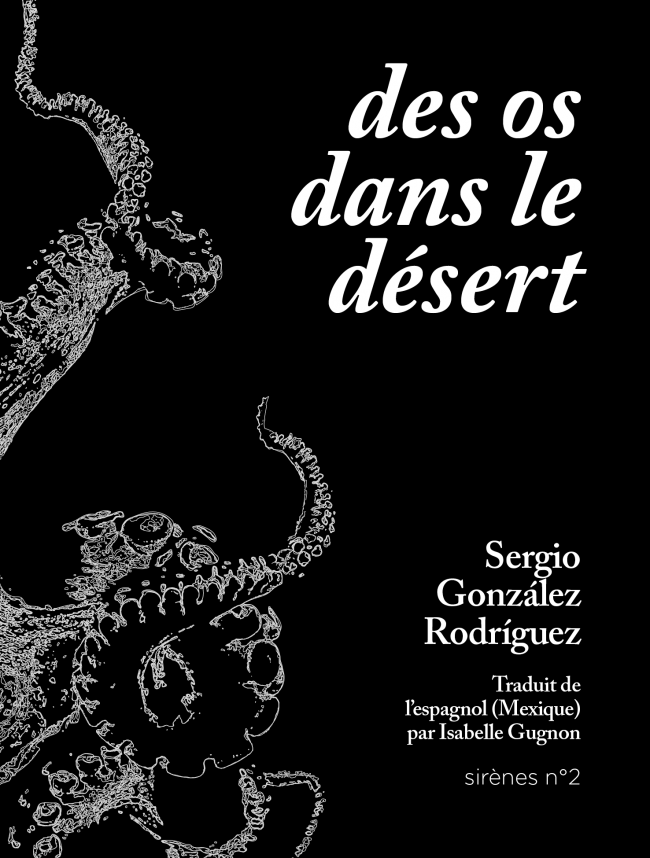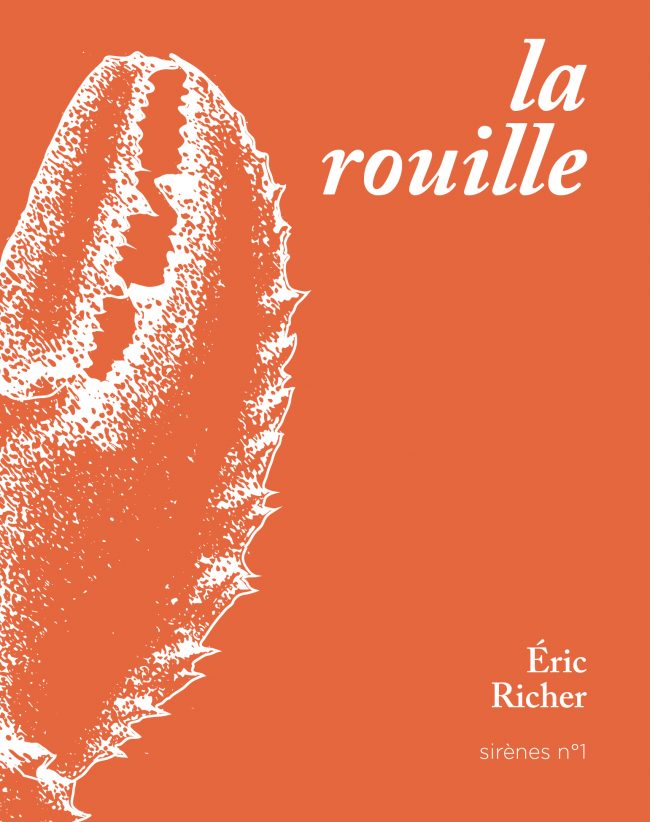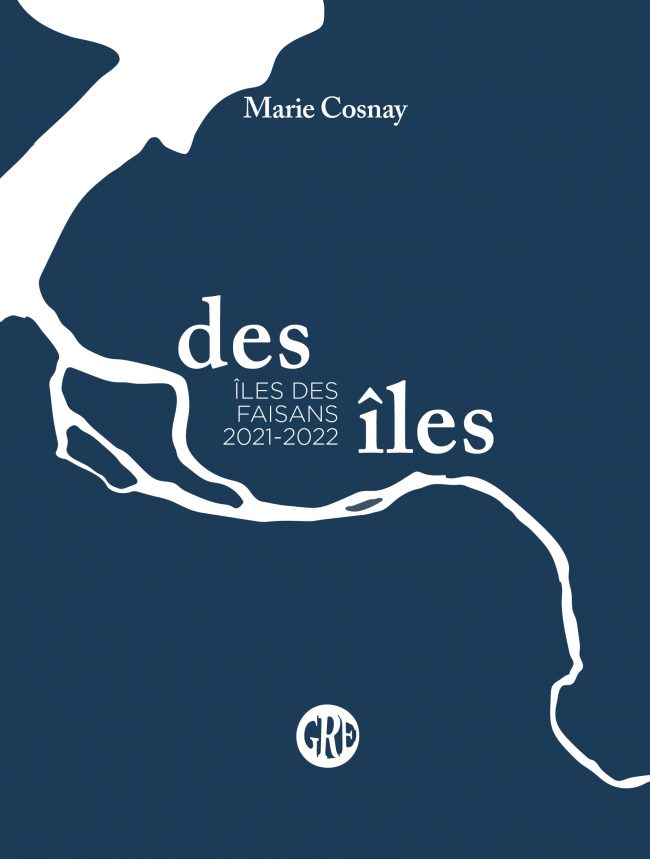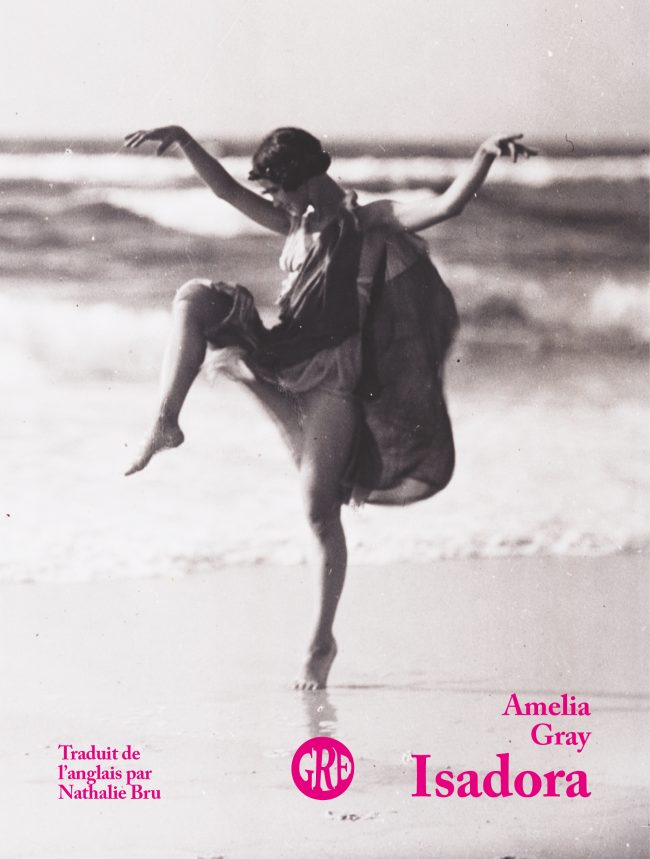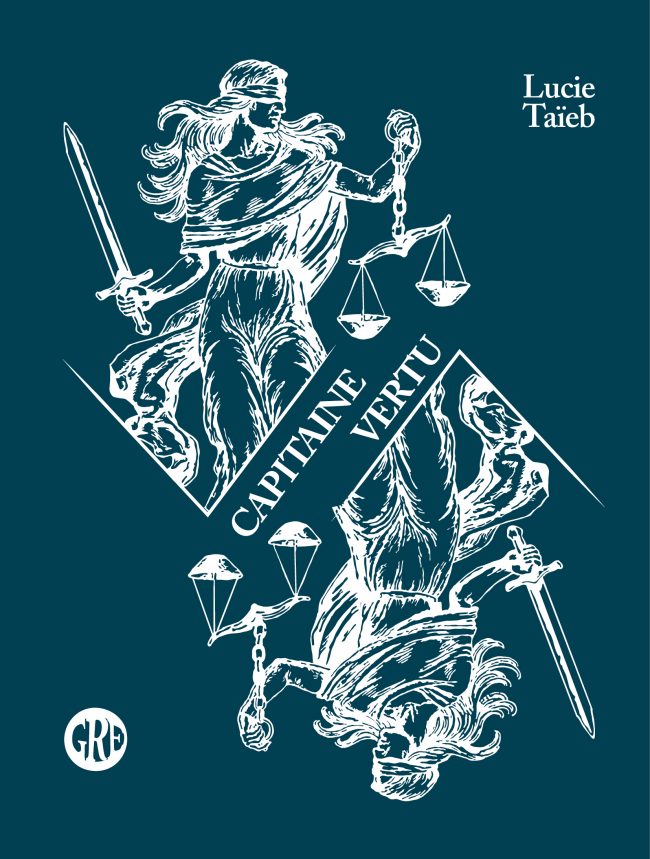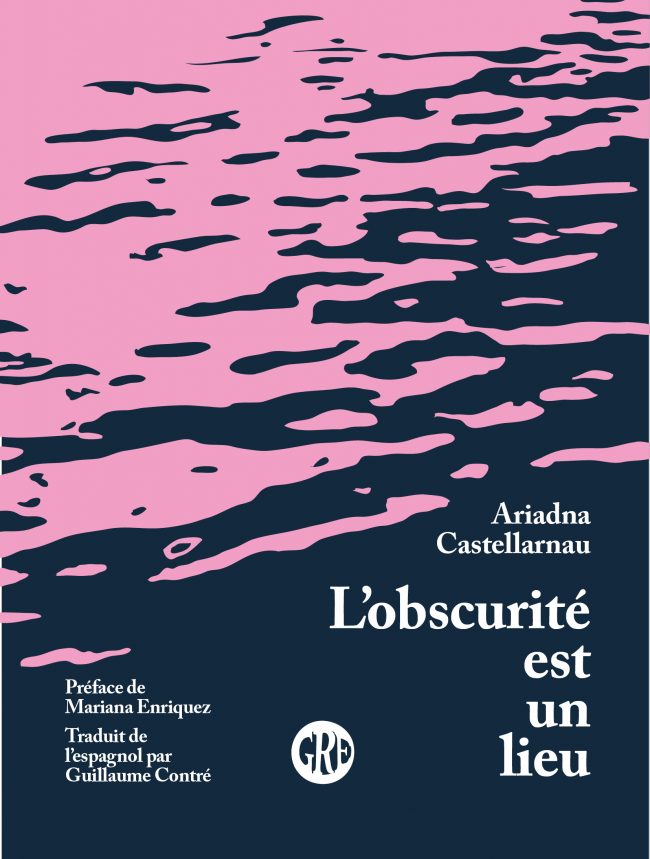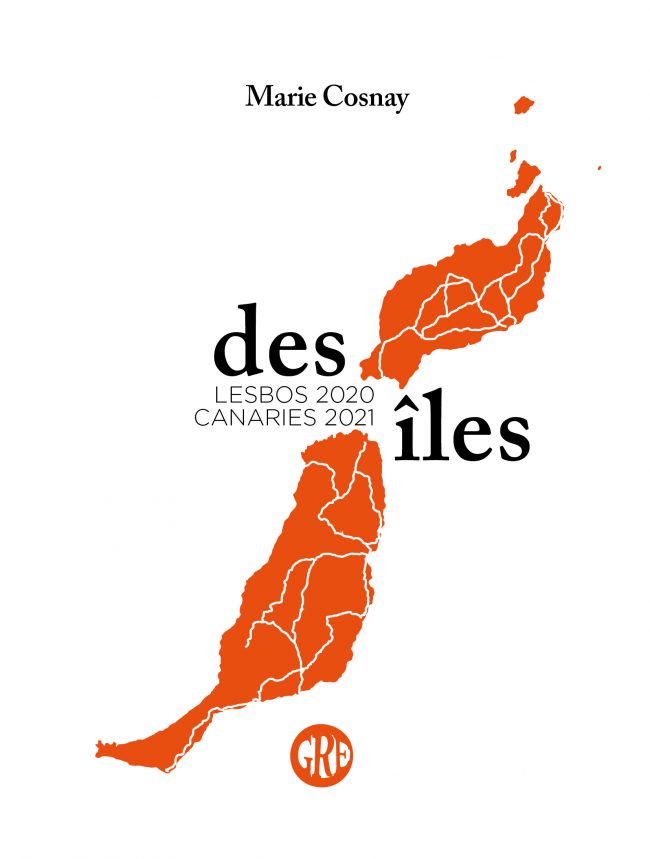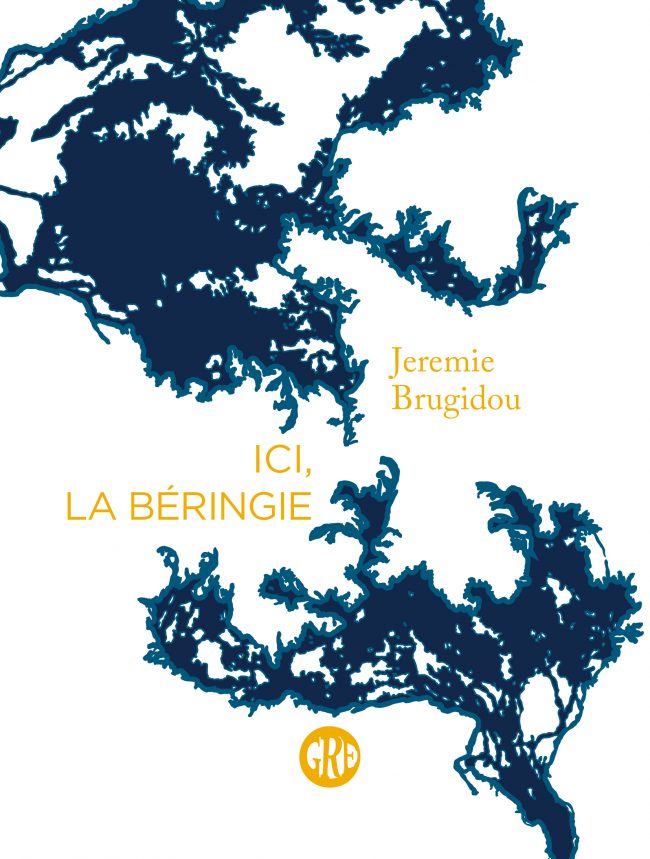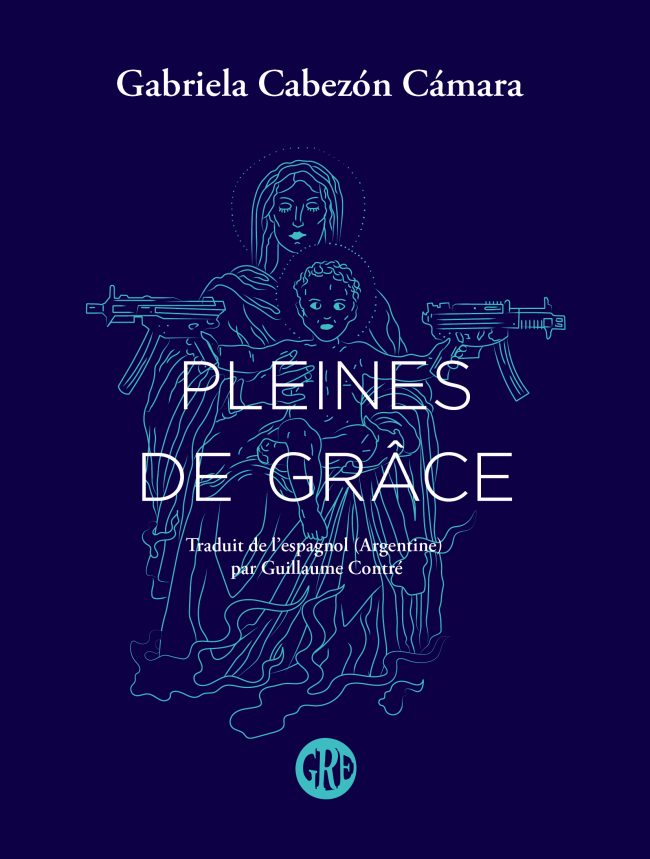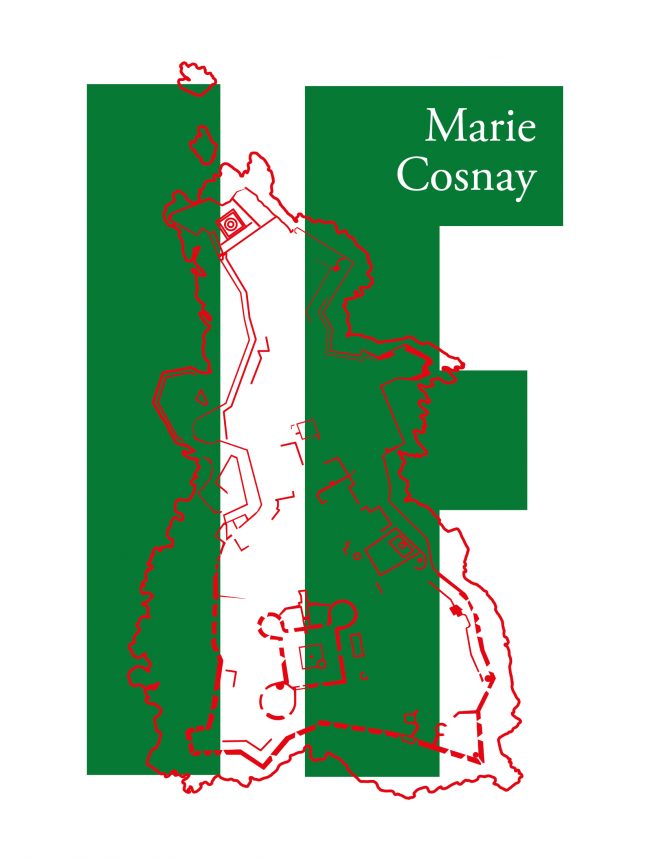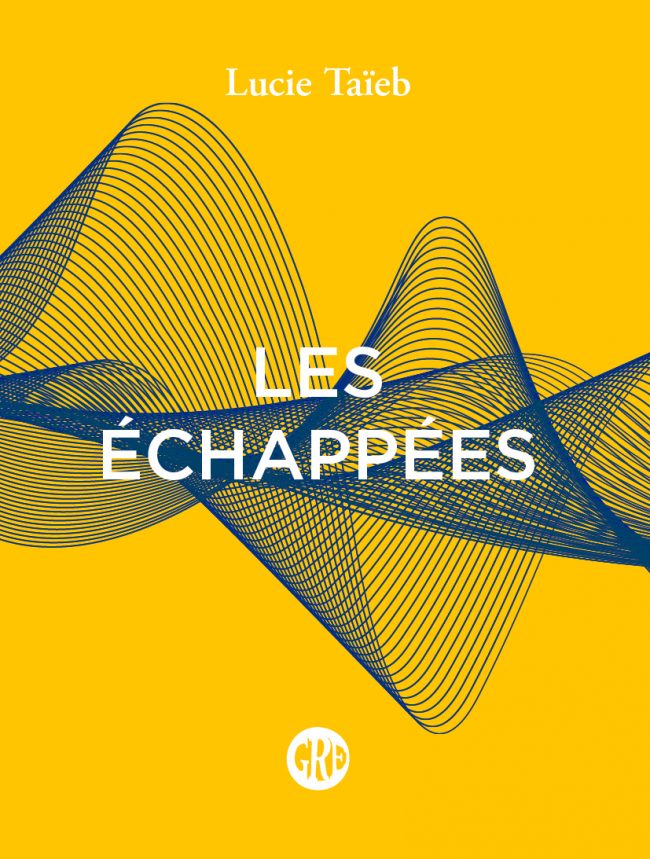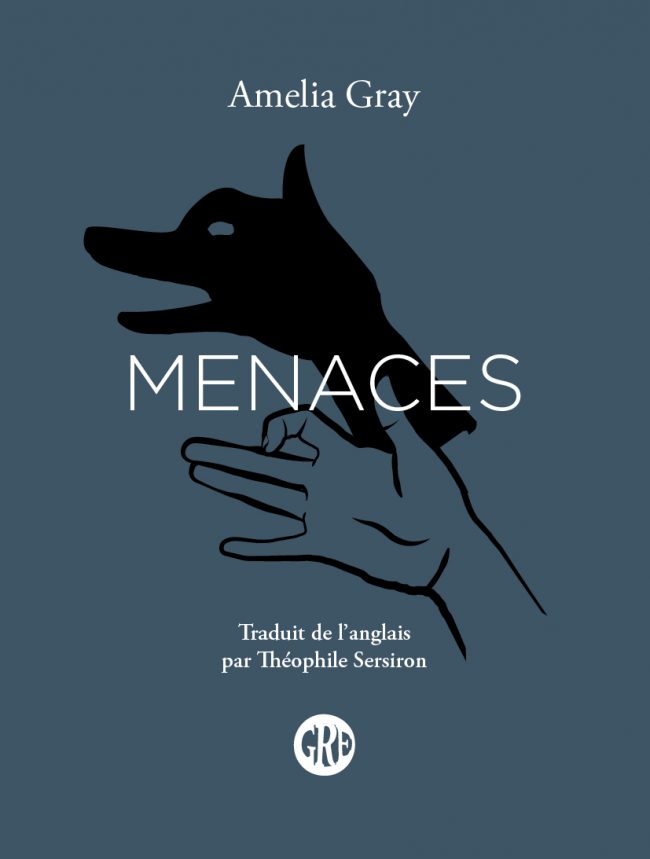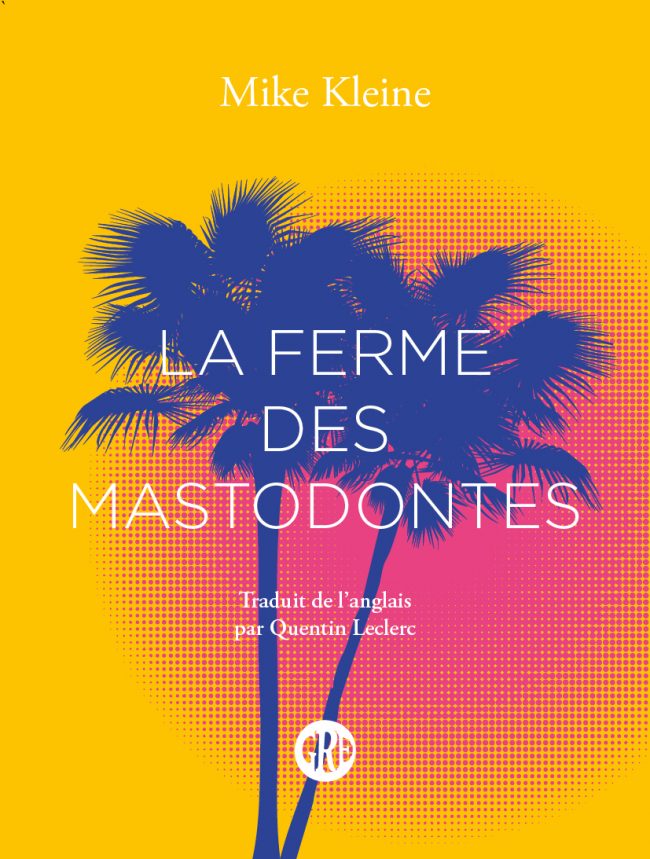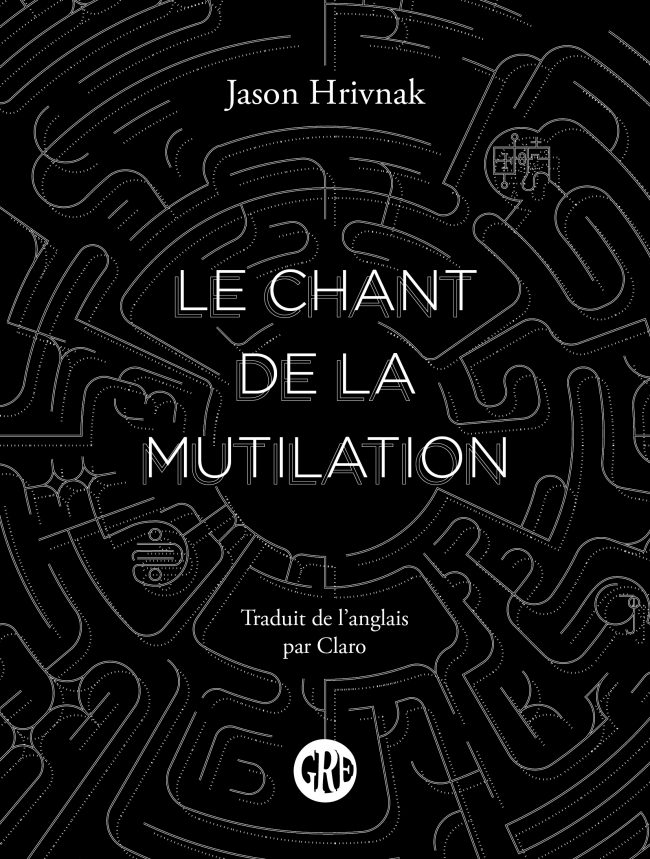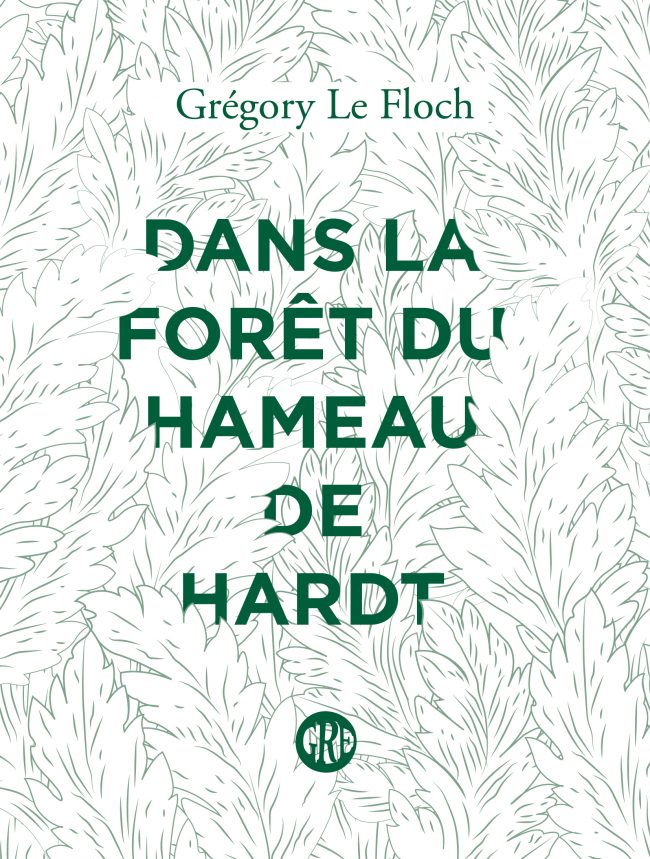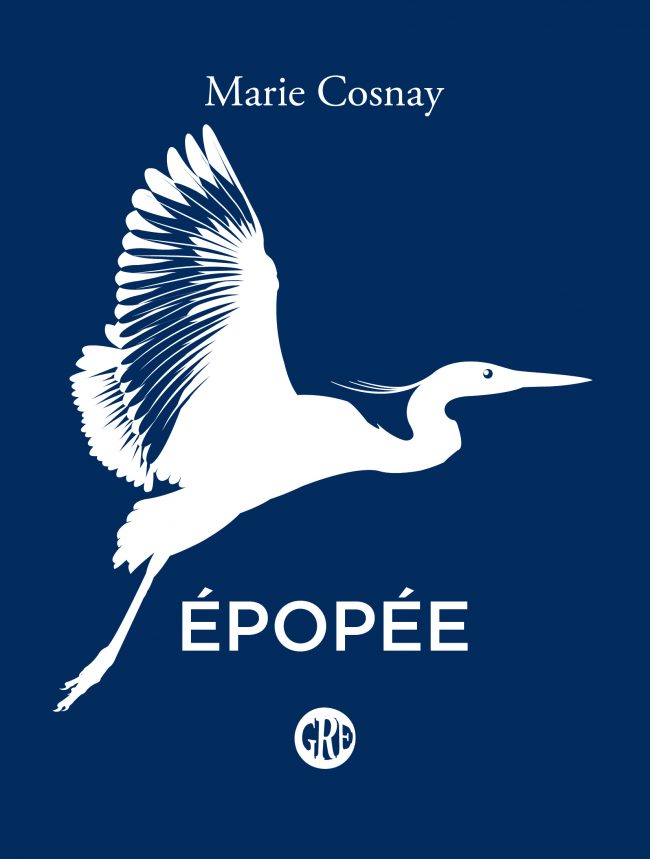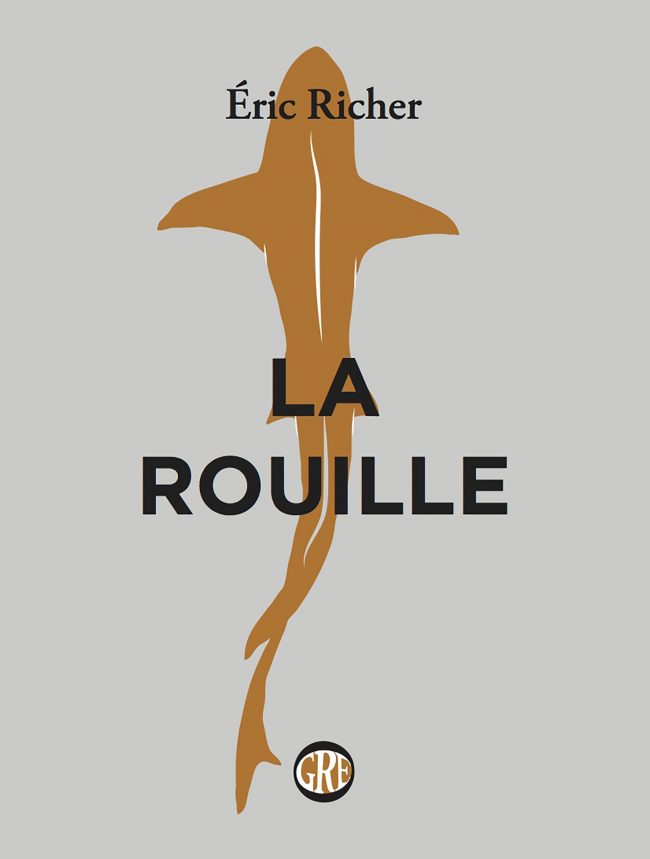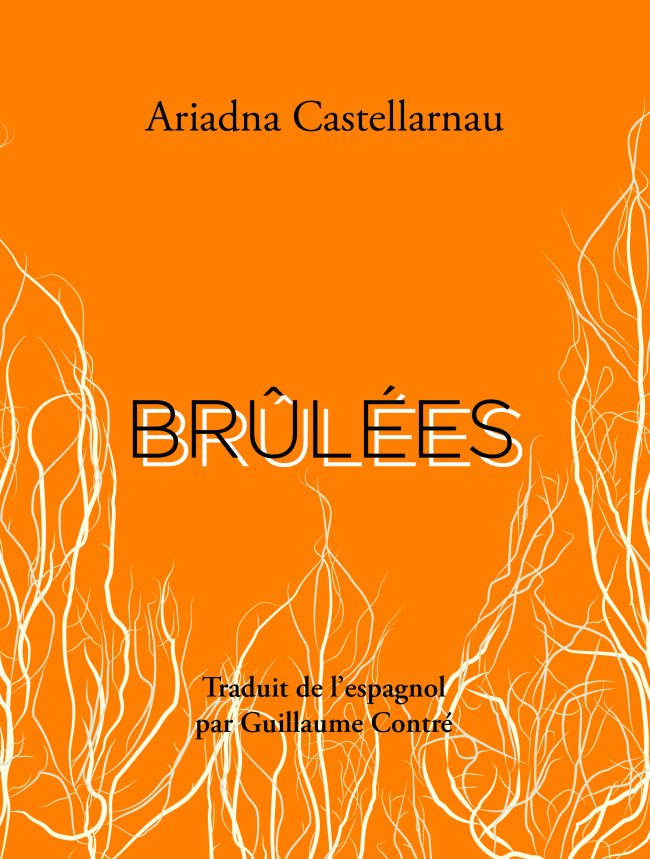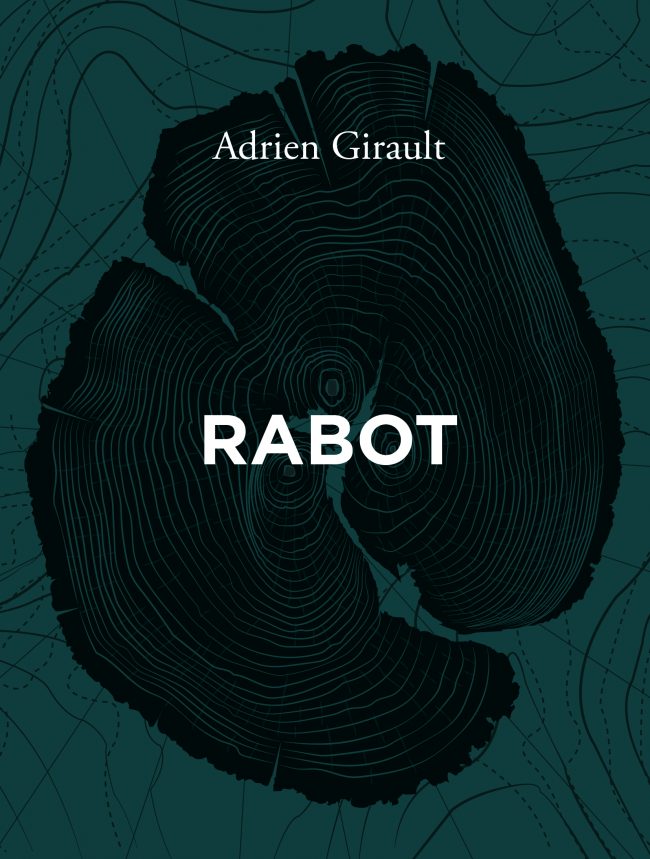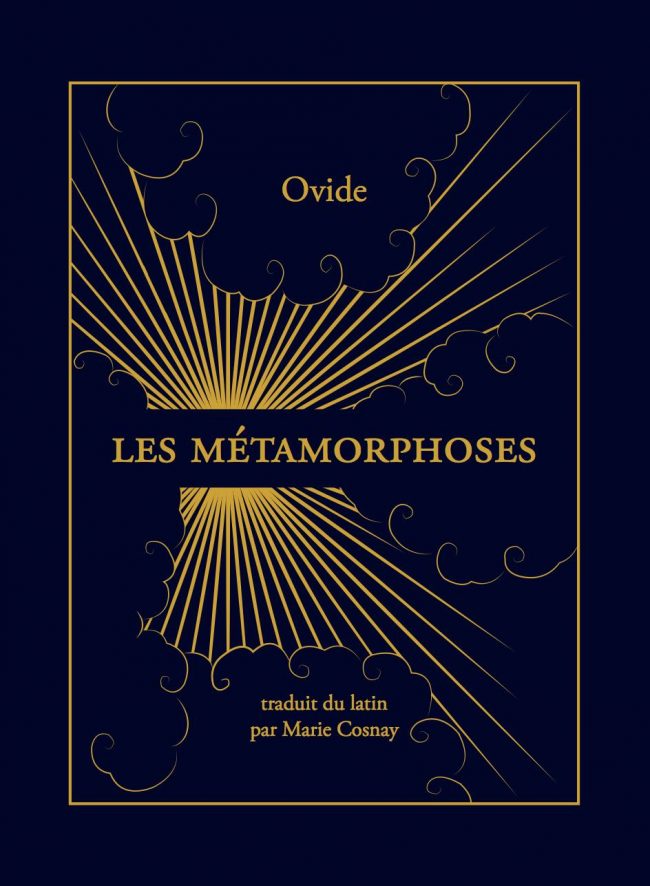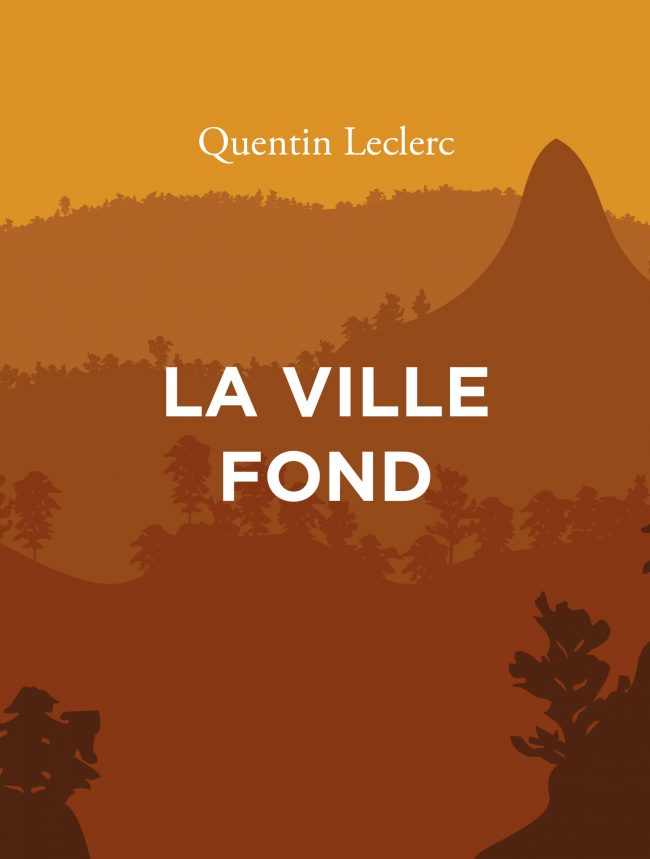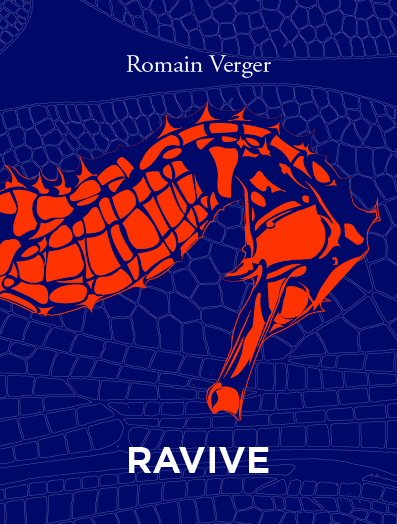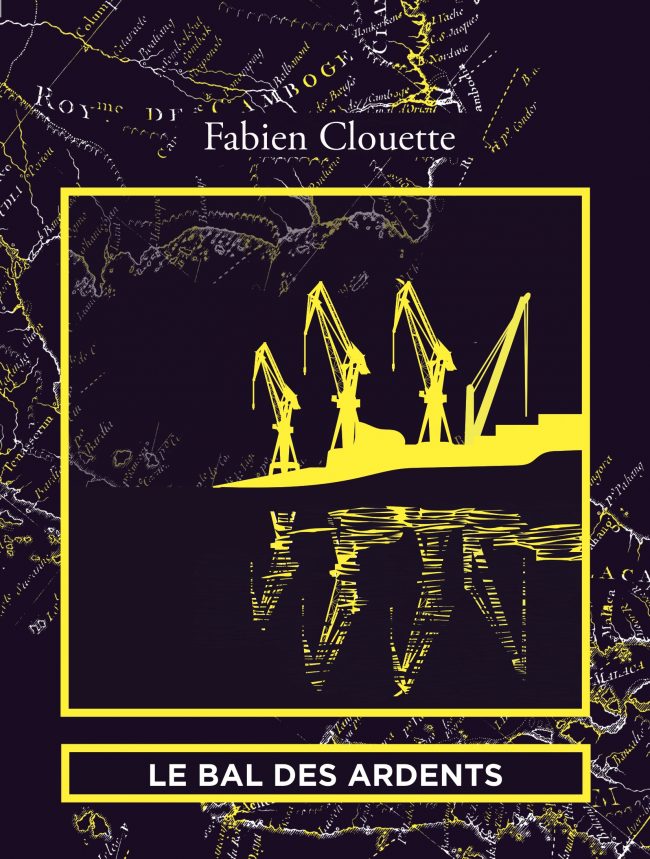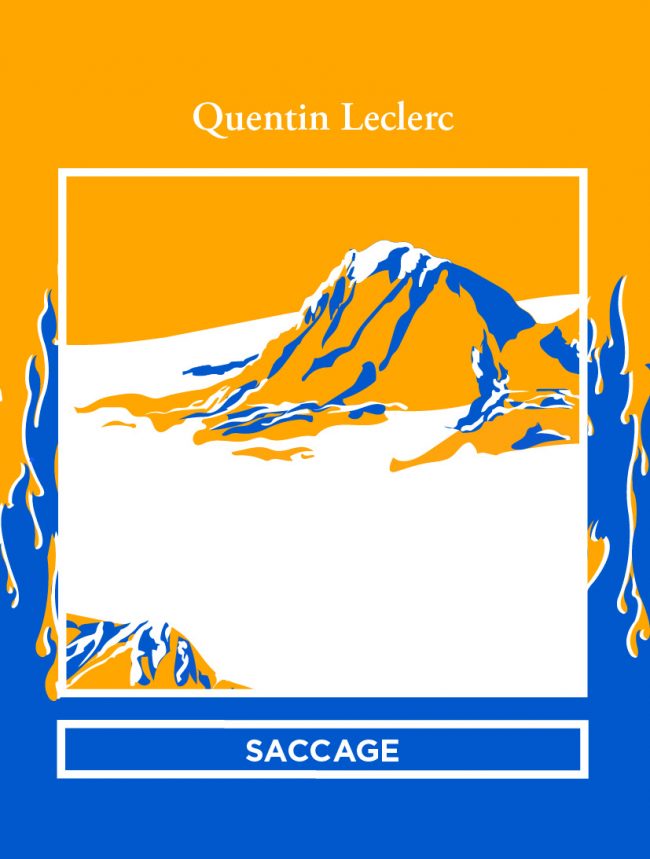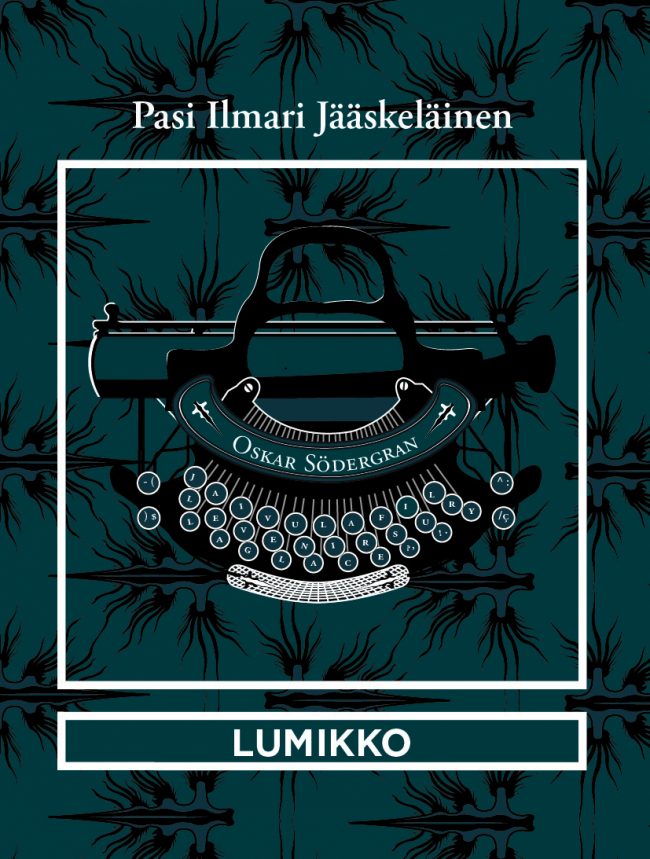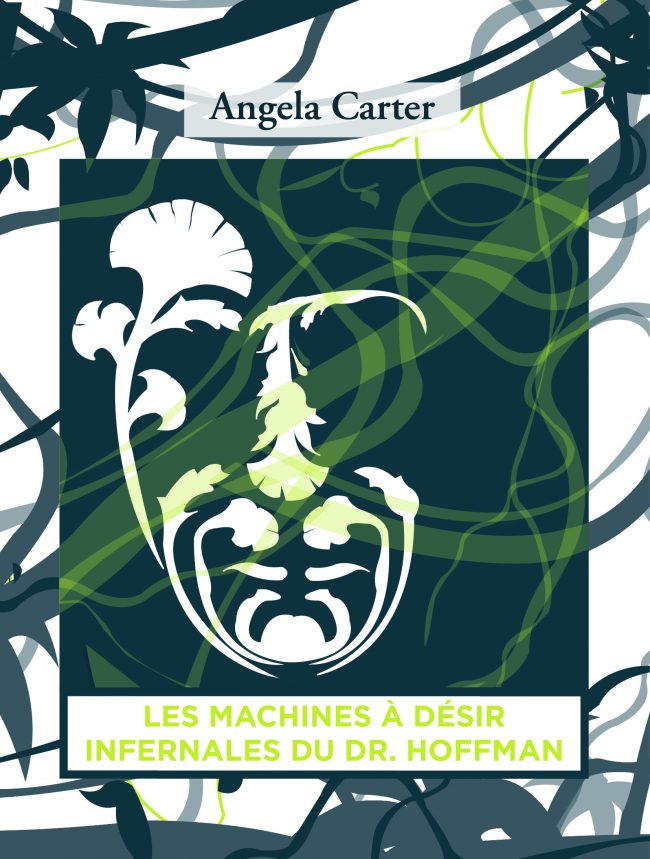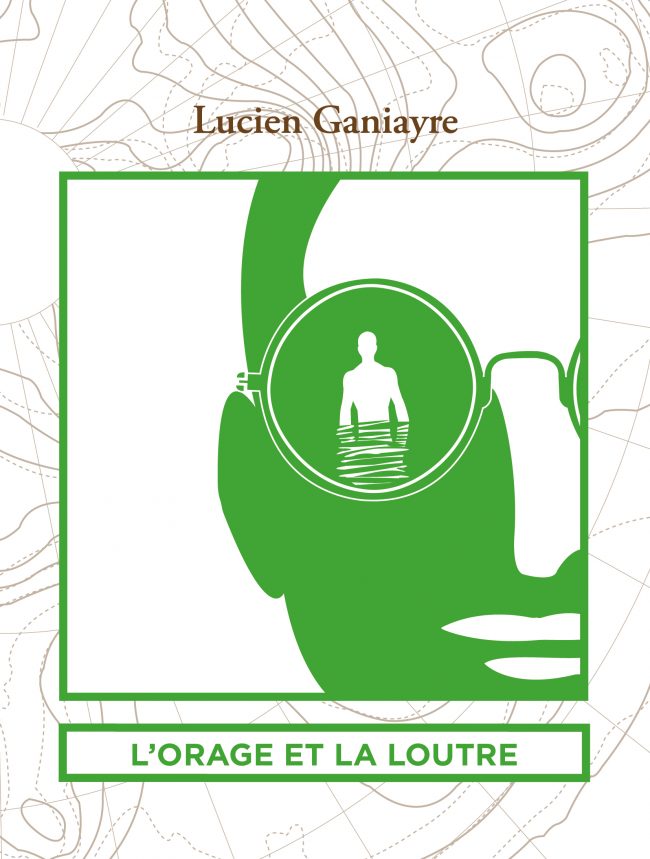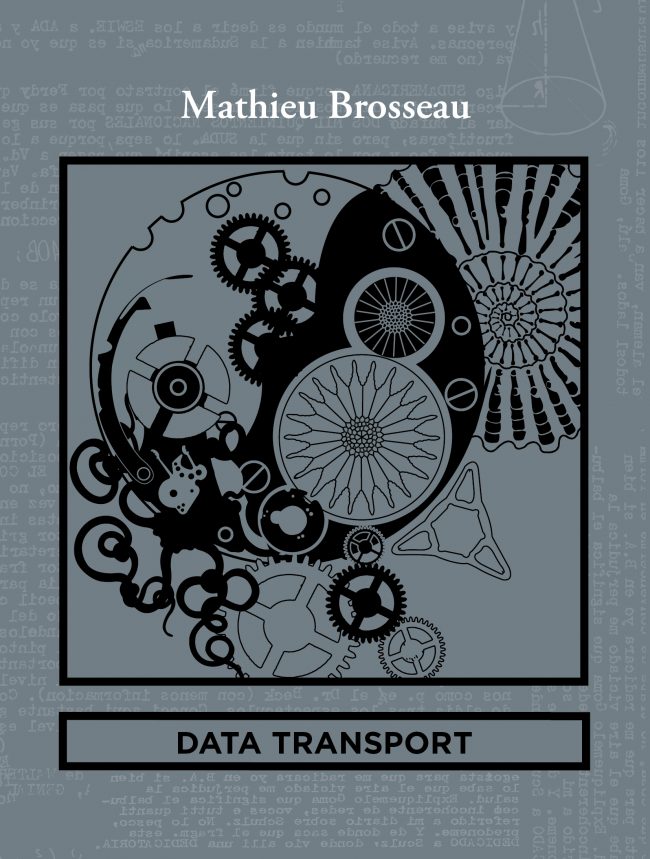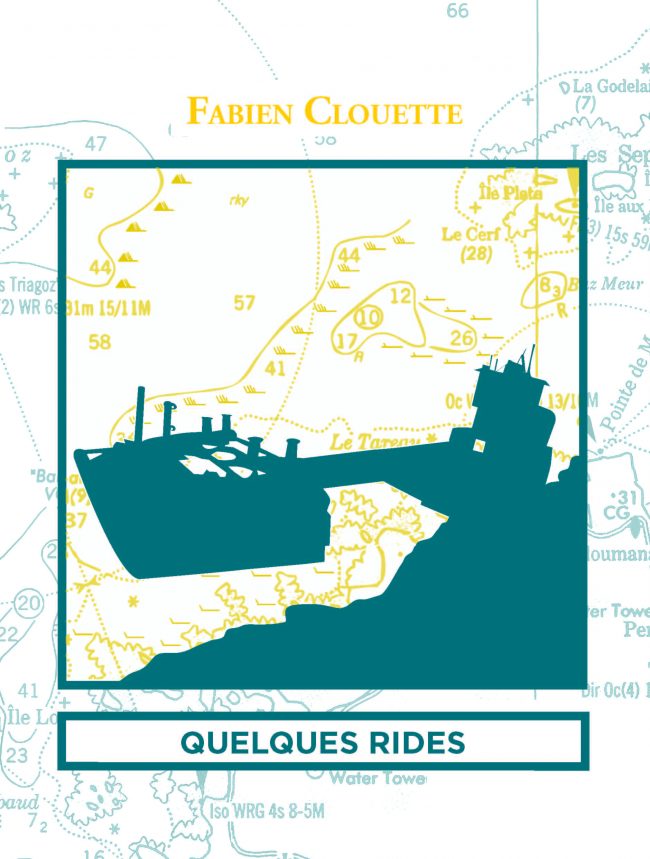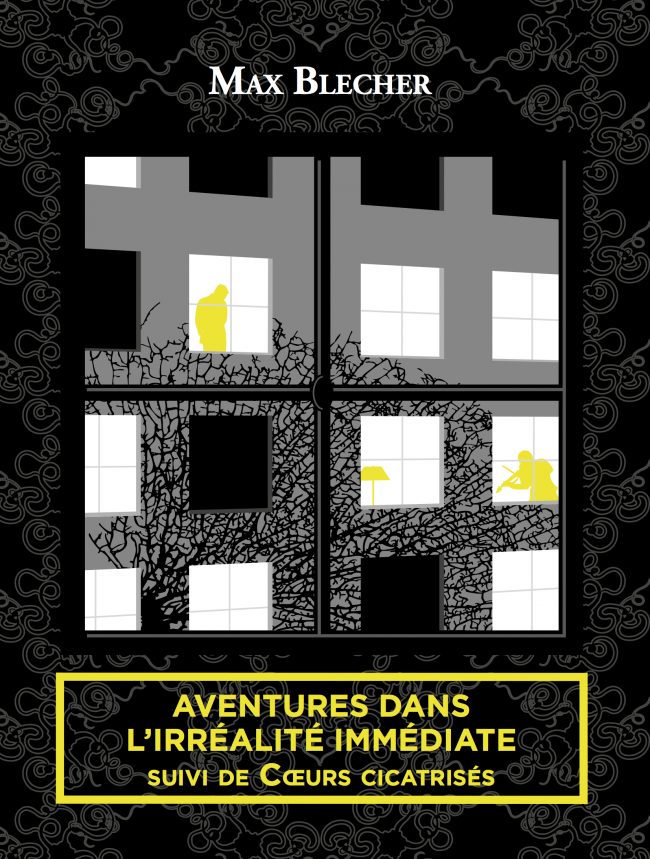Des années plus tard, entre son départ d’Argentine et son retour en Catalogne, elle a conçu les nouvelles de L’Obscurité est un lieu, qui ressemblent peu à son premier livre, si ce n’est dans leur écriture délicate et suggestive. La nouvelle qui donne son titre au volume se déroule, bien que cela ne soit pas dit, dans le Nord de l’Argentine. Dans la région du Nord-Est, plus exactement, là où se trouvent les grandes plantations de maté, la boisson favorite du pays tout entier, dont l’histoire, comme c’est souvent le cas lorsqu’il s’agit des puissants propriétaires terriens, est faite de brutalité et de travail mal payé confinant à l’esclavage. Mais c’est également une région clé pour son syncrétisme et son métissage : située à la frontière avec le Paraguay et le Brésil, elle vit en suspension entre des cultures et des croyances diverses. Ici, les mythes de la terre cohabitent avec la vie réelle, la terre est rouge, la forêt dense, et les créatures de la cosmogonie guarani – l’un des peuples autochtones de la région – partagent l’espace avec les immigrants d’Europe du Nord : c’est une région de communautés lituaniennes et suédoises, pleine de cimetières enchantés et de plats typiques du froid le plus extrême. L’un des protagonistes de la nouvelle est surnommé le Suédois et un lecteur peu au fait de la réalité de cette région si particulière pourrait croire à une licence de la fiction – ce qui est aussi le cas, bien sûr – ; pourtant, de nombreux habitants d’origine suédoise sont arrivés dans le pays au début du xxe siècle et se sont installés dans le Nord du pays. C’est une Amérique latine presque secrète et, ajoutée à l’imagination et au goût du merveilleux de Castellarnau – à la fois savant et enthousiaste –, c’est un paradis à découvrir. La violence de la nouvelle, dans cette région où la nature est ingouvernable, est unie à Lucía, une fillette en contact avec un esprit de la terre, lequel ressemble à un garçon mais n’en est pas un ; il veut être son ami tout en représentant quelque chose de menaçant, pas de ce monde. Tout cela, ce coin de la planète, est un monde personnel, fermé et secret. Il ne s’agit pas non plus d’un conte de fées conventionnel : l’allusion à Angela Carter et à sa relecture du merveilleux dans un contexte contemporain n’est pas gratuite, c’est une manière de dire que le récit ne s’achève pas, qu’il ne fait que changer de forme ; les mythologies locales et les traditions orales fantastiques furent et sont toujours des moyens de comprendre le monde, de faire le deuil, d’expliquer les joies, les malheurs et les dangers. Toujours, c’est-à-dire encore aujourd’hui.
Dans « Calypso », la nouvelle suivante, tout n’est que danger et inquiétude. Pire encore, il s’agit d’un des pires maux contemporains : le trafic de petites filles à des fins sexuelles ou allez savoir à quelles fins. Où vont toutes ces fillettes qui disparaissent, comme dans les contes justement, comme si elles pénétraient dans un bois, à ceci près qu’il s’agit maintenant de monter dans une camionnette à l’aube ? Le conducteur, bien sûr, est toujours un loup, un prédateur. La petite fille de « Calypso » parle sans arrêt et nous ignorons si c’est parce qu’elle n’a pas peur ou qu’elle n’a aucune idée de ce qui pourrait lui arriver. Peu importe : la tension est insupportable parce qu’en tant que lecteur, nous savons qu’elle fait face à un danger indicible. On n’en dira pas plus ici, si ce n’est que cette fillette prodigue en mots possède un secret, un sortilège. Protéger les fillettes dans ce monde n’est pas facile et il est encore plus difficile de le faire quand elles sont seules. « Calypso » est une nouvelle qui évite la perversion et la violence, préférant se faufiler dans un territoire qui précède l’explosion, une cocotte-minute où la tension conduit à une fin inattendue.
« Marina Fun » est l’une des nouvelles centrales de ce recueil pour de nombreuses raisons. Elle est non seulement très drôle, particulièrement dans sa description hyperréaliste des relations familiales, mais surtout elle inverse un thème classique des contes de fées : ici, plutôt qu’une sirène-fillette ou une jeune femme, nous avons un garçon-sirène qui dépérit dans la piscine à l’arrière de chez lui, qui contribue à l’économie du foyer telle une attraction de foire, et qui s’appelle Nilo, comme le fleuve d’Égypte. Le décor est contemporain : Nilo a des fans, des filles désespérées et amoureuses. Dans un article publié sur la revue en ligne Libros prohibidos, la critique Maielis González écrit : « L’objectif n’est jamais d’expliquer l’origine de l’anomalie ou du monstrueux, le potentiel effet horrifique de ces éléments surnaturels est atténué par l’effet de réalité et le comportement de ceux que nous considérons comme « normaux ». » Les enfants supportent le poids du monstrueux, du terrifiant : ils sont la bombe qui réduit la famille en éclats. Comme c’est souvent le cas dans la réalité. Et comme le sont souvent les enfants dans les contes de fées. Lors d’un entretien pour The Objective, Castellarnau a dit : « Je crois que l’esprit humain est un lieu plutôt sombre. La plupart des personnes, et j’en fais partie, passent beaucoup de temps enveloppés dans leurs phobies, leurs manies, leurs cauchemars ou leurs peurs. Lorsque de telles pensées ne nous occupent pas, c’est que nous essayons d’y échapper. Mais l’obscurité est aussi un grand sujet pour la littérature. Ce qui ne veut pas dire qu’il faut avoir une âme tourmentée pour pouvoir écrire. Néanmoins, l’obscurité est un terrain intéressant où s’aventurer. Je trouve qu’il y a une grande beauté dans ce qui nous déconcerte, dans ce qui est étrange, monstrueux, tordu. »
Le moment est venu de dire que ces récits, bien qu’enracinés dans la tradition du conte de fées, sont des fictions obscures. On y trouve de la terreur, du fantastique, de l’angoisse, une réalité qui se fendille. Et, au centre de cet univers sombre, on trouve des familles. Castellarnau expliquait dans le journal La Vanguardia : « Le genre fantastique m’attire beaucoup, puisqu’il permet de déployer l’imagination et de connaître le monde depuis des points de vue divers qui ne sont pas ceux habituels. Cela m’a permis d’aborder sous une autre perspective une obscurité très domestique, celle des liens familiaux. Aujourd’hui encore, on a une vision plutôt idéalisée de la famille, puisque c’est là que nous recevons les premières attentions, où nous apprenons à devenir des personnes et où nous pouvons obtenir une certaine forme de bonheur sur Terre. Alors, lorsque la famille est absente ou qu’elle éclate, il y a un sentiment d’échec. Comme s’il nous manquait quelque chose d’essentiel, un bras ou une jambe. »
Et s’il y a bien une famille en pièce, c’est celle de la nouvelle « Soudain, un déluge », dont la première page est bouleversante, pleine d’horreur et de tristesse :
« Il était assis par terre à jouer avec le chien lorsque son père entra. Il venait de défricher le terrain du fond de l’île et portait quelque chose dans ses bras.
– Regarde ce que j’ai trouvé, lui dit-il. C’est ta sœur.
Les yeux sombres de Mauro s’emplirent d’eau. Il cligna, mais l’eau ne bougea pas, comme retenue derrière une vitre. Face à lui, sur le sol crasseux, son père avait posé un tas d’ossements et un crâne. Le chien tendit son museau et renifla avec précaution. Il y avait encore un peu de chair collée aux os.
– Je les ai trouvés dans le ruisseau à sec, dit-il encore. Ils étaient là. Ils ont été là tout ce temps. »
Cette nouvelle partage un air de famille avec La Mort et le Printemps, le roman posthume et inachevé de l’immense écrivaine catalane Mercé Rodoreda, avec ses forêts d’ossements et ses morts égarés. Rodoreda a presque rompu avec son oeuvre littéraire précédente en écrivant ce roman dystopique, sous influence des contes de fées les plus noirs, écrit en exil pendant la Guerre Civile espagnole. C'est un livre qui suinte la mort, la guerre et les disparus. Et bien que l’intention politique ne soit pas évidente dans la nouvelle de Castellarnau (pas plus que l’influence du roman que je viens d’évoquer), il est impossible de ne pas penser aux fosses communes fermées (et certaines ouvertes) en Espagne, à la brutalité de son après-guerre, et aux morts sans sépulture de la dictature argentine qui pourraient être partout et nulle part. Les deux traditions littéraires de Castellarnau – celle de son pays, et celle du Rio de la Plata en Argentine – se rejoignent ici en parvenant à cette sorte de langage universel qu’est le fantastique ou la dark fiction anglo-saxonne, une influence générationnelle, transgenre, réappropriée sans préjugés, particulièrement par des écrivains nés dans les années 1970. Par-dessus viennent s’empiler les désastres de la guerre et les cicatrices des familles détruites.
Le retour au lieu d’origine est toujours difficile après un exil volontaire. L’écrivaine argentine Silvina Ocampo disait que ses fictions n’avaient rien à voir avec sa vie et elle détestait qu’on la lise sur le mode autobiographique, néanmoins un auteur accède toujours, si ce n’est dans ses expériences directes et leurs reflets, dans ses névroses, ses craintes, sa psyché. Dans la frénétique nouvelle « Au meilleur de tous nos enfants », il y a quelque chose de cette peur du retour à l’excès de la terre natale, la crainte que le mimétisme avec ce qu’on a laissé derrière soi ait une puissance telle que tout ce qu’on a appris loin d’ici finisse par se fondre dans le paysage familier et originel : que toutes les nouveautés n’aient servi à rien. Ce n’est pas ce qui est arrivé à Castellarnau en tant qu’écrivaine, bien au contraire. Mais peut-être n’en pourra-t-on pas moins lire cette nouvelle sous le prisme de l’anxiété du retour, l’étouffement placide d’un retour au ventre maternel, à la famille, aux liens premiers, au village.
Les enfants sont également les protagonistes de « Les enfants jouent dans le jardin », où ils incarnent matériellement l’idée du sinistre, de ce qui s’approprie l’environnant, ce qui est reconnaissable bien qu’étrange, ces enfants qui se déplacent en troupeau, bizarres et capricieux. La nouvelle rappelle les enfants cruels de Silvina Ocampo, si prompt à doter l’enfance de perversion, et, naturellement, elle rappelle aussi de nouveau les contes de fées, où les enfants ne sont pas toujours des victimes puisqu’ils peuvent appartenir à l’espèce des êtres féeriques, inquiétants, venus d’on ne sait quel monde souterrain. L’existence, après tout, n’est-elle pas un mystère ? Ou les étapes de la vie ? Et il n’y a pas d’étape plus mystérieuse que l’enfance.
Dans « L’île dans le ciel », Ariadna Castellarnau invoque William Butler Yeats, poète irlandais qui se mouvait entre mysticisme, folklore et politique. C’est un récit aux résonances religieuses qui laisse ensuite place au bouleversant « L’homme de l’eau », dans lequel transparaît l’éducation chrétienne de Castellarnau et une autre origine du conte merveilleux : les miracles, les prophéties, les hommes saints. Du païen au sacré. L’importance de l’action de l’imagination sur le réalisme. Castellarnau, lors d’un entretien avec le journal Público, dit la chose suivante : « Nous sommes à un moment de crise du réalisme. Pendant longtemps, on a cru que le réalisme était le seul genre capable de proposer une critique de la réalité, alors même que la science-fiction et le genre fantastique n’ont jamais cessé de le faire et de façon très intense. C’est un exercice philosophique qui naît d’une conscience de l’aspect trompeur de la perception, l'idée selon laquelle ce que nous voyons n’est pas ce qu’il semble être. C’est une crise au niveau littéraire, car nombreux sont ceux qui se rendent compte que pour approcher la réalité, la représenter ne suffit pas. Il y a d’autres portes et d’autres façons plus tangentielles d’y parvenir. »
D’autres portes. D’autres points de vue. La perception trompeuse. Ce qui échappe à notre contrôle. Ou, comme l’a dit Ursula K. Le Guin en gagnant le National Book Award aux États-Unis : « Des temps difficiles approchent, où nous allons avoir besoin des voix des écrivains capables de voir des alternatives à notre façon de vivre actuelle ; capable de deviner d’autres façons d’être au-delà de notre société terrorisée et de ses technologies obsessionnelles. Nous allons avoir besoin d’écrivains qui se souviennent de la liberté : des poètes, des visionnaires, des réalistes d'une réalité plus ample. »
Ariadna Castellarnau fait partie de ces écrivains.
Mariana Enríquez