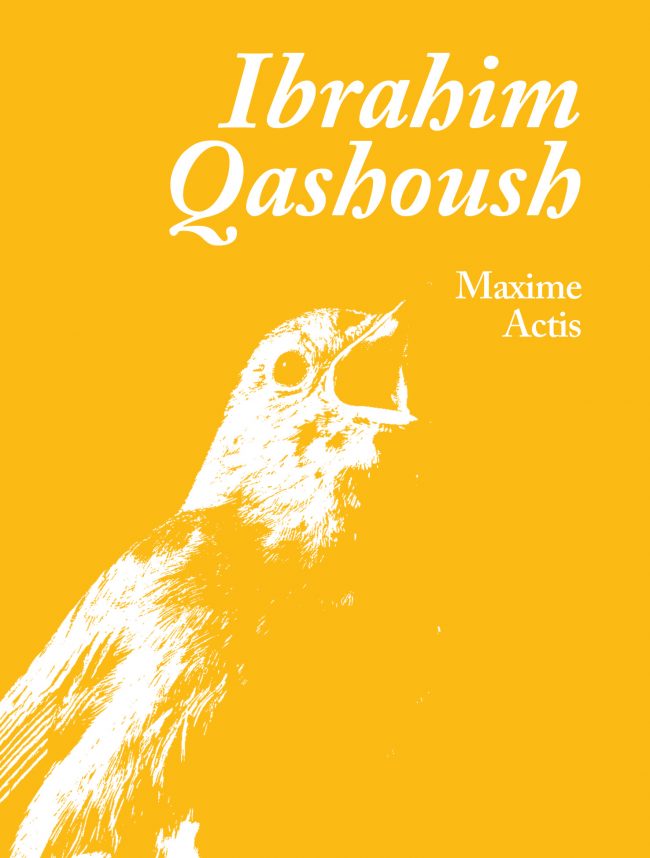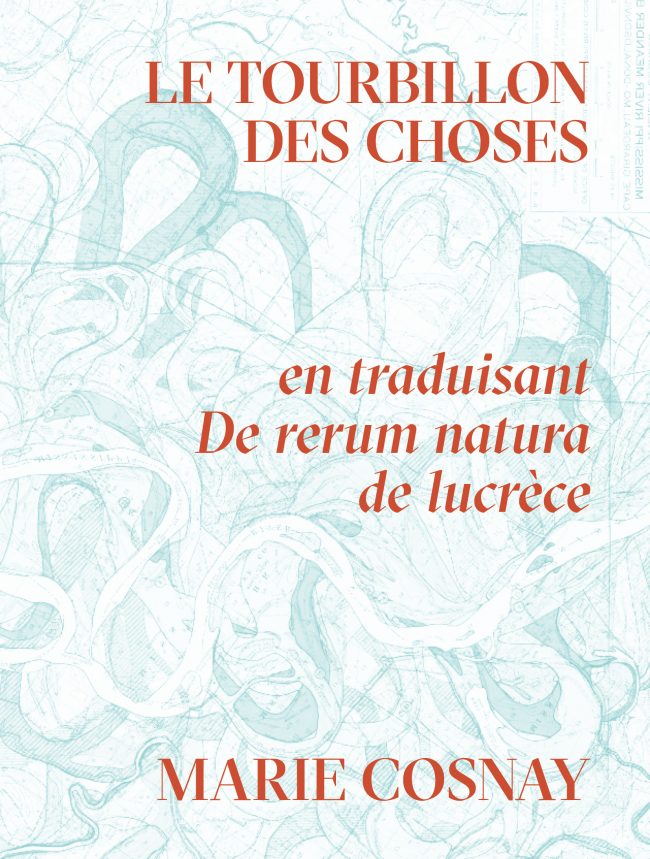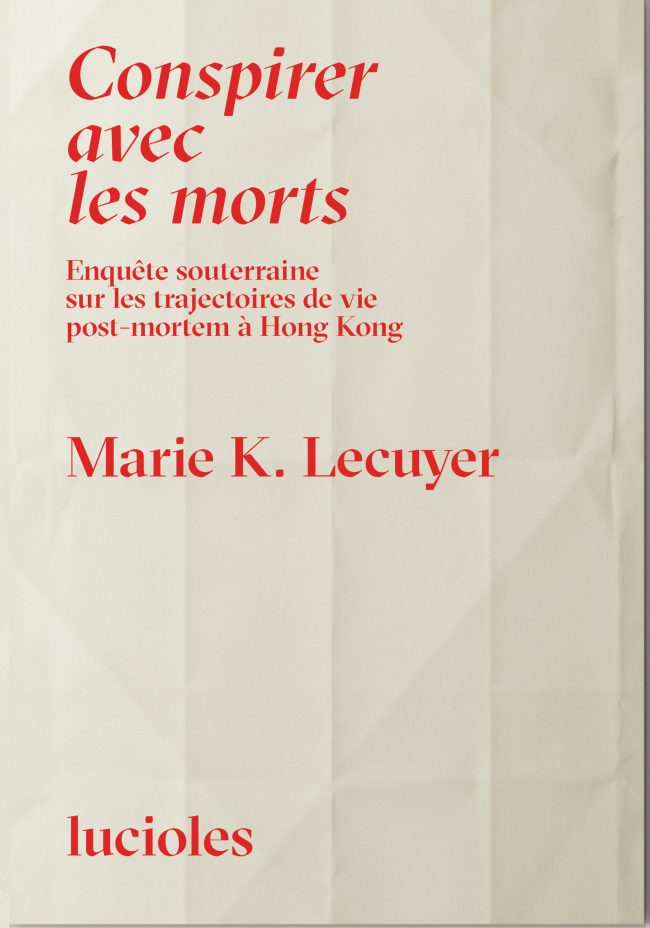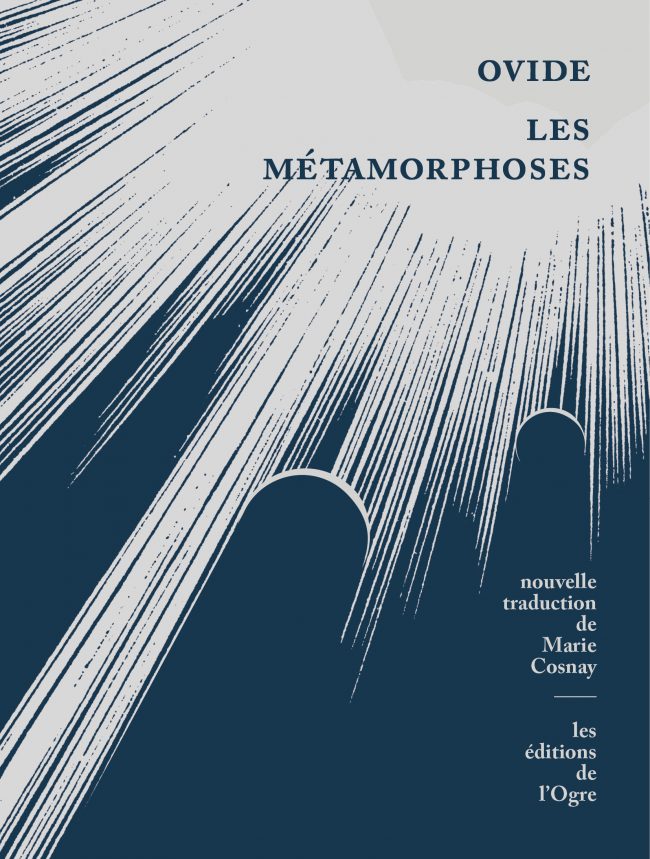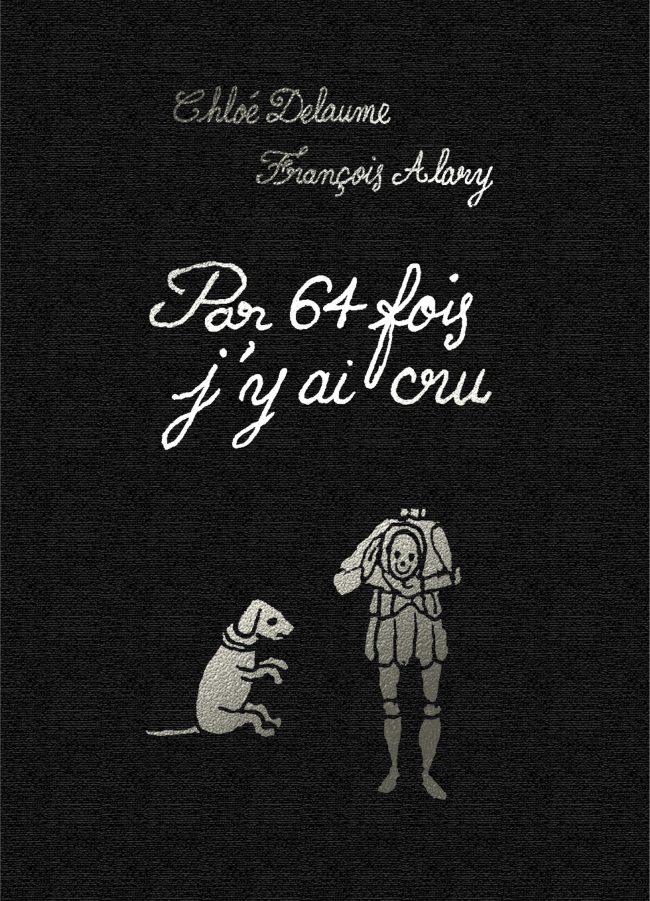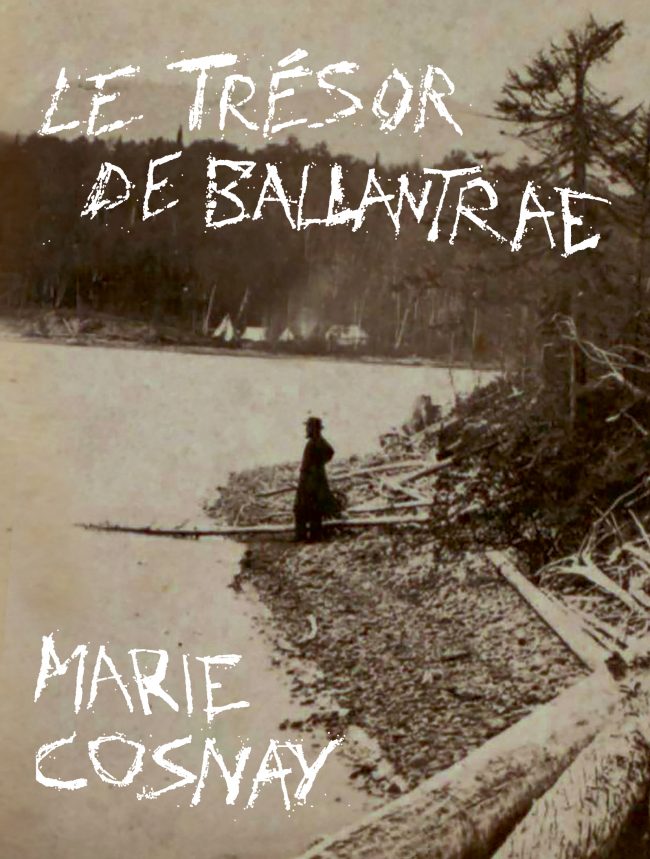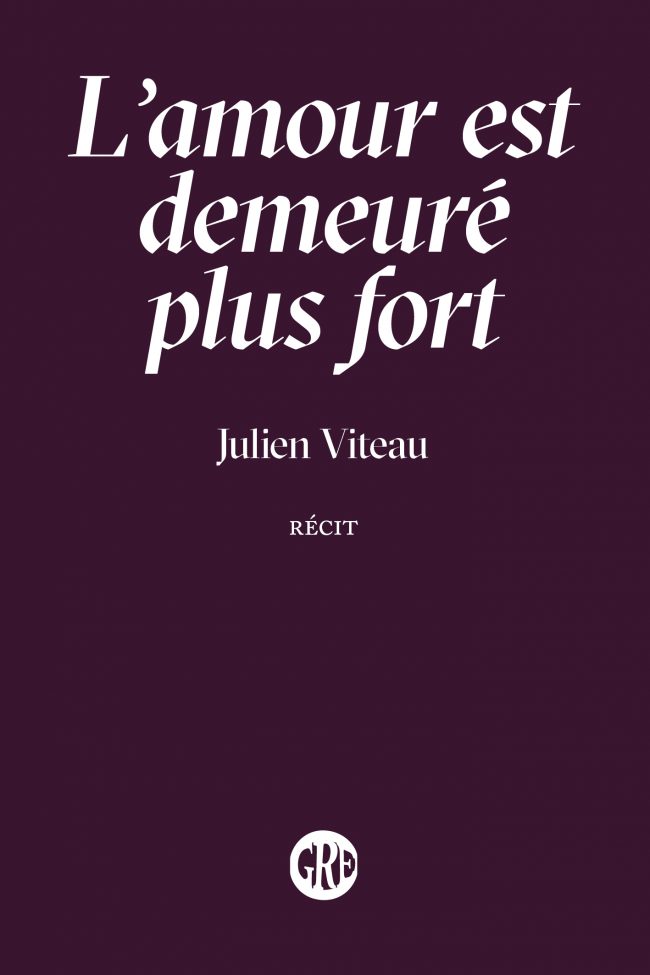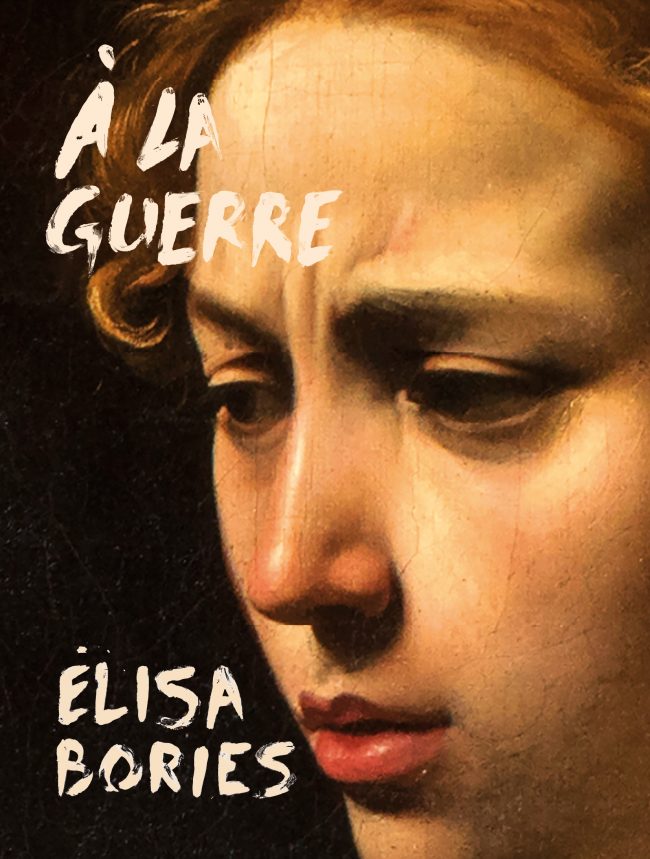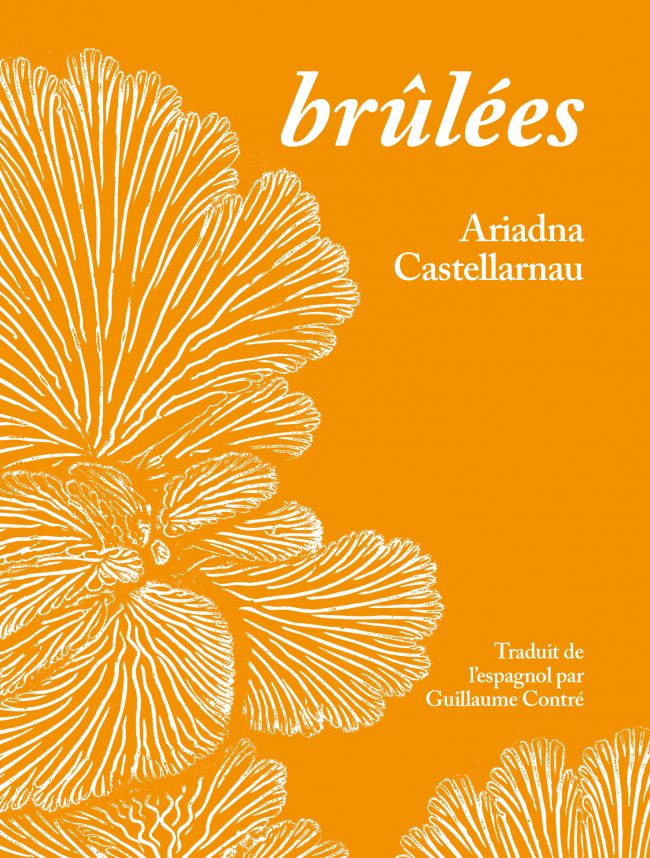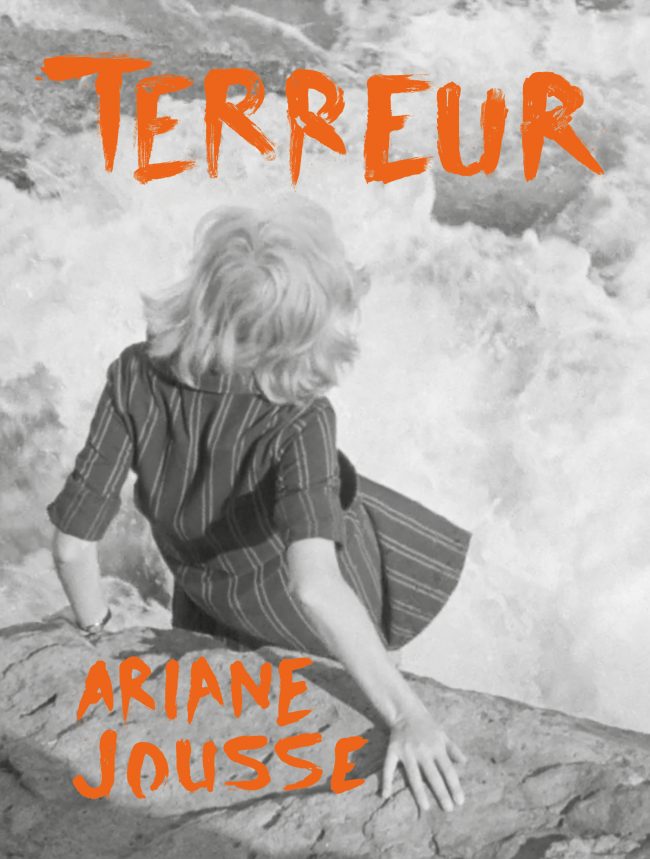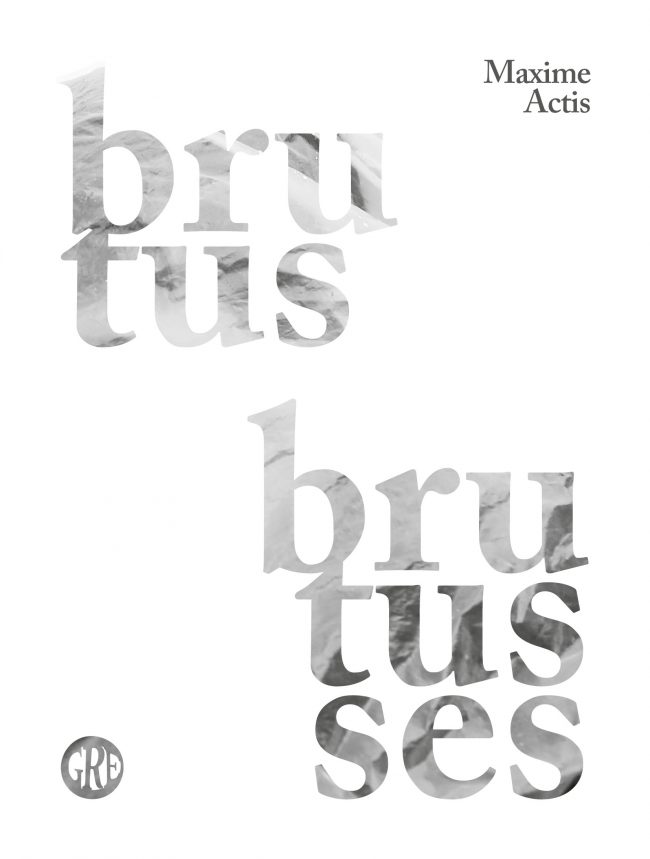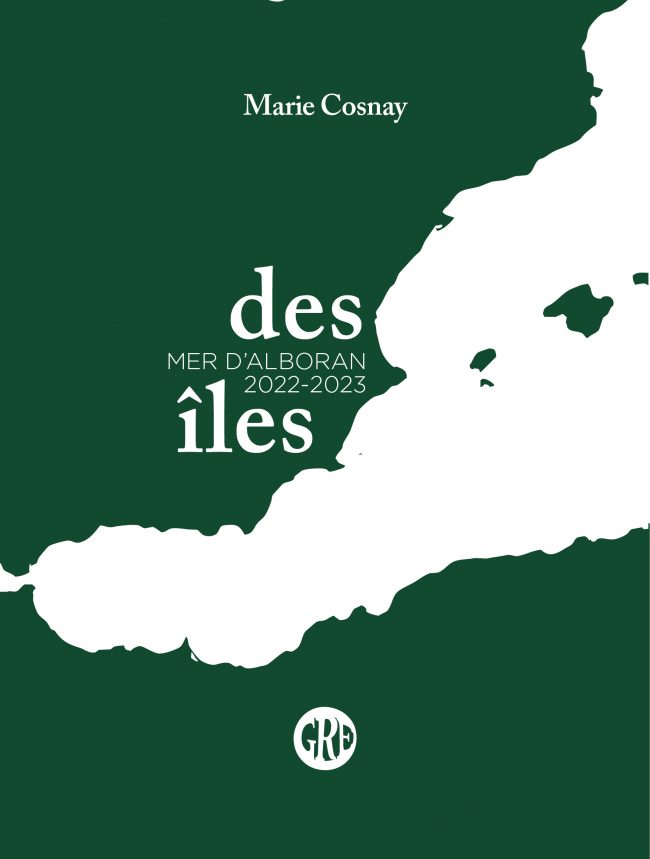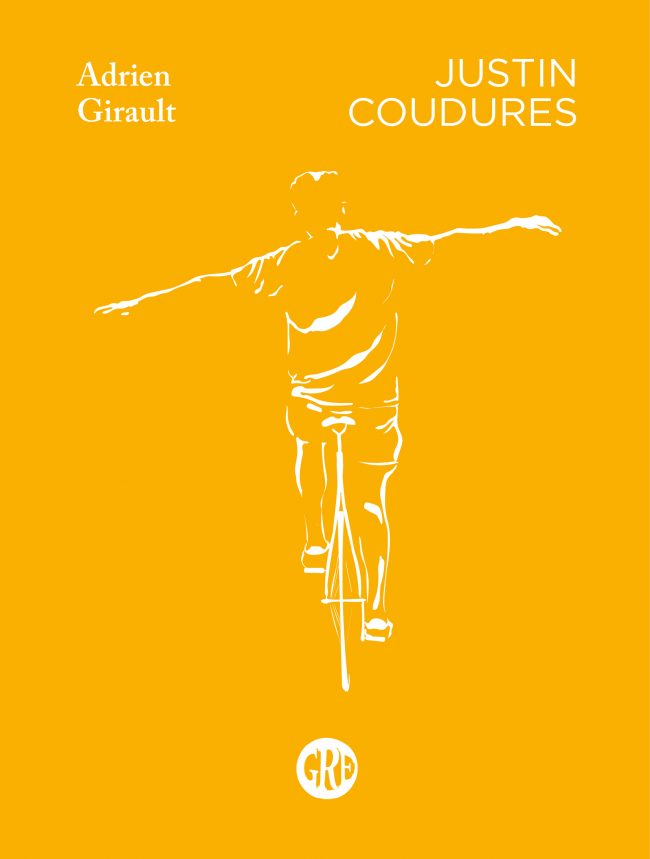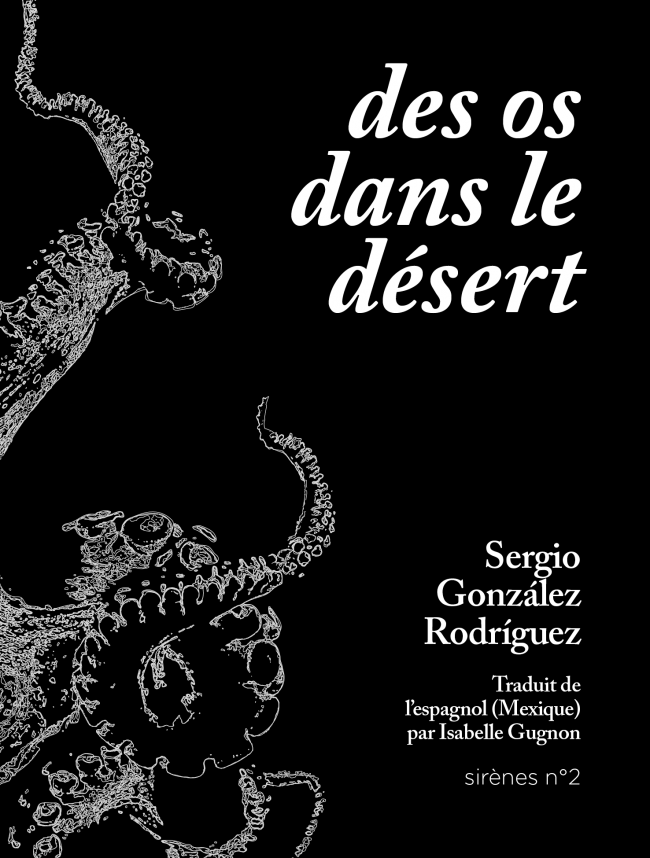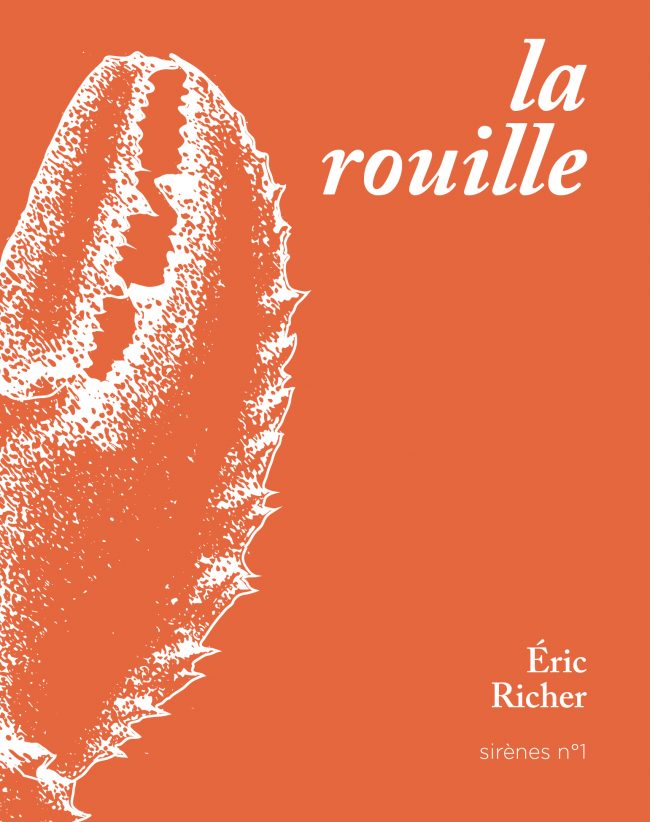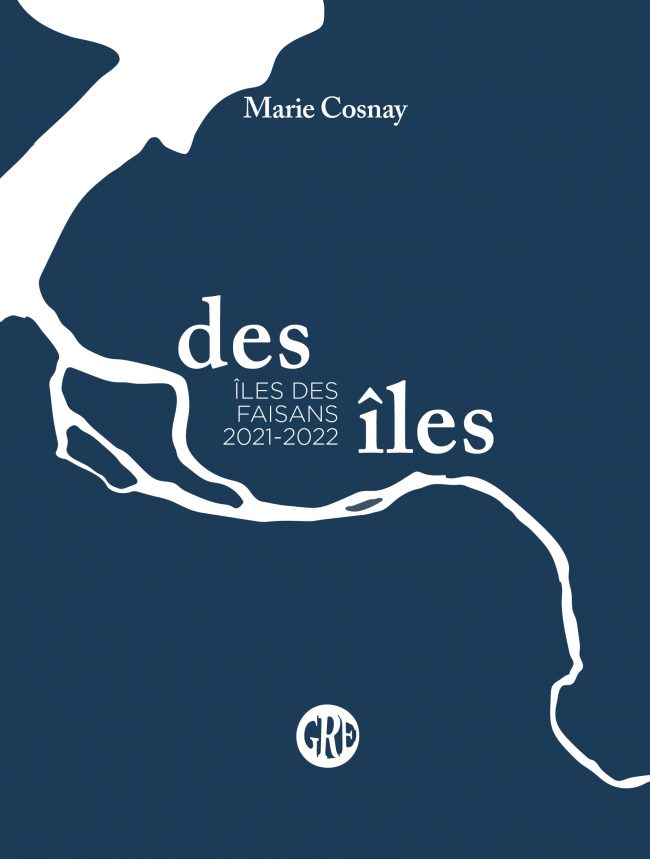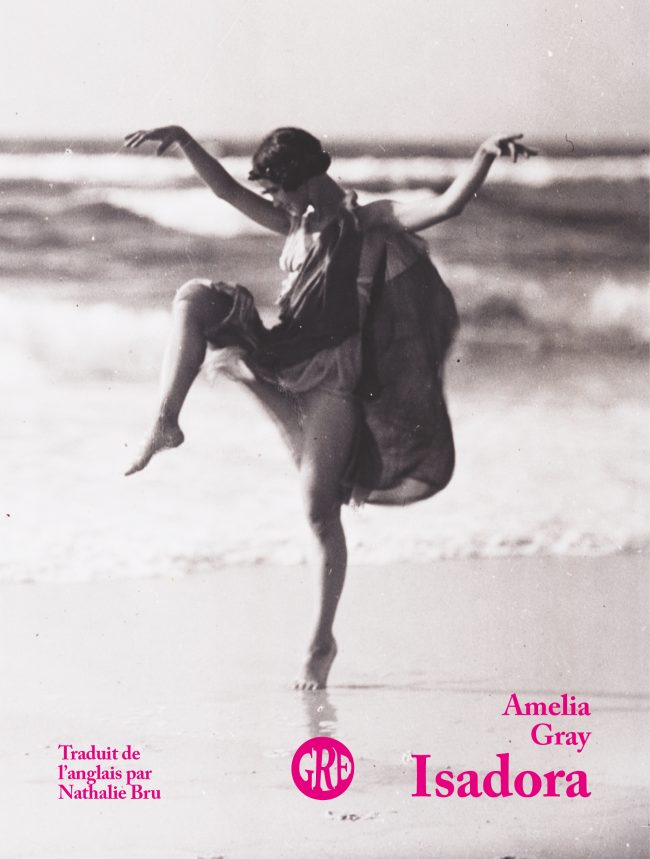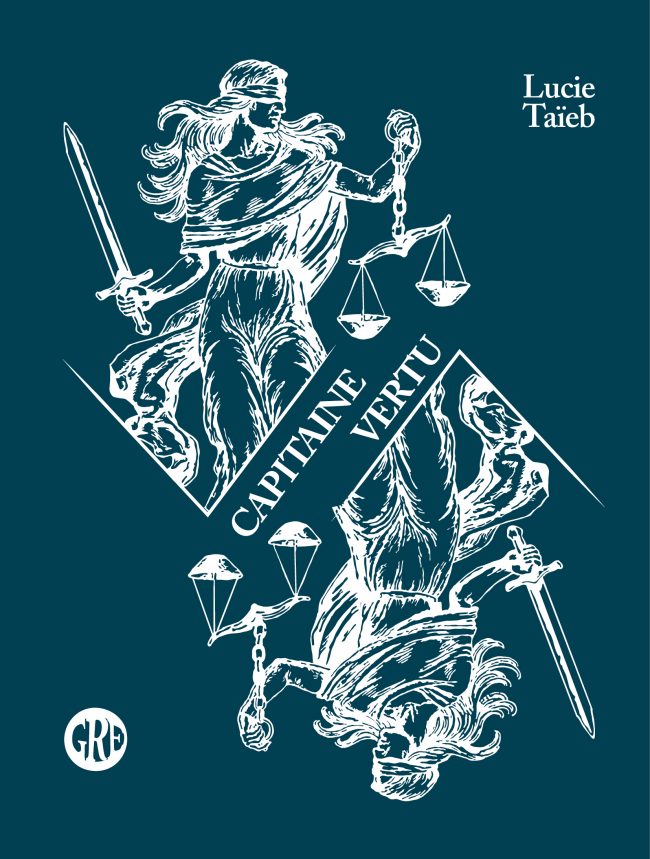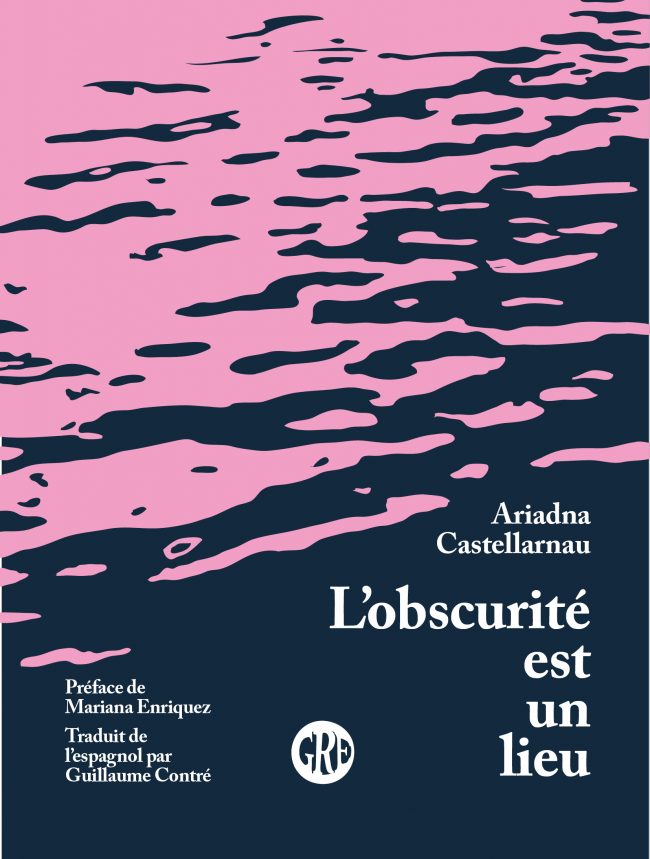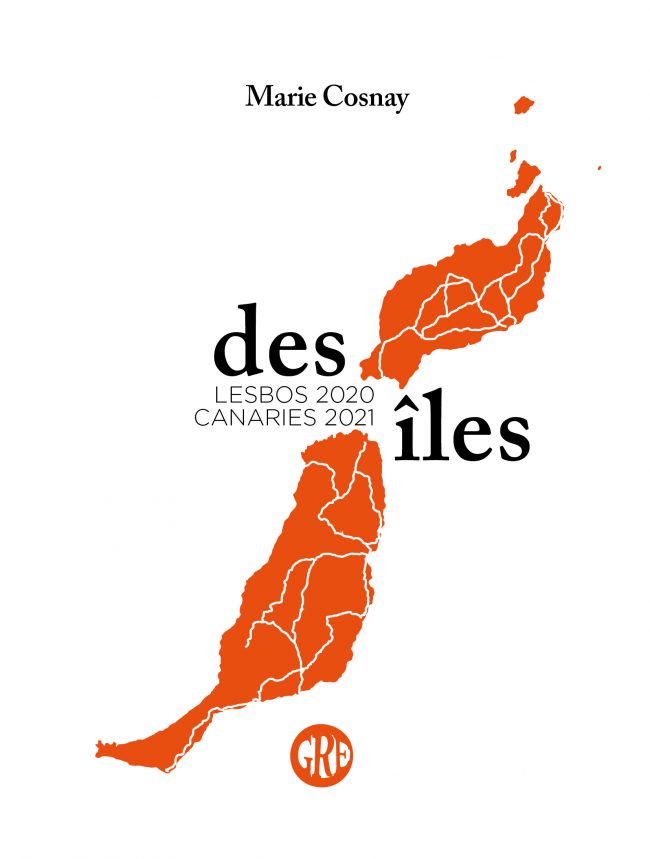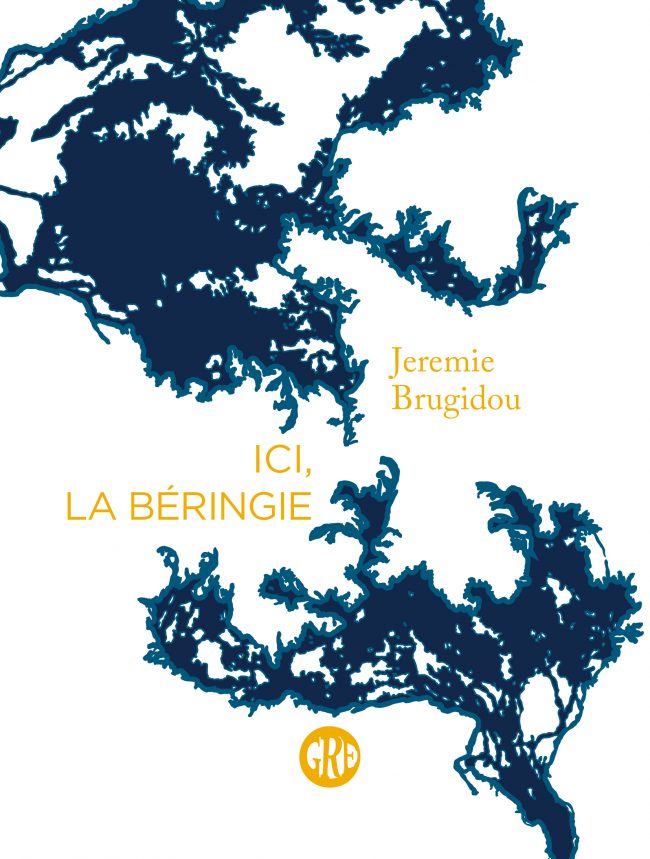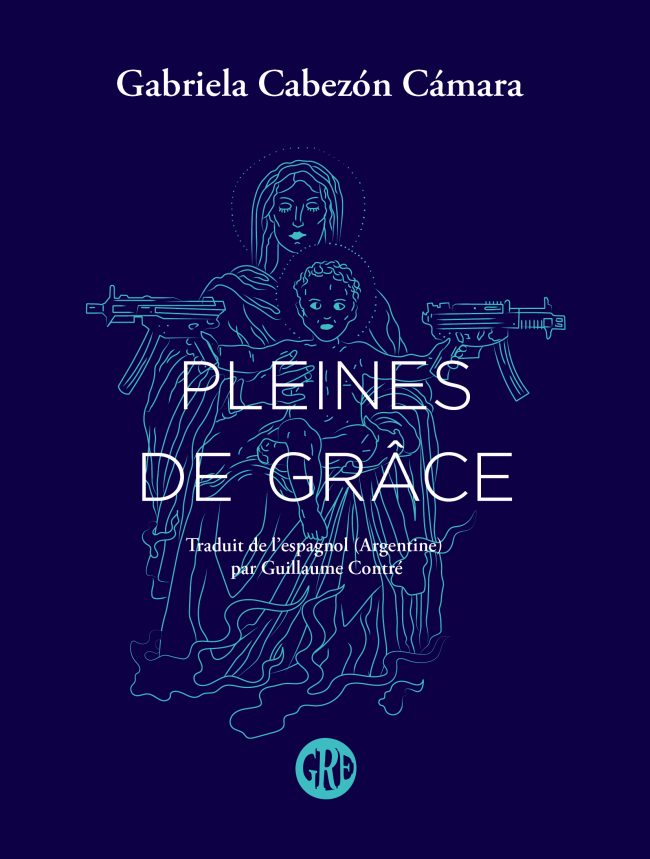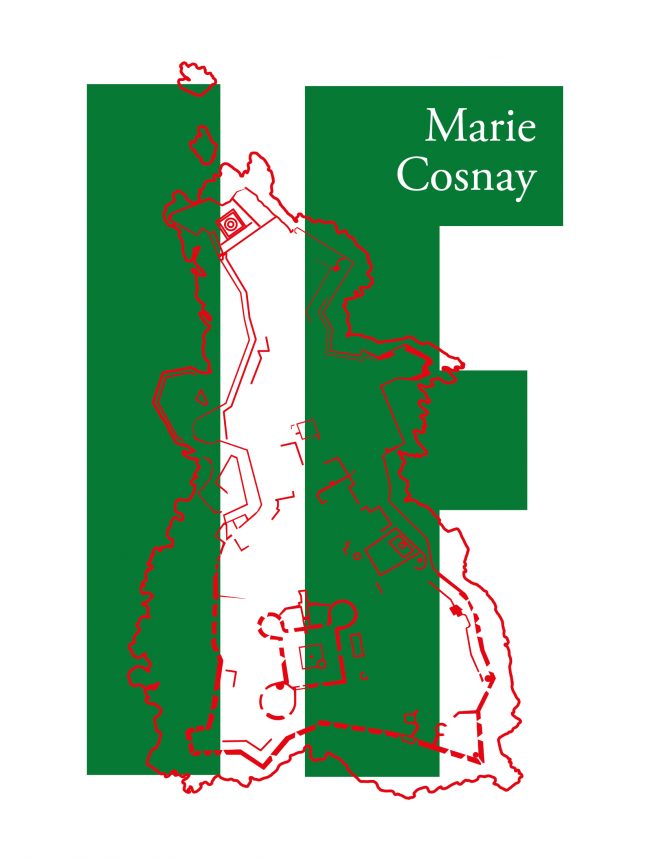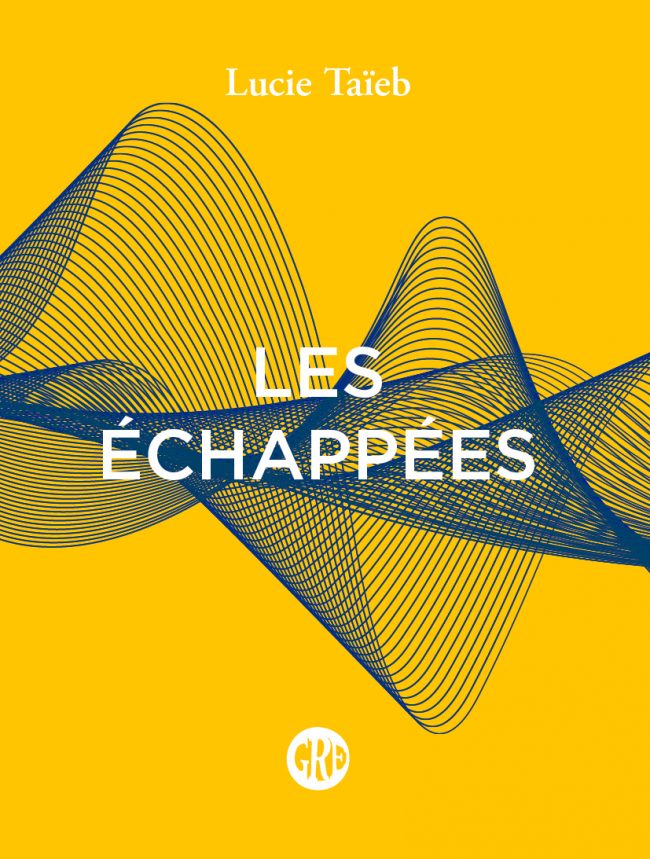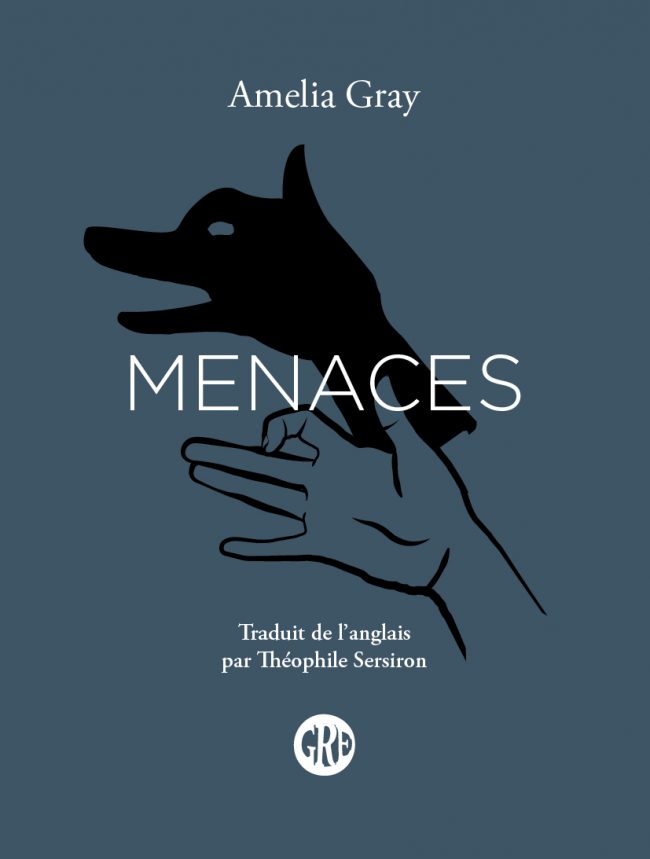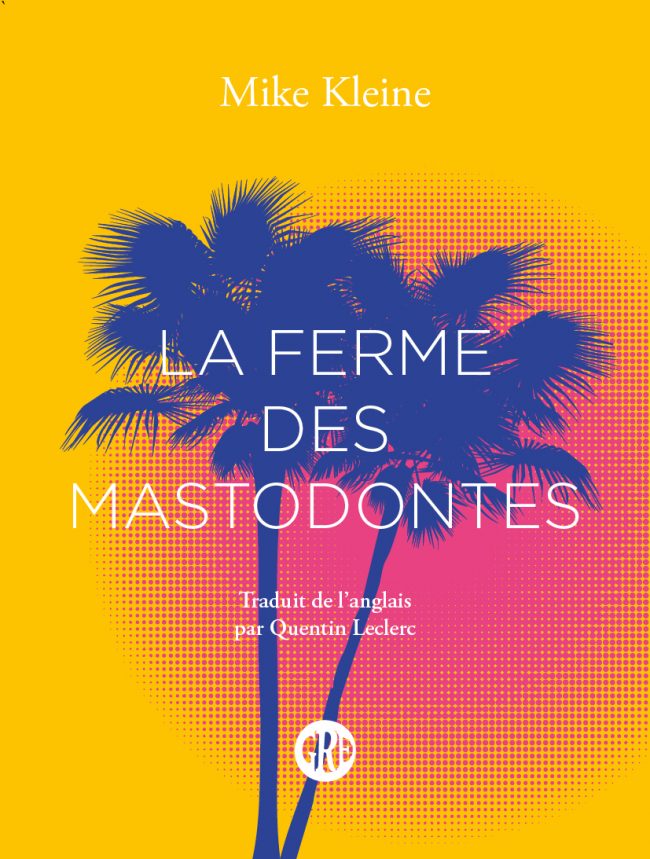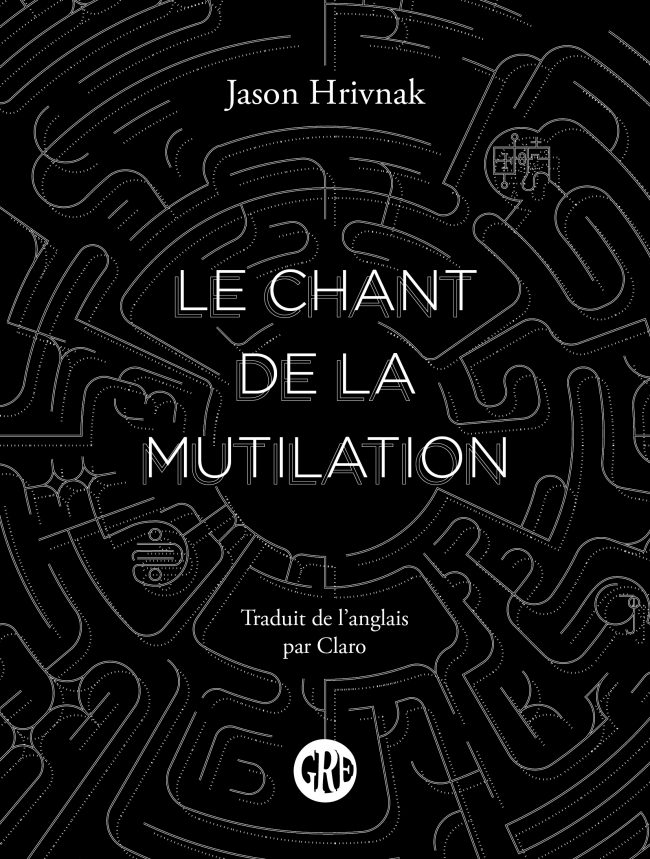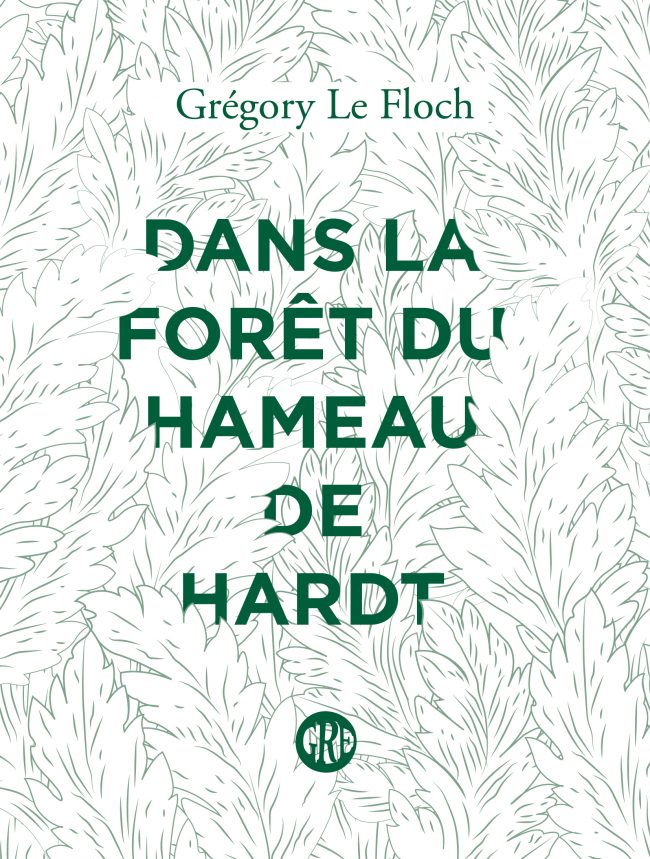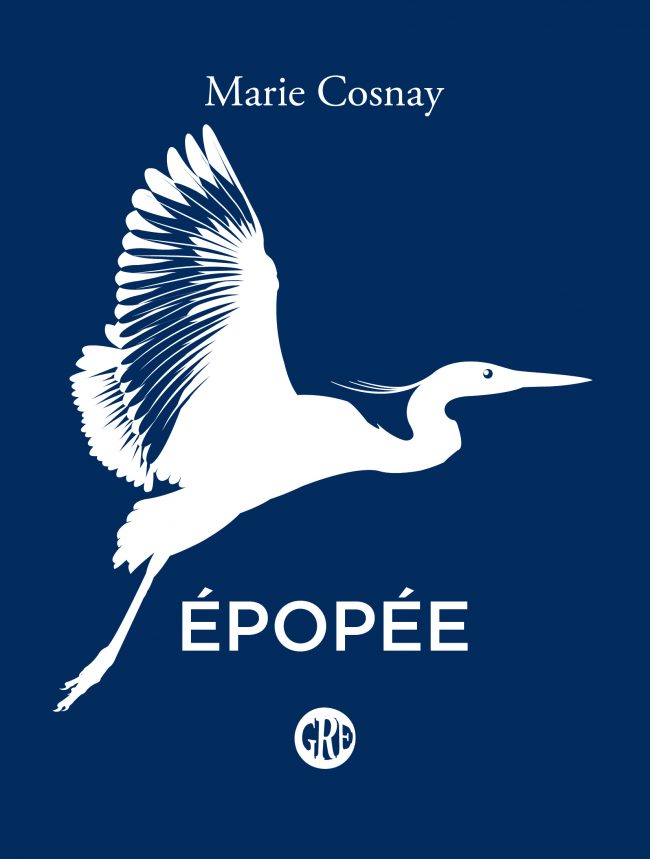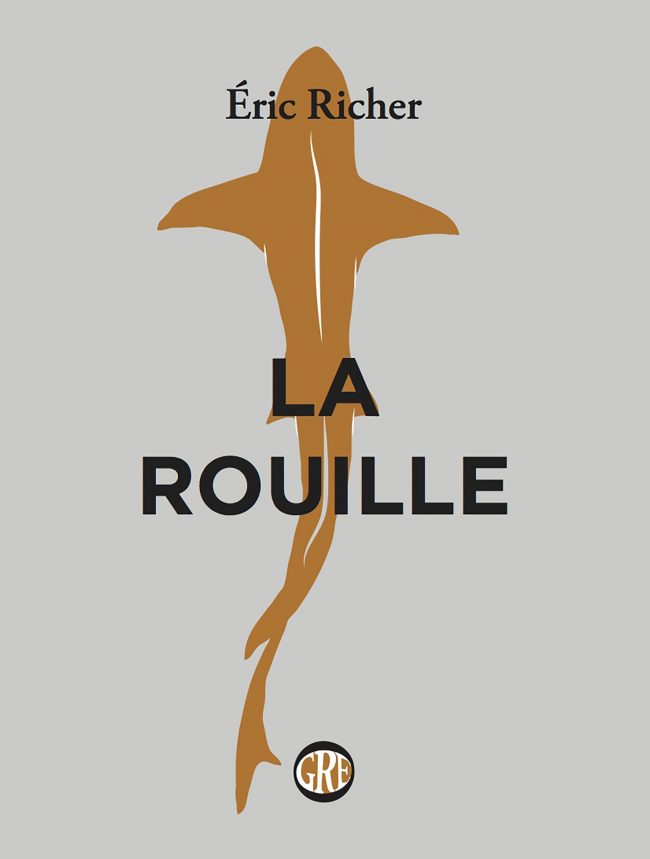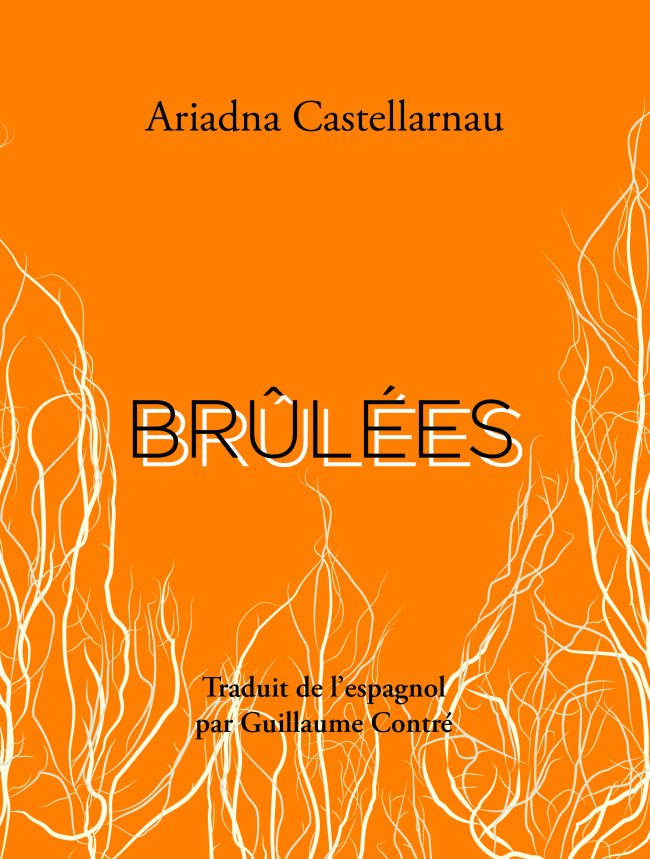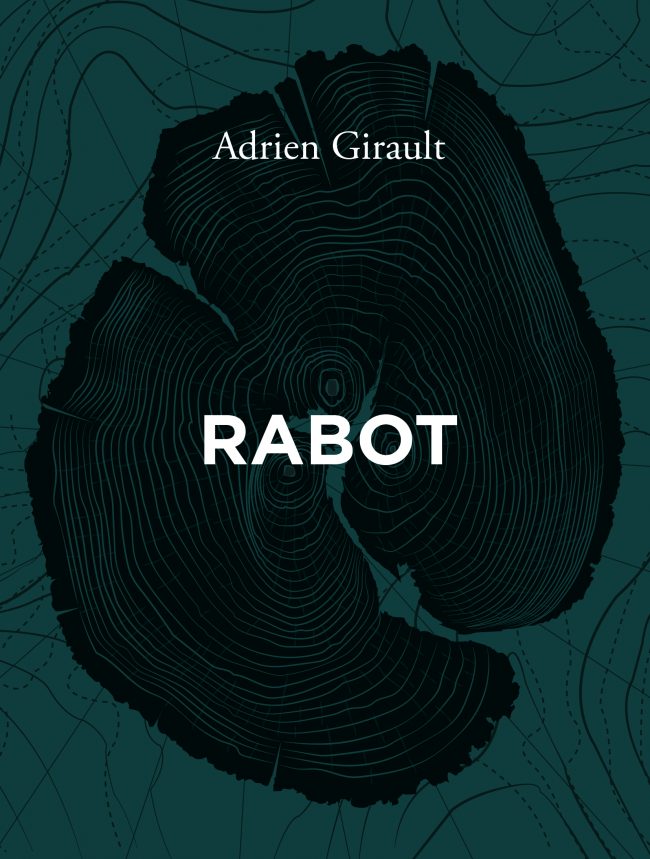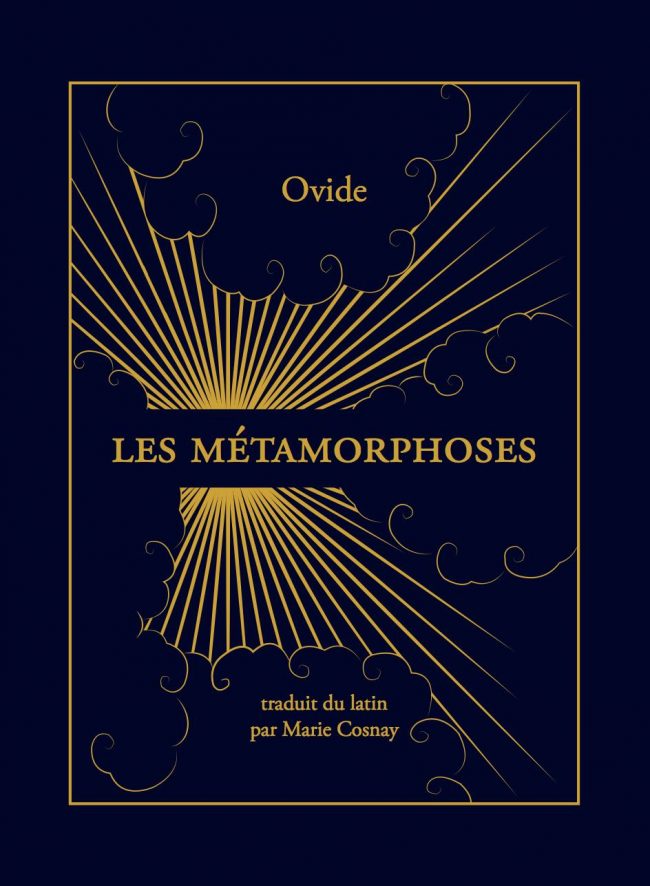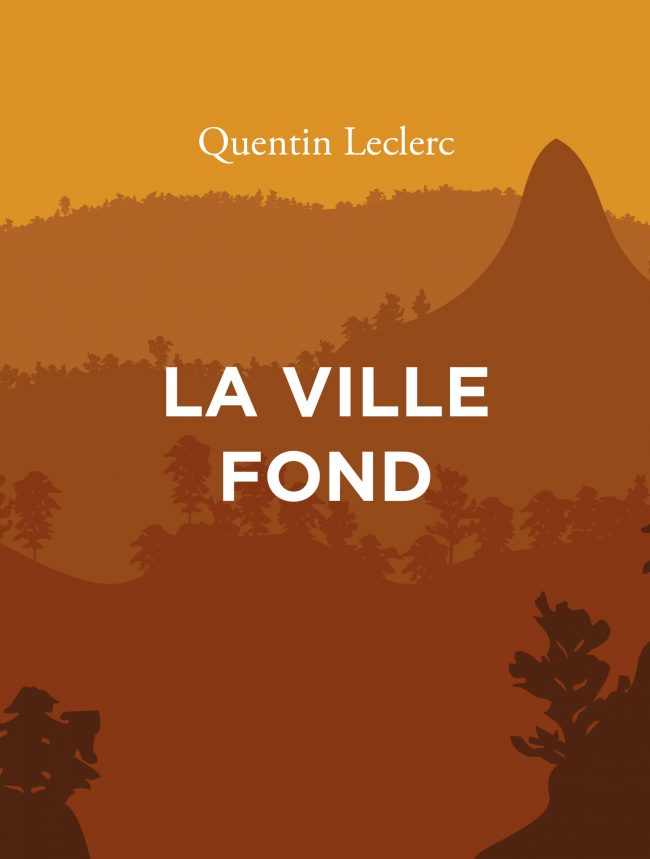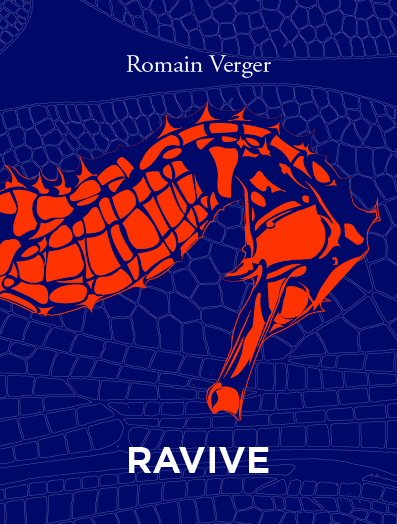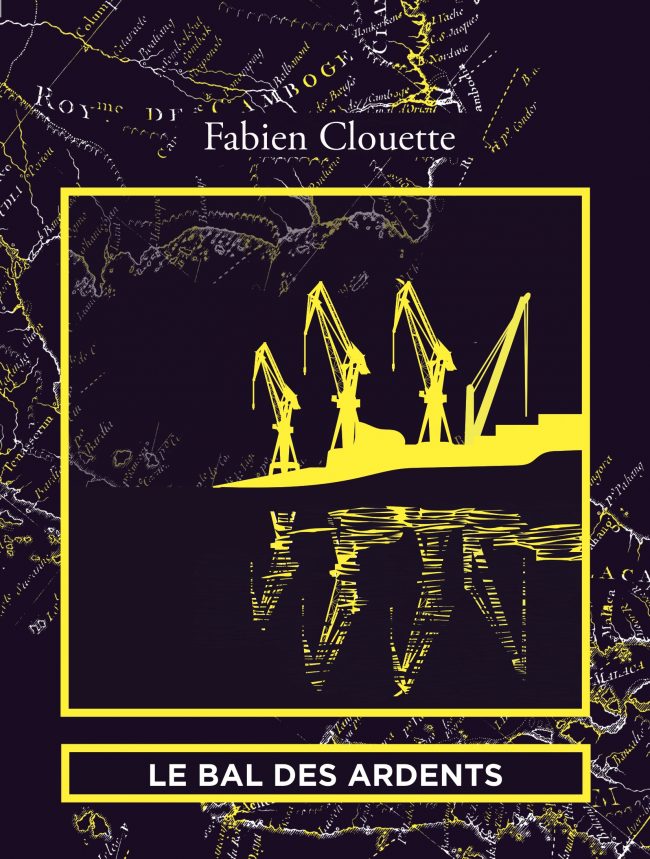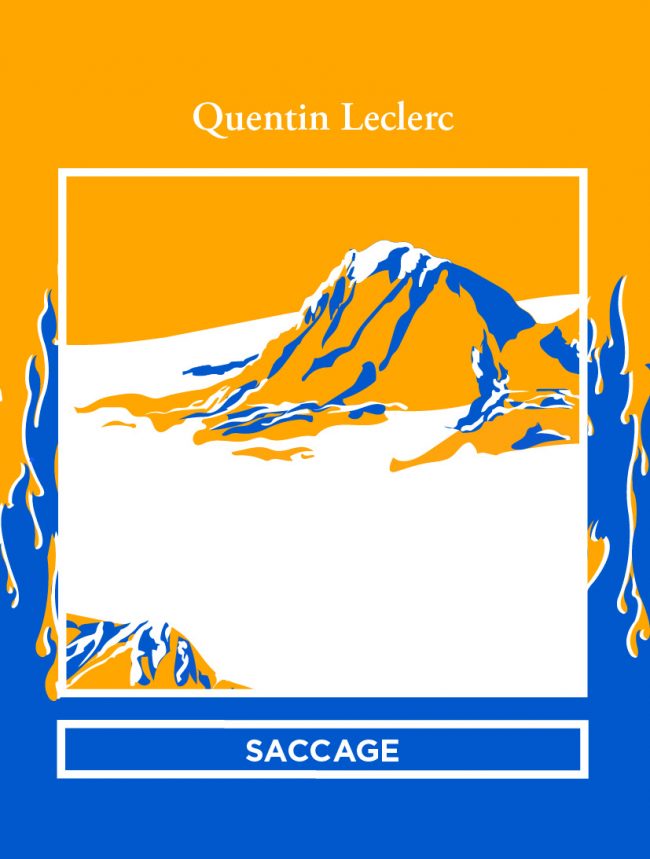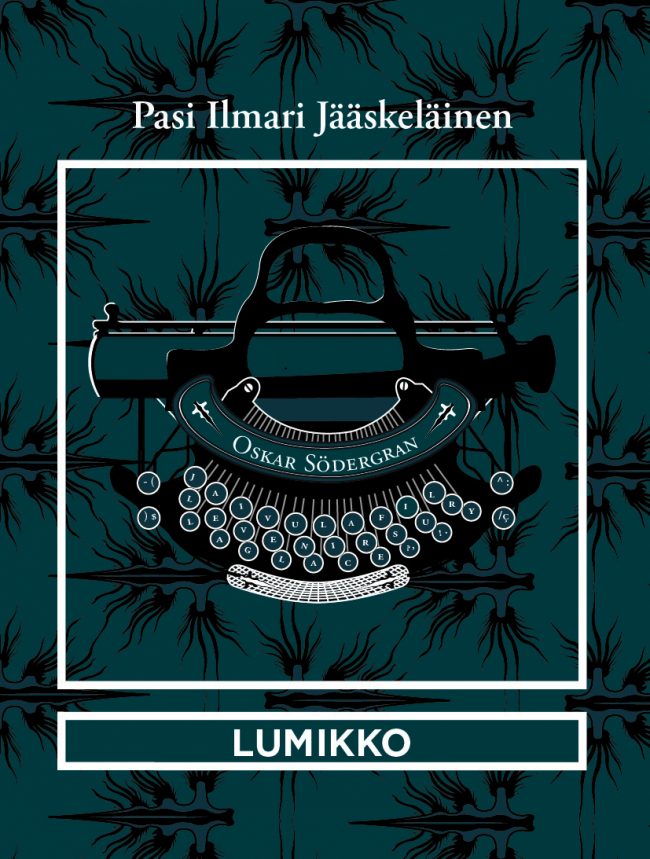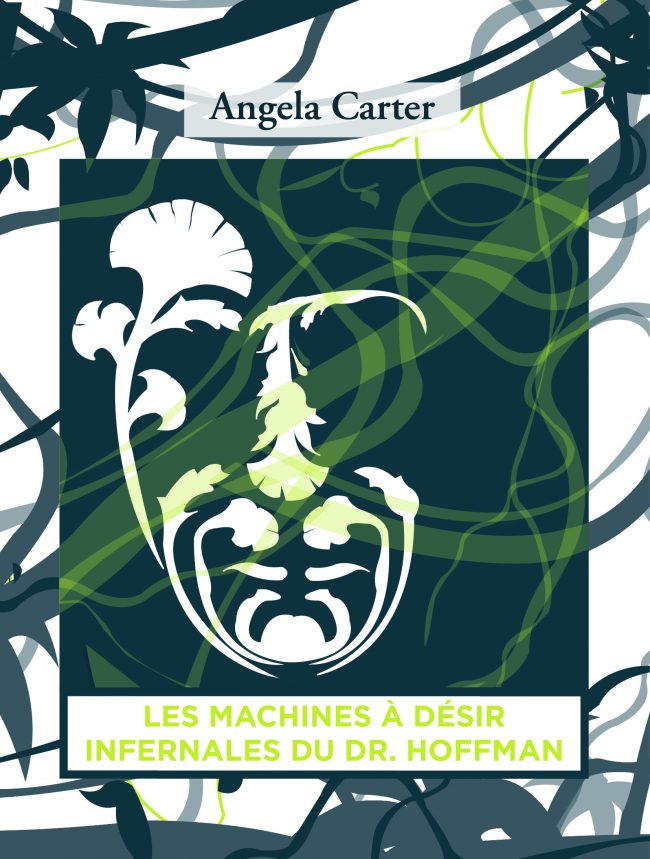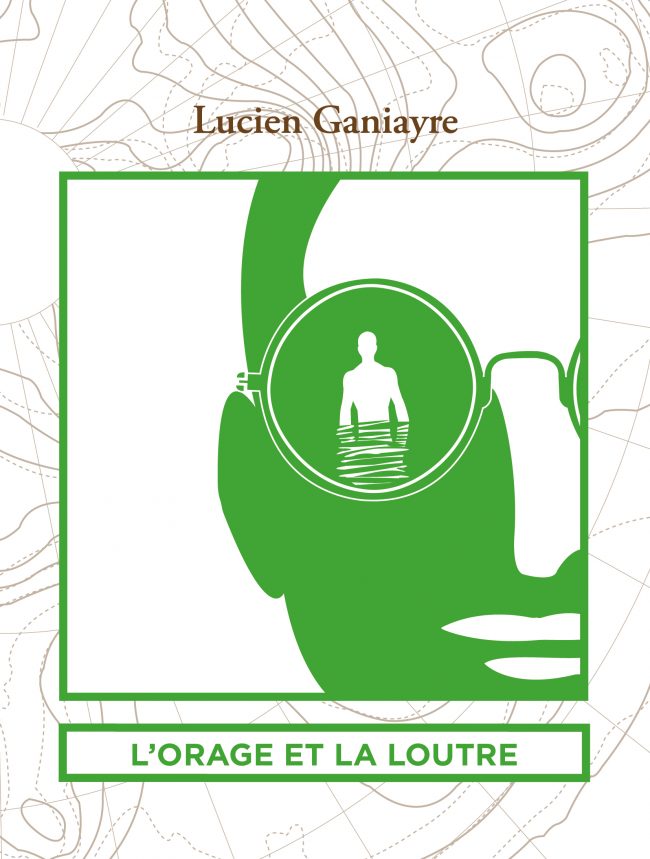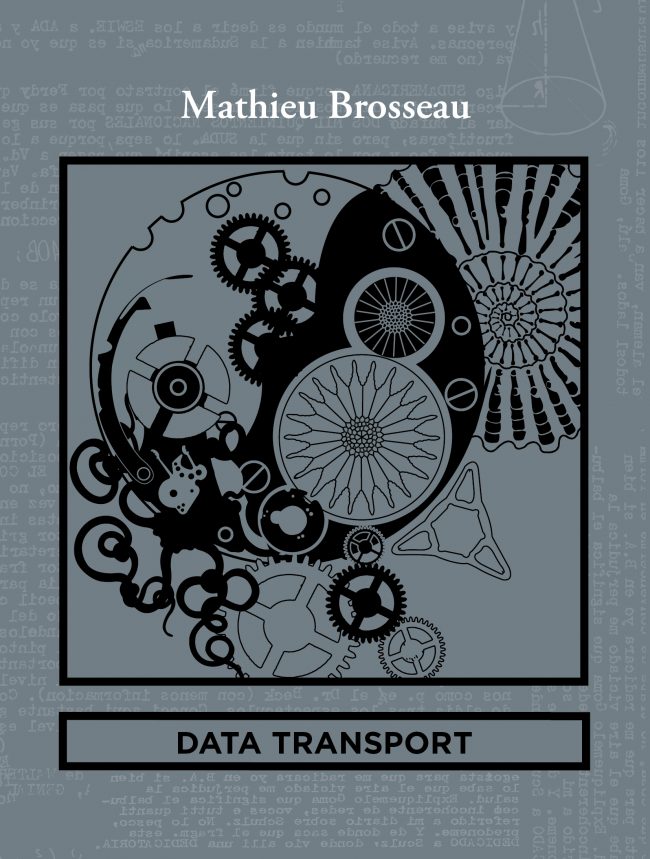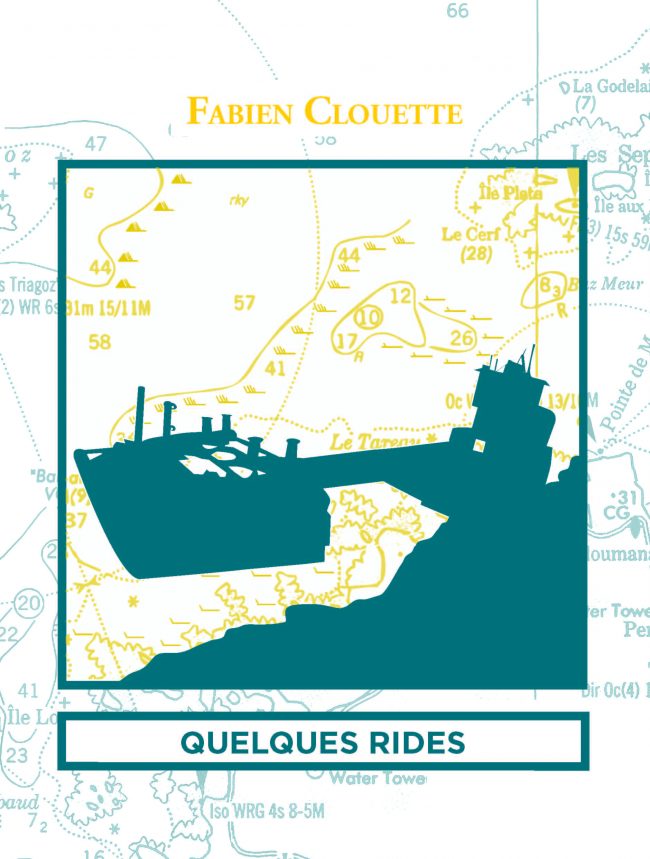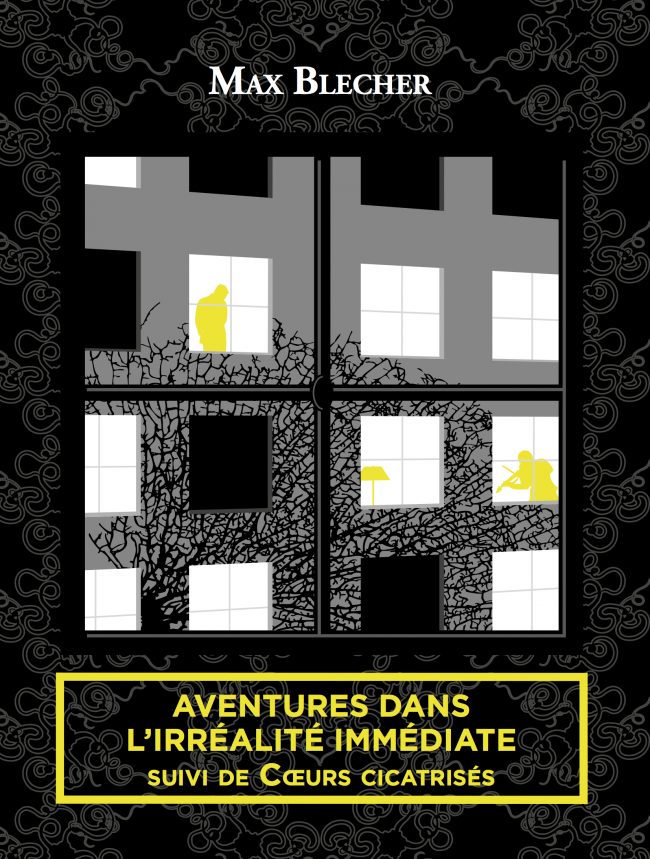I
Je distingue à peine le sommet de l’hôtel, fondu dans le brouillard. Le bâtiment dans son ensemble est perdu dans les ténèbres. Les haies de buis toutes taillées à l’identique encerclent la propriété comme les douves d’un château fort.
Alors que je passe la grille d’entrée, une silhouette immobile apparaît derrière une lucarne. Elle maquille son ombre et fixe de ses yeux blancs l’inconnu que je suis.
Partout les hôtels se dégradent, lentement. Ils sont dégueulasses. Les propriétaires crachent dedans, souillent au lisier les boiseries – parfois des chiens pissent dans les couloirs, et avec les chiens les locataires –, on dit des locataires : carcasses. C’est le terme. Carcasses, dont je fais partie, j’entends : rapaces, fauves, hommes, requins-marteaux, reptiles. On doit trouver refuge là où la foudre n’a pas encore déclenché d’incendies, les failles de séismes. On erre parfois des mois dans les parages en quête d’asile. Nos figures, nos manières carnivores, attirent la traque ; la milice, les paysans – seuls les hôtels nous cachent pleinement de la colère des fourches.
Nous sommes débarquées dans des hôtels comme celui-ci au hasard de nos voyages. Certaines carcasses sont là depuis des années, déjà au terme de leur ultime métamorphose. D’autres, comme moi, ont encore tout à accomplir. Des hôtels identiques se trouvent ainsi sur tout le territoire, à des distances égales réglementées par la milice. Toute carcasse se trouvant à l’extérieur d’un hôtel peut être interpellée par la milice. La milice craint l’influence des carcasses, a peur de ce qu’elles pourraient dire à qui les croise.
Autour de l’hôtel, sur plusieurs kilomètres à la ronde, les habitations ont été désertées. Les civils ont été transférés ailleurs. Les derniers intrus encore présents dorment sous des abris en carton. Ils vivent en groupes, mangent des conserves périmées. Leurs télévisions n’ont pas d’antenne, et les écrans rendent un bruit blanc infernal qu’aucun bouton n’éteint. La nuit, ces intrus dévalent les pentes de la ville à bord d’engins trafiqués. Les pneus des engins éclatent et brûlent à mesure qu’ils dérapent.
D’autres haies brise-vent jalonnent les champs jusqu’à la ville. Les cultures ont brûlé mais le bocage conserve son apparence d’autrefois : talus, taillis, hameaux, ensembles de chênes rongés à la sève, vergers pourris, déchaumeuses embourbées.
Les palmiers aussi dépérissent.
Une enseigne de néons bleus défectueux grésille sous le crachin et projette quelques flammèches qui se consument à mes pieds – une succession de flèches rouges peintes à la va-vite mène distinctement vers l’entrée principale, sur le côté droit, sous un porche.
Je passe une large porte ; les gonds grincent. La lumière filtre à peine depuis les lampadaires jusque dans le hall. Aux murs : des portraits lavés à la Javel, aussi d’autres tableaux monumentaux illustrent d’impressionnantes batailles remportées tour à tour dans le sang et la boue – des fresques de cités englouties sous les océans, brûlées par les météores, dévorées par des monstres aux crocs d’acier.
Au toucher, le plomb : caractéristique odeur de migraine, de vapeur, de poussière de migraine, qui adhère à l’épiderme et couvre d’une flaque noire la pulpe du doigt. Les murs sont faits de ce qui contamine. En chaque corps de carcasse la ruine couve : rapidement les joues se creusent, les os crissent comme du sable sous la dent, la chair de nos bouches se fend à mesure que l’on mâche. Les bras tombent rongés par la gangrène, les yeux cèdent derrière des voiles calcaires. Et nul remède au calvaire. Le plomb encore fixé à mon doigt m’irrite un instant, rougit mon empreinte, puis aussitôt disparaît, absorbé par la détresse de mon corps déjà pleinement embrassé par la mort.
II
J’appelle, mais personne ne m’accueille. Le refuge ne m’a donné aucune indication au cas où personne ne se présenterait. L’hôtel est en piteux état. Le carrelage au sol craque par endroits
– tout est brisé, fracturé, déchiré, de l’eau goutte du plafond, des fissures rayent les moulures. Seules les dorures de la cage d’escalier sont encore fraîches, les câbles intacts. Là, rien n’a été dégradé, rien n’a été volé ni tranché ; personne n’est passé.
Une photographie prend tout l’espace au-dessus du comptoir. Sur celle-ci, on aperçoit un chantier, et des ouvriers, et les ouvriers versent du ciment sur des fondations démolies. Le jardin c’est de la boue, les arbres des souches, et sur les souches des dames assises patientent. Sur une autre photographie, à côté, plus petite, il y a un terrain vague, et des néons éclatés sur le sol, et autour des néons des chiens qui rôdent. J’emprunte l’escalier dans l’espoir de croiser quelqu’un.
À travers les œilletons montés à l’envers des portes (sur chacune, capiton et mousse épaisse teintée rouge vif) : des carcasses, identiques, l’échine à l’atelier, le regard froncé sur du papier de verre, le visage barbouillé d’encre sympathique. Toutes les carcasses sont coiffées de cagoules avec une ouverture grillagée au niveau de la bouche. En caressant leurs bras on récupère une liqueur particulière qui fait pourrir la terre. Les cagoules, c’est pour dissimuler la laideur. Des hôtesses se tiennent debout à leurs côtés, portant à bout de bras de petits plateaux d’argent sur lesquels sont disposés divers instruments. Aussi le travail ainsi s’initie : une carcasse achève son texte, plie la feuille, l’insère dans une enveloppe et la repose sur le plateau d’argent que tient l’hôtesse. L’hôtesse alors enflamme la lettre qui, à mesure qu’elle se consume, hurle des prophéties de sorcier. On prévient : c’est l’unique méthode pour écouter les récits des carcasses. Sans ces précautions. Je préfère ne pas en parler.
À l’aide de micros disposés dans chaque pièce, les propriétaires enregistrent ces prophéties sur les bandes noires de leurs magnétoscopes, puis ils les revendent ensuite à de riches industriels. Les industriels ont de quoi traduire les prophéties des carcasses. Ils accèdent ainsi au sublime. Seuls les industriels ont l’argent pour atteindre le sublime.
Je remarque, au bout des couloirs de chaque étage, les portes de pièces qui semblent plus luxueuses. Ce sont les bureaux des propriétaires. De petits écriteaux indiquent chez qui l’on rentre. Leurs noms sont gravés dans l’or. Un unique monte‑charge transporte la vaisselle des propriétaires depuis l’entrée de leurs bureaux respectifs jusque dans la cuisine, au sous-sol. Les propriétaires ne se nourrissent plus. Les soupières, terrines et autres bols de porcelaine basculent à la sortie, éclatent là et s’amoncellent dans les couloirs. Je m’entaille la plante d’un pied sur un éclat saillant.
Il y a une dépendance pour loger les carcasses non loin du marécage : il faut pour s’y rendre se faufiler en voiture entre plusieurs marais, et mieux vaut de bonnes roues car les voies sont pleines de nids-de-poule, et dans ces nids-de-poule des caïmans barbotent.
Comme garde rôde un vigile aveugle ; il se dirige au son de sa matraque qu’il fait résonner à coups légers sur des grilles de fer forgé. Il loue un mobile-home insalubre et utilise les vêtements des intrus débusqués comme ardoises pour isoler son abri de fortune ; leurs têtes, il en fait de la purée, qu’il mélange avec du jambon et conserve au froid dans du gros sel ; il distribue les os à ses chiens de chasse, qu’ils saisissent d’une patte, mâchonnent lentement, puis laissent pourrir au fond de leur chenil.
Je ne sais rien de plus que ce qu’on m’en a dit, et ce qu’on m’en a dit n’a aucune valeur.