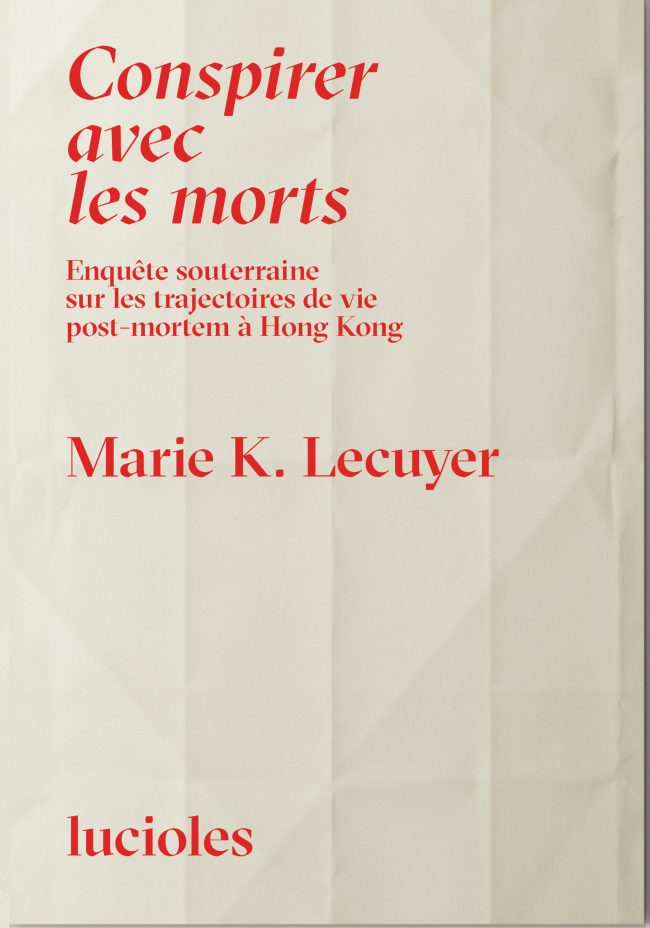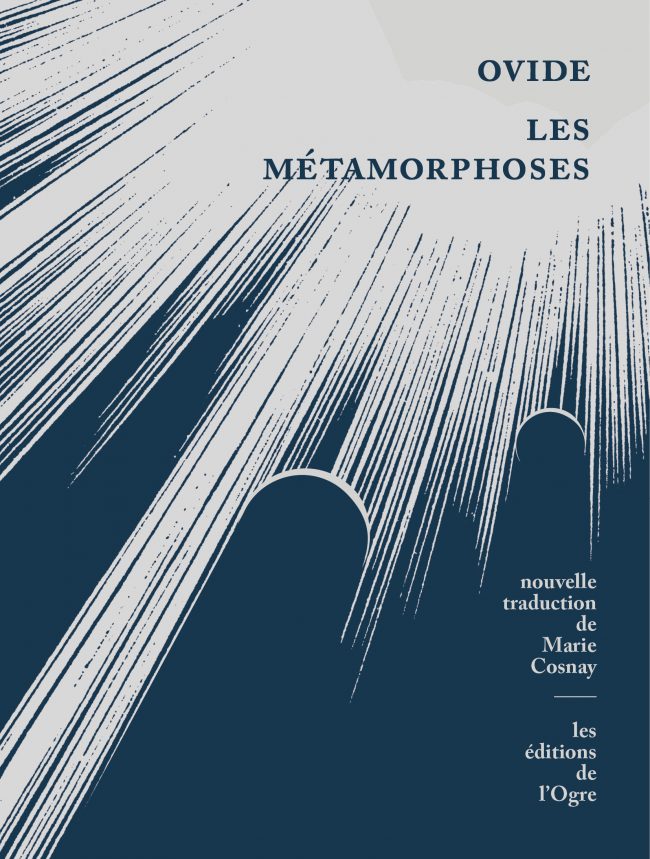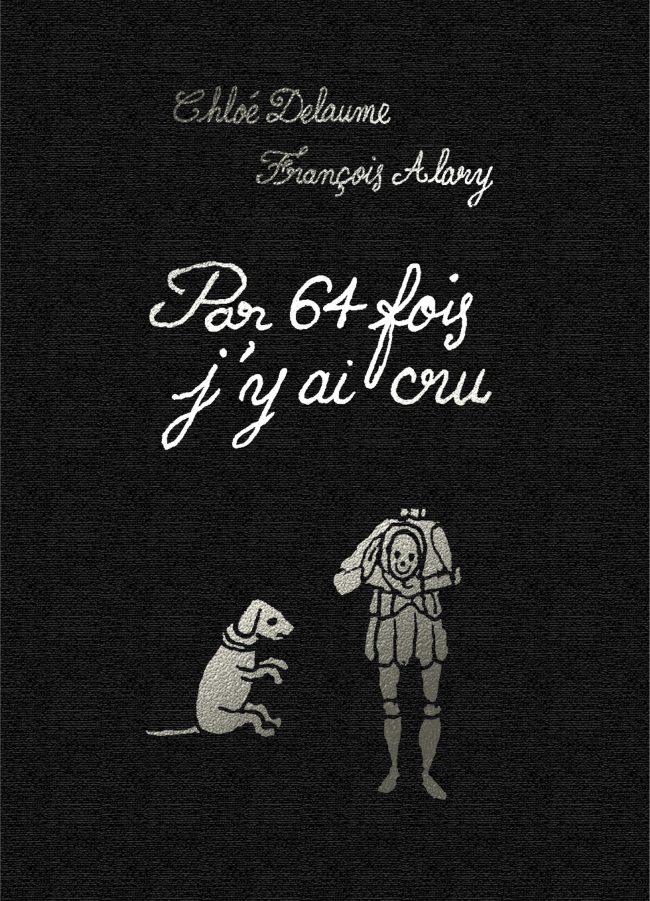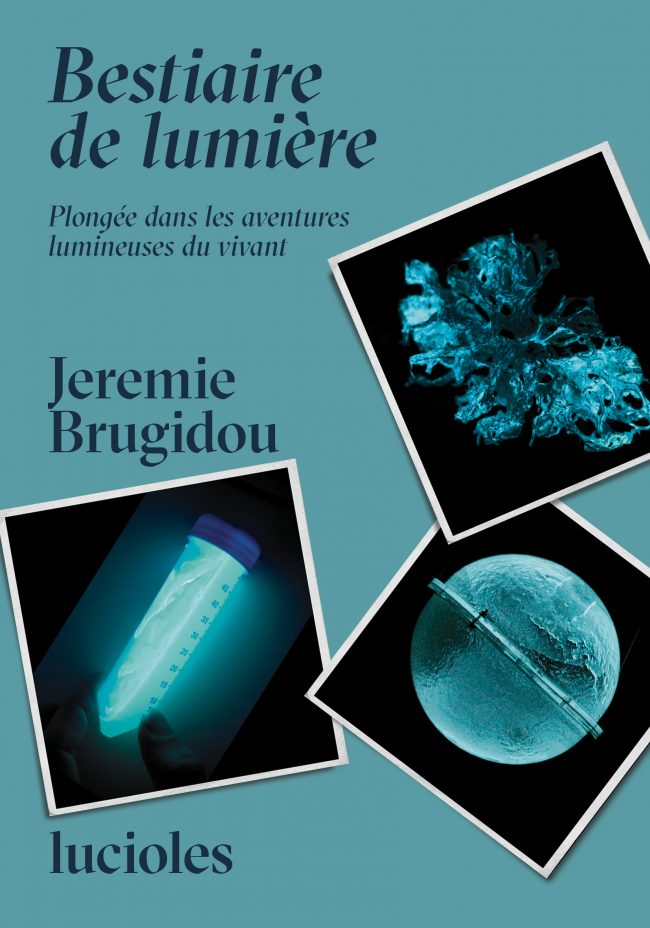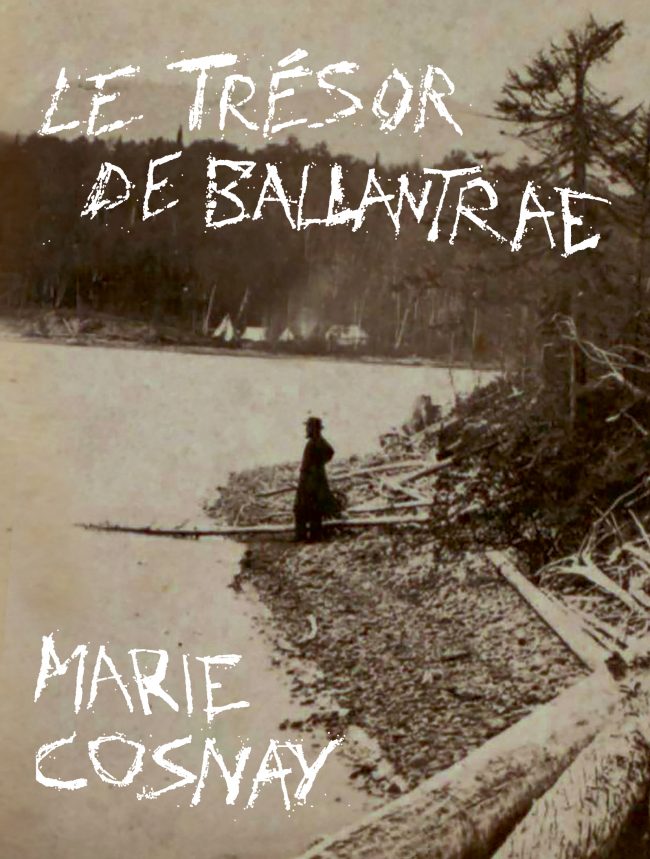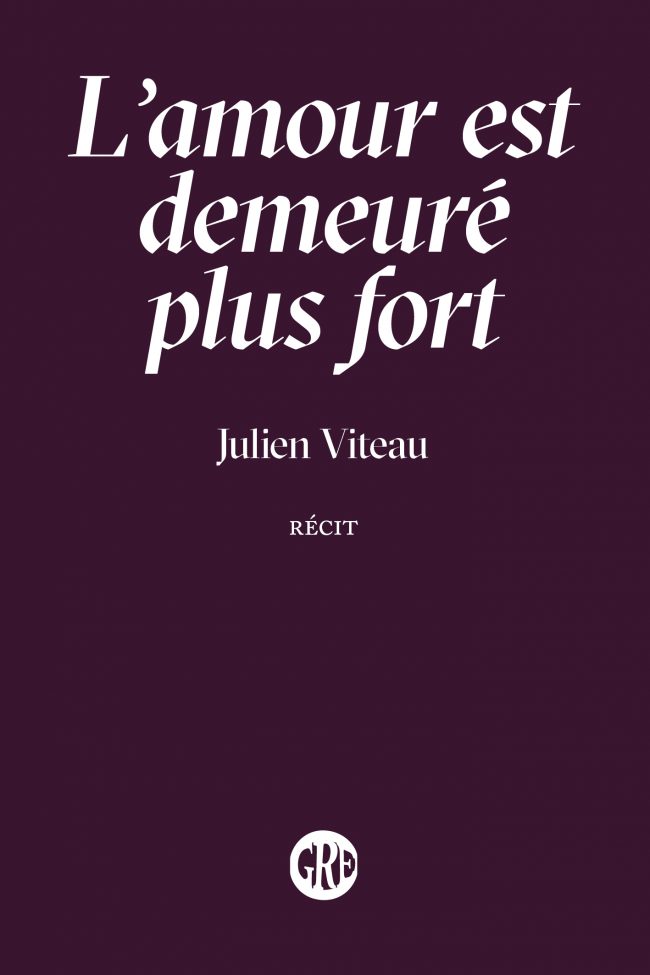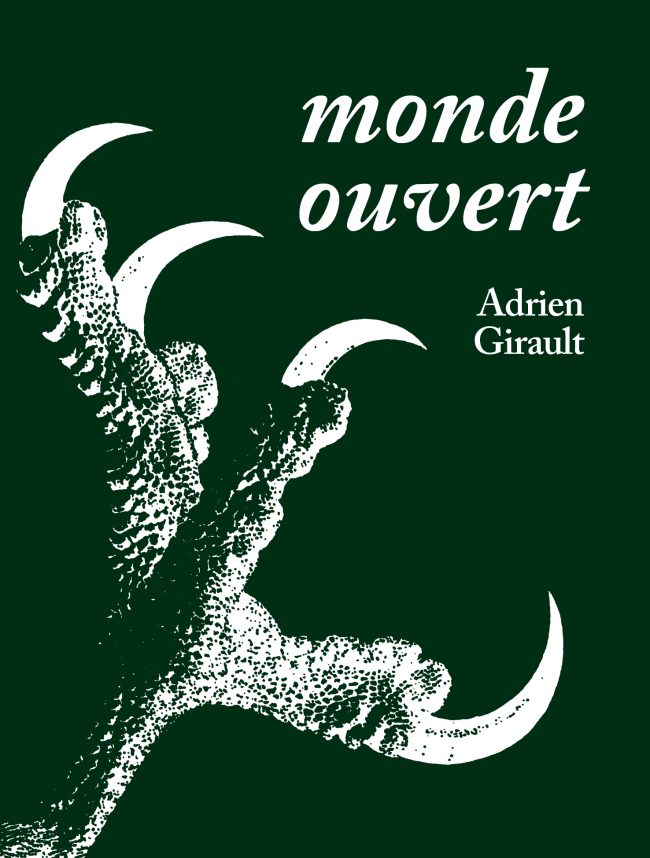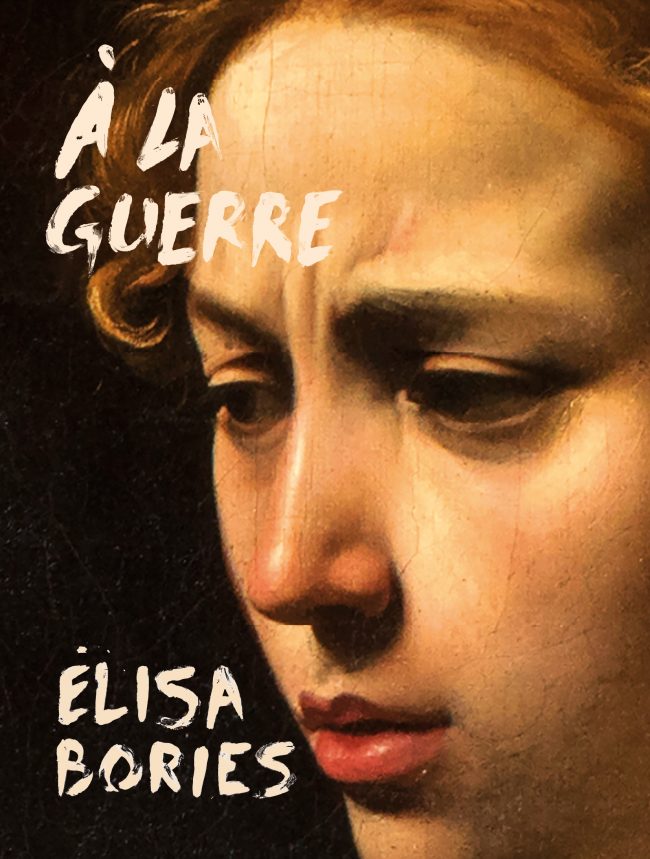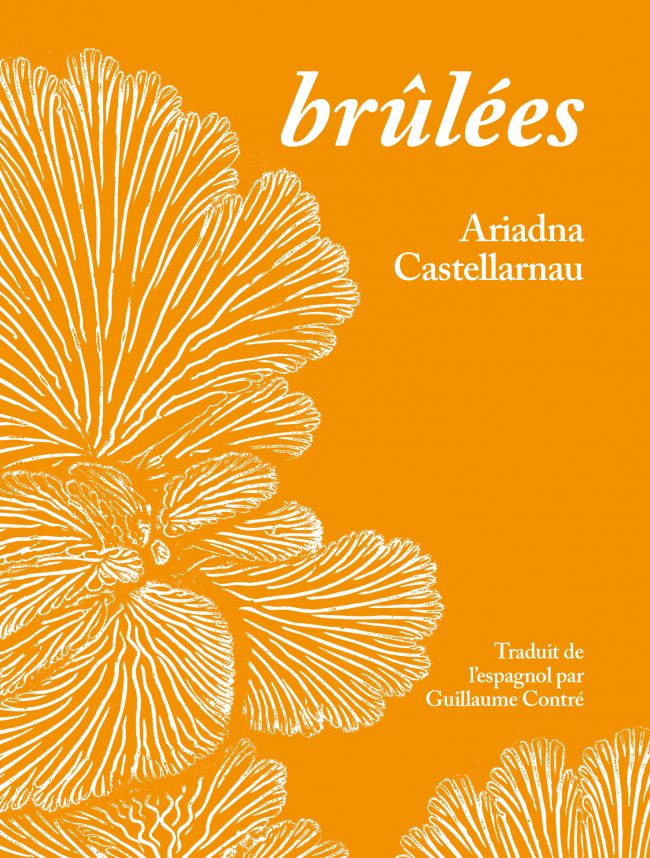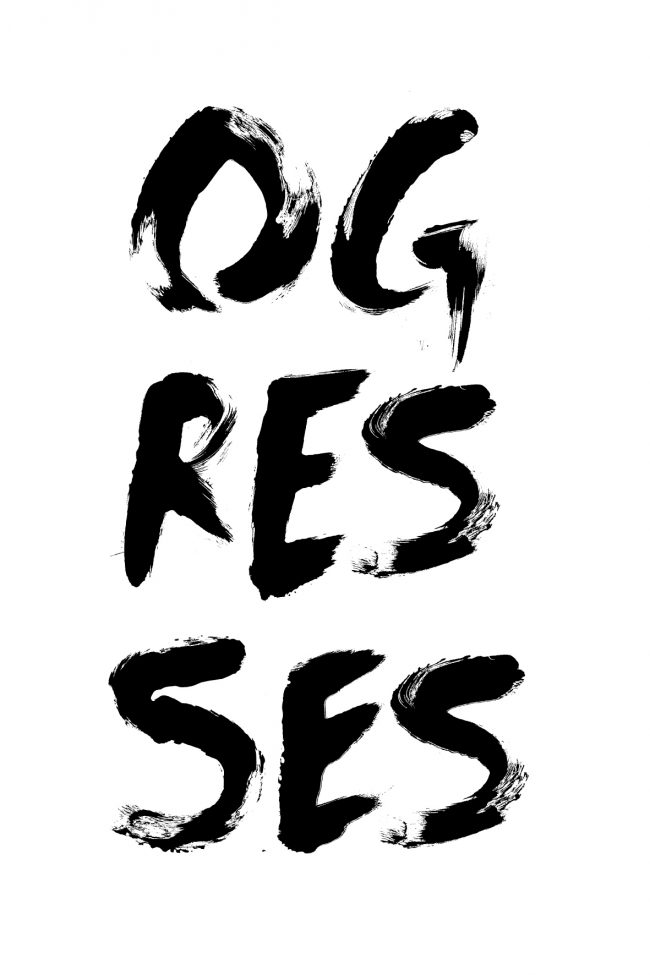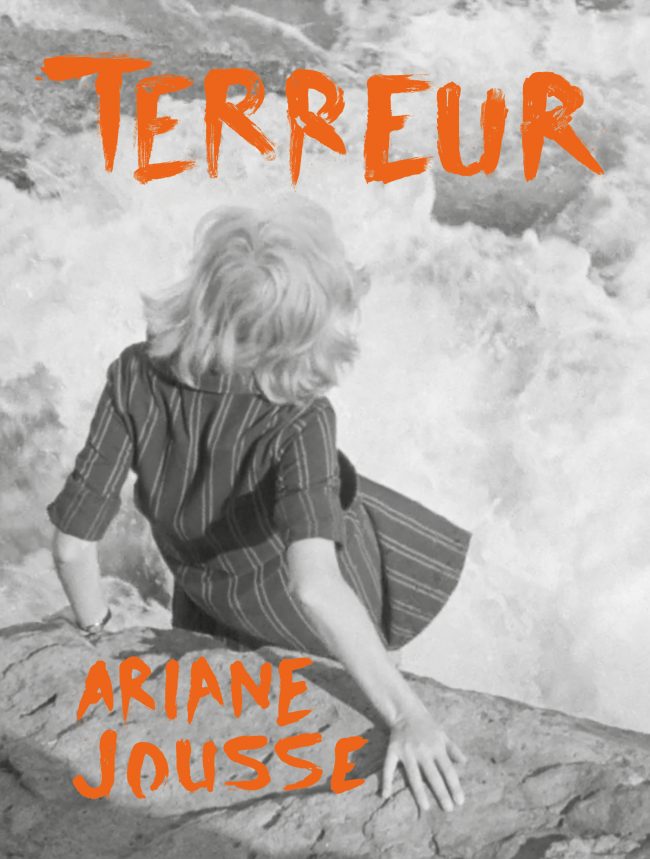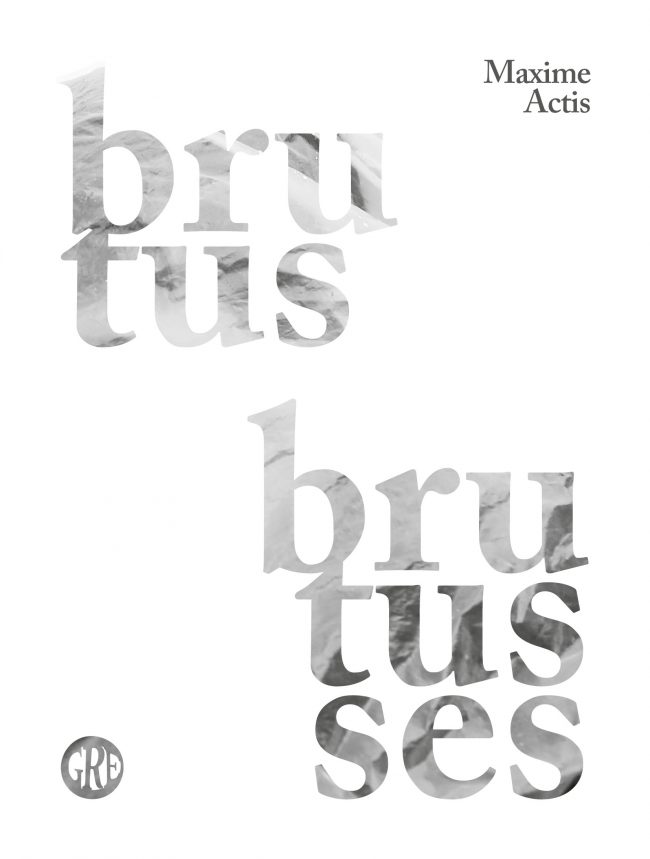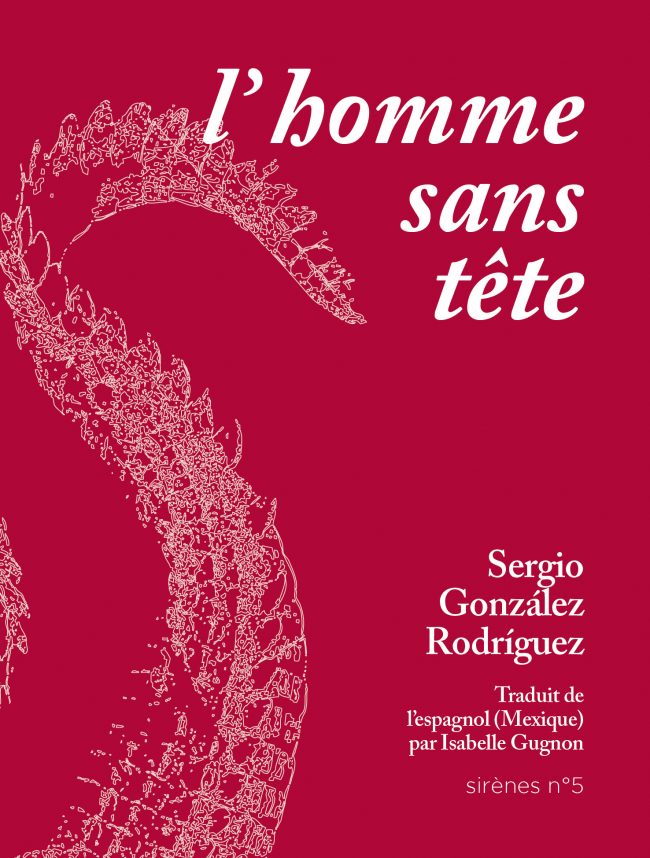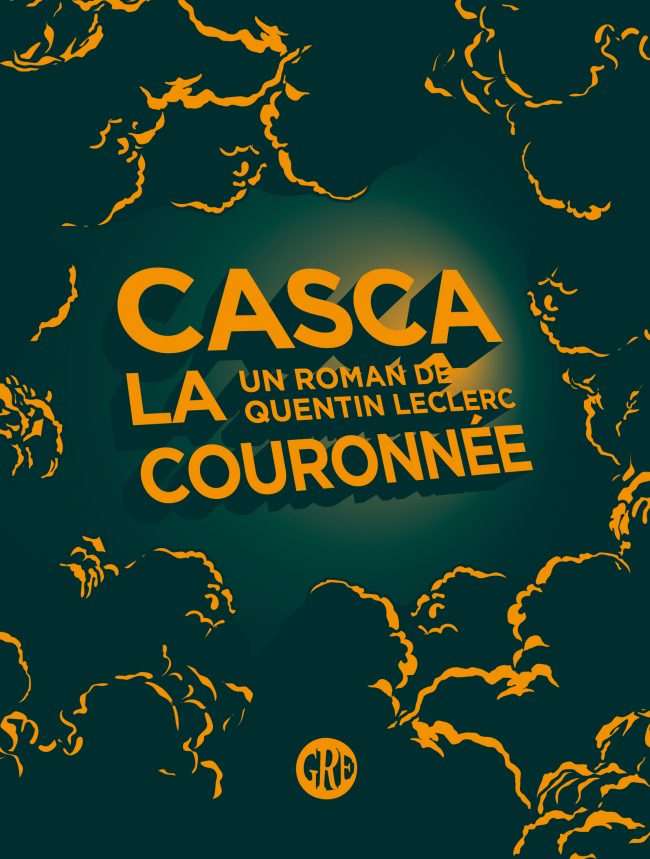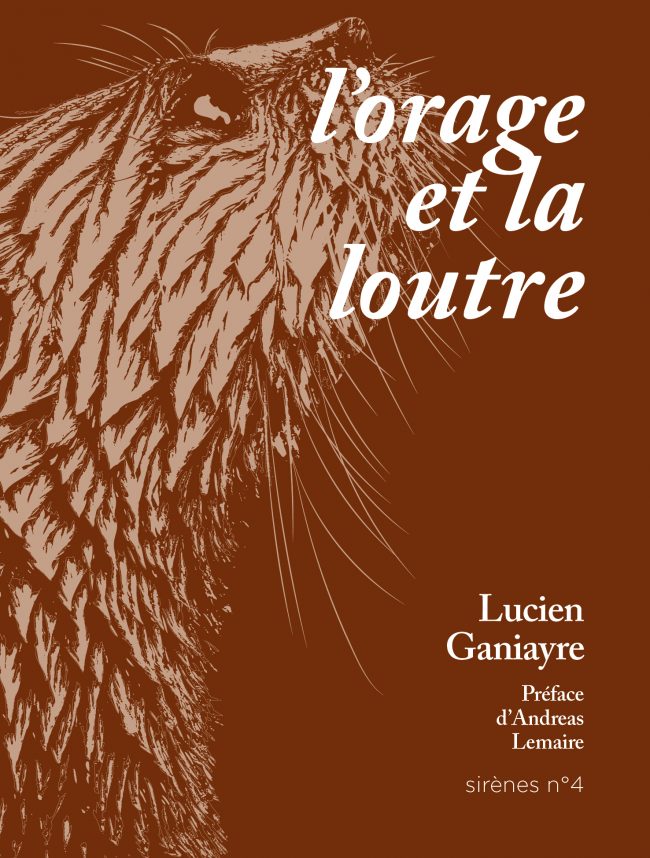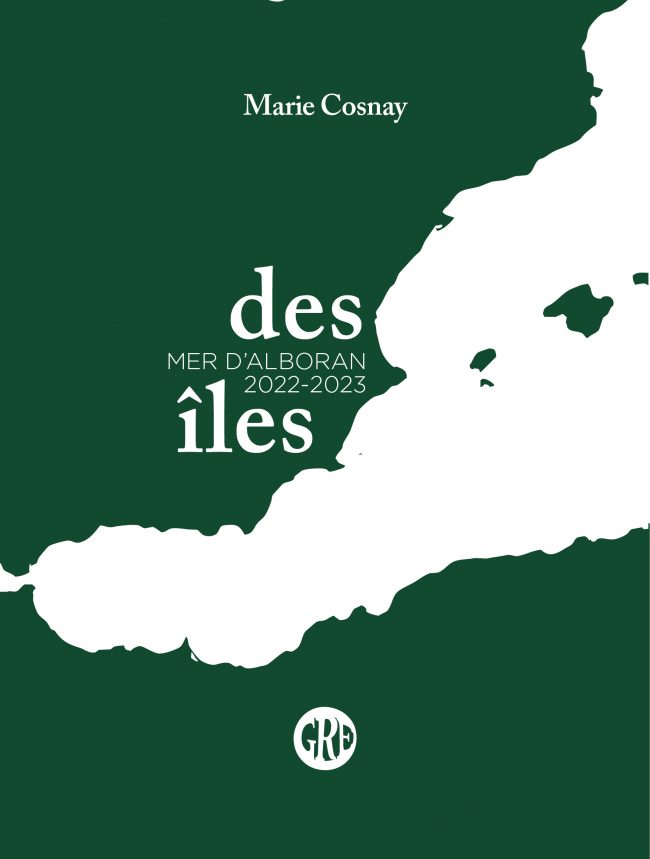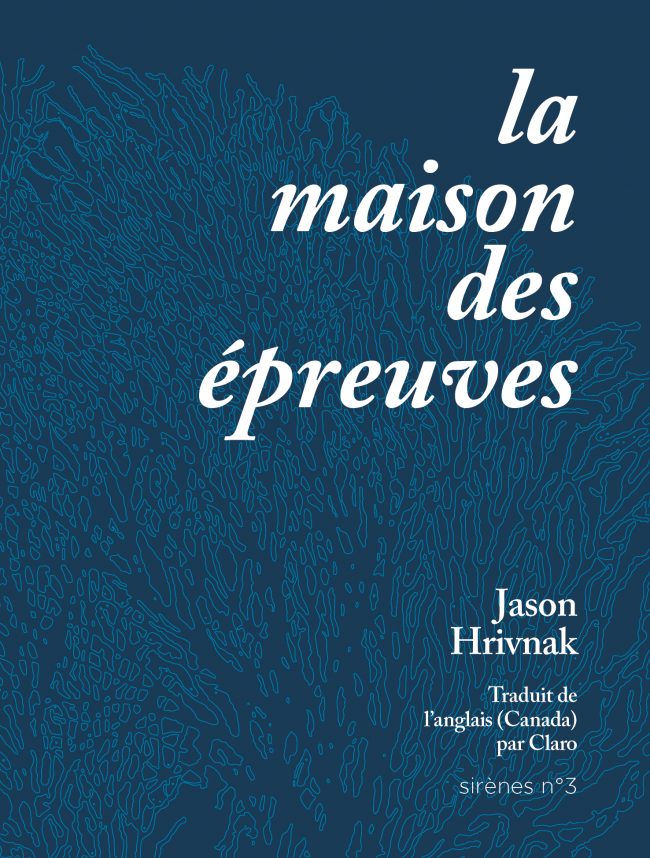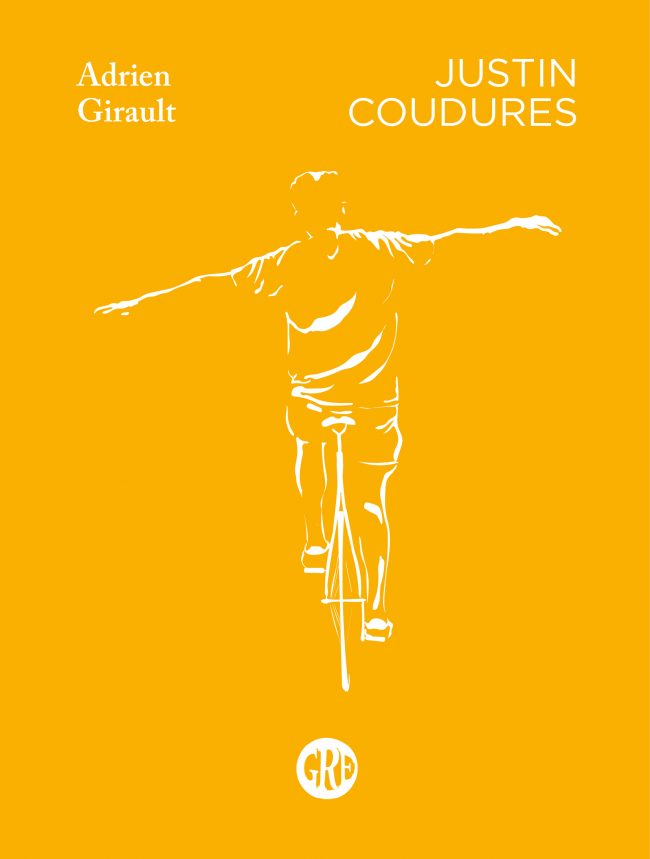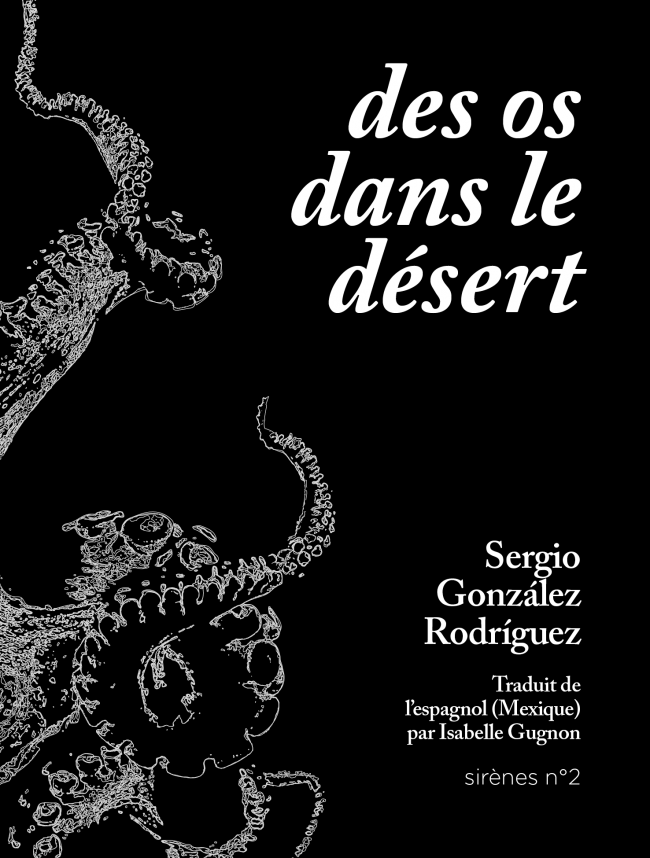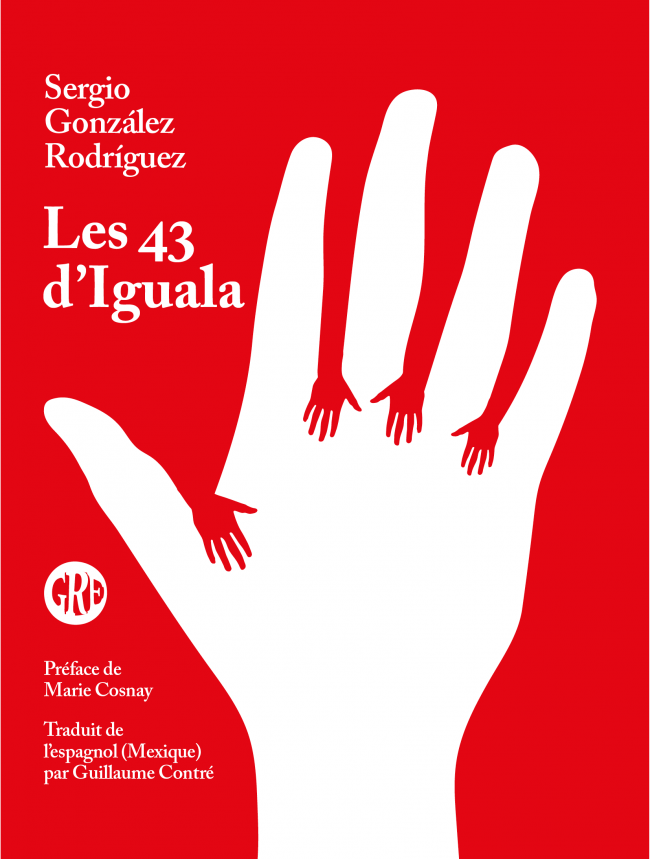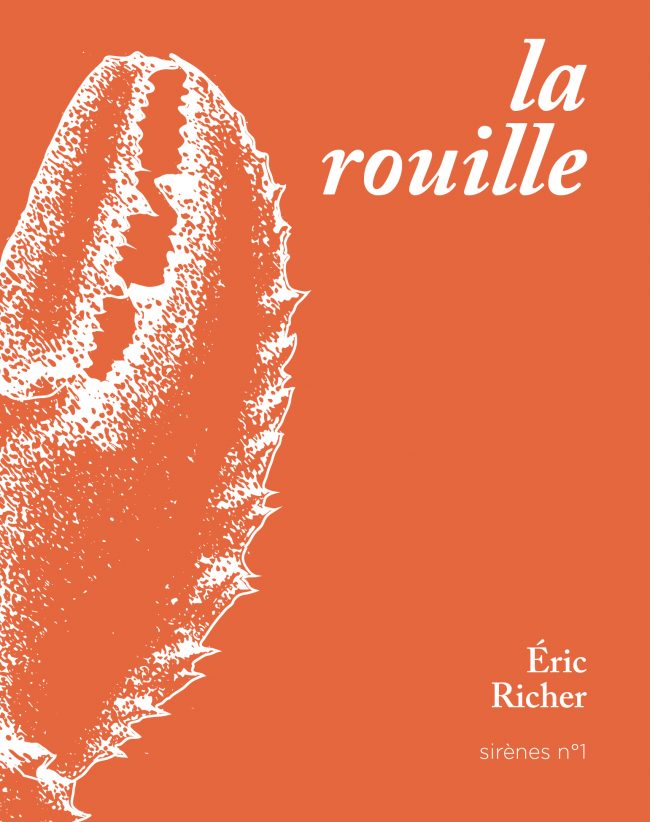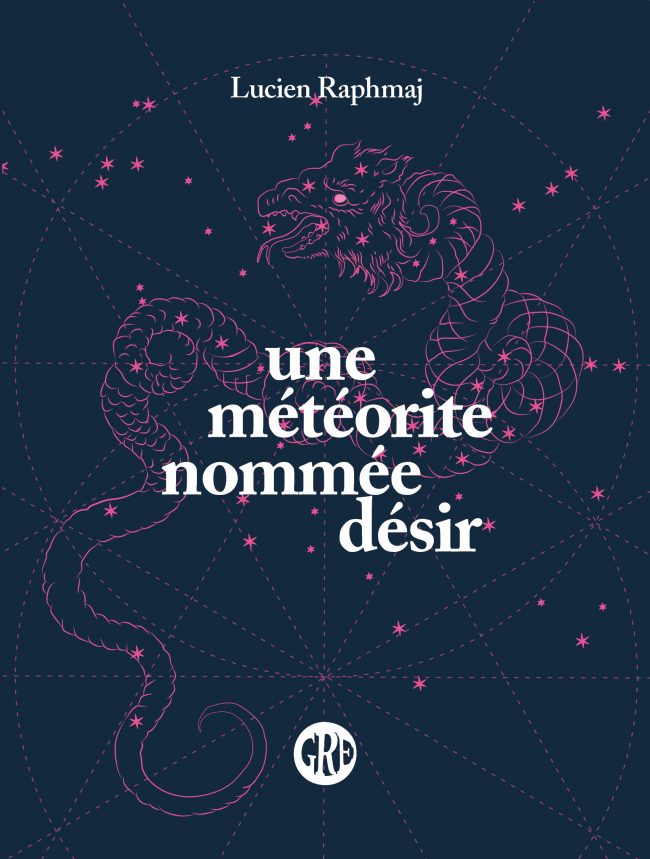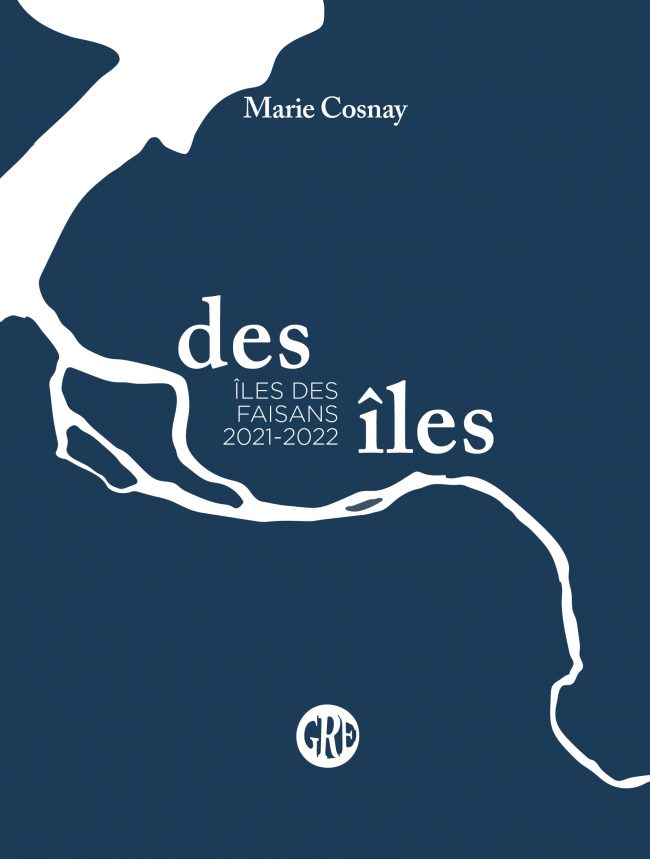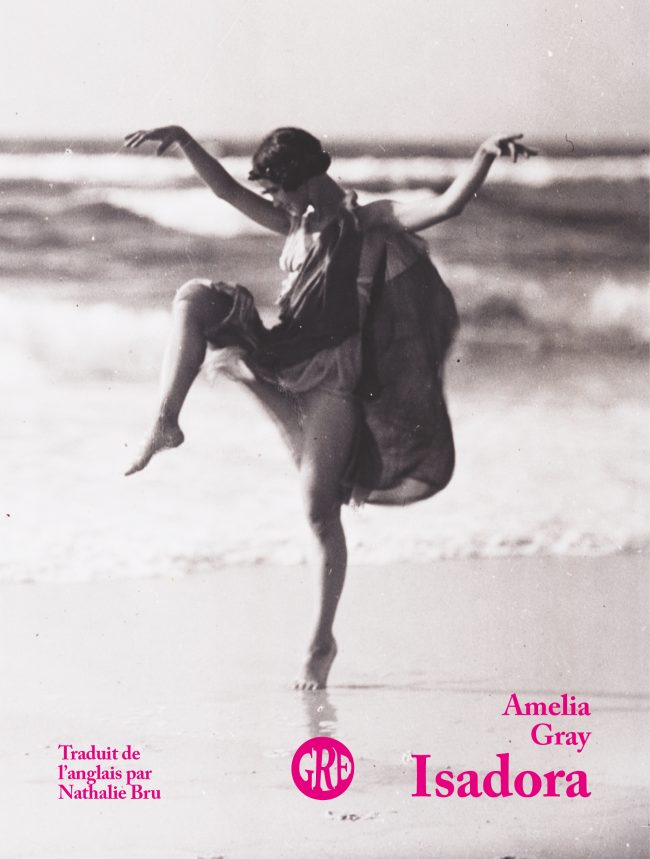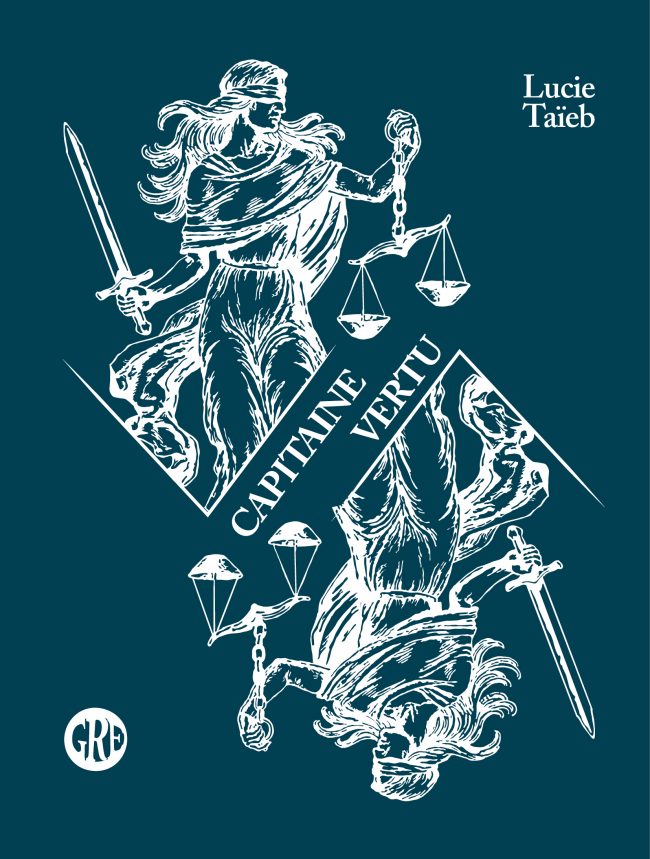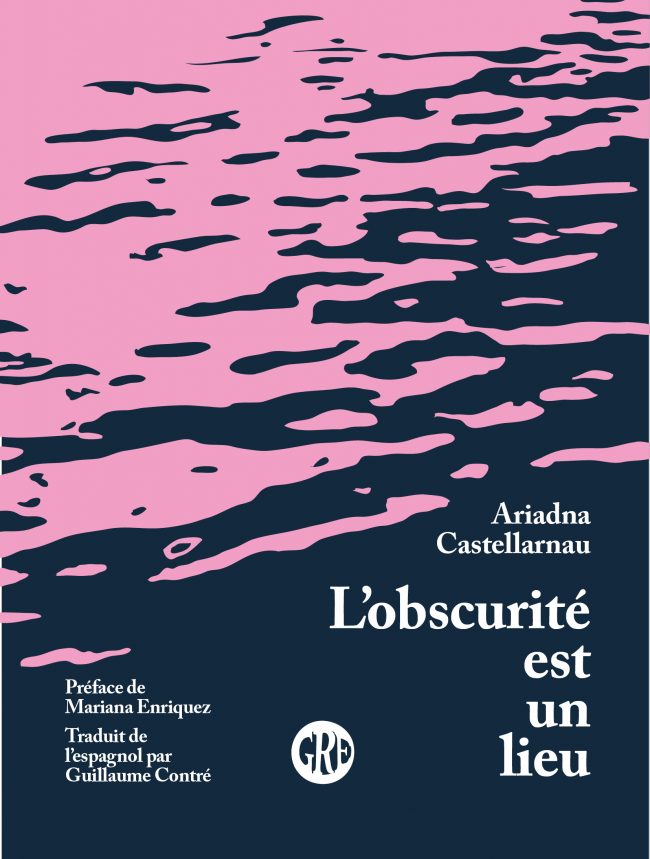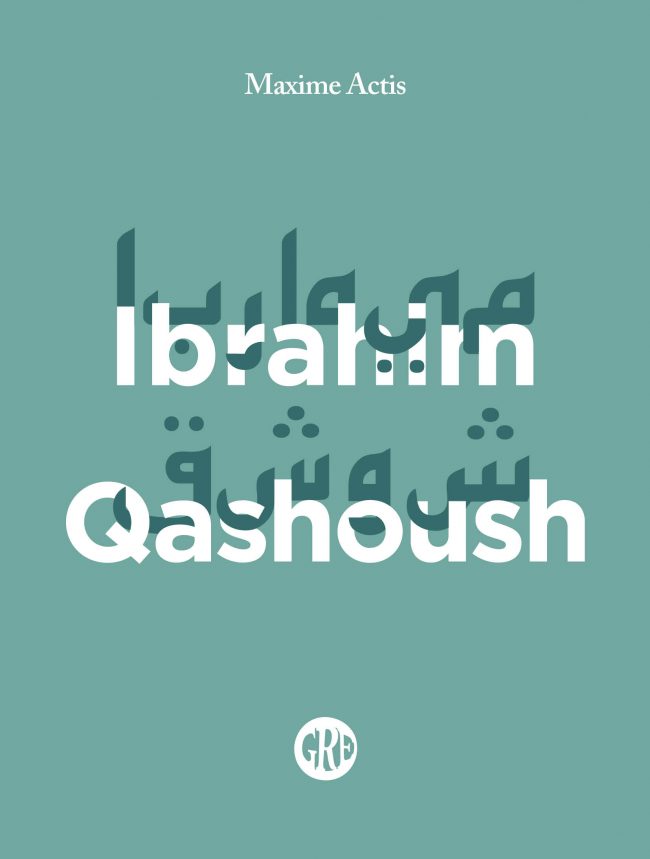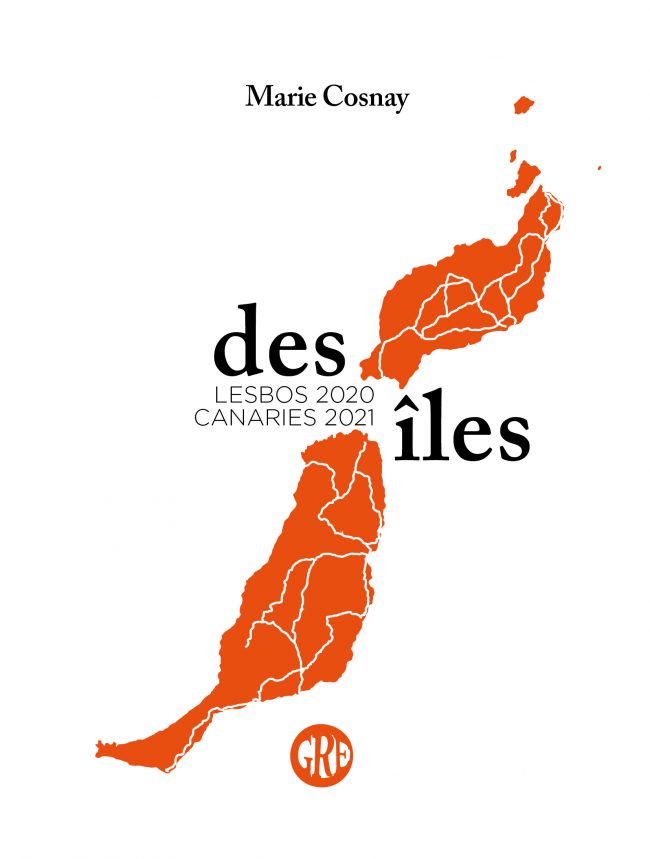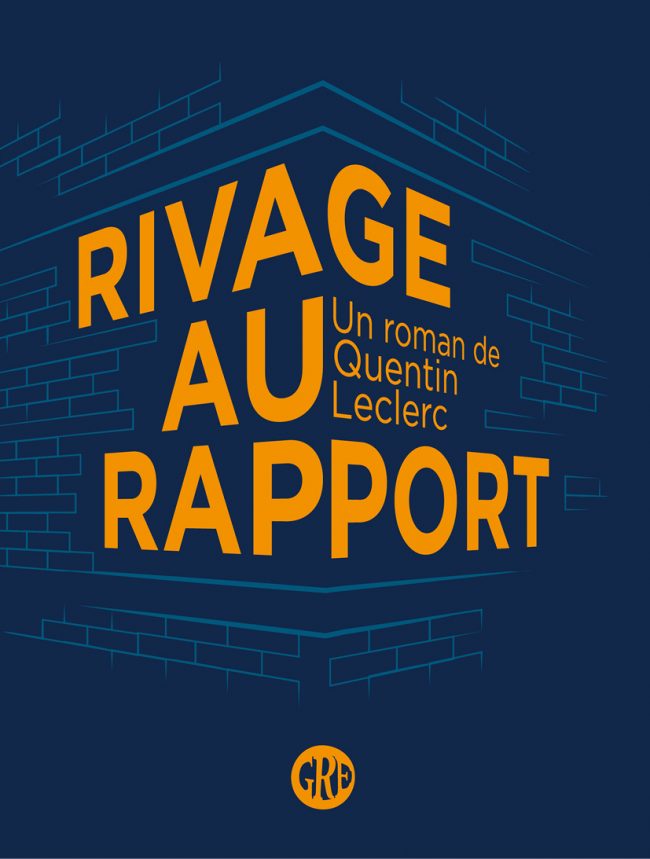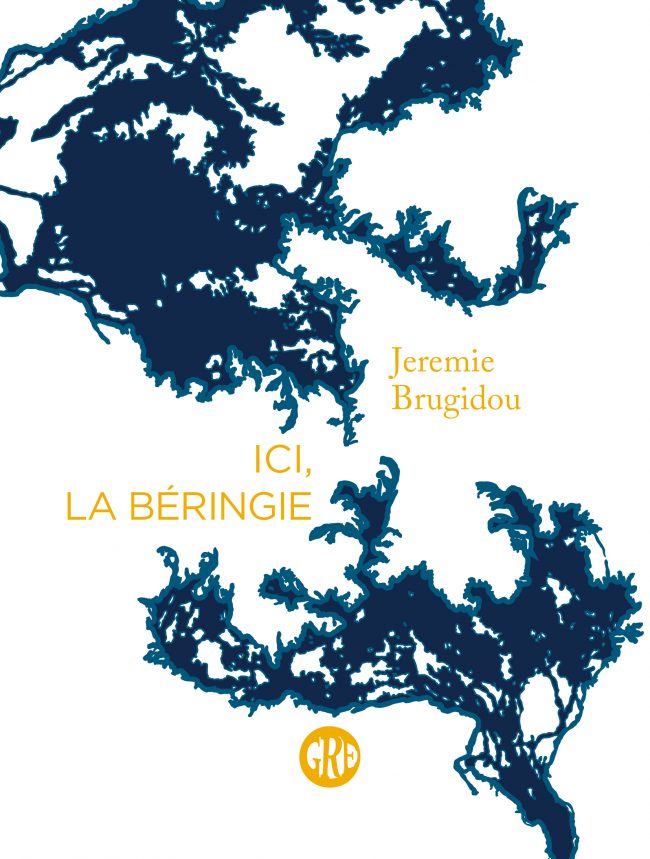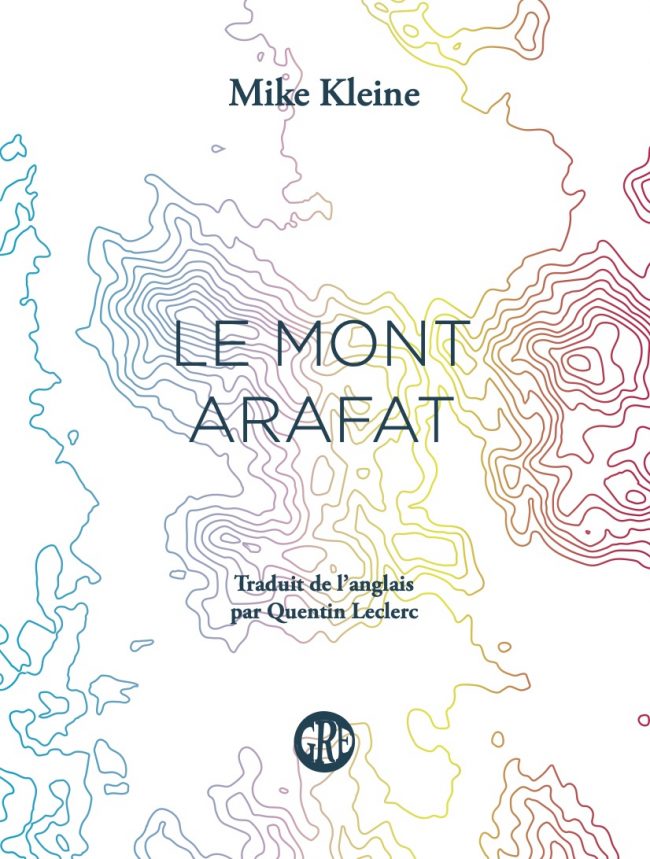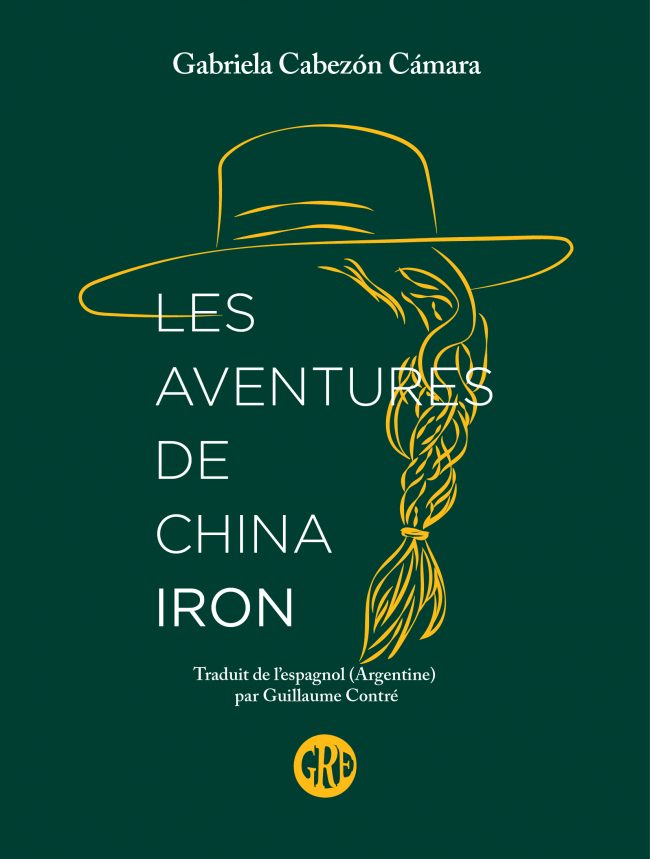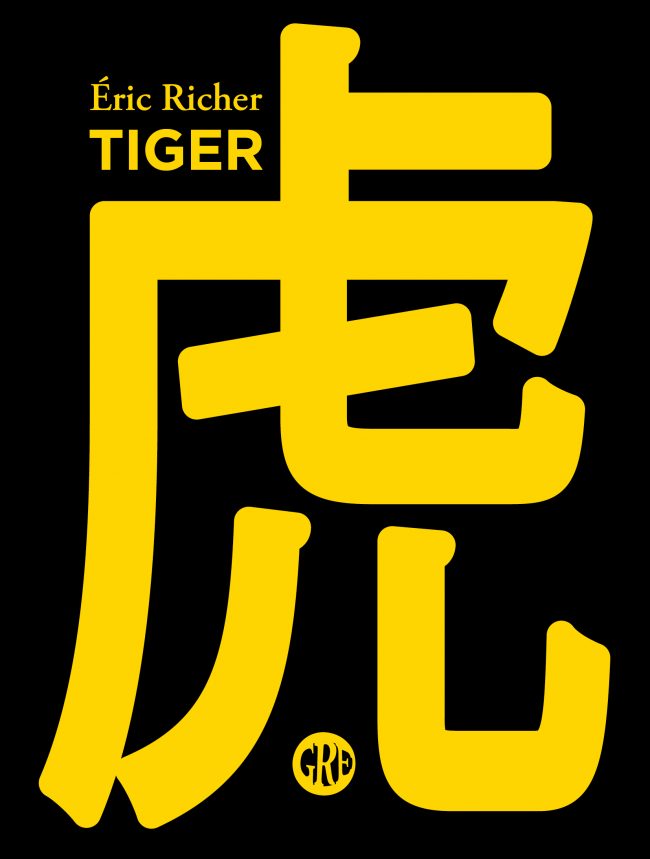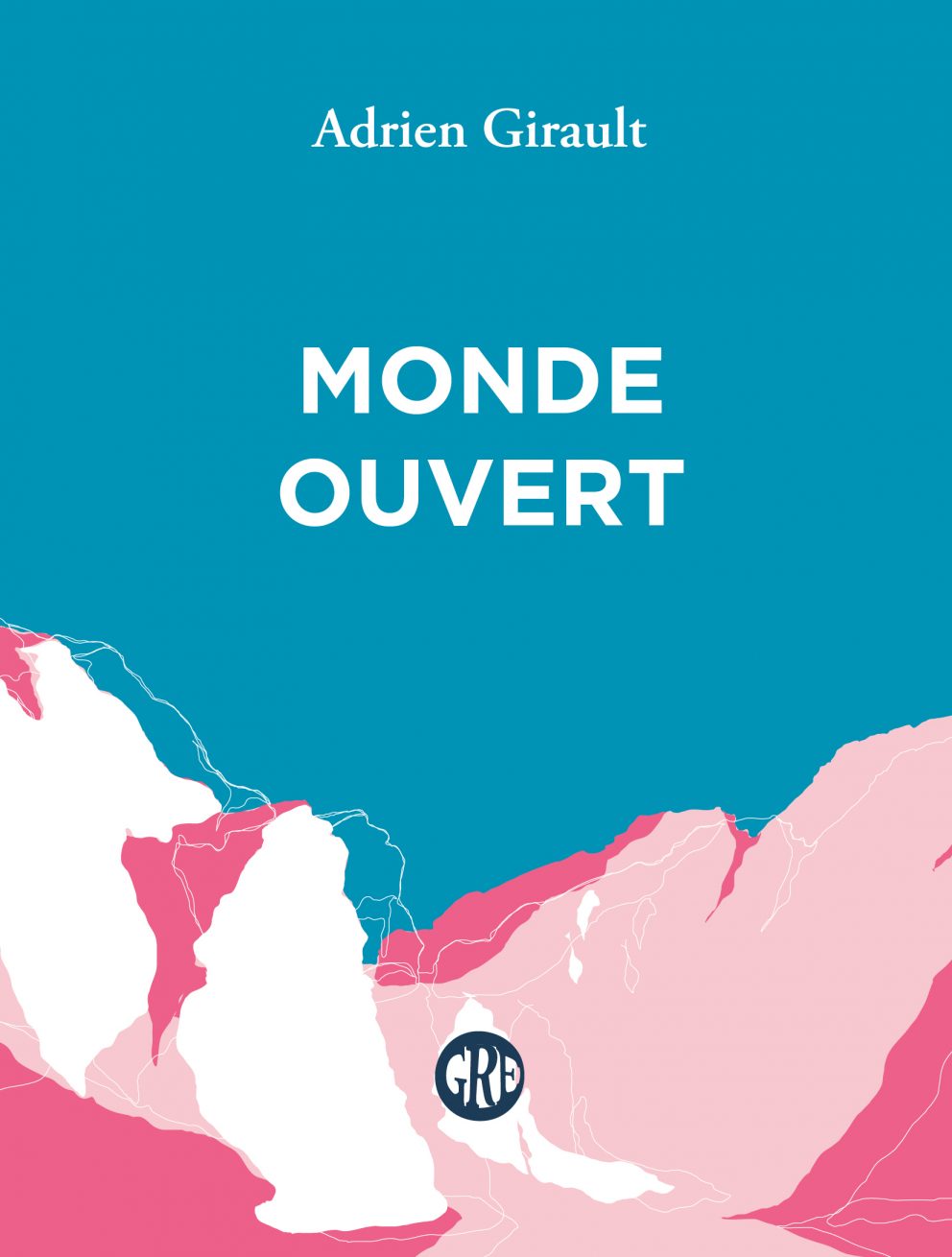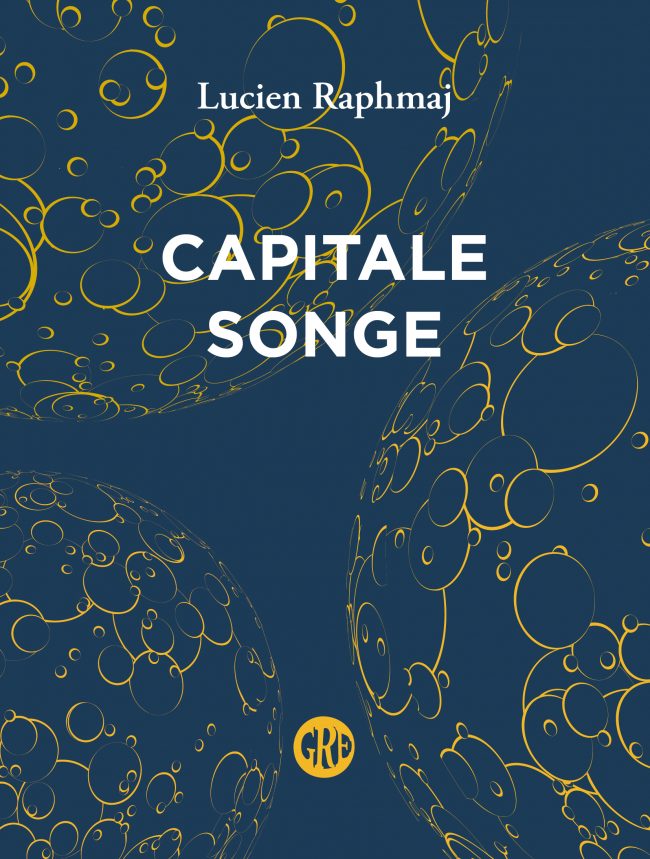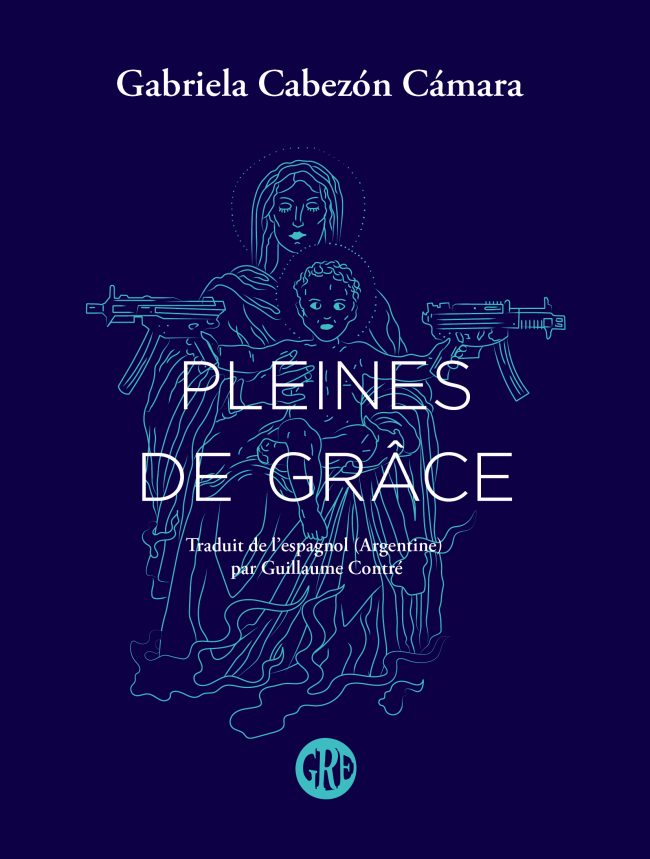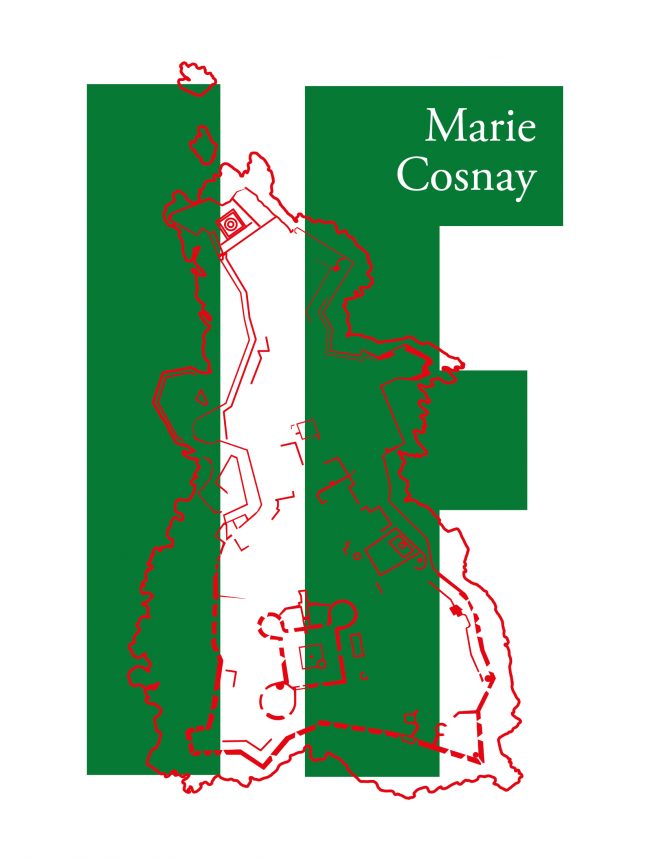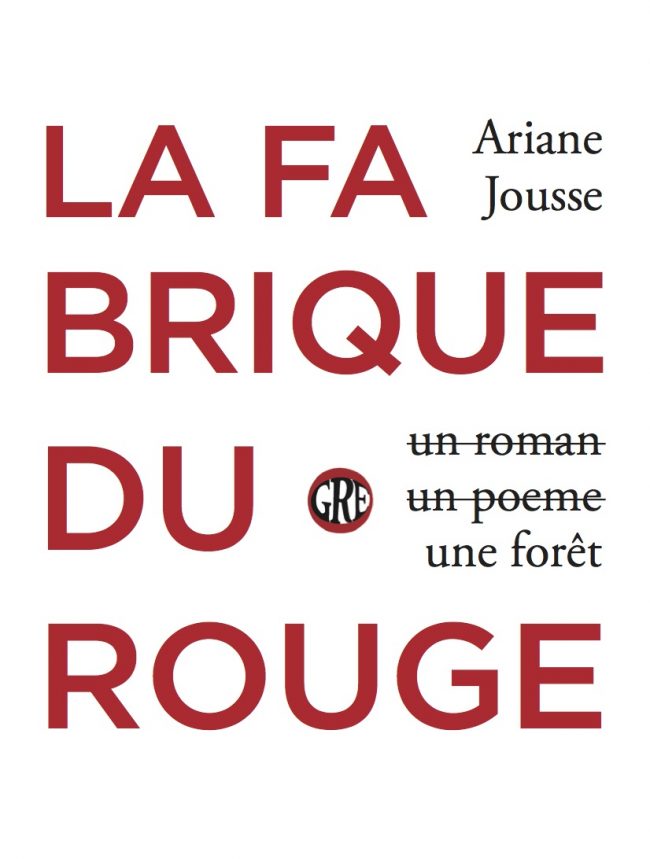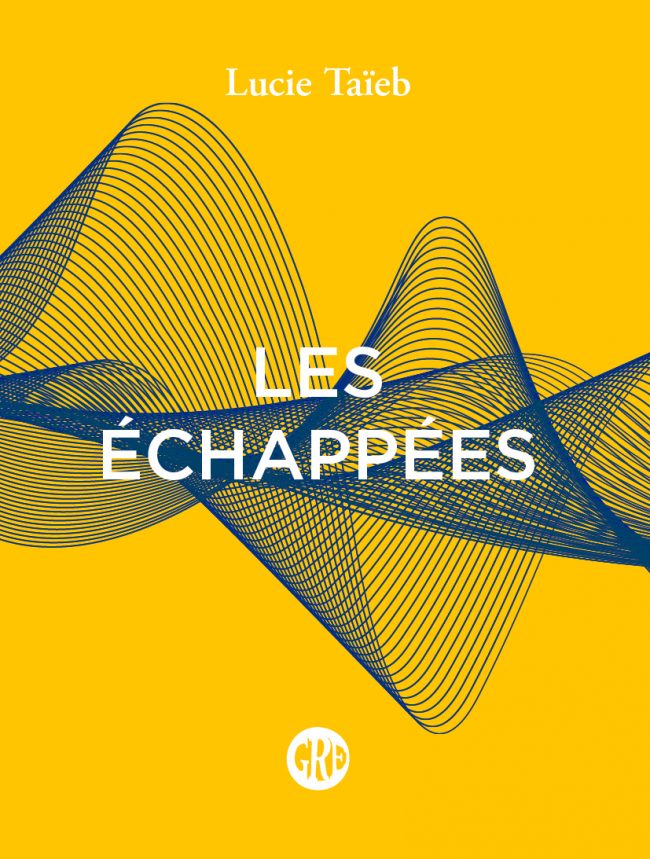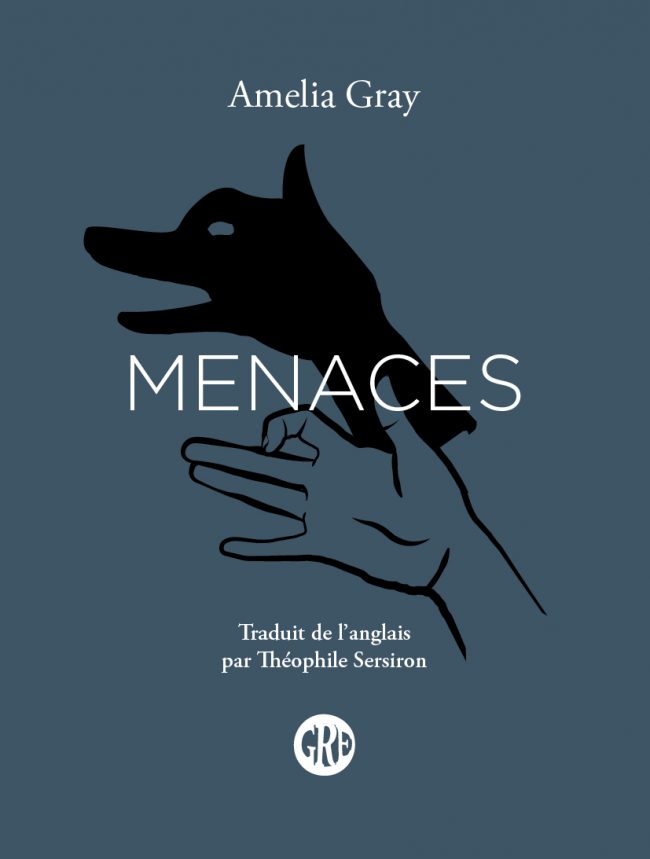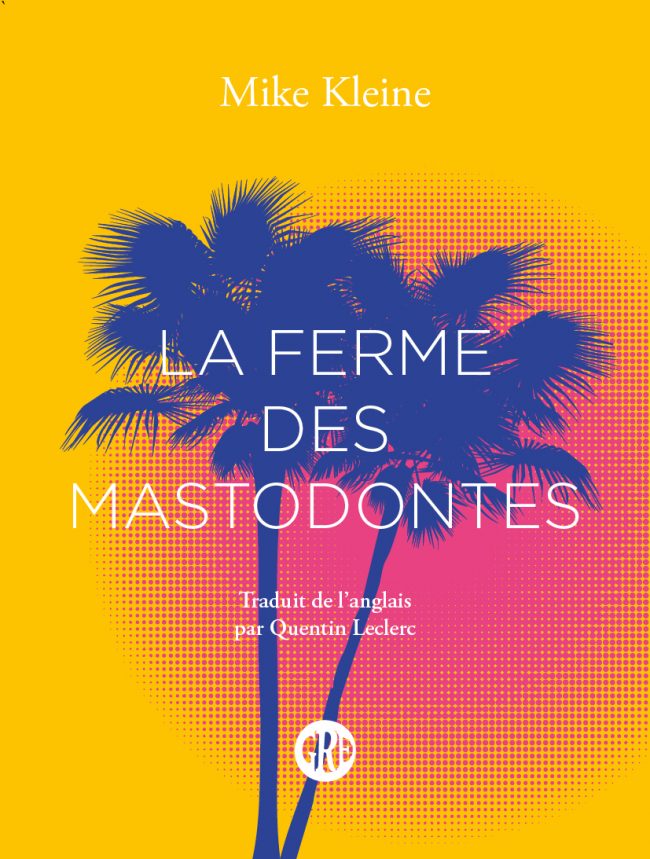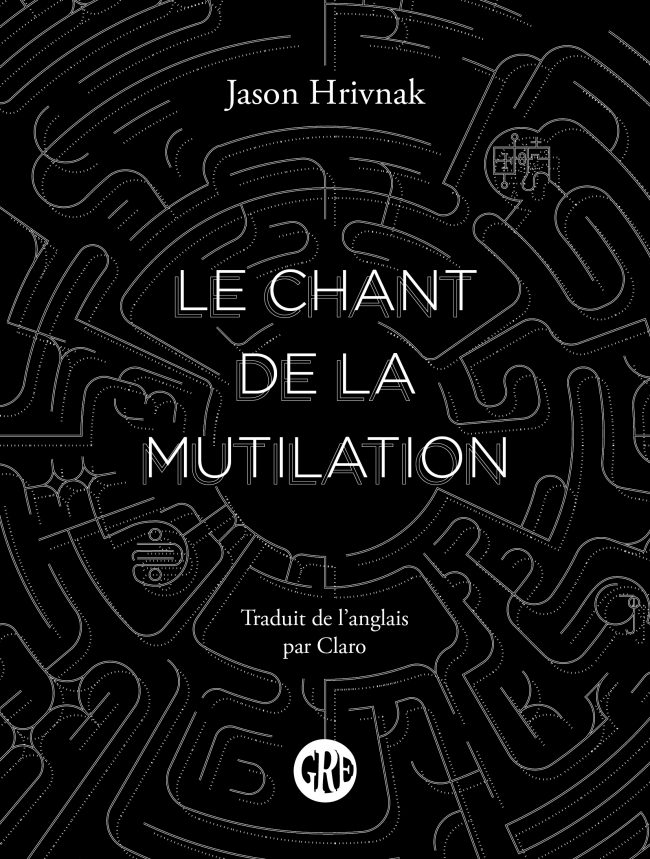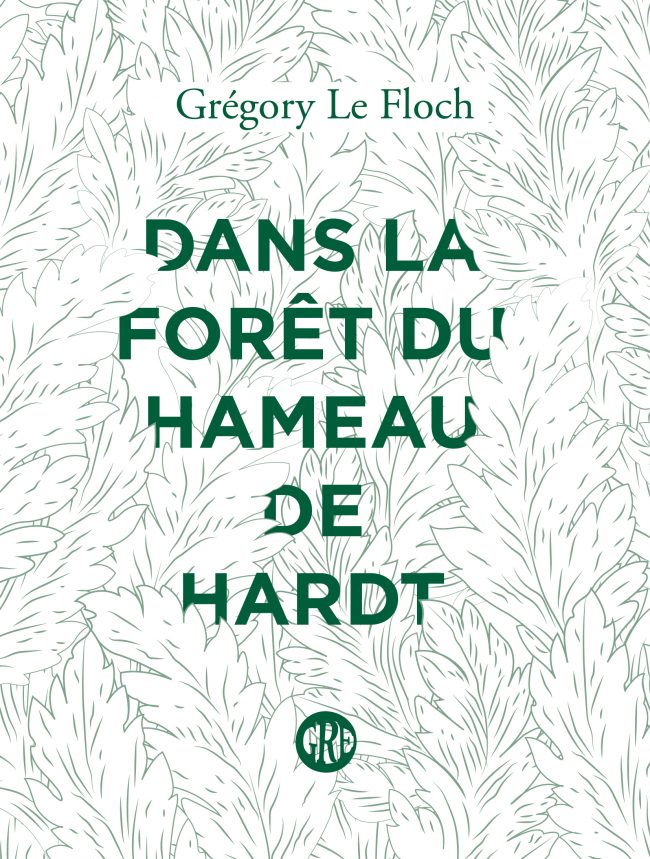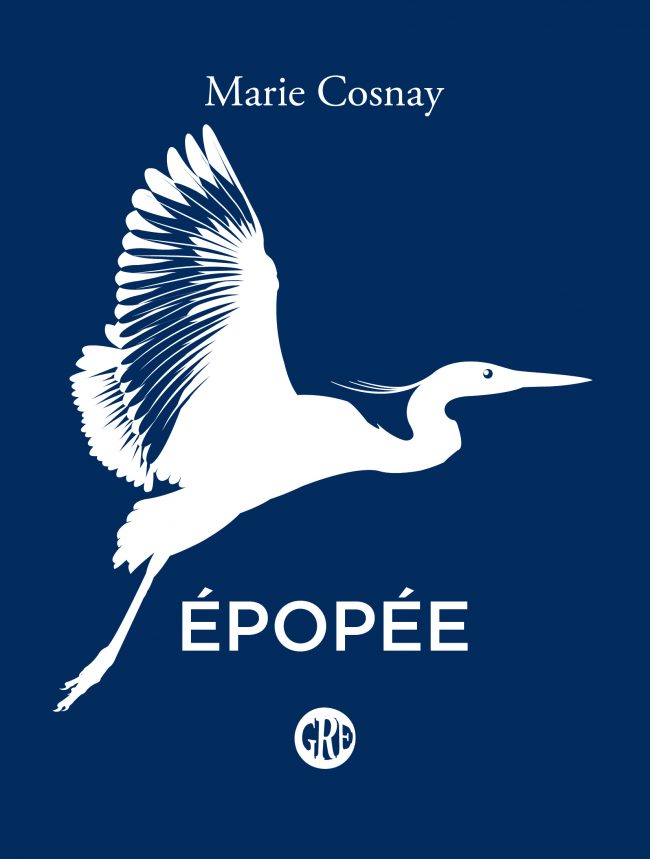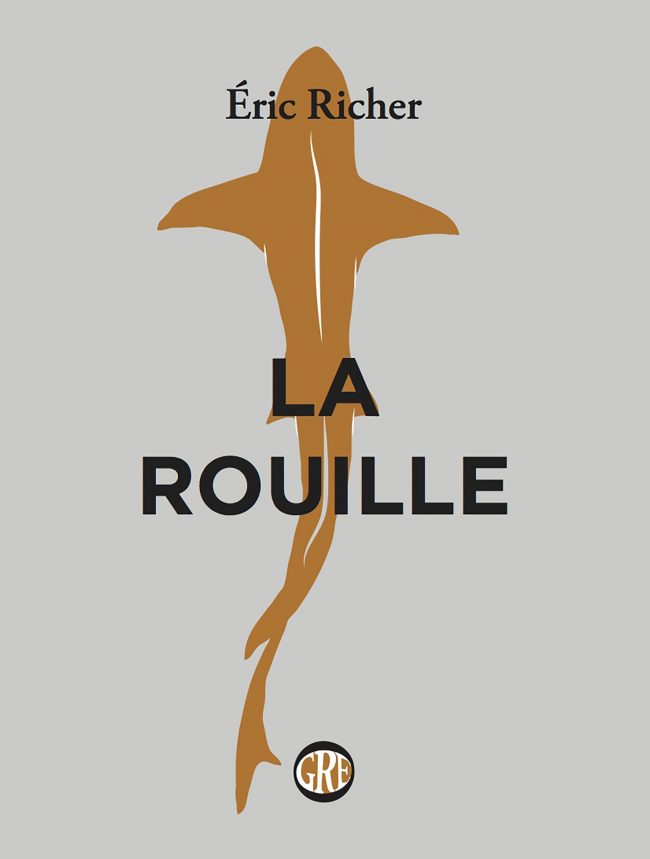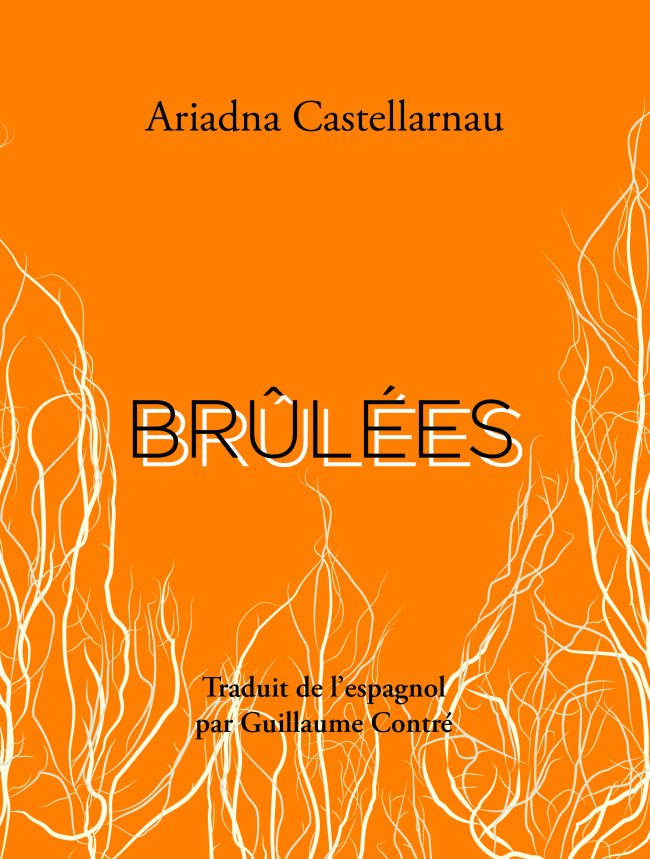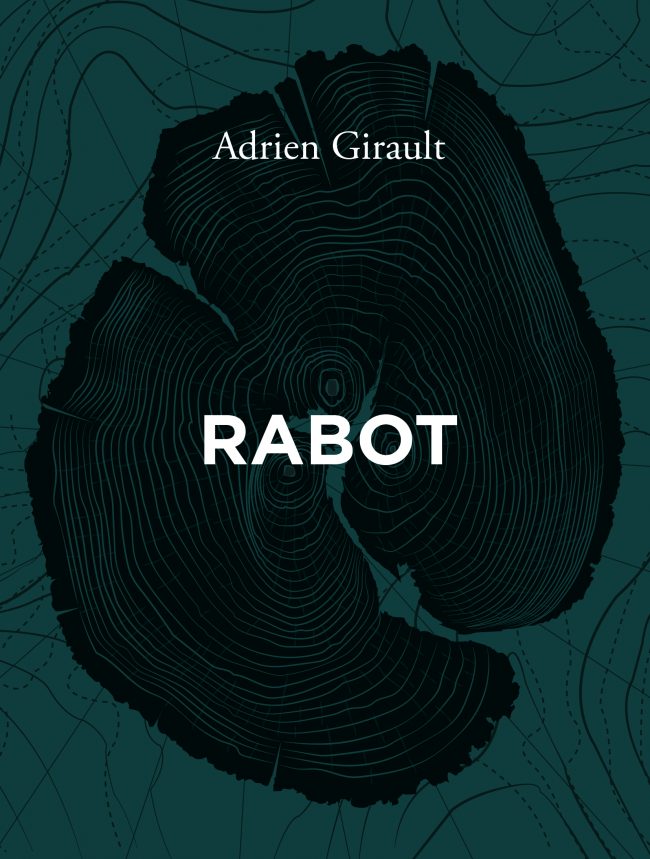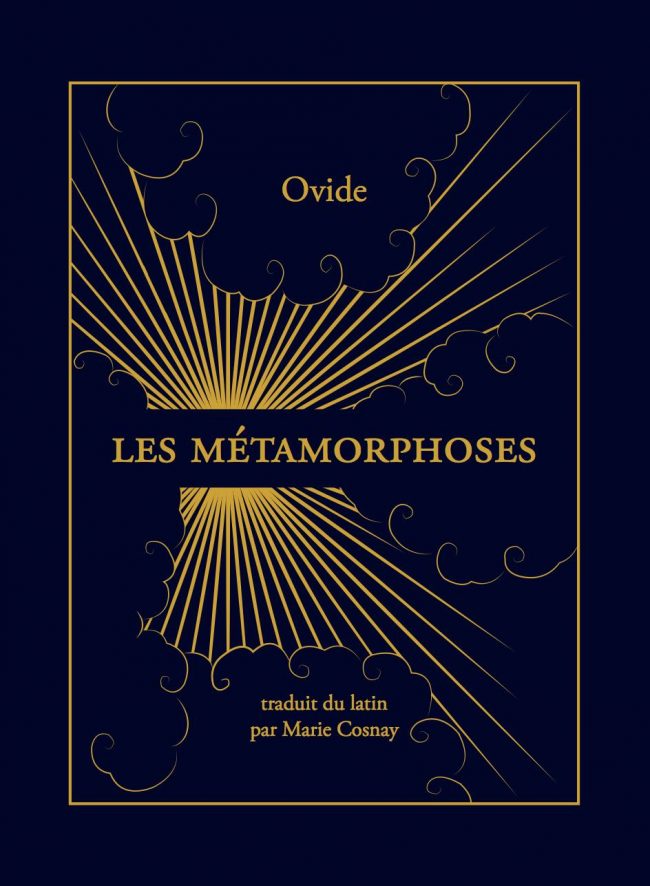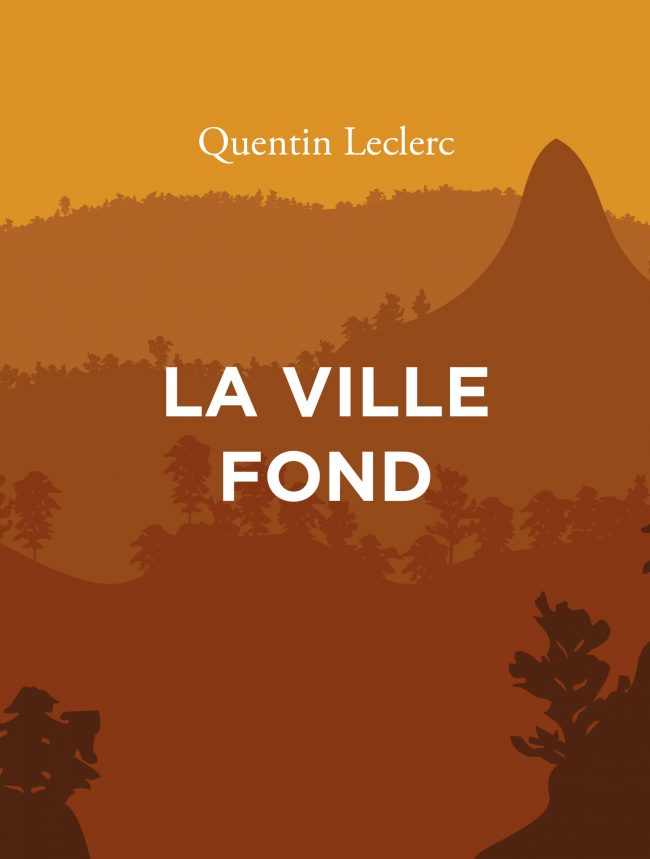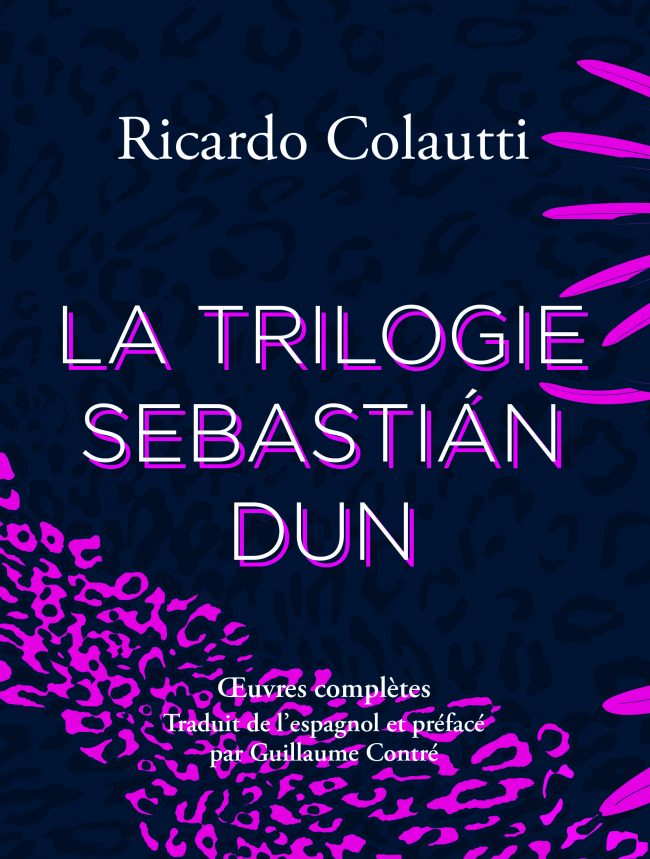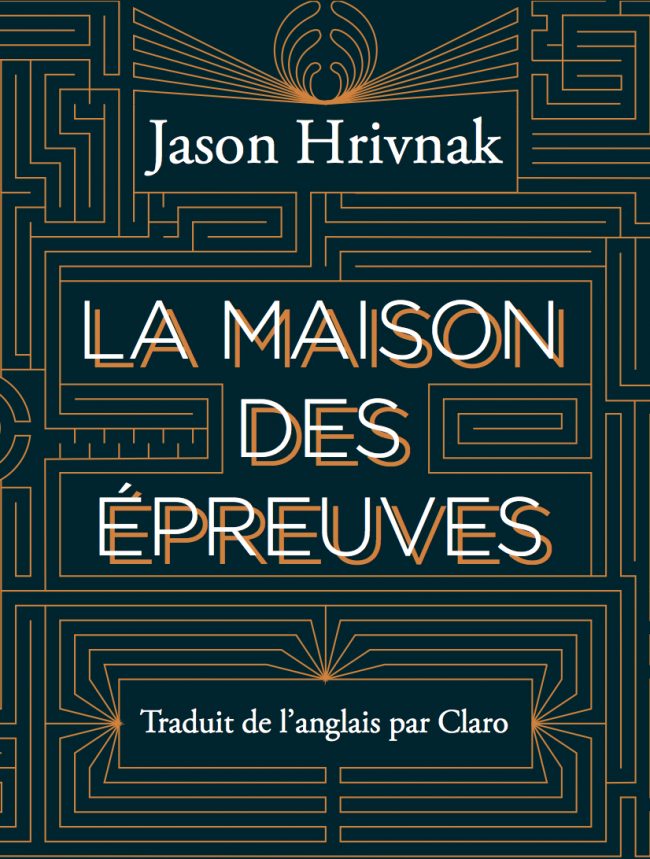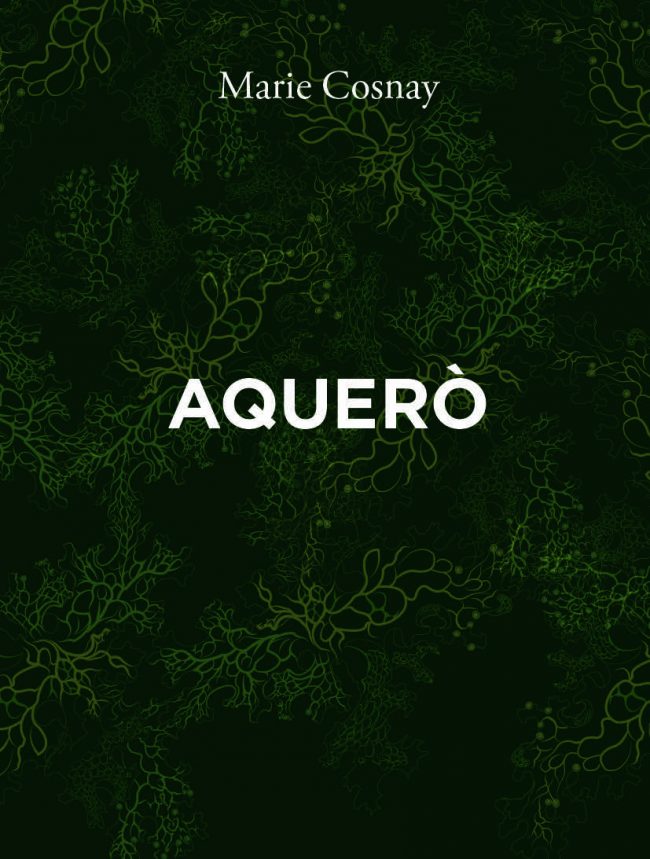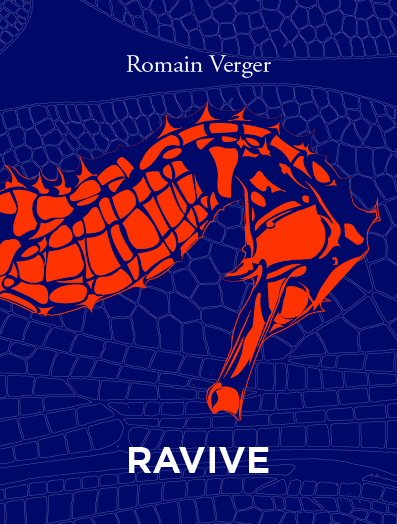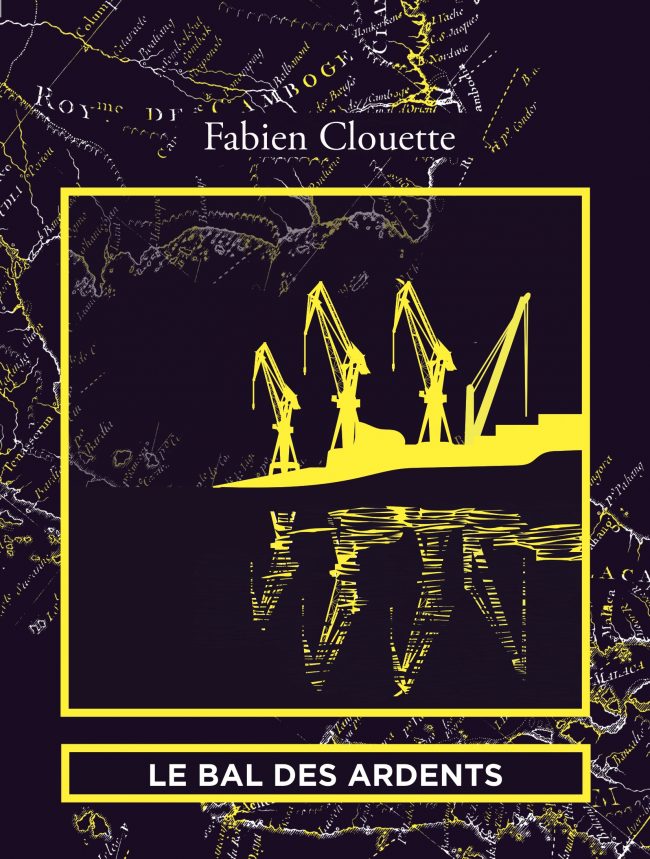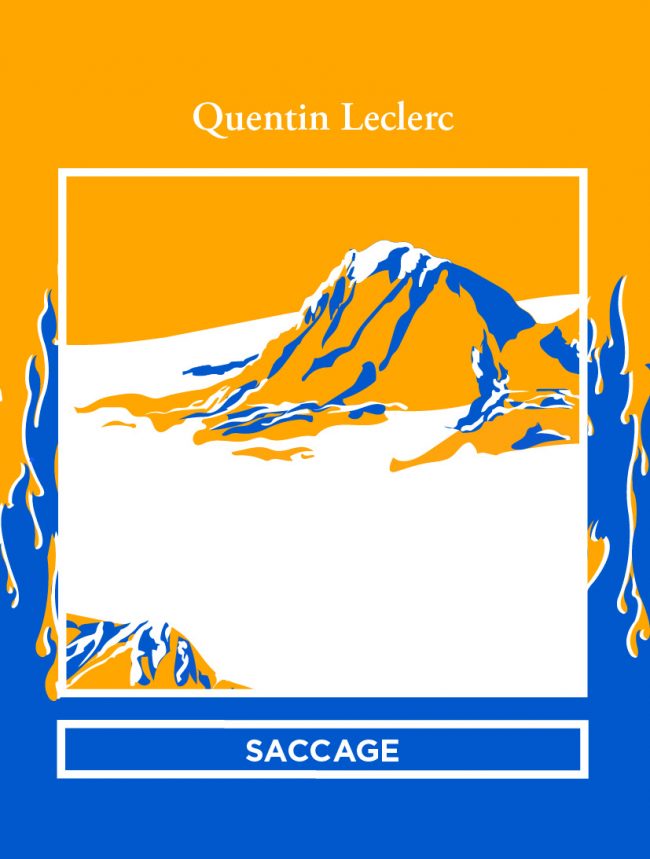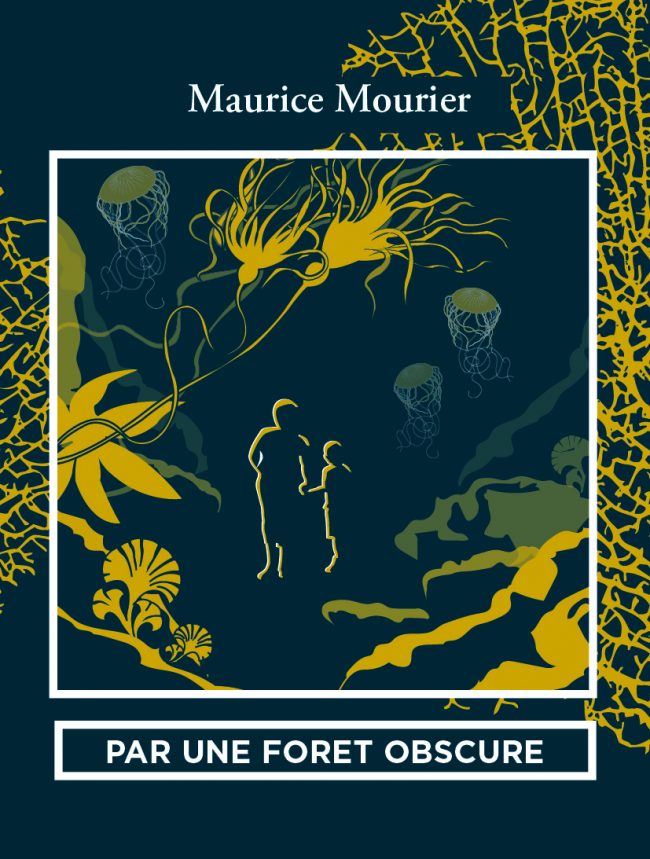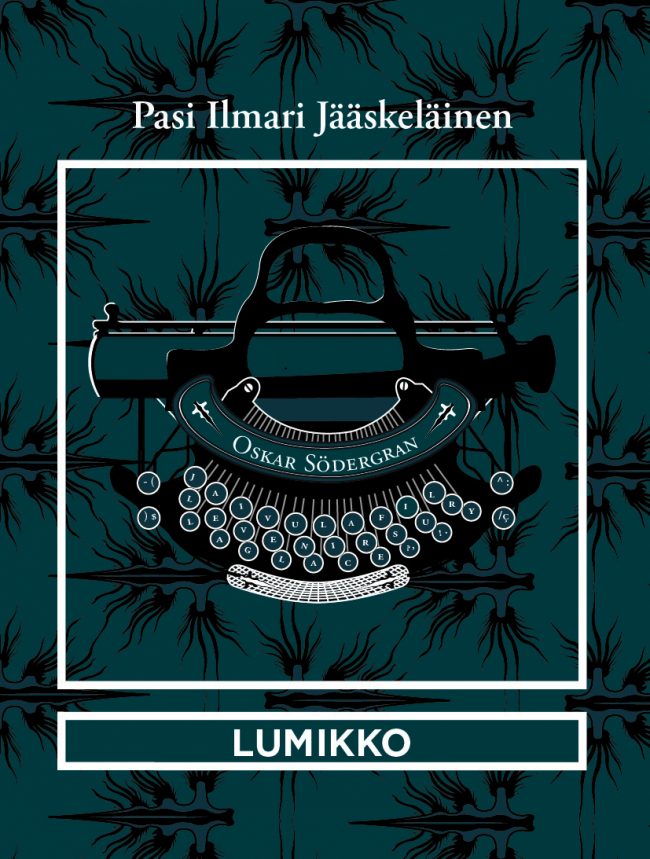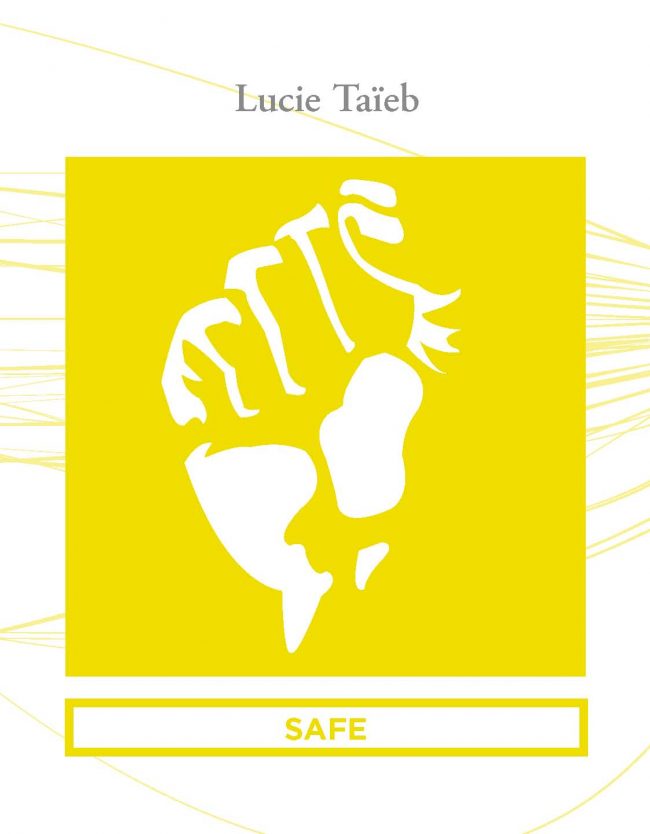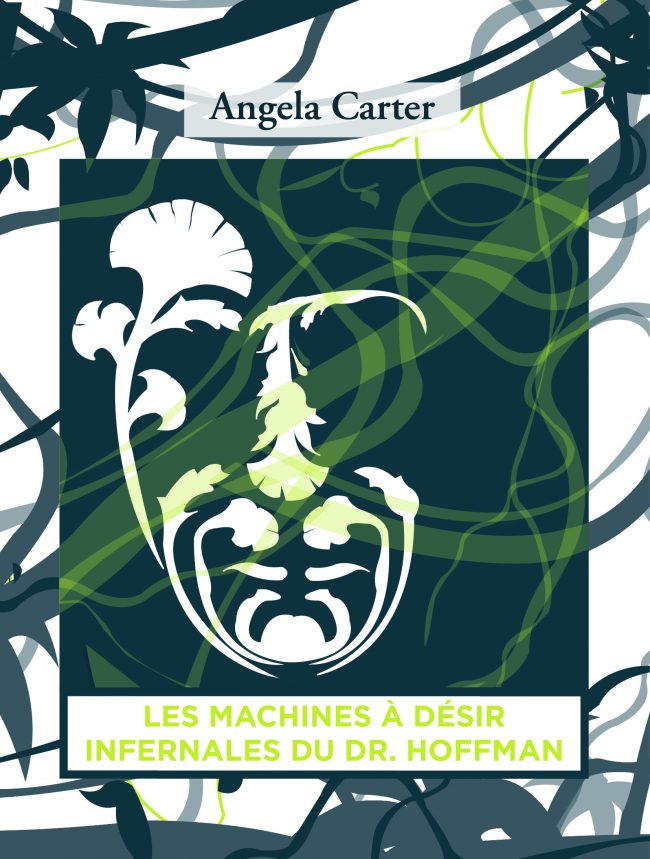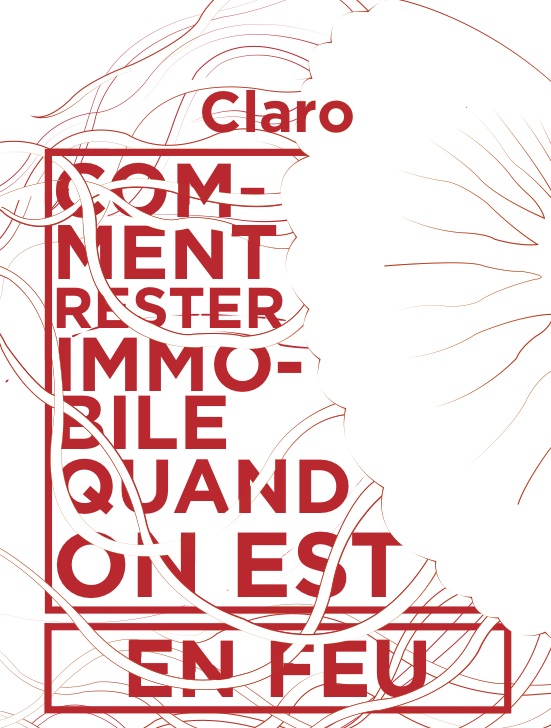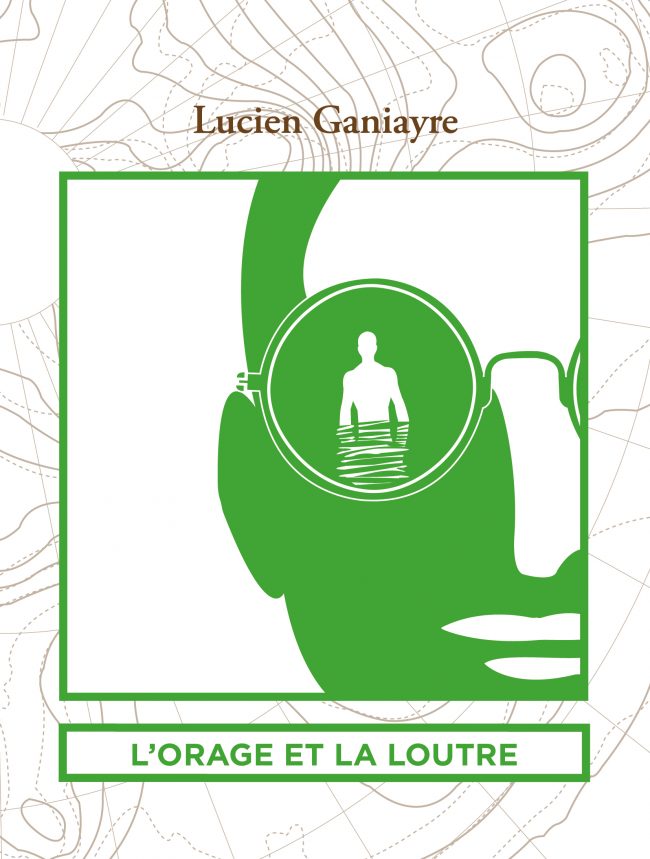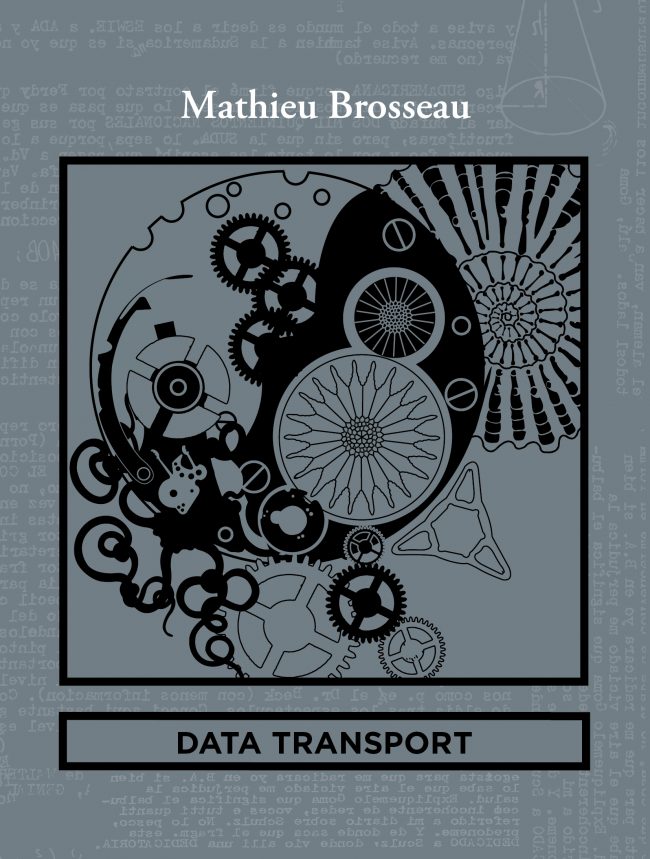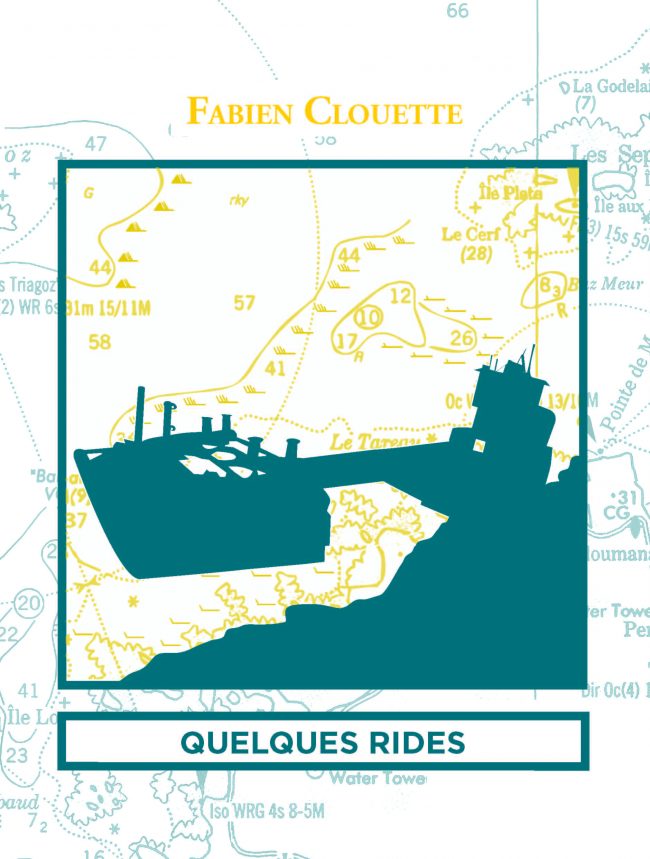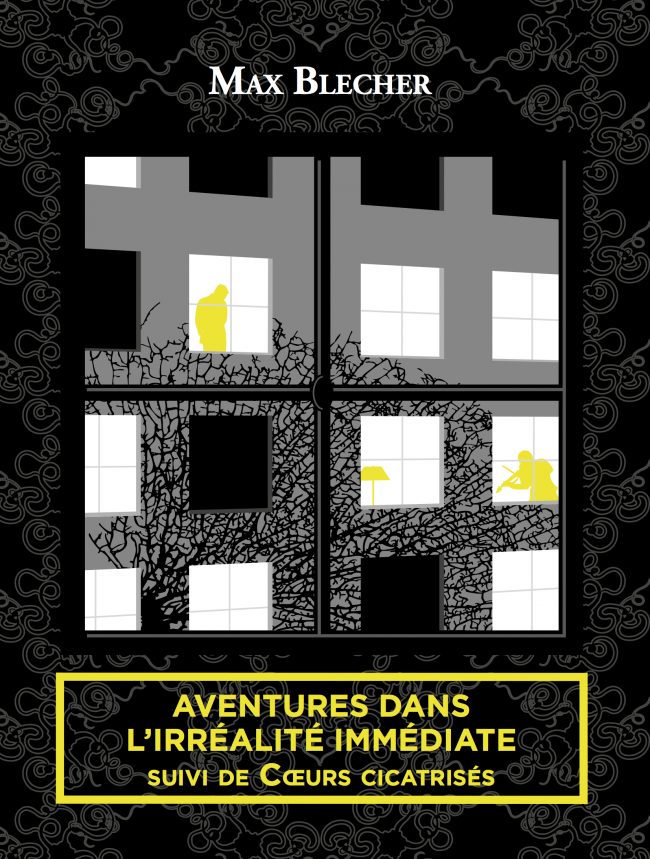Le trésor de Ballantrae
OGRESSES N°3 – Marie Cosnay
Le trésor de Ballantra
13 juin 2025
Taille : 140 mm / 185 mm – 256 p. – 20 €
ISBN : 978-2-37756-231-2
Après Cordelia la guerre et Épopée, suivez une nouvelle aventure de Ziad et Zelda !
“Je découvris sur la colline un autre chevalier, que je pris d’abord pour un fantôme, car le bruit de sa mort, en plein front de bataille, avait couru dans l’armée entière. C’était le Maître de Ballantrae.” – R. L. Stevenson
Zelda, ancienne flic et détective privée, se remet de sa dernière enquête dans la clinique de Caradoc au Pays basque. Certains signes ne trompent pas : quelqu’un cherche à la mettre sur une piste. Quand la clinique prend feu, Zelda se lance sans le savoir à la poursuite d’un fantôme tout droit sorti d’un roman écrit 250 ans plus tôt et aujourd’hui bel et bien au cœur d’un complot mondial.
Le Trésor de Ballantrae de Marie Cosnay nous entraîne avec une vélocité jubilatoire dans une enquête qui joue avec notre désir insatiable de fiction : jusqu’où sommes-nous prêts à aller pour une bonne histoire ?
EXTRAIT
I-
I was lost.
1
Fin de l’été 2023, le Canada, la Grèce et la Kabylie ont vu partir en fumée des hectares et des hectares de forêts – en Grèce, huit fois Paris, disent à Paris ceux pour qui Paris est la mesure de tout. Fin de l’été 2023 : l’Espagne et la Grèce ont reçu tornades et masses d’eau boueuse déboulonnant les ponts après canicule, sécheresse et incendies. On m’apprend ici à changer de regard : à le diriger vers les arbres du parc du château de Caradoc. Des magnolias et cèdres du Liban, classés remarquables, les racines au sol dessinent un pays. Peu importe le ciel – qu’il soit gris ou bleu roi, sous les feuilles. Au lieu d’un pays en crue et flammes, je cherche la petite image où me réfugier. Je ne la trouve pas, bien sûr.
J’écoute les histoires des pensionnaires qui partagent le goût des arbres et se laissent guider vers le chemin de la petite lumière à entretenir au fond de soi, quel que soit le nom qu’on lui donne : ici on ne se méfie de rien. La nuit, je rêve d’histoires aussi remarquables que les arbres, alors que les matins se succèdent, neufs, dépourvus d’événements, lavés de suspens, passifs comme on m’explique qu’il faut tenter de le rester.
Je ne sais quel aiguillon pointe pourtant, sous l’apparente tranquillité. Je crois, alors que le ciel atlantique et changeant fait ce qu’il sait faire de mieux, se lever, s’obscurcir tour à tour, alors que les racines immenses du magnolia, s’étendent sans limites sur le terre-plein qui n’en peut plus, je crois savoir que quelque chose va venir.
Ici, on m’appelle communément Z – drôle de zèbre, dit Nelly. Un jour, à l’accueil du château, devant le parc de Caradoc aux sentiers, sources, rond-point aux magnolias, un jour, il faut dire lequel pour retenir de la durée au moins une menue aspérité, le 5 septembre 2023, quelqu’un a demandé Zelda à l’accueil.
Mes parents m’ayant gratifiée du prénom qui est aussi leur et mon patronyme, je ne sais si la personne qui me cherche est suffisamment intime pour demander Zelda ou Zelda, de mon nom d’ex-commissaire du xixe arrondissement parisien, d’ex-privée ratée d’un peu partout en Europe et de présente résidente de Caradoc. On ne m’a trouvée ni dans ma chambre ni dehors. Je doute qu’on m’ait réellement cherchée. L’homme qui me demandait était confus, c’est l’adjectif utilisé. L’homme venait-il de ma vie passée, celle des enquêtes malheureuses et des retentissants échecs ? On ne m’a pas appelée, expliqué-je à Nelly le lendemain. Qui caressait la tête des poneys du parc, se fichant complètement du type qui avait demandé Zelda et portait un chapeau haut de forme.
Dire que tout aurait pu s’arrêter là, dans le parc du château. Calme, je poursuivrais la quête de la petite image du fond de moi.
En réalité, je ne tenais pas en place.
Je ne tenais pas en place n’a aucun rapport avec ce qui s’est passé deux jours plus tard. Aucun état d’esprit n’a le pouvoir d’influencer à ce point les événements. Le temps filait sans retenir la succession des jours. Il laissait la place à ce que voici : un homme d’un certain âge, parlant un français maladroit, cherchait Zelda à Caradoc sans préciser si c’était pour raisons personnelles ou professionnelles. Il portait un chapeau haut de forme démodé et boitait légèrement. C’est ce que j’avais à me mettre sous la dent. Je cherchais mon téléphone sous le matelas, sans succès. Dans la salle de bain et les chambres des filles, sans succès. Il avait disparu.
Le surlendemain, Caradoc a connu de nouveau une visite incongrue. Cette partie de l’histoire est controversée et je dois à la vérité de rappeler que j’étais seule, ce jour-là, surlendemain du 5 septembre 2023, au moment de la visite qui a changé notre vie à toutes : la mienne et celle des filles de Caradoc, Nelly en tête. Celle de tous les protagonistes de l’affaire du Trésor de Ballantrae, comme on l’a appelée. J’avais accompagné Nelly à l’écurie, nous allions nourrir les poneys, patientes comme nous l’étions devenues – quoi qu’après l’annonce de la première visite du chapeau haut de forme, en vérité, je n’aspirais plus qu’à retrouver mon téléphone, ma liberté et mes chers soucis. Nelly semblait coupée en deux, sa part de Caradoc luttait contre l’autre, que je ne connaissais pas mais que je découvrais taillée pour l’aventure. Il faisait nuit, la nuit basculait vers l’aurore, quelques nappes plus claires balayaient l’horizon dégagé. Le portail faisait une forme floue et compacte. Nous sommes entrées dans l’écurie pour flatter les poneys ; Nelly s’est souvenue qu’elle avait laissé dans sa chambre ce qu’elle voulait me montrer : elle revenait dans un instant. Elle a installé la lampe torche sur son front, on a ri parce qu’elle déplaçait avec elle un halo rond comme une bulle d’eau. Je me suis retournée vers le portail qui luttait pour rester la forme compacte et obscure qu’il avait été durant la nuit.
C’est à ce moment précis du crépuscule. Je me suis frotté les yeux. J’ai distingué, détachée derrière la forme sombre du portail de bois, la dépassant de haut, une deuxième forme. La lumière négligeait l’horizon pour se concentrer sur le front de celui qui attentait au portail. Nul besoin de lampe torche devant la chevelure blonde et la couronne radieuse que faisait maintenant le soleil rouge autour du visage apparu. Nelly n’est revenue, son album de photographies sous le bras, qu’après le départ du visiteur.
Combien de temps a duré notre conversation ? Je n’en ai aucune idée. Je me suis approchée, posant des questions conventionnelles, les réponses ont fusé, telles que je ne saurais les répéter. Le jeune homme, dont les traits, sous les longs cheveux d’étoupe, étaient distingués, venait me chercher, disait-il. J’étais interdite. Il n’était qu’un émissaire, disait-il encore : je venais ou ne venais pas ? Qu’il soit bien clair pour moi qu’il n’en avait rien à faire. Je restais, je partais, au temps pour moi. Il se mettrait en marche, que je le suive ou pas. Il avait fait un long chemin, il était fatigué, il s’en retournait.
Il a joint le geste à la parole. Il chantait, dos à moi, une ballade folk. Abasourdie, je l’ai hélé, de manière à couvrir la chanson : je ne comprends pas ce que vous voulez. Il a eu la bonté de faire quelques pas vers moi, je l’ai trouvé beau et effrayant. Par-dessus le portail, il m’a tendu une lourde enveloppe, il était tout sourire. Vous avez raté le coche aujourd’hui, a-t-il dit, moqueur. Derrière le sourire, je sentais une sorte de tendresse. De nostalgie ?
I saw you walking by the other day
I know that you saw me, you turned away
And I was lost
Tandis que Nelly me montrait, dans le foin, les photos du passé, dont elle aurait dû se débarrasser, je ne pensais plus qu’au garçon aux cheveux de paille qui avait marché vers moi depuis un lieu inconnu que j’imaginais lointain.
Les jours qui ont suivi, j’ai confondu l’image floue d’un vieil homme boiteux portant un chapeau haut de forme avec celle d’un garçon blond et lumineux. Je caressais l’enveloppe que ce dernier m’avait remise, sans l’ouvrir. Je retardais le moment, hésitant devant ce qui serait peut-être un caprice, un élan irrépressible, tout à fait le genre de chose qui m’avait conduite ici, auprès de Nelly, des poneys, des personnes qui nous engageaient à l’oubli et des arbres remarquables. Je n’hésitais pas, que cela soit clair : j’attendais. Je retardais.
2
Georg Ludwig, parent éloigné de la reine Anne d’Angleterre, monta sur le trône à l’âge de cinquante-quatre ans, en 1714. Il passait devant une bonne poignée de parents plus proches qui avaient eu la mauvaise fortune de naître catholiques. La loi d’établissement, votée par le parlement en 1701, garantissait la succession de la couronne aux membres de la famille protestante de Georg, liée aux Stuarts. Tout ça pour éloigner du trône Jacques III, chef du parti jacobite. Georg Ludwig devint George Ier et des révoltes éclatèrent dans les Highlands, Jacques le jacobite exaltant, de loin, depuis l’exil, ses bandes et ses hommes, parmi eux le bien nommé Mar. Celui-là regroupait, dans les hautes terres, les chefs de clan pour les inviter à une partie de chasse contre les hommes de George. Aux hommes des hautes terres, habitués aux conditions difficiles des déserts montagneux, où les hivers descendaient jusqu’à moins trente, on joignit des Irlandais, catholiques comme les jacobites de l’exilé. Les montagnes vertes, trouées de taches de bruyère, dévalaient vers les lochs et la mer des Hébrides. Le nord des terres d’Écosse tomba sous les assauts des dix mille hommes de Mar. Quant au vieux Jacques, il ne tenait plus vraiment debout et quand il arriva en Écosse, pour assister aux batailles du sud, il était trop tard : il n’eut pas l’occasion de se réjouir. Mar, au mois de novembre, comprit au cours de la bataille de Sheriffmuir que son armée, plus nombreuse que celle de l’ennemi, n’en pouvait plus. Le vieux Jacques choisit de laisser les Highlanders, qui l’avaient défendu, à eux-mêmes, au froid de l’hiver neigeux, à leur déception et à des errances de loin plus périlleuses que celle qui le ramenait, vieux bonhomme, en France, lieu de son séjour de réfugié catholique. Bien sûr l’armée, qui n’avait jamais été très organisée, à présent décomposée, pleine d’un désespoir porteur de colère, brûla quelques villages avant de remonter vers ses terres, ses côtes, les flancs de ses montagnes, ses pics, ses corniches et ses couleurs. On voyait tituber, pris d’alcool, quelques soldats dégingandés, prêts à tout.
Que notre attention se porte sur deux d’entre eux : ils font marche commune, à cheval, vers le loch où embarquer pour les îles Hébrides. Que faire dans la déroute ? Eh bien, celui qui garde aux lèvres un sourire étrange propose une course à cheval, c’est quand même pas le moment, dit l’autre qui est irlandais et blessé à l’épaule, une éraflure, comment on nous a traités, ici en Écosse, et votre Jacques qui nous a laissés tomber – celui du sourire écossais répond qu’il n’est, quant à lui, ni plus catholique que toute l’armée qui lui a fait face ni plus pieux qu’un troupeau de moutons des montagnes du Nord. Enfin, que l’autre galope sans tarder : il n’y a pas moins patient que lui dans tout le royaume. L’Irlandais, tout blessé qu’il est, refuse qu’on lui donne des ordres, ce à quoi l’Écossais répond qu’il faut résoudre l’épineux conflit, galoper ou ne pas galoper, par un duel. Les deux hommes vaincus de l’armée jacobite descendent de cheval en même temps. Nous n’entendons pas qui, de l’Irlandais ou de l’autre, qui ne se départ pas d’un sourire vicieux, propose qu’on tire au sort le destin de leur équipage : pile, ils se font bons amis et on ne parle plus d’ordres ni de course ; face, ils se battent à mort. On voit bien que l’Écossais a l’habitude de jouer la vie et la mort à pile et face. L’Irlandais aussi, peut-être, mais contre son gré : il soupire légèrement, cachant des sentiments que des mois de guerre l’ont déjà obligé à cacher. Pile. Les deux hommes se serrent la main, remontent sur les chevaux, il n’y a plus de temps à perdre, Jacques a pris un bateau, fuyant vers la France, on va essayer d’en faire autant. Les deux hommes chevauchent toute la nuit et quand l’aube se lève, en bas, tout en bas, elle dessine un halo gelé sur la mer sombre. La chance, c’est qu’on distingue un bateau, non loin de la plage de sable fin : il attend. Peut-être pas pour longtemps. Il faut descendre de cheval, donner un coup sur la croupe des bêtes, espérant qu’elles rejoignent d’autres errants ou highlanders décidés à rentrer à la maison, à se fondre dans la masse. Puis les deux hommes entament, en contre-jour, lumière montant dans leur dos alors qu’ils s’accrochent aux pierres et aux rares végétations, la descente de la falaise jusqu’au sable. Le bateau s’appelle la Sainte-Marie-des-Anges. À ce moment-là de l’histoire il serait bon que l’un de nos deux personnages, celui au sourire pervers ou l’autre, désabusé, fasse remarquer au capitaine, irlandais comme l’un de nos amis, quel est l’état calamiteux de la révolte et annonce les réfugiés, moins rapides, qui remontent en ce moment même, eux aussi, vers le nord, qu’ici, en contrebas du grand Minch, il est encore possible d’attendre.
Personne ne fait mention ni de la révolte, ni de ses perdants, ni de ses retardataires, le capitaine ne pose pas de questions et le bateau appareille.
L’Irlandais, que nous appellerons Burke, prie dans sa cabine et prie sur le pont. Ce bon jacobite irlandais se retrouve en butte aux moqueries de l’autre, que le jeu de monnaie lui a donné pour ami et que nous n’avons pas nommé encore.
Un mécréant dans un bateau dirigé par un capitaine dont la moindre des choses est de dire qu’il est peu inspiré, voici ce que ça donne, pense Burke, qui ne renonce pas aux prières.
Le soir même, les vagues prenaient le bateau d’assaut, quelques pauvres hères moins habiles que nos deux héros, réfugiés, au nom de l’Irlande de l’un d’entre eux, dans la cabine du capitaine, tombaient, du pont, à l’eau : on voyait les épaules s’enfoncer et, encore une fois, puis une autre, des bouches sans cri descendre dans les creux, revenir à flot, on voyait des yeux sans espérance puis on ne voyait plus rien, ni bouches ni yeux. Trois hommes seuls remontent à bord, glacés. Ils ne seront plus jamais les mêmes : ils ont vu le trépas, ils sont revenus de ce dont on ne revient pas. L’un se met à chanter à voix basse. On ne lui accorde aucune attention. Comme les autres rescapés, il grelotte. Ceux du bateau, accrochés aux cordages ou repliés dans les cabines, comme Burke et son camarade écossais, ne veulent rien savoir. C’est ainsi avec les naufrages : qu’on y reste ou qu’on y échappe, on garde le silence.
Ce n’est pas fini. La tempête soulève la Sainte-Marie-des-Anges à la verticale, la proue crève des nuages qui ne se font pas prier, le capitaine donne des ordres inutiles, il faut quitter le lit du vent mais le vent fait des surprises, qui vient des quatre points cardinaux si bien qu’on se croit, même protégés comme nos deux malins dans la cabine du capitaine, dans une sorte de face à face divin. Jonas est sur le bateau – ou qui que ce soit d’autre avec qui Dieu ira jusqu’au bout. Le héros anonyme se moque de l’autre, Burke, qui prie. Se moque aussi du capitaine, irlandais, et pour la peine, de l’Irlande tout entière – c’est un démon, pense Burke qui à l’instant du danger, sans doute ultime, aime les démons, la Terre, le ciel, les alliés, les ennemis, Jacques et George et tout ce qu’on peut bénir quand on n’a plus rien à bénir. Deux matelots tombent à l’eau, puis quelques passagers qu’on ne compte pas, les corps chutent sans qu’on les remarque, on ne voit pas leurs yeux d’effroi monter descendre s’éloigner suivant la houle parce que la houle est comme le vent, sans direction, elle avale ce qu’on lui donne. Le ciel est dans l’eau et la mer aux étoiles, une étole, un linceul, et comble du comble : ces éclairs qui zèbrent le ciel que Burke ne voit pas. Leur grondement provient des gouffres marins comme des altitudes, chose purement inimaginable. Si Burke se bouche les oreilles, c’est moins contre l’orage que contre le blasphème. Trois jours. Trois jours et trois nuits dure la tempête. On a perdu les plus courageux. À l’aube du quatrième jour, le capitaine irlandais, qui n’est pas un modèle de délicatesse, pleure sur le pont comme un gamin, Burke près de lui prie, rend grâce, ses lèvres remuent vers le ciel revenu. L’Écossais, toujours le même, a tiré de son uniforme un jeu de cartes et sur la table de la cabine du capitaine fait des réussites sans s’émouvoir des pleurs, des craintes et des joies nouvelles : on a passé l’épreuve, le destin n’était pas pour nous, maintenant à nous l’oubli, à nous le jeu et à nous le silence.
Ce n’est pas fini. La terreur, quand on voit un petit galion approcher. Il vient droit sur la Sainte-Marie-des-Anges. L’embarcation qui s’en détache, ramant vers Irlandais et Écossais vaincus et survivants, est remplie d’hommes aux cicatrices cinématographiques, cheveux attachés dans le dos, bras musclés tatoués, couteaux entre les dents, celles qu’il leur reste. Leur chef les a d’or et il rit, à les montrer toutes, encourageant ses matelots à prendre d’assaut la Sainte-Marie-des-Anges.
Les Irlandais prient une nouvelle fois, on se doute que notre Écossais est à la fête et on apprend qu’un bon mot sauve la vie. Le très croyant Burke, devant l’assaut, au capitaine des pirates, celui au rire d’or, lance : si vous êtes l’enfer, j’ai trouvé pour vous Satan : désignant l’Écossais à ses côtés, qui, calme toujours, saute immédiatement à bord de l’embarcation pirate, ne craignant ni hommes d’équipage ni chef. Le spectacle est terrifiant : Burke y assiste, que le chef des pirates, Teach, en un élan, a tiré vers lui sur son rafiot. Un bon mot est un bon mot, l’homme nous servira. Après avoir dépouillé les rares survivants de guerre et de tempête, la bande menaçante et totalement ivre obéissant aux ordres de Teach les envoie à présent sous les eaux, et dieu qu’il est long, alors, le temps de mourir, les corps s’accrochent aux planches auxquelles on a mis le feu, l’immensité avale de tout petits hommes dont les têtes s’immergent au fur et à mesure et filent à la dérive. Burke, de loin, sidéré, abasourdi, n’en perd pas une miette. Teach exige qu’il chante, alors il chante et ce qu’il chante se tord dans les ciels merveilleusement bleu roi et glacés. Une sorte de prière tordue dont Burke pense qu’elle va le perdre une fois pour toutes et c’est ce qu’il y a de mieux à espérer. Mais rien ne perd Burke ni son compagnon écossais qui, il le répète, et on le voit, n’a peur de rien, surtout pas de la mort. Nos deux héros boivent moins que l’équipage mais participent, qui se battant, qui chantant pour amuser la compagnie, aux assauts des navires de rencontre. Ils les dépouillent de leurs richesses et de leur rhum, les envoient aux enfers sous-marins dont, pense Burke, nous avons là deux capitaines, ou deux chefs, ou deux rois, ou deux Sheitan – comme on voudra.
Un matin, très tôt, Teach n’a rien trouvé de mieux que de se trémousser sur le pont en un spectacle auquel jamais Burke n’avait pensé assister. Il a peint ses joues de goudron, de sang son front, de sanie son torse et il dévore du verre pillé en hurlant des ordres contradictoires. Il tue pour le geste, théâtralement, deux de ses hommes d’équipage, leur arrache l’or des dents qu’il avale en glouton. En voilà assez, dit soudain Satan l’Écossais. Il renvoie à l’anonymat, sans autre forme de procès, du haut de son autorité mystérieuse, le grossier capitaine Teach. Teach est mort, qu’on le passe par-dessus bord.
L’Écossais prend la direction de l’équipage. Personne ne proteste. Pendant des mois, il ordonne, à l’abordage, on dépouille les navires et s’enrichit. Le propre d’un butin, c’est qu’on le veut toujours plus gros. Navire après navire, on joue le jeu de la planche à la mer et cela ne cesse pas. Parfois simplement pour un peu de whisky ou de tabac.
Jusqu’au jour où, après un de ces actes de piraterie dûment dirigés par notre Écossais, alors qu’on choisit les prisonniers qu’on garde et ceux qu’on envoie aux enfers, on en distingue un, écossais. Il répond au nom d’Anderson. Le garçon est jeune, il a de nombreux grains de beauté sur une peau tavelée par le soleil atlantique, et une fragilité peu commune. Il ne cesse, quand sur le pont, soir après soir, boivent et chantent les marins, de fixer le Maître, puisque c’est ainsi qu’on appelle le Satan écossais. Jamais le Maître ne fait preuve avec le garçon gracile de la moindre cruauté. Il se passe trois mois, c’est Burke qui a compté, avant qu’un de ces mêmes soirs de beuverie sur le pont, Anderson, toujours sobre, finisse par lancer au Maître, sans le quitter des yeux : et dire que vous êtes mort.
Le compagnon de Burke ne répond pas tout de suite. L’étain noir de son regard pourrait clouer sur place chacun des pirates passagers et prisonniers convertis. Il omet de ficher son œil perçant sur Anderson qui vient de parler.
Après un temps interminable pour tous : veuillez laisser les morts où ils sont, mon jeune ami. Anderson fait profil bas. Les autres aussi, à qui le capitaine, terrible, s’en prend à présent.