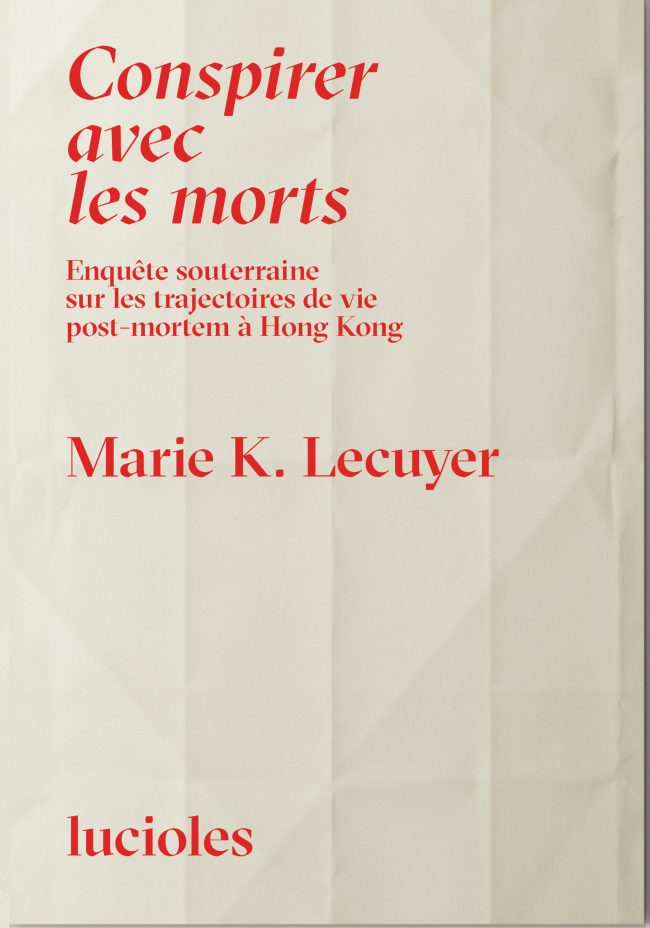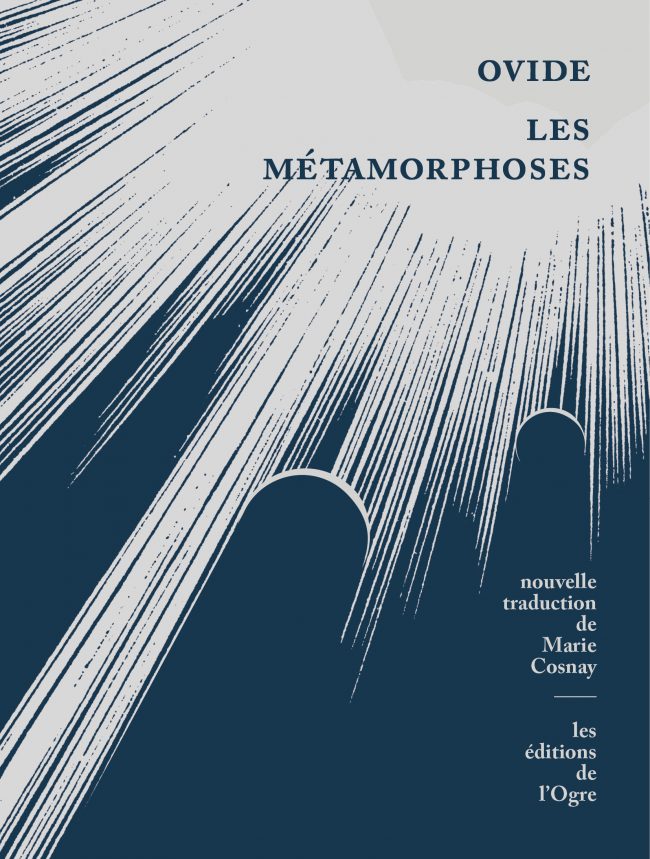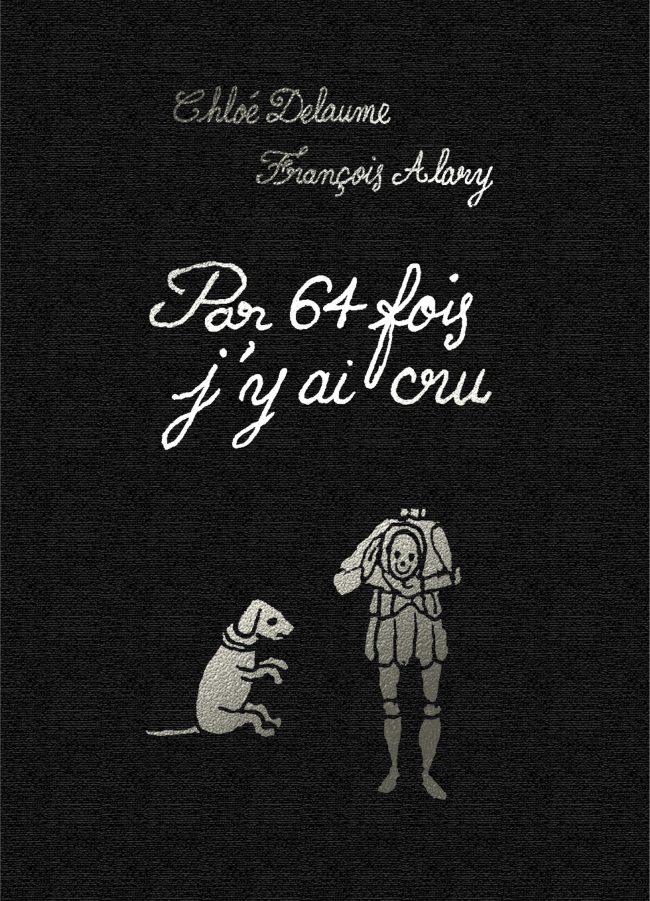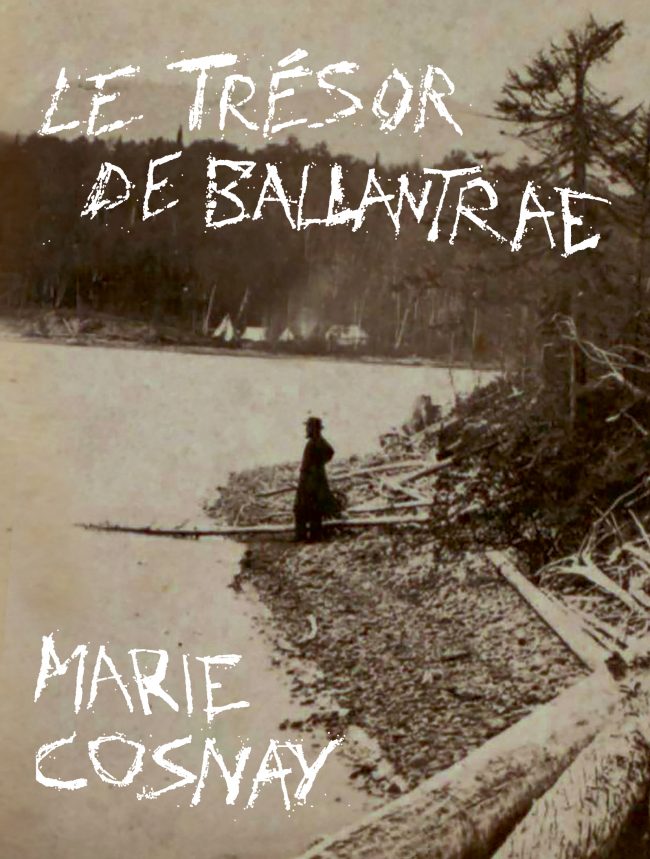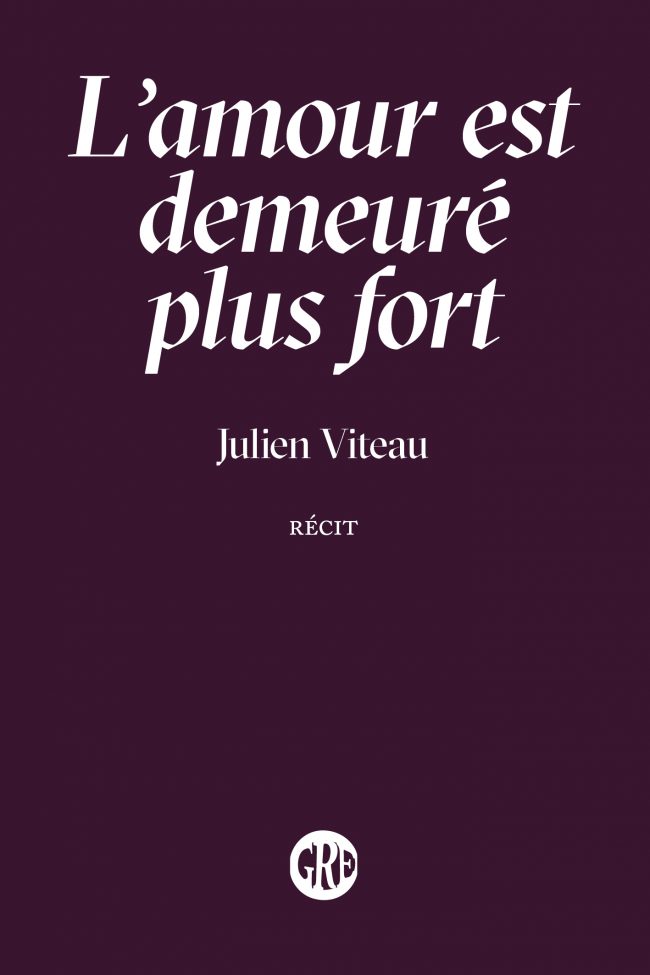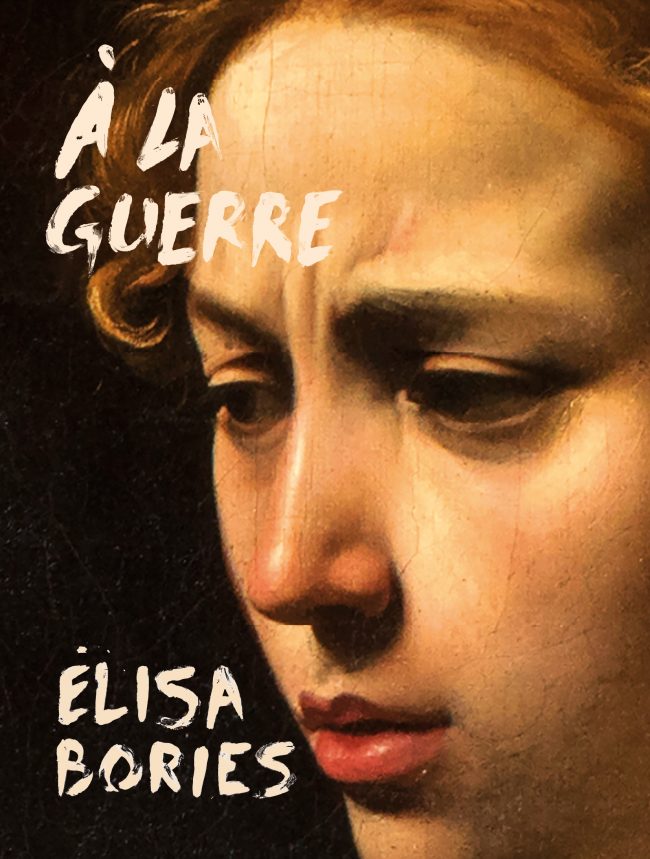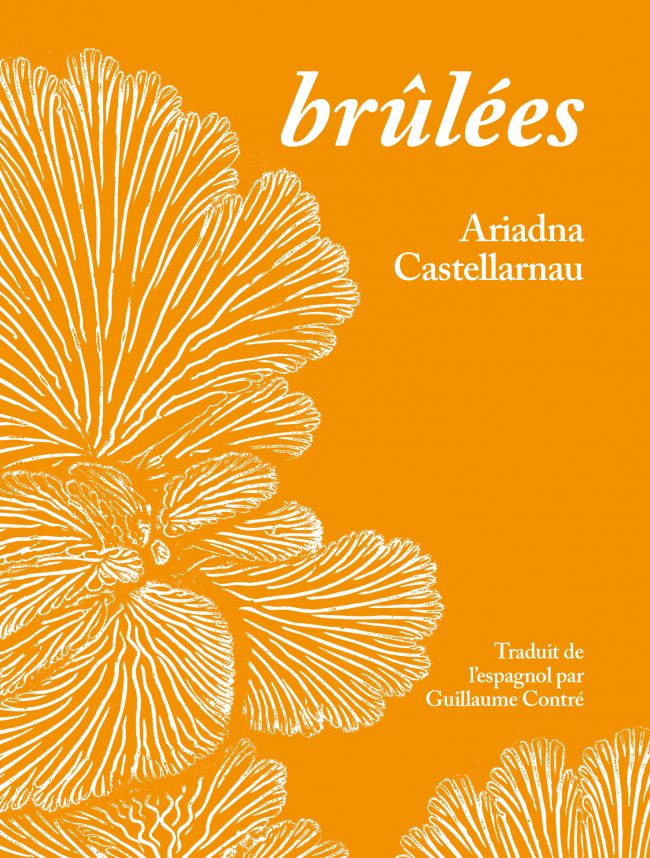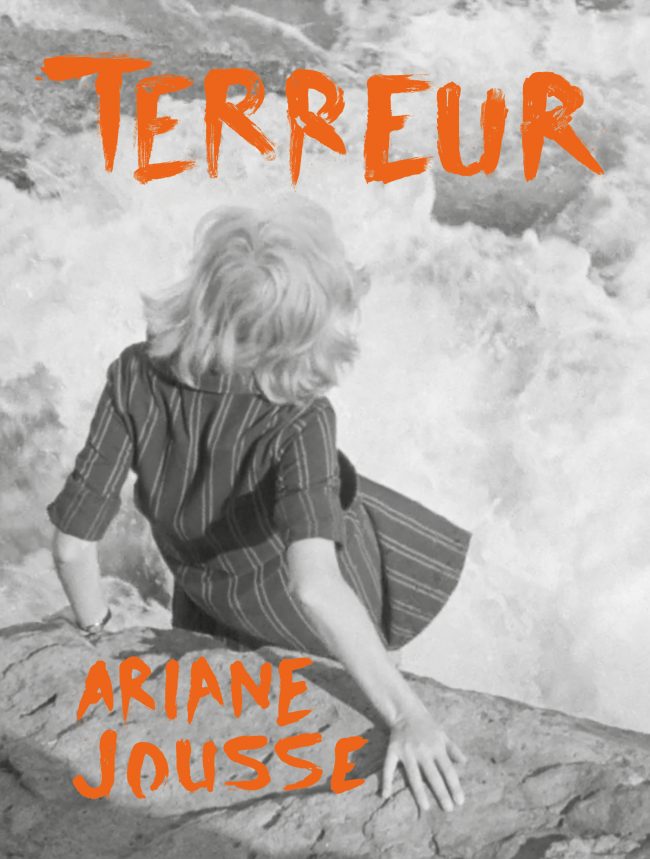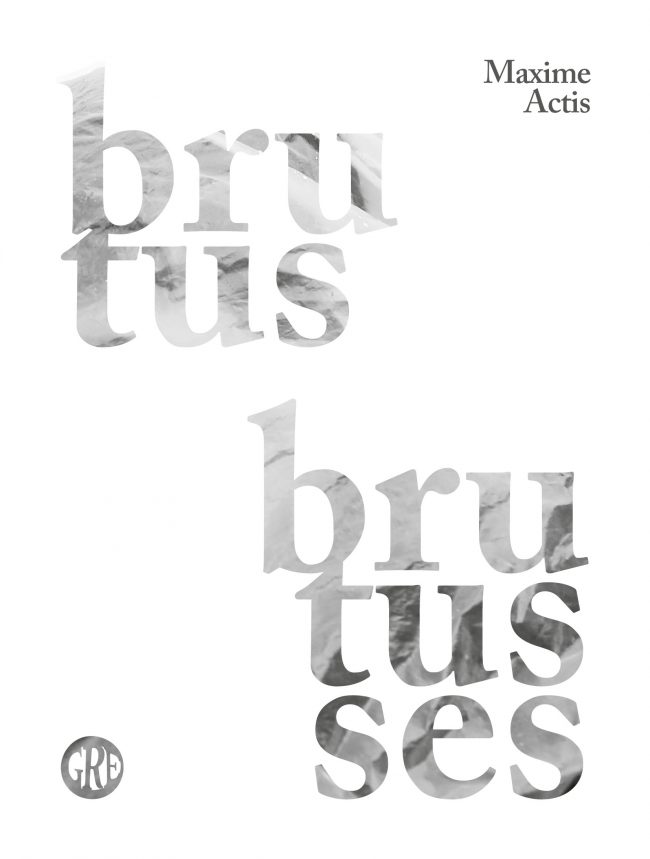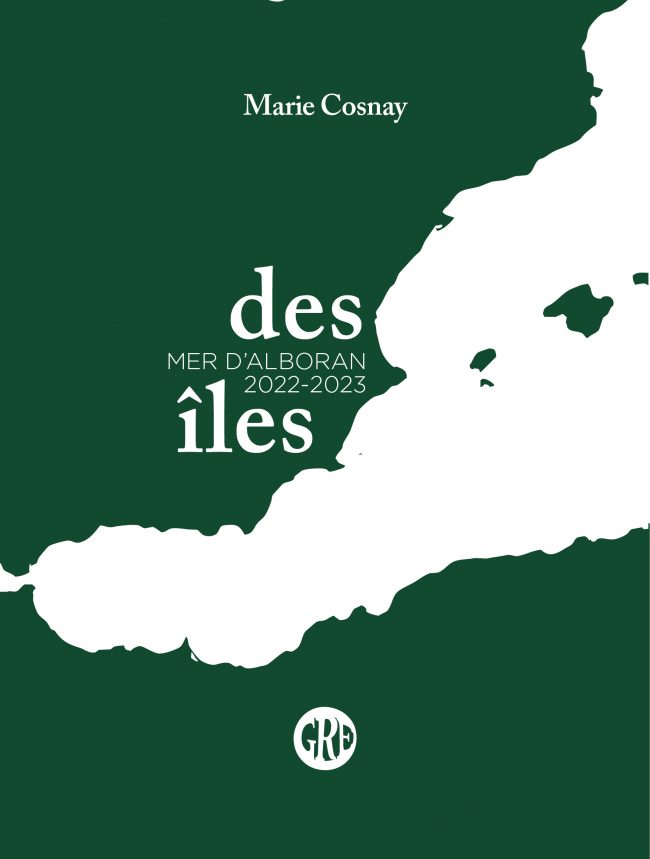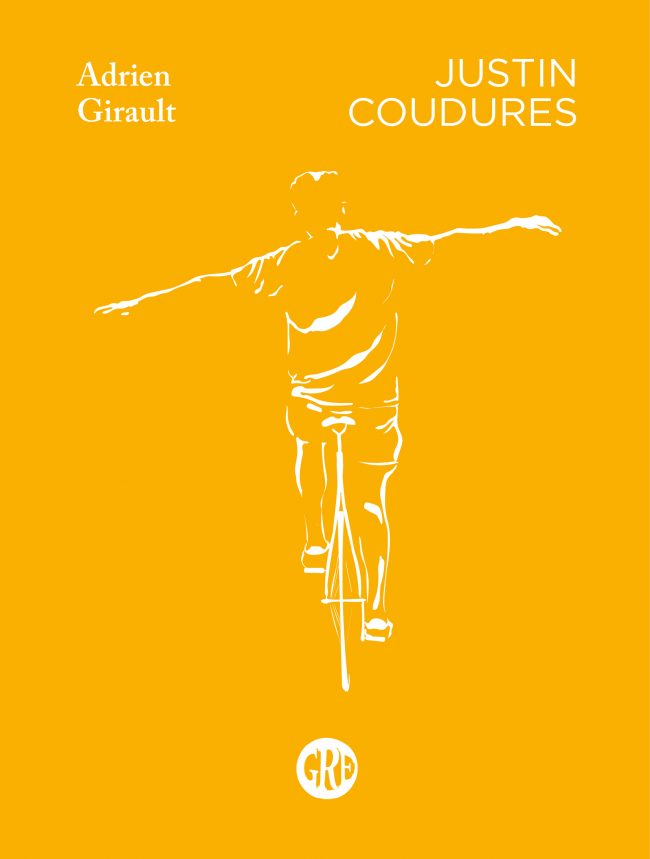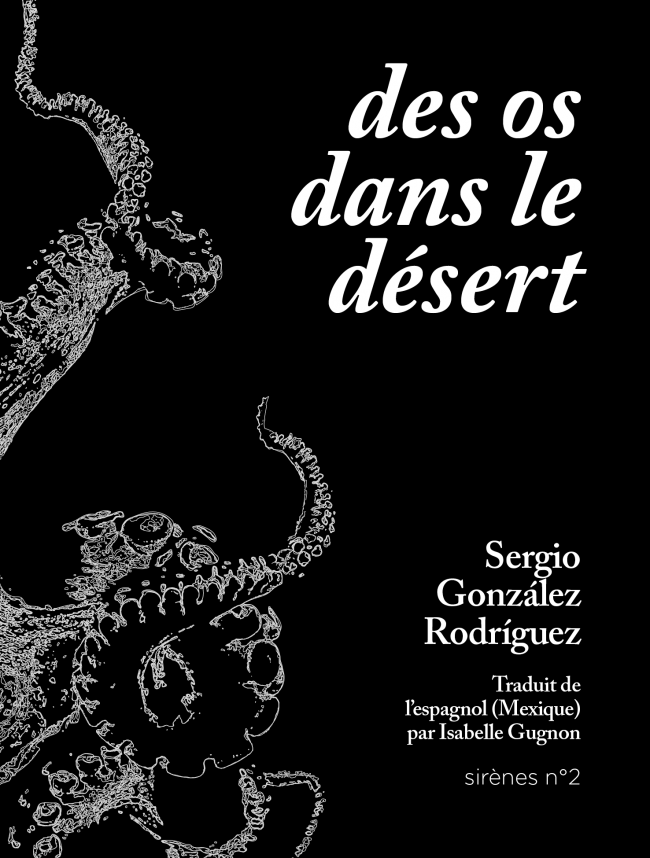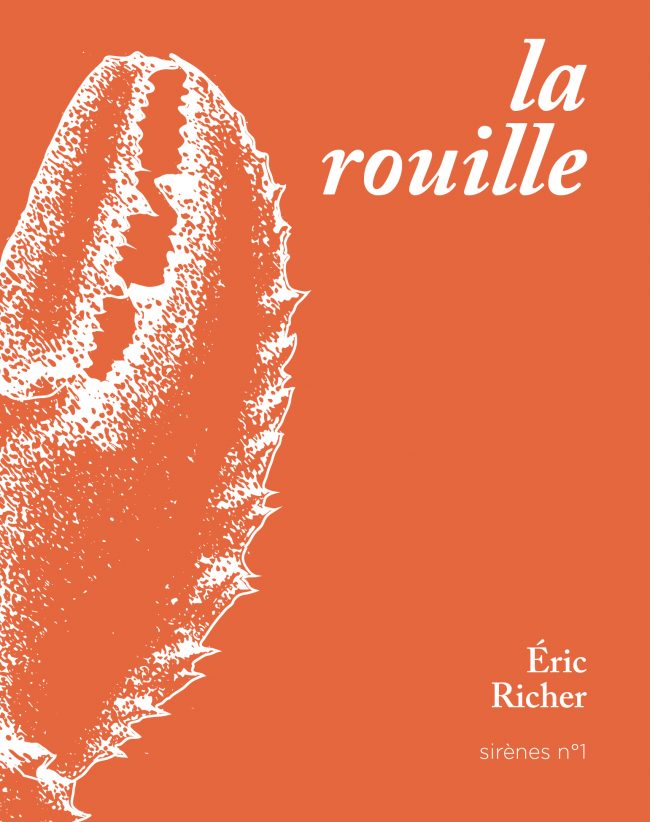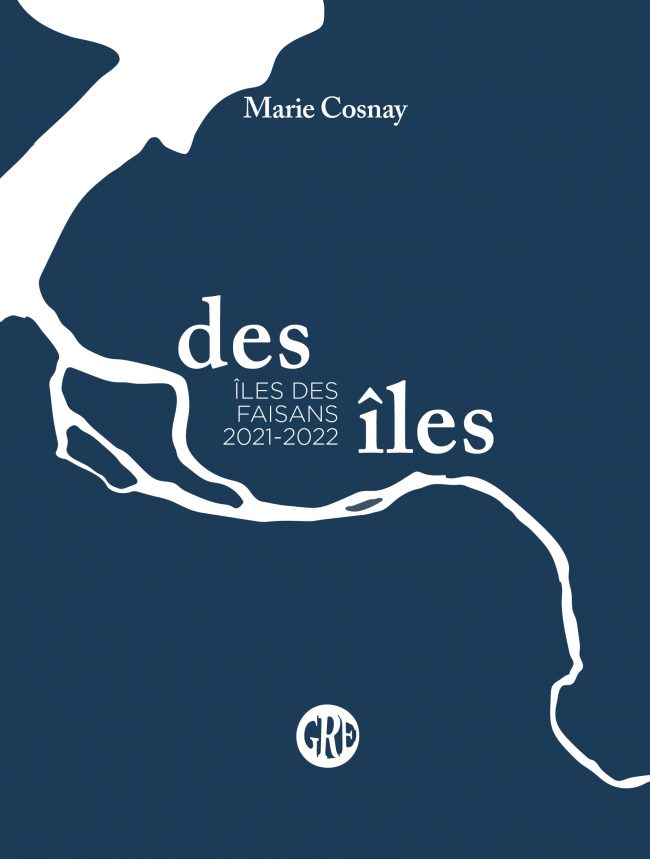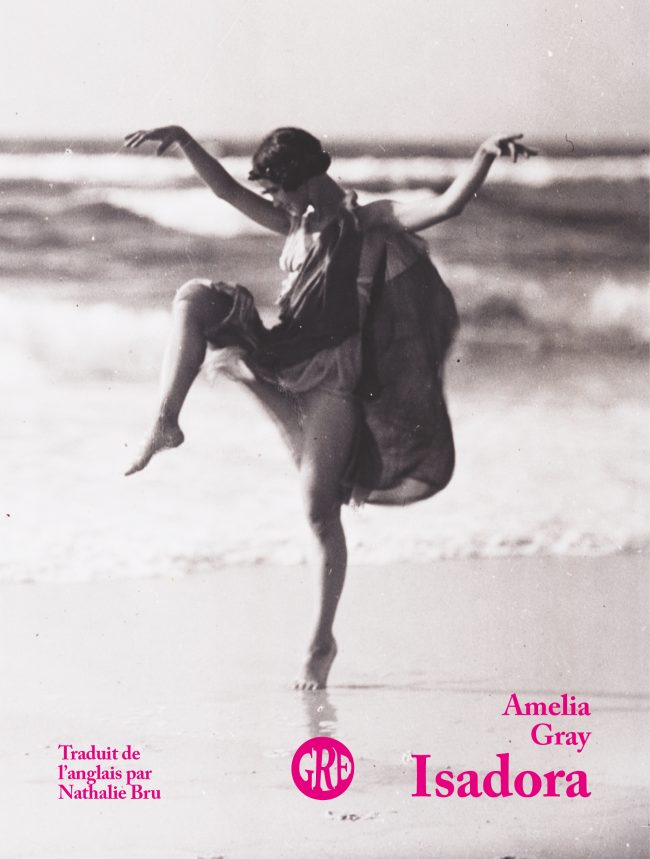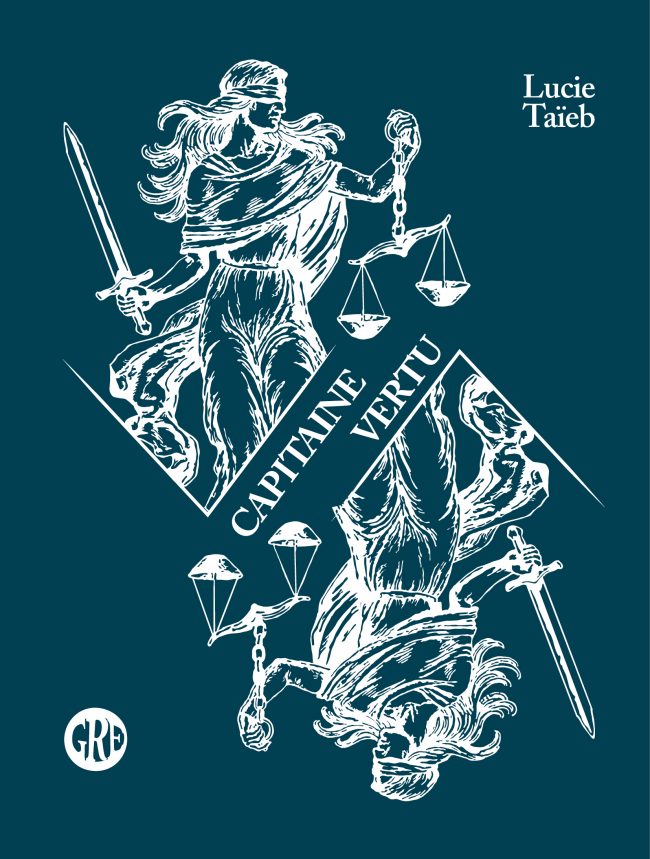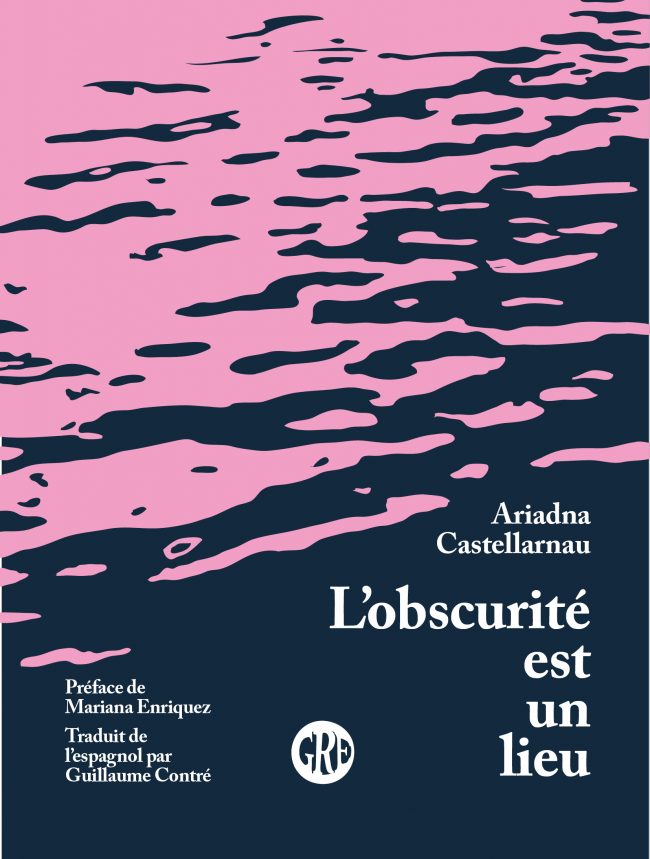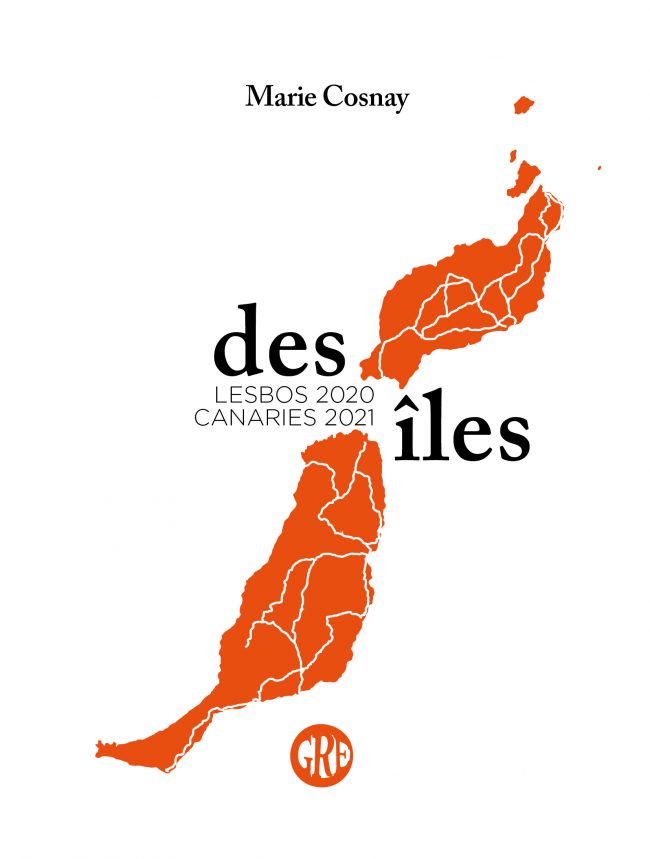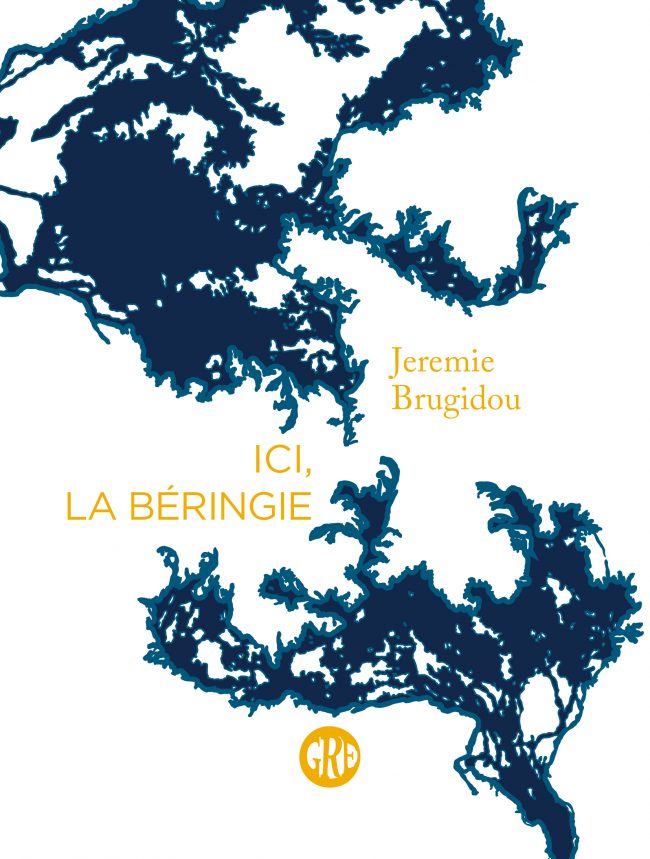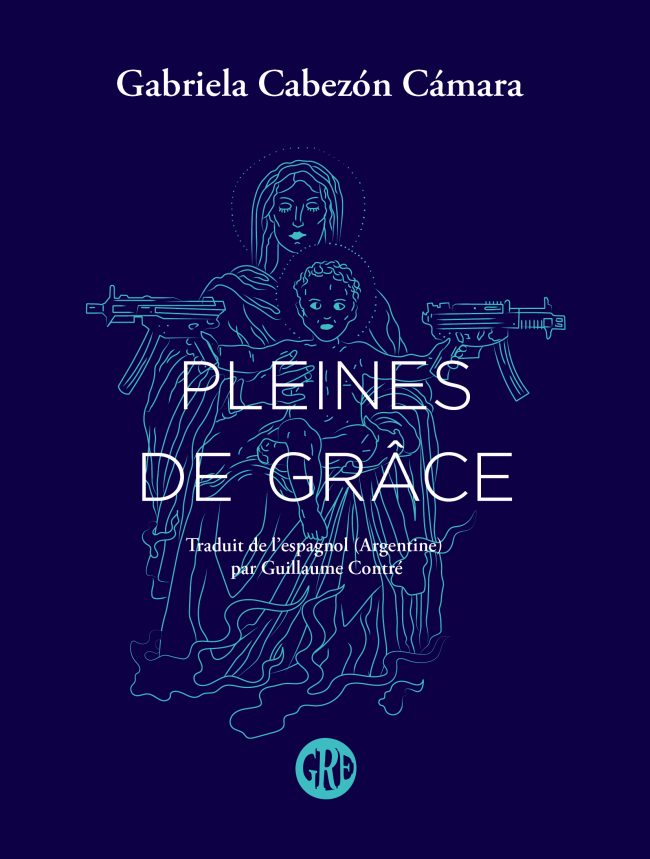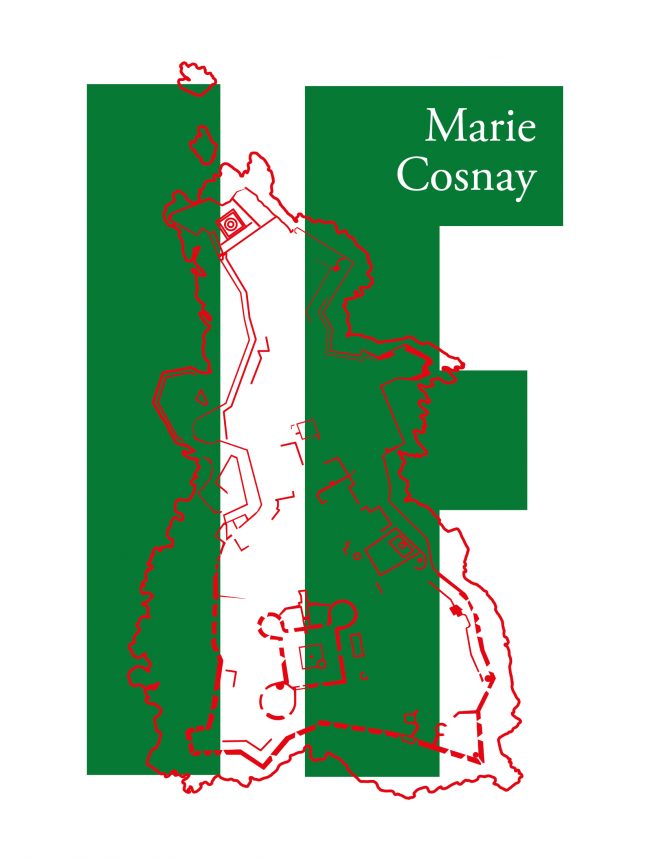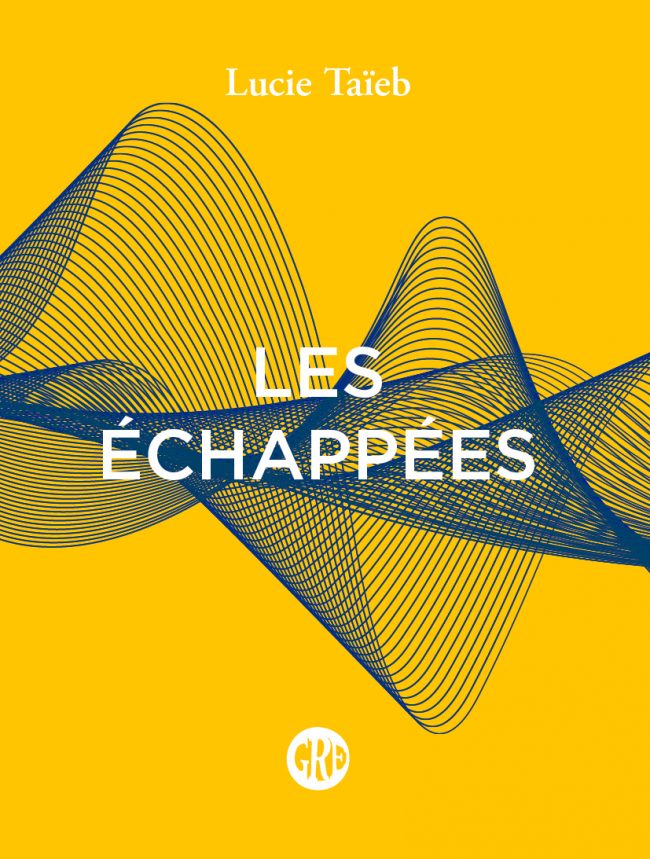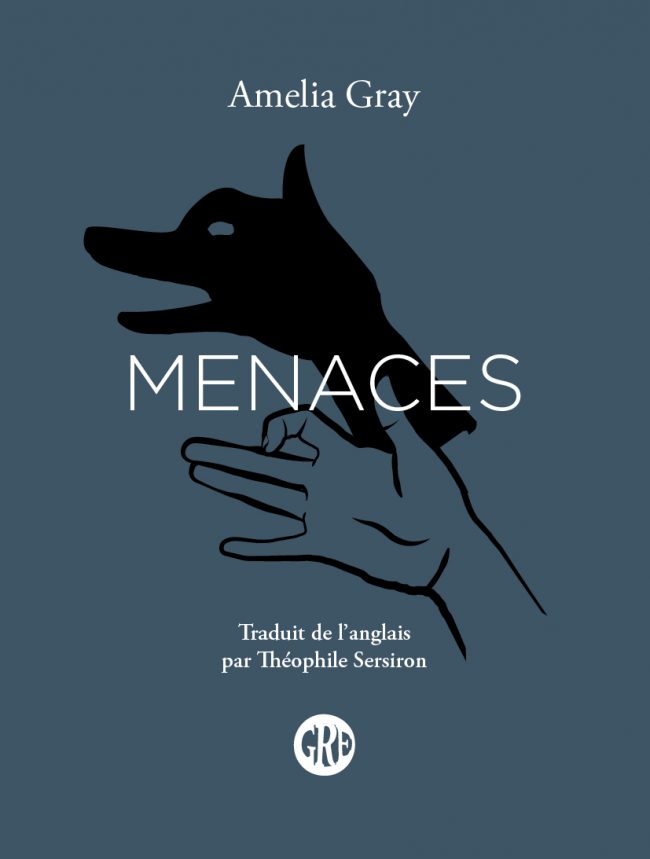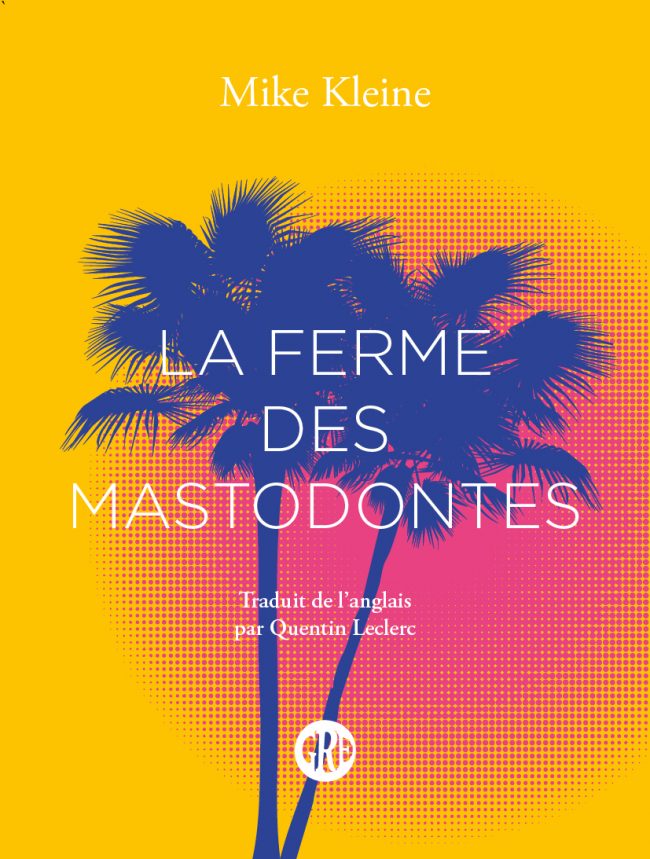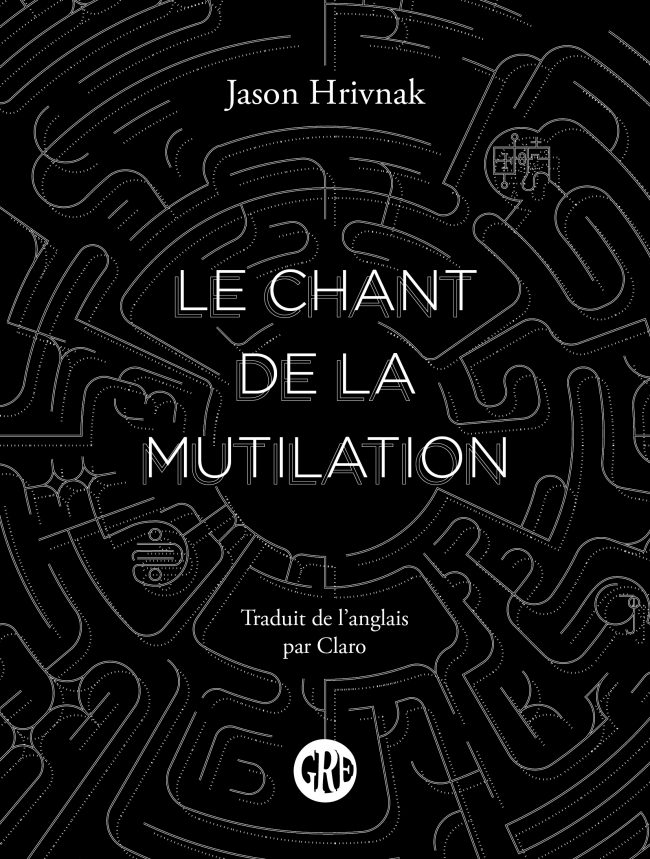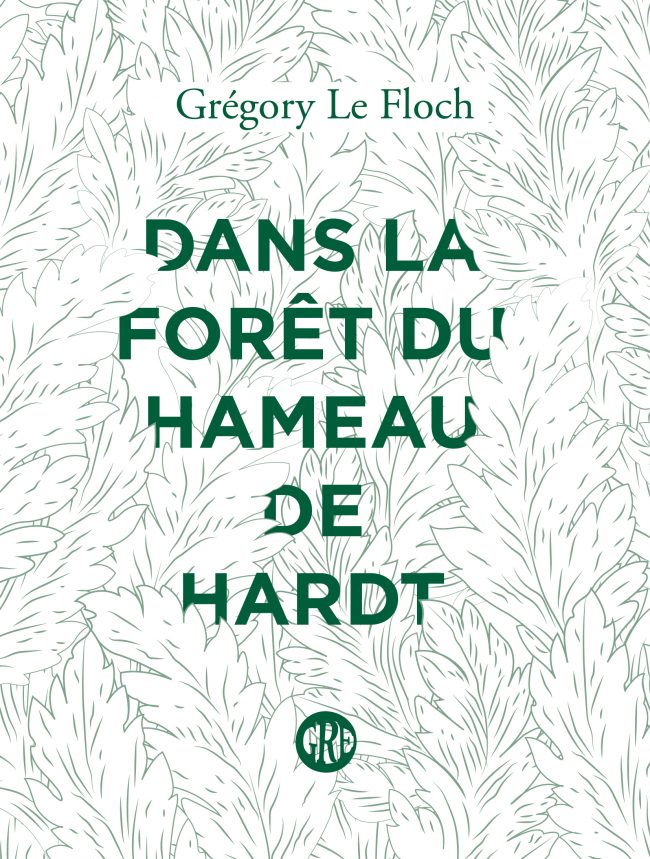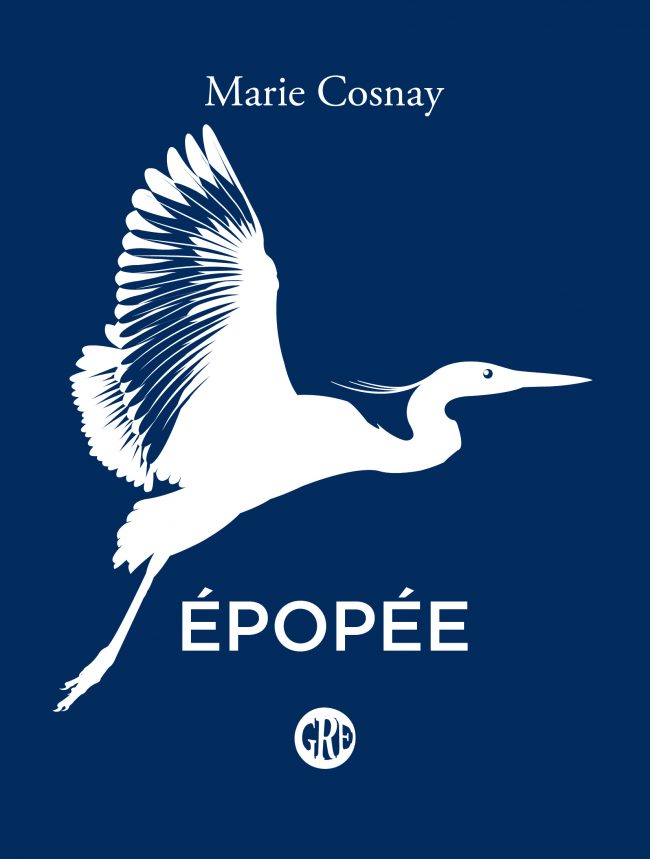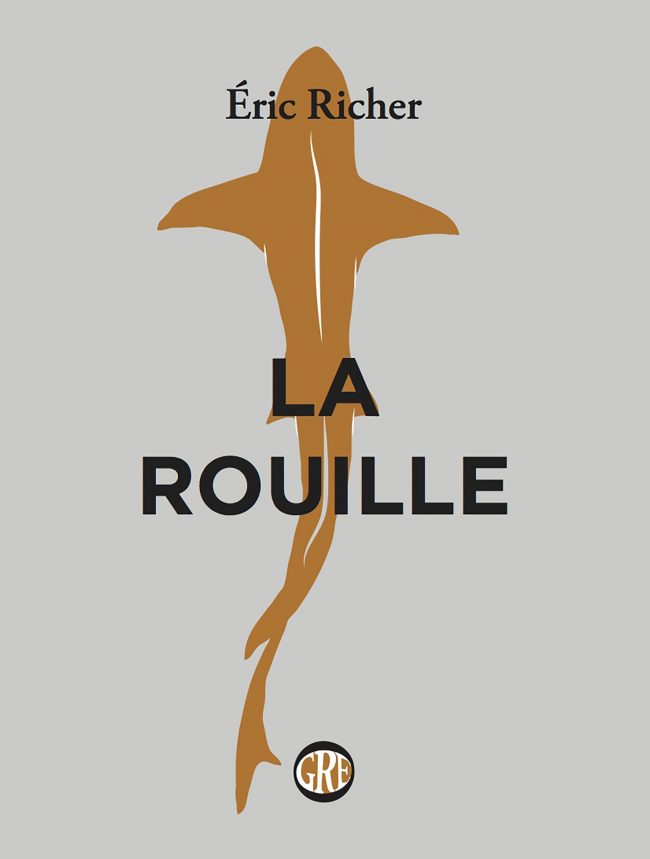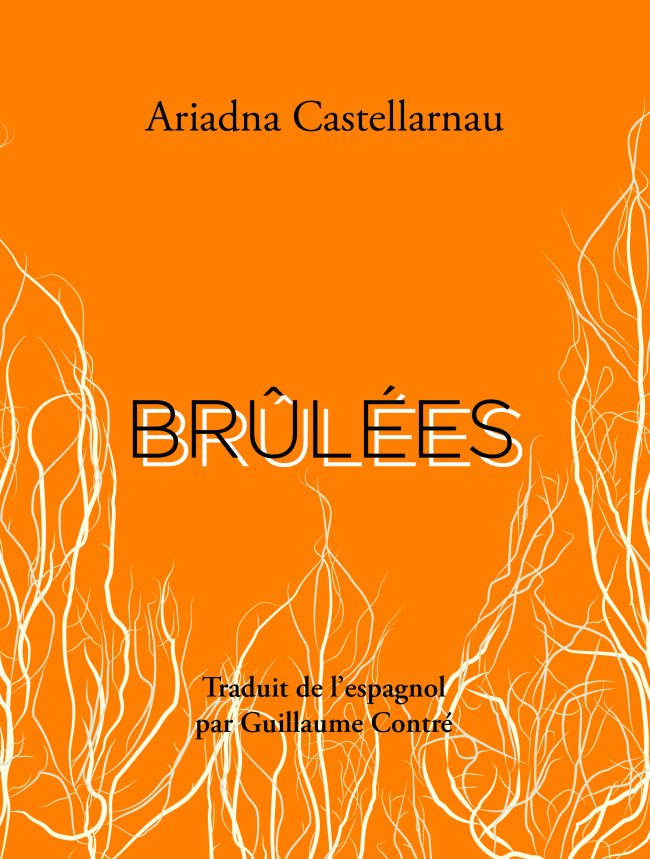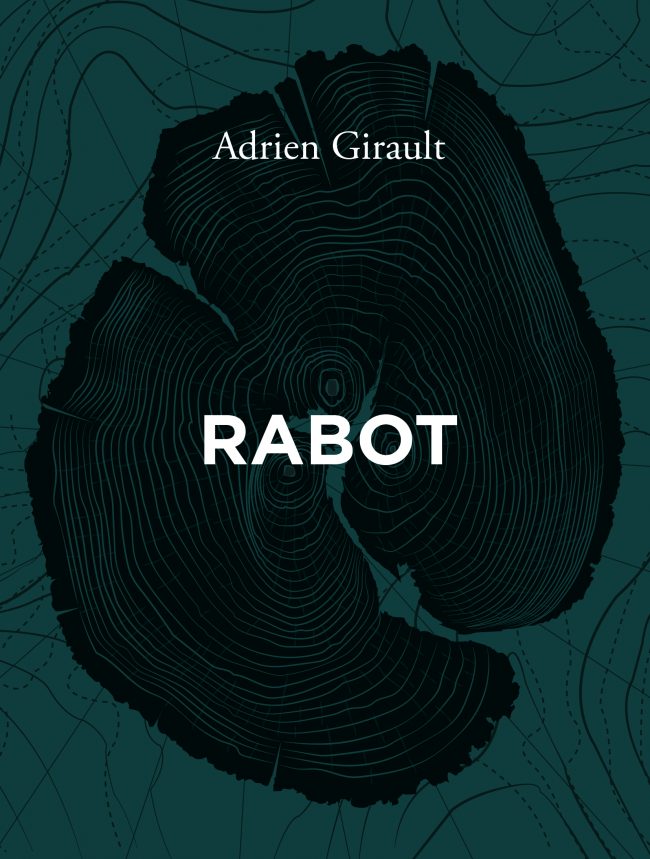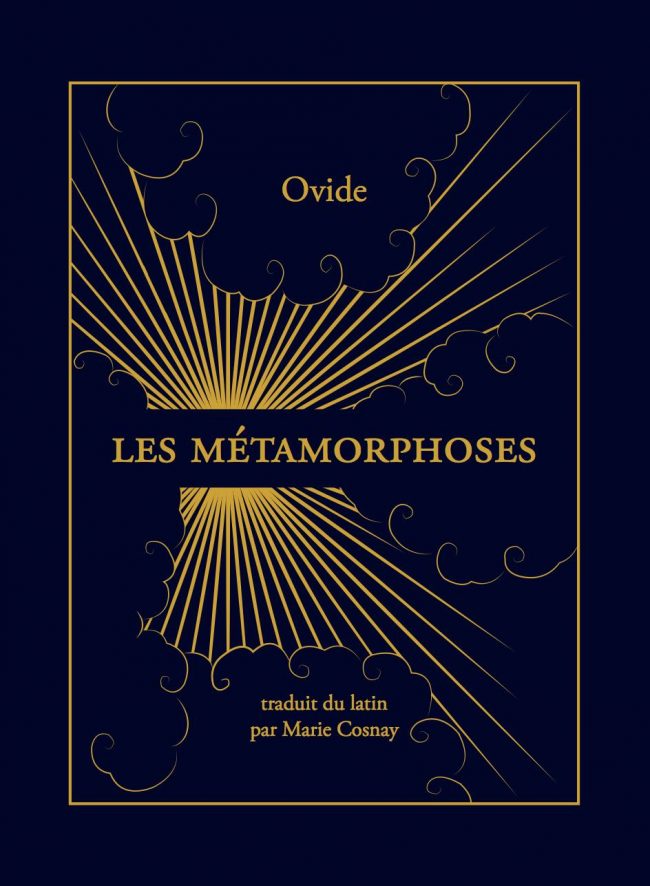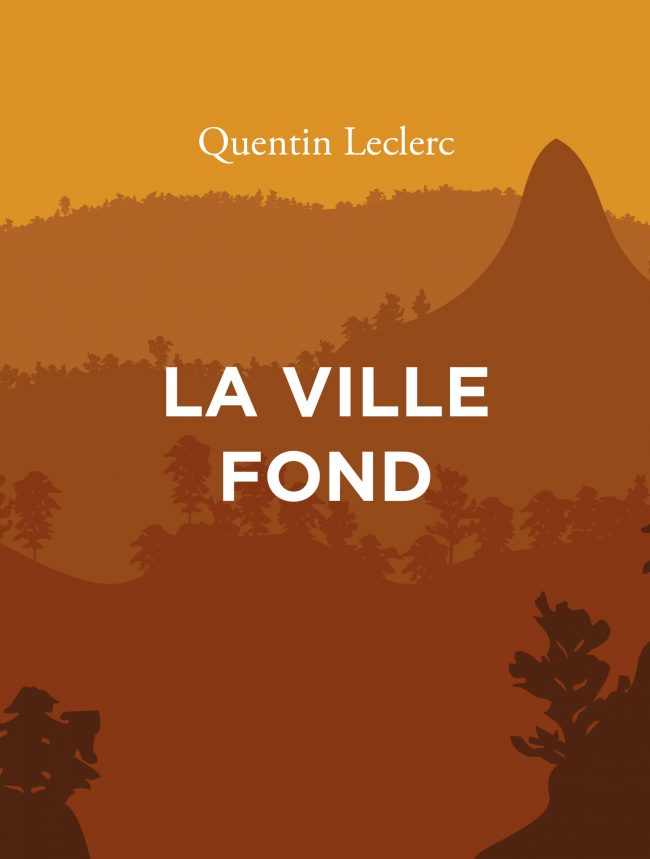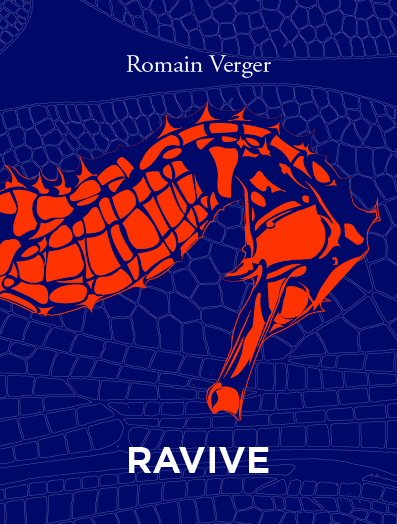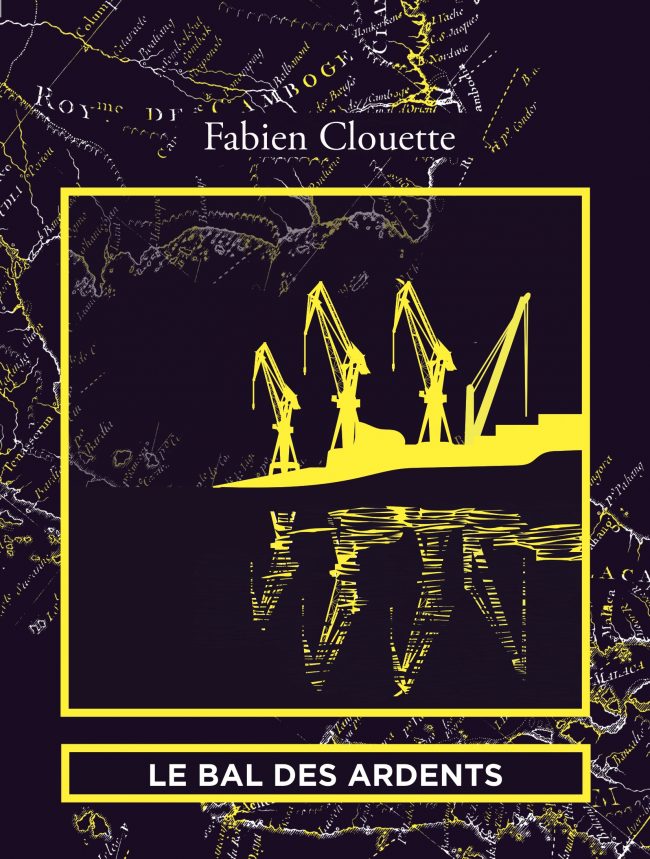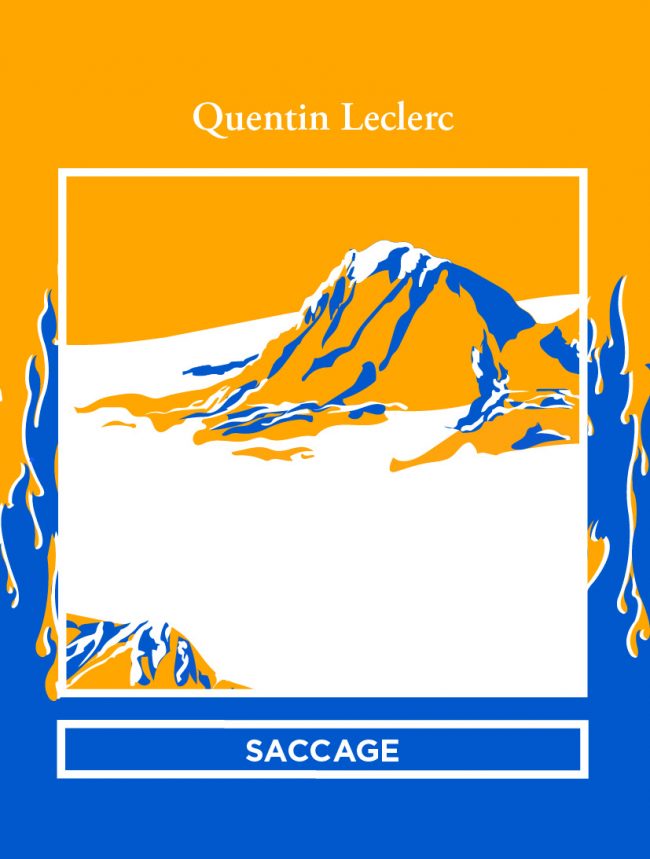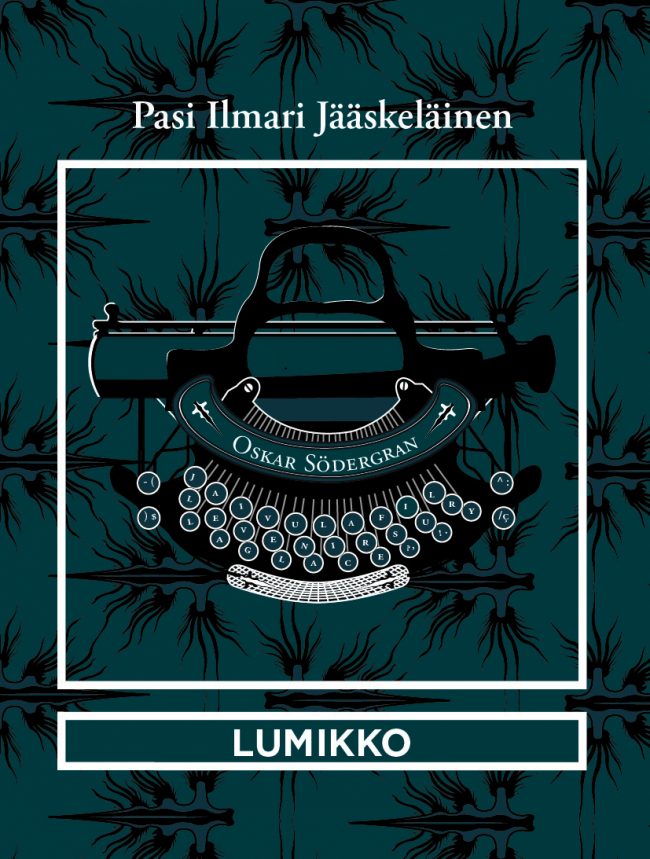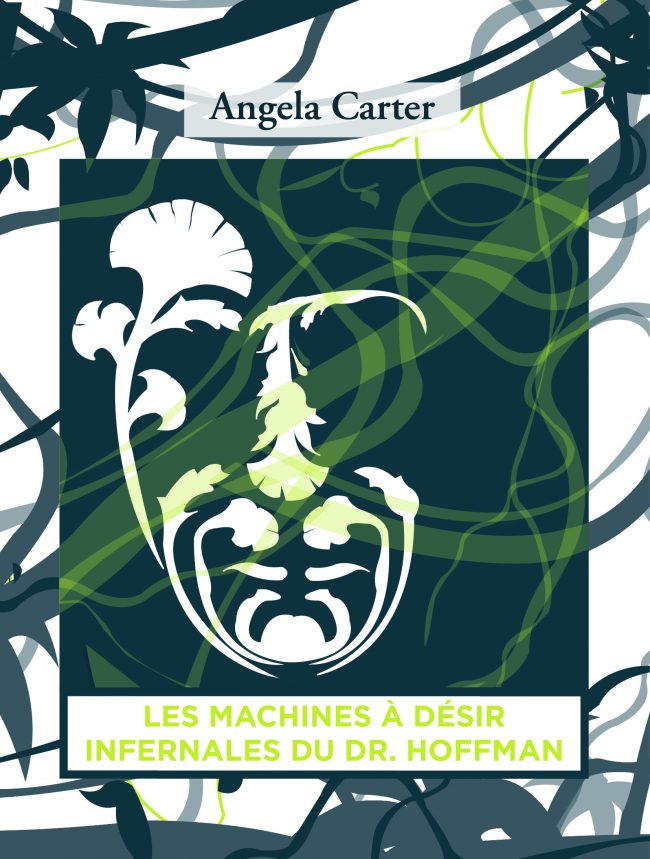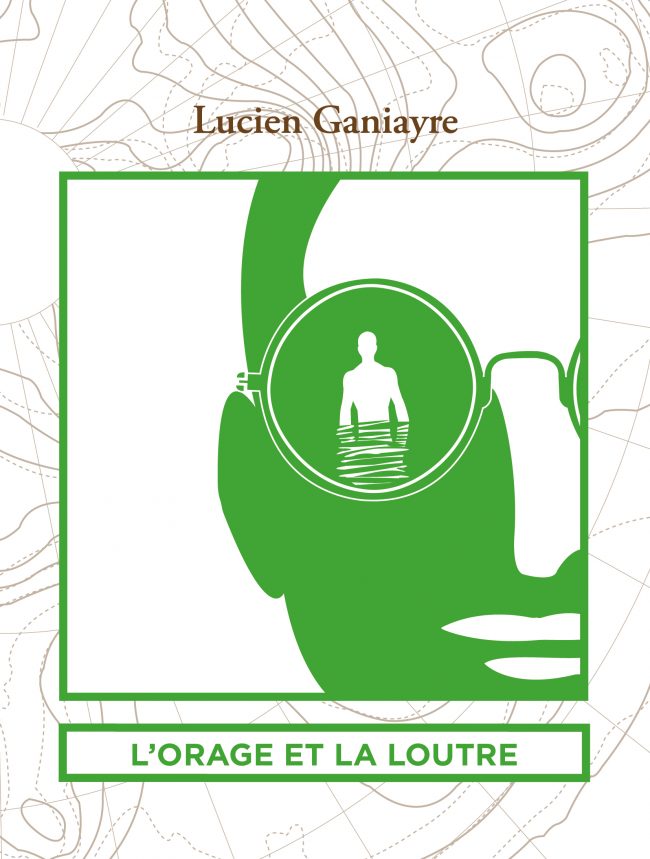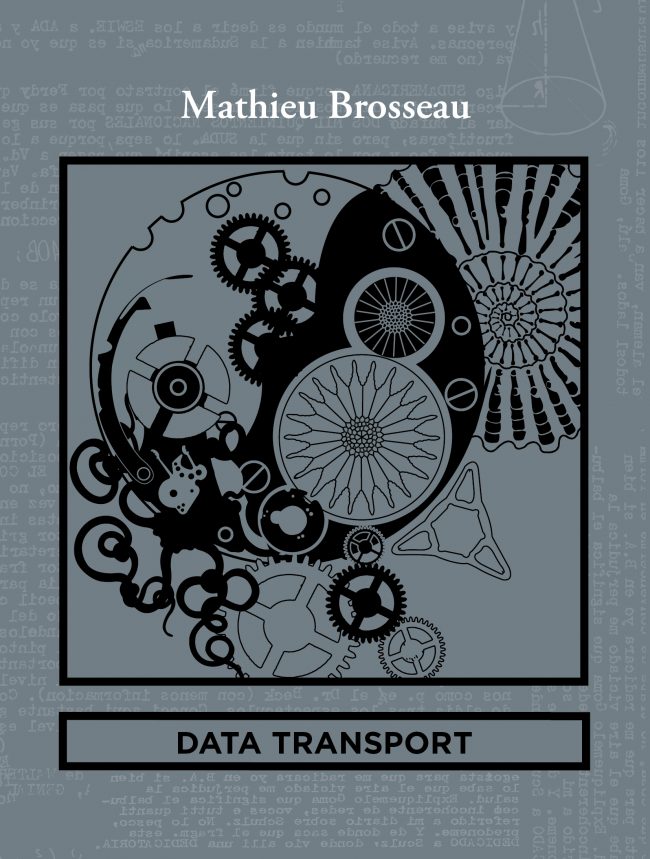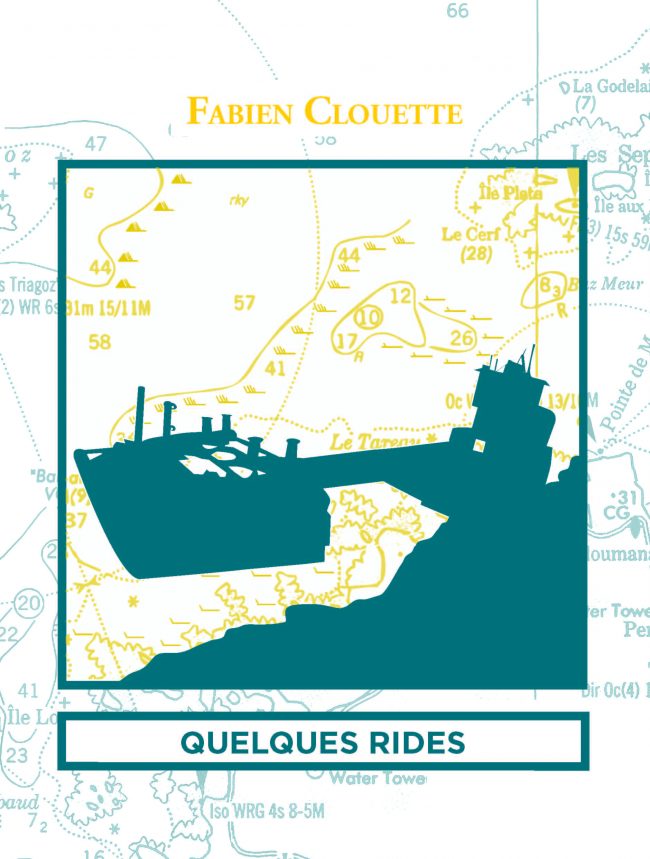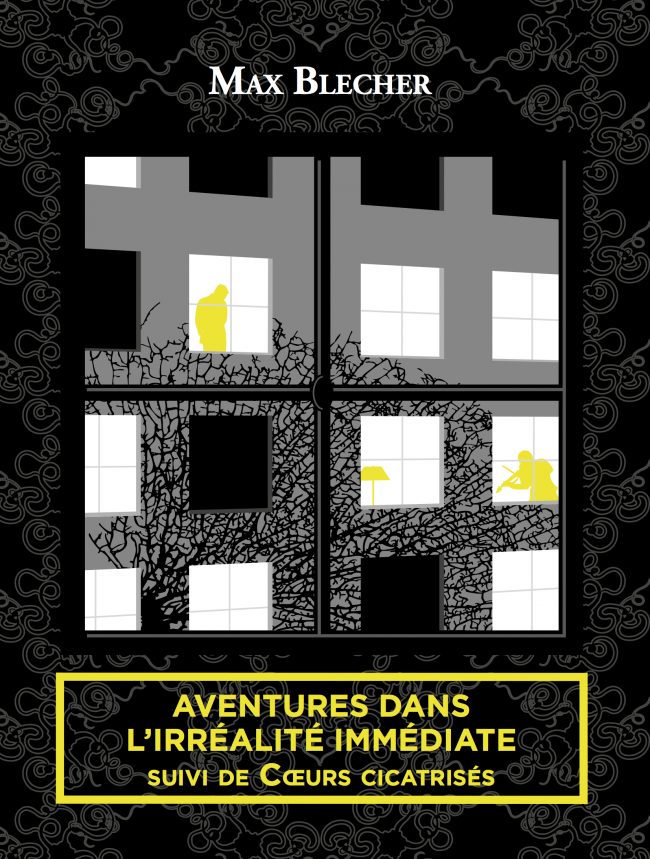Les Métamorphoses
OGRE N°20 – Ovide
Les Métamorphoses
Traduit par Marie Cosnay
jeudi 05 octobre 2017
Taille : 165/218 mm – 528p. – 25€
ISBN : 979-10-93606-99-6
La traduction
La traduction d’un livre aussi extraordinaire que Les Métamorphoses d’Ovide relève d’une forme de folie. Imaginez : une traduction fleuve de plus de dix ans et de quelque 12 000 vers. Pourtant ce projet semble découler naturellement de l’activité d’écrivaine et de traductrice de Marie Cosnay. En 2006, alors que Marie Cosnay enseigne les lettres classiques au collège depuis de nombreuses années, les livres X, XI, XII des Métamorphoses d’Ovide sont inscrits au programme du baccalauréat littéraire. L’Éducation nationale utilise des adaptations vite éditées de l’une des traductions existantes des Métamorphoses, versions qui permettent au lecteur d’avoir accès au contenu mais pas à sa dimension littéraire et poétique. Alors, Marie Cosnay se lance dans la traduction de ces trois chants à destination des Terminales. La première réaction des jeunes élèves et de leurs professeurs, c’est qu’ils n’imaginaient pas Ovide si contemporain. Si contemporain ! Le projet est lancé, et elle reprend Les Métamorphoses depuis le livre I pour en achever la traduction en juin 2016. On imagine la constance et l’énergie incroyable qu’il a fallu puiser pour en arriver à bout. Une nouvelle traduction donc, qui vient s’ajouter à celles de Georges Lafaye et d’Olivier Sers aux Belles Lettres ou à celle de Danielle Robert chez Actes Sud.
Non seulement Les Métamorphoses fait partie de ces œuvres qui méritent et appellent plusieurs traductions, mais il en manquait une, celle qui révélerait toute la modernité de l’écriture d’Ovide et qu’on lirait non pas comme un texte antique, mais comme de la poésie ou comme un roman d’aventure.
Traduire, c’est construire à partir de ce qui a été construit, recommencer en partant des mêmes principes. On en rajoute une couche : on re-re-fait le monde, le nôtre, en partant de très loin, celui du vieil Ovide d’il y a 21 siècles. Il s’agit de sortir Ovide du décor et des classes de latin, et de réussir avec Ovide ce que Jean-Michel Déprats a fait avec Shakespeare ou André Markowicz avec Dostoïevski. Le latin d’Ovide est novateur, c’est un latin qui lui est propre (qui est fait de plein de choses, de grec, de pas mal de Virgile, etc.). Quand il écrit Les Métamorphoses, il n’obéit pas tout à fait aux règles et aux codes littéraires de son époque. C’est cette originalité que Marie Cosnay tente de traduire. Durant toutes ces années, quand elle écrit, c’est avec le compagnonnage d’Ovide, et quand elle traduit, c’est toute la diversité de son écriture, au croisement du récit, de la poésie et de la réflexion politique, qui converge vers un but, rendre aux Métamorphoses sa dimension orale, populaire et contemporaine.
Le livre
Les Métamorphoses, c’est un livre monstre par sa forme et par son projet, un poème de 15 livres qui rassemble en quelque 12 000 vers le récit de 246 fables racontant les métamorphoses des dieux et des héros, depuis le chaos originel jusqu’à la métamorphose de Jules César en étoile. C’est un texte tellement important qu’il irrigue tout un pan de l’art et de la littérature. Même si vous ne l’avez pas lu, vous en avez forcément des images ou des fragments d’histoires. Ovide pioche dans l’immense répertoire des mythologies grecques et romaines et recompose sa propre épopée pour nous raconter le monde. Ovide est un poète de l’amour, du désir et de l’orgueil, et ce qu’il nous livre est un immense roman d’aventure.
LA PRESSE EN PARLE
« Les Métamorphoses, d’Ovide », par Cécilia Suzzoni, Esprit, avril 2018 : La réussite de cette traduction est d'abord de nous rendre ces Métamorphoses comme en train de se faire, devant nos yeux, à nos oreilles, « paroles de chair et d'os ».
« Métamorphoses transfigurées » par Bertrand Leclair, Le Monde, 9 novembre 2017 : C’est aussi cette exigence [de la traduction] qui donne au texte son allant et sa modernité, sans afféterie aucune, mais avec la volonté d’atteindre à une littérature susceptible de faire un peu trembler le rapport au réel. Pour le regarder d’une autre manière, comme assurément y invite le « poème sans fin » d’Ovide qui conserve, après vingt siècles, la capacité de rendre absolument vivante et agissante la mythologie, ainsi que sa puissance prophétique. « Fond d'œil n° 3 : Les Métamorphoses d'Ovide », Lisez Voir, 6 juillet 2018 : Cette traduction d’Ovide était nécessaire. Elle sublime Les Métamorphoses, les dépoussière pour rendre ses lettres de noblesse à une œuvre manifestement intemporelle qui mérite d’être lue pour la formidable aventure qu’elle représente : celle de dieux anciens devenus personnages de folklore et celle de notre culture et de notre langue. « Mutatis Mutandis », par Eric Darsan, Blog d'Eric Darsan, 20 décembre 2017 : Ces nouvelles Métamorphoses, loin d'être réservées à l'école ou à l'université, affaire de classe(s) et de lettrés – à l'image de leur auteur, fils de qui semble déranger sans jamais tout à fait déroger – se révèlent à la fois plus simples et plus riches, plus intemporelles et plus actuelles que jamais. « Notes de lecture : Les Métamorphoses », par Hugues Robert, Charybde 27 : Le Blog, 11 décembre 2017 : Et c’est ainsi qu’un texte classique parmi les classiques, avec ses deux millénaires d’existence, ressurgit pour nous frapper, beauté enflammée de la littérature jamais résignée, jamais lissée, jamais assagie. « Les Métamorphoses d'Ovide, par Marie Cosnay », par Anne, Textualités, 28 novembre 2017 : [O]n (res)sent la syntaxe et la grammaire latine dans la traduction de Marie Cosnay, on y retrouve vraiment cette langue diligente, efficace et évocatrice, son oralité et ses tournures inaccoutumées, comme si la traductrice avait créé une langue nouvelle, un français exotique fait d’impropriétés novatrices, d’images neuves. C’est un véritable tour de force, tant en termes de traduction que d’écriture ! « Les Métamorphoses d'Ovide, 10 ans de traduction, par Marie Cosnay », entretien entre Marie Cosnay et Fabien Ribery, Blog de Fabien Ribery, 31 octobre 2017 : Fabien Ribery : Tout est métamorphose. Qu’y a-t-il de Lucrèce/Epicure et de Pythagore chez cet auteur latin ? Marie Cosnay : Si on est écartelé entre le malheur d’identification à soi-même (fixé, attaché comme on peut l’être à la terre, au sol, à la souche ou au tronc) et le désir de toujours échapper, grâce ou par le ciel, grâce ou par le nuage qui cache le corps qu’il ne faut pas montrer ou emporte celui qui reste libre, on est écartelé entre le corps malheureux et limité et l’infini des temps, l’âme, si on veut. C’est bien la question de l’âme qui se pose à la fin, c’est Pythagore qui la pose, un Pythagore à qui Ovide donne la parole. Pour Pythagore, l’âme ne meurt pas mais change. Dès qu’elle a quitté un lieu, elle en occupe un autre. Le corps est ce qui peut beaucoup souffrir, être écartelé, écorché, brisé. Mais il possède un souffle éternel, immortel, anima, ce souffle éternel migrant de formes en formes, vers des corps nouveaux. « Métamorphoser Les Métamorphoses d'Ovide », par Catherine Lalonde, Le Devoir, 3 août 2019 : Une traduction qui insuffle à l’épopée un vent frais, la retransforme en lectures essentielles aujourd’hui en rechargeant la langue de sa puissance transmuante, transmutante. « Pourquoi il faut relire Ovide », par Rémi Bonnet, L’Écho républicain, 5 décembre 2017 : Un travail d'équilibriste remarquable qui permet de redécouvrir un chef-d’œuvre d'une fraîcheur inaltérable. « Les Métamorphoses », par Aurélie Janssens, Page des Libraires, 27 novembre 2017 : Une quête de dix ans pour aboutir à une traduction magistrale qui permet de mieux saisir la puissance de cet ouvrage. Une métamorphose pleinement réussie ! « Enfin, les Métamorphoses« , par Yannick Haenel, Charlie Hebdo, 22 novembre 2017 : La poésie classique est-elle dépassée par l'éreintante rapidité de nos sociétés start-up ? Non. Pour s'en convaincre, rien de mieux que de se plonger dans les Métamorphoses d'Ovide, merveilleusement retraduite par Marie Cosnay. « Tout ce qui nous a rendu heureux cette semaine », par Florence Besson et Édouard Dutour, Elle, 4 novembre 2017 : Ovide rechante. On n'avait jamais véritablement plongé dans les Métamorphoses, le Star Wars de la Rome antique. La latiniste Marie Cosnay a travaillé dix ans pour les retraduire, alors on se laisse emporter par le plus beau chant du monde. « La traduction métamorphose », par Claire Paulian, En Attendant Nadeau, 1er novembre 2017 : La traduction de Marie Cosnay ouvre un espace de lecture dans lequel on plonge pleinement, avec un étonnement qui, de métamorphose en métamorphose, ne se dément pas. Ovide est lisible, accessible, en continu. « Elle nous a rendu Ovide », par Christophe Lucet, Sud Ouest Dimanche, 28 octobre 2017 : Les Métamorphoses ? Un livre d'images, un roman fantastique accessible à des jeunes qui aiment l'heroic fantasy. « Ovide radicalement métamorphosé », par Alexandre Gefen, Le Magazine Littéraire, n° 585, 27 octobre 2017 : À l'ombre des succès éphémères de la rentrée littéraire, la beauté piolée de cette traduction brille ainsi de tout son courage. (…) On n'a rien lu d'aussi simple, d'aussi dense, d'aussi escarpé. « Marie Cosnay a vécu 10 ans avec Ovide », par Pierre Penin, Sud-Ouest, 10 octobre 2017 : Le travail de Marie Cosnay porte Les Métamorphoses comme on transmet un trésor. Cette nouvelle traduction en livre toute la modernité. La question centrale, c'est comment échapper à ce qui nous lie. C'est une réflexion sur l'identité, les identités. Un plaidoyer pour les déplacements intérieurs, une invitation à ne jamais croire ce qu'on a l'air d'être. Deux mille ans d'humanité. « Chez Ovide, les identités sont feuilletées et feuilletables », entretien avec Marie Cosnay, Marie de Quatrebarbes et Maël Guesdon, remue.net, 1er octobre 2017 : Chaque fois qu’on fiche, qu’on fixe, qu’on fige, c’est la mort, chez Ovide. « Les formes, les changements, le nouveau et le chant », par Alain Nicolas, L'Humanité, 28 septembre 2017 : Changer de langue n'est pas la moindre des Métamorphoses. « Quel avenir pour Ovide ? », par Manou Farine, Poésie et ainsi de suite, avec Marie Cosnay et Pierre Judet de la Combe, France Culture, le 13 octobre 2017 : Deux invités et des métamorphoses. Marie Cosnay et Pierre Judet de la Combe. Une écrivaine latiniste et un helléniste. Puisque donc, tout change. Sauf le langage, sauf le poème. C’est l’une des leçons des métamorphoses d’Ovide. Celles que Marie Cosnay vient de traduire aux Éditions de l’Ogre. Jupiter, Écho, Narcisse, Daphnée, Europe, Io, Médée, Orphée, des dieux, des hommes, des bêtes, des roches et des plantes, des répertoires d’images, une langue qui court de récit en récit, de corps en corps, de transformations en réincarnations dans un poème sans fin écrit il y a deux mille ans. 12000 vers, 15 livres, plus de 200 fables transformistes, du début du début du monde jusqu'au temps d’Ovide sous le règne d’Auguste. Et en creux sans doute la plus belle des définitions du poème. Il aura fallu dix ans à Marie Cosnay, passés dans la langue d’Ovide et dans son poème. Dix ans à traduire et à poursuivre dans le même temps sa propre œuvre largement irriguée par Ovide et son refus de la fixation des choses. A ses côtés, Pierre Judet de la Combe, directeur d’études à l’EHESS qui signe une longue et lumineuse préface à la traduction de Marie Cosnay. Il y a de l’avenir chez les anciens. « Des nouvelles de Jupiter », par Nicolas Demorand, le « 7h43 », France Inter, 20 septembre 2017 « Pourquoi faut-il retraduire Ovide ? », par Mathilde Serrell, Le billet culturel, France Culture, 31 août 2017 : Autre évènement majeur de cette rentrée littéraire : la nouvelle traduction des Métamorphoses !
LES LIBRAIRES AUSSI
Tropismes (Bruxelles) : Lire Ovide comme on lirait un roman d'aventures mystérieuses et sentir dans le rythme des langues les enjeux palpitants du mythe. Quelle merveille !
EXTRAIT
La création
Je veux dire les formes changées en nouveaux
corps. Dieux, vous qui faites les changements, inspirez
mon projet et du début du début du monde
jusqu’à mon temps faites courir un poème sans fin.
Avant la mer et les terres et le ciel qui couvre tout,
le visage de la nature était un sur le globe entier,
on le disait Chaos, matière brute et confuse,
rien qu’un poids inerte, des semences
amoncelées, sans lien, discordantes.
Aucun Titan alors n’offrait sa lumière au monde
ni Phœbé ne réparait, en croissant, ses cornes nouvelles
ni dans l’air tout autour la terre n’était suspendue,
balancée sous son poids, ni vers les lointains
bords des terres Amphitrite ne tendait les bras.
Quand il y avait terre, il y avait mer et il y avait air,
mais c’était terre instable, onde innavigable,
air sans lumière, rien ne gardait sa forme,
une chose empêchait l’autre, car dans un même corps
le froid battait le chaud, l’humide le sec,
le mou le dur, le sans-poids le poids. Un dieu et une bonne nature ont mis fin à cette lutte. Ils ont retranché du ciel les terres et des terres les eaux, d’un air compact ont séparé le ciel limpide. Ils ont déroulé les choses éparses, les ont tirées du tas aveugle et les ont attachées en des lieux où elles s’accordent en paix. La force de feu, impondérable, du ciel incliné a éclaté, elle s’est fait place aux plus hauts sommets. Proche du feu est l’air, en légèreté et lieu. Plus lourde qu’eux, la terre, traînant de grands éléments, pressée sous son propre poids ; l’humeur qui lui coule autour habite les dernières régions, enserre le globe solide. Un dieu, quel qu’il soit, a disposé l’amas, puis l’a coupé ; coupé, il lui a donné des membres : d’abord la terre et, pour qu’elle ne soit pas, en ses parties, inégale, il l’a arrondie en forme de grand globe. Après, il a versé les flots, a ordonné qu’ils gonflent sous les vents rapides, qu’ils entourent les rives d’une bande de terre. Il a ajouté des fontaines, d’immenses nappes d’eau, des étangs, il a ceinturé de rives pentues les fleuves descendants. Divers selon les lieux, parfois ils sont absorbés par la terre, ils parviennent à la mer parfois. Reçus dans une plaine d’eau plus libre ils cognent, au lieu des rives, les rivages. Il a ordonné aux plaines de s’allonger, aux vallées de s’asseoir, aux forêts de se couvrir de feuilles, aux montagnes pierreuses de surgir. À droite deux zones, autant qu’à gauche, coupent le ciel, et une cinquième, au milieu, est plus chaude. Le lourd fardeau qu’enferme le ciel est divisé en parts égales, le dieu en a eu soin. Autant de régions marquent la terre. Celle du milieu n’est pas habitable, à cause de la chaleur. La neige haute en couvre deux. Aux deux autres, intermédiaires, le dieu a donné, avec le feu et le froid, l’équilibre. L’air s’étend au-dessus. Il est plus léger que la terre et plus léger que l’eau et plus lourd que le feu. Qu’ici s’installent les brouillards, ici les nuages, dit-il, ici les tonnerres qui émeuvent les esprits d’hommes, ici les vents qui font les foudres et les éclairs. Le créateur du monde ne leur donne pas sans frein l’air à posséder. À peine peut-on les empêcher, maintenant que chacun mène les souffles de son côté, de déchirer le monde, tant est grande la discorde des frères. Eurus1 recule vers l’Aurore et le règne des Nabatéens, vers la Perse et les crêtes soumises aux rayons du matin, Vesper et les rivages que tiédit le soleil couchant sont proches de Zéphyr. L’horrible Borée envahit la Scythie et le Septentrion, la terre en face se mouille sous les nuages qui y vivent et sous l’Auster pluvieux. Au-dessus des vents, le dieu a posé, fluide, sans pesanteur, l’Éther. Il n’y a rien en lui de la lie terrestre. À peine le dieu a-t-il tout clôturé dans de sûres limites que, cachées sous la masse qui les écrasait depuis longtemps, les étoiles ont commencé à mettre le feu au ciel. Pour qu’aucune région ne soit privée d’êtres vivants, des astres et des formes de dieux occupent le sol du ciel, les eaux à habiter font place aux poissons brillants, la terre prend les bêtes et l’air agité ce qui vole. Noble, capable de haute pensée, un animal manquait encore, pour dominer les autres. L’homme est né. Ou il est fait de semence divine par l’artisan des choses, l’origine du monde meilleur, ou la terre nouvelle, à peine séparée de l’Éther élevé, retient encore les semences de son parent le ciel et l’enfant de Japet mélange la terre aux eaux de pluie, la modèle à l’effigie des dieux qui règlent tout. Alors que les autres animaux, courbés, regardent la terre, il donne à l’homme une tête qui se lève, il lui ordonne de voir le ciel et de dresser haut son visage vers les étoiles. Ainsi, jadis brute et sans image, la terre transformée se couvre de figures d’hommes inconnues. Les quatre âges du monde D’or est né le premier âge et sans chef, de lui-même, sans loi, il respectait la foi et le droit. Ni peines ni peurs, on ne lisait aucune parole menaçante sur le bronze gravé, la foule suppliante ne craignait pas le regard de son juge, on était sauf, sans chef. Il n’avait pas encore, pour voir le monde, été arraché à ses montagnes, le pin, il ne descendait pas sur les eaux limpides, les mortels ne connaissaient, à part les leurs, aucun rivage. Les fosses en pente raide n’entouraient pas encore les villes. Ni trompette de bronze travaillé, ni corne de bronze courbé, ni casque, ni glaive. Ils n’avaient pas besoin de soldats, les peuples dans le calme vivaient de bons loisirs. Libre, intacte de coups de bêche, blessée d’aucune charrue, d’elle-même la terre donnait tout. Heureux des nourritures créées sans contrainte, on cueillait les petits des arbousiers, les fraises des montagnes, la cornouille, les mûres accrochées aux durs buissons de ronces et les glands qui tombaient de l’arbre épanoui de Jupiter. C’était un printemps éternel, les doux Zéphyrs frappaient de brises tièdes les fleurs nées sans semence. Bientôt la terre sans labour portait des fruits, le champ qu’on ne remuait pas blanchissait sous les barbes des épis ; déjà des fleuves de lait, des fleuves de nectar déjà coulaient, et blondes, du chêne vert, tombaient des gouttes de miel. Après, Saturne est envoyé dans le Tartare ténébreux, le monde appartient à Jupiter : vient la race d’argent, inférieure à celle d’or, plus précieuse que le bronze fauve. Jupiter a raccourci la durée du printemps antique et en hiver, été, automne inégaux et bref printemps, a poussé l’année sur quatre temps. Alors l’air brûlé de bouillonnements secs a blanchi et l’eau glacée par les vents est tombée. Alors on est entré aux maisons ; les maisons sont des grottes, des arbrisseaux feuillus, des lianes nouées de racines. Alors on a enfoui les semences de Cérès dans de longs sillons et, pliés sous le joug, les taureaux ont gémi. Une troisième race a succédé, celle de cuivre, plus cruelle par nature, plus vive en armes horribles mais sans crime. De fer dur est la dernière. Aussitôt sur cet âge de mauvaise veine ont fondu toutes les barbaries. Ont fui la pudeur et le vrai et la foi, en leur lieu sont venus les fraudes et les ruses et les pièges et la violence et le criminel désir d’avoir. Le marin donnait ses voiles aux vents qu’il ne connaissait pas encore et, longtemps debout sur le haut des monts, le bois des coques sautait dans les flots inconnus. À tous, comme les lumières du soleil et les brises, est la terre, que le géomètre prudent limite de longues frontières. On lui réclame moissons et aliments, c’est une riche terre ; mais on va aussi dans ses viscères et les richesses qu’elle cache, rangées aux ombres du Styx, on les extrait. Ce qui excite les malheurs. Maintenant, le fer nuisible et, plus nuisible que le fer, voici l’or. Et voici la guerre, qui avec l’un et pour l’autre se bat, agite d’une main ensanglantée ses armes qui claquent. On vit de vols. L’hôte ne protège pas l’hôte ni le gendre le beau-père. La bienveillance des frères est rare. Le mari invente la perte de sa femme, la femme celle de son mari. D’effrayantes belles-mères mélangent l’aconit pâle. Le fils avant le temps compte les années de son père. La piété est morte et la vierge, dernière des habitants du ciel, Astrée, quitte les terres mouillées de meurtres. Mais l’Éther élevé n’est pas plus sûr que les terres. Les Géants, dit-on, abordent au royaume céleste et posent montagnes sur montagnes, jusqu’aux étoiles. Le Père tout-puissant, d’un trait de foudre, brise l’Olympe, arrache le Pélion à l’Ossa2 qui le tenait. Écrasés sous la masse, les corps sinistres gisent. La terre est touchée du sang de ses enfants et s’en imbibe, dit-on. Elle anime ce flot tiède et, pour qu’il reste une trace de son espèce, en fait des faces d’hommes. À son tour cette race méprise les dieux, désire le meurtre sauvage, se fait violente ; tu comprends, elle est née du sang. Lycaon Quand il voit ça, notre Père, fils de Saturne, du haut de son domaine, pleure. Il se souvient d’une histoire trop récente pour être connue : le hideux repas à la table de Lycaon. Dans son cœur il conçoit d’immenses colères, dignes de lui. Il appelle ses conseillers. Appelés, les voici tout de suite. Il est un chemin dans les hauteurs, évident par ciel serein, qui a pour nom Lactée remarquable de blancheur. C’est le trajet des dieux vers le toit du Grand Tonnant, la maison royale. À droite, à gauche, portes ouvertes, sont les salles des nobles dieux. Le peuple habite à l’opposé. Ici, et tout autour, les puissants habitants du ciel ont installé leurs foyers. Ainsi est le lieu, si je suis libre des mots, que j’appellerai Palatin du ciel3. Les dieux sont installés dans leur retraite de marbre et Jupiter, plus haut, appuyé sur le sceptre d’ivoire, secoue trois fois, quatre fois, sa terrifiante chevelure avec laquelle il bouge la terre, la mer et les étoiles. Il ouvre ainsi sa bouche de révolte : « Je n’ai pas été plus anxieux pour l’empire du monde au moment de la Grande Tempête, quand les queues de serpent4 de leurs cent bras voulaient se précipiter sur le ciel captif. Oui, l’ennemi était sauvage, mais cette guerre dépendait d’un seul corps, d’une seule race. Aujourd’hui, sur toutes les terres que Nérée cercle et claque, il faut perdre le genre humain. Je le jure, par les fleuves d’en bas, qui glissent sous les terres, jusqu’au bois du Styx, j’ai tout essayé ; la blessure est sans remède, il faut trancher au fer pour épargner la part intacte. J’ai des demi-dieux, j’ai des démons de campagne, des nymphes, des faunes, des satyres, des sylvains de montagne ; puisqu’on ne les honore pas encore du ciel, ils doivent habiter en paix les terres données. Dieux d’en haut, est-ce que vous les croyez en sécurité quand moi, qui vous possède et dirige, avec la foudre, j’ai été piégé par Lycaon, connu pour sa sauvagerie ? » Tous frémissent et avec une énergie brûlante l’encouragent à oser. Ainsi, lorsqu’une main impie furieuse a cherché dans le sang de César à éteindre le nom romain, le genre humain, devant l’effroi d’un malheur imprévu, a été sidéré. Et l’univers entier, pris de frissons. Pour toi, Auguste, la piété des tiens n’est pas moins chère que celle des dieux pour Jupiter. De la voix, de la main, celui-ci calme les murmures ; tous font silence. Dès que les cris sont calmés par la majesté du souverain, Jupiter brise le silence pour la deuxième fois : « L’homme a payé sa peine, n’ayez crainte. Son délit et ma vengeance, je vous les dirai. La mauvaise réputation de cet âge avait touché mes oreilles. Je la désirais fausse mais voilà : je glisse de l’Olympe et, dieu sous image d’homme, j’arpente les terres. Ce serait trop long, tant de torts je trouve partout, de les énumérer. La réputation est au-dessous du vrai. J’étais passé par l’horrifiant Ménale aux cachettes de bêtes fauves, par le Cyllène et les pinèdes gelés du Lyrcée ; me voici au lieu et au toit inhospitalier du tyran d’Arcadie. J’entre. Les vieux crépuscules poussaient vers la nuit. Je donne signe que le dieu est venu et la foule commence à prier. D’abord, Lycaon rit des offrandes pieuses. Puis il dit : « Je vais tester, en combat ouvert, si ce dieu n’est pas mortel. On ne pourra pas douter de la vérité. » La nuit, je suis lourd de sommeil, il veut me perdre de mort subite. Voici une épreuve de vérité ! Cela ne lui suffit pas. Un otage envoyé de chez les Molosses : d’un trait il lui coupe la gorge et, ses membres mi-morts, dans des eaux bouillantes il les ramollit. Les autres, il les grille sur le feu. À peine a-t-il posé le repas sur la table que, de ma foudre de vengeance, je fais tomber le toit sur un foyer bien digne de son maître. Effrayé, celui-ci s’enfuit. Il tombe dans le silence des bois et hurle en vain, essaie de parler ; la bouche en elle concentre toute la fureur rentrée ; son désir de meurtre, il l’exerce sur les troupeaux ; maintenant encore il jouit du sang. Ses habits s’effacent en poils, ses bras en jambes. Il devient loup et garde des traces de son ancienne forme. Même blancheur, visage de même violence, même brillance dans les yeux, même image de cruauté. Une seule maison est tombée ; elle n’était pas la seule à devoir périr ; là où s’étend la terre, là règne la bestiale Érinye ; tu croirais qu’on complote des crimes. Que tous, au plus tôt, subissent les peines méritées, telle est ma façon de voir. » Les uns approuvent les paroles de Jupiter et stimulent sa colère grondante, les autres se contentent d’acquiescer, mais la perte du genre humain est une douleur pour tous ; une terre privée d’hommes, se demande-t-on, quelle forme future aura-t-elle, qui apportera aux autels l’encens, aux bêtes est-on prêt à donner la terre à peupler ? On demande et il répond : il aura soin lui-même de tout, le roi des dieux, il ne faut pas s’agiter, il promet une lignée différente de la précédente, d’origine merveilleuse. Le Déluge Déjà, le dieu va jeter ses foudres sur toutes les terres, il craint que l’Éther sacré, à force de feux, ne conçoive des flammes et que sa longue voûte ne brûle. Il y avait dans les destins, il s’en souvient, un temps où la mer, où la terre et les royaumes du ciel seraient pris, brûleraient, où la masse assiégée du monde souffrirait. Alors, il pose les lances fabriquées par les cyclopes et choisit une autre peine : perdre le genre humain sous les eaux, faire tomber de tout le ciel des pluies d’orage. Aussitôt il enferme l’Aquilon dans les grottes d’Éole et tous les souffles qui font fuir les nuages accumulés. Il envoie Notus. Notus s’envole, ailes mouillées, terrible, couvert au visage d’une ténèbre de poix. Sa barbe est lourde de pluies, de ses cheveux blancs l’eau coule, sur son front siègent les brouillards, ruissellent ses plumes et son sein. De sa large main il presse les nuées suspendues et le fracas se fait ; des averses serrées tombent de l’Éther. La messagère de Junon, de toutes les couleurs, Iris, absorbe les eaux et les offre aux nuages. Les moissons sont terrassées et pleurées des paysans. Elles gisent, regrettées ; le vain travail d’une longue année, perdu. La colère de Zeus ne se contente pas du ciel ; son frère bleu azur l’aide de ses eaux alliées. Il convoque les fleuves ; ils entrent au toit de leur maître, « Pas besoin de longs discours, leur dit-il. Versez vos forces, voici le travail. Ouvrez vos maisons, brisez les digues, à vos flots lâchez les rênes. » Il ordonne ; ils y vont, ouvrent les bouches des fontaines, roulent d’une course sans frein jusqu’à la mer. Il frappe la terre de son trident. Elle tremble et sous le mouvement ouvre le chemin des eaux. Vagabonds, les fleuves se ruent à travers champs, avec les récoltes prennent tout, arbres, troupeaux, hommes, toits et autels avec objets sacrés. Si une maison a tenu bon, a su résister, debout, à un si grand mal, l’eau plus haute en couvre le sommet ; englouties, ses tours s’enfoncent dans l’abîme. Entre la mer et la terre, il n’y a plus de limite, tout est océan, l’océan est sans rivage. L’un s’installe sur la colline ; l’autre, sur le bec d’une barque, agite les rames là où hier il labourait. L’un sur ses moissons et le faîte de sa maison immergée navigue ; l’autre pêche un poisson au sommet d’un ormeau. On jette l’ancre au hasard, dans une prairie verte, les coques courbes frottent sous elles les vignes et là où les chèvres frêles ont brouté l’herbe, des phoques informes posent leur corps. Sous l’eau, les néréides admirent bois, villes et maisons. Les dauphins vivent dans les forêts, se jettent aux plus hautes branches, cognent et bousculent les troncs. Nage le loup au milieu des brebis, l’onde porte les lions fauves, l’onde porte les tigres et ni au sanglier ses forces de foudre, ni au cerf emporté leurs jambes rapides ne sont utiles. Depuis longtemps il en a cherché, des terres où se poser : sur la mer l’oiseau errant se laisse tomber, les ailes lasses. L’immense liberté de l’océan a couvert les collines et de nouveaux flots frappent les pointes des montagnes. La plupart des êtres sont pris par l’onde et ceux que l’onde épargne, de longs jeûnes, par manque de nourriture, les domptent. La Phocide sépare les Aoniens des champs de l’Œta, terre fertile quand c’était terre mais en ce temps-là morceau de mer, large plaine d’eaux précipitées. Ici une montagne aux deux sommets, abrupte, cherche les astres, son nom, le Parnasse, ses pointes dépassent les nuages. Ici, Deucalion, quand l’océan avait recouvert le reste, avec sa compagne, porté sur un petit radeau, a accosté. Ils priaient les nymphes du Parnasse, les divinités de la montagne, et Thémis la fatidique qui alors rendait les oracles. Aucun homme meilleur ni plus amoureux de justice que lui, aucune femme plus respectueuse des dieux qu’elle. Jupiter, quand il voit que le monde baigne dans ces marais liquides, et qu’il reste, de tant de milliers, un seul homme, et qu’il reste, de tant de milliers, une seule femme, tous les deux innocents, tous les deux soucieux des divinités, disperse les nuées et, alors que l’Aquilon écarte les pluies, montre au ciel la terre et l’Éther à la terre. La colère de la mer ne dure pas et d’un trait à trois pointes le maître des mers adoucit les eaux et par-dessus l’abîme, dressé, couvert aux épaules de son pourpre natif, fait venir Triton bleu azur : qu’il souffle, ordonne-t-il, dans le coquillage sonore ; les flots et les fleuves, qu’il les renvoie à ce signal. Celui-ci prend la trompette creuse, tortillée, qui s’évase, large, de la base au pavillon, qui, en pleine mer, quand elle avale les airs, remplit de sa voix les rivages d’un côté et de l’autre de Phœbus. Elle a touché la bouche du dieu, que mouille la barbe ruisselante, elle a chanté, exaltée, l’ordre du retrait, de toutes les eaux des terres elle est entendue et de toutes les eaux des mers ; entendue des eaux, elle les contraint toutes. Maintenant la mer a un rivage, le lit des rivières est plein, les fleuves descendent, on voit pointer les collines, surgir la terre, croître les lieux, décroître les eaux et après un long jour les forêts montrent leurs cimes nues – elles portent sur le front un peu encore de limon. Deucalion et Pyrrha Le monde est revenu. Quand il le voit vide, quand il voit les terres désolées faire un profond silence, Deucalion, avec des larmes, dit à Pyrrha : « Ô ma sœur, ô ma femme, ô unique survivante, toi à qui une même famille, l’origine de nos pères, puis le mariage m’ont uni, maintenant les dangers nous unissent. Des terres que voient le Couchant et le Levant, nous restons le seul peuple. La mer possède le reste. Nous ne pouvons pas encore nous fier à la vie avec certitude. Encore les nuées terrorisent ma pensée. Si sans moi tu avais été arrachée à la mort, malheureuse, comment ferais-tu ? Comment, seule, supporterais-tu la peur ? Qui consolerait ta souffrance ? Moi, crois-moi, si l’océan te prenait je te suivrais, ma femme – et l’océan me prendrait. Ô, si je pouvais refaire des peuples avec l’art de mon père et verser des âmes dans la terre façonnée ! Maintenant le genre humain, c’est nous deux. Ainsi l’ont voulu les dieux, nous restons seuls échantillons des hommes. » Il dit et tous les deux pleurent. Ils veulent prier la force céleste et demander de l’aide aux oracles sacrés. Sans attendre ils vont aux eaux du Céphise, elles ne sont pas limpides, coupent déjà le tracé connu. Ils versent un peu de l’eau puisée sur leurs vêtements et leur tête ; ils tournent leurs pas vers le sanctuaire de la déesse sacrée, les pentes du toit blanchissaient d’une vilaine mousse et les autels, debout, étaient sans feux. Devant l’escalier du temple, l’un et l’autre se couchent et, penchés au sol, dans l’épouvante, donnent des baisers à la pierre gelée. Ils disent : « Si sous les prières justes les divinités vaincues s’attendrissent, si la colère de la déesse se retourne, dis, Thémis, par quel art réparer la ruine de notre espèce ? Offre ton aide, Très Douce, aux choses immergées. » La déesse est émue et rend cet oracle : « Éloignez-vous du temple, couvrez-vous la tête, détachez vos ceintures et derrière votre dos jetez les os de la Grande Vieille Mère. » Ils restent longtemps saisis ; Pyrrha rompt le silence la première et refuse d’obéir aux ordres de la déesse, elle demande pardon d’une voix épouvantée, épouvantée de blesser avec des os jetés les ombres d’une mère. Ils cherchent cependant à comprendre, dans les ténèbres aveugles, les paroles obscures et les agitent en eux et entre eux. Le fils de Prométhée caresse la fille d’Épiméthée de paroles apaisantes et : « Ou mon intelligence me trompe ou les oracles religieux ne commandent jamais d’acte barbare. La terre est une grande vieille mère. Les cailloux dans le corps de la terre, on peut les dire des os ; on nous ordonne de les jeter derrière notre dos. » La fille du Titan est touchée de l’interprétation de son mari, elle doute pourtant de son espoir ; ils se méfient tous deux des conseils célestes ; mais quel danger à essayer ? Ils s’éloignent, voilent leur tête, délacent leur tunique et envoient derrière leurs pas les cailloux qu’on a dits. Les pierres (qui le croirait, mais l’Histoire en témoigne) commencent à perdre leur dureté, leur rigidité ; un peu de temps pour s’amollir, pour amollies prendre forme. Bientôt elles grandissent, une plus douce nature leur vient, de sorte, mais ce n’est pas évident, qu’on peut voir une forme d’être humain, comme une ébauche dans du marbre, imprécise, semblable à une statue brute dont une part, avec un peu de suc, est humide et faite de terre ; la forme nouvelle sert de corps. Ce qui est solide et ne peut être fléchi se change en os, ce qui était veine, sous le même nom, demeure. En un bref instant, sous la volonté des dieux, les pierres envoyées par les mains d’un homme prennent figure d’hommes, du geste d’une femme une femme est réparée. Python Depuis, nous sommes une race dure, qui connaît les peines, nous témoignons de l’origine de notre naissance. D’autres bêtes aux formes diverses, la terre en accouche seule quand la vieille humidité par le feu du soleil est réchauffée, que la boue et les eaux des marécages sont gonflées de chaleur, que les semences fertiles des choses, nourries dans un sol de vie comme dans le ventre d’une mère, ont poussé. Après du temps, elles prennent figure. Ainsi, quand le Nil aux sept bouches déserte les champs mouillés et ramène ses eaux dans la coque ancienne, quand le reste de limon s’échauffe sous l’étoile du ciel, les paysans sous les mottes de terre retournées trouvent plein de bêtes, certaines à peine ébauchées, au moment même de naître, certaines inachevées, ils les voient tronquées et dans le même corps souvent une partie vit quand une partie est de terre brute. En effet, l’humide et le chaud, s’ils trouvent l’équilibre, conçoivent : de ces deux principes tout naît. Le feu combat l’eau, mais la vapeur humide crée toutes les choses, et la discorde, avec la concorde, sait enfanter. Lorsque la terre, boueuse du déluge récent, blanchit sous les soleils du ciel et la haute chaleur, elle produit des images innombrables, ramène les figures anciennes, crée les monstres nouveaux. Peut-être ne l’a-t-elle pas voulu, mais toi aussi, grand Python, elle t’a engendré. Pour les peuples nouveaux, serpent inconnu, tu étais la terreur. Tant tu tenais d’espace, de haut en bas de la montagne. Le dieu porteur d’arc, qui n’a jamais usé d’une telle arme que contre les daims et les chevreaux qui fuient, de mille traits t’accable, vide presque son carquois, te tue, venin versé dans les blessures noires. Pour que l’Histoire ne puisse détruire la réputation de son œuvre, il institue des jeux sacrés en un concours célèbre, qu’on appelle Pythiques, du nom du serpent dompté. Ici les jeunes qui de leur main, de leurs pieds et des roues de leur char ont vaincu reçoivent pour hommage une couronne de chêne. Il n’avait pas encore le laurier, il couronnait sa tête ravissante, sa longue chevelure, de toutes sortes de feuillages, Phœbus. Daphné Le premier amour de Phœbus est Daphné du Pénée, ce n’est pas le hasard qui la lui a donnée, mais la colère cruelle de Cupidon. Le dieu de Délos, tout fier, juste après que le serpent a été vaincu, voit Cupidon courber les deux côtés de l’arc et tendre la corde : « Que fais-tu, petit rigolo, avec cette arme de force ? dit-il, c’est un poids pour mes épaules à moi ! Moi je sais blesser une bête, je sais blesser un ennemi, le gros Python qui pressait de son ventre pestiféré des arpents de terre, je l’ai abattu de mes innombrables flèches ! Toi, avec ta torche, contente-toi d’exciter je ne sais quelles amours ; ne cherche pas ma gloire. » Le fils de Vénus : « Ton arc perce tout, Phœbus, mais tu es percé du mien. Oui, tout animal recule devant un dieu ; oui, ta gloire est plus petite que la mienne. » Il dit. Il broie l’air de ses ailes frappées et vif s’installe à la cime ombragée du Parnasse. De son carquois il sort deux flèches aux différents emplois : l’une fait fuir, l’autre fait l’amour. Celle qui fait l’amour est dorée et brille sur sa pointe acérée, celle qui fait fuir est épaisse, elle a du plomb sous le roseau. De la dernière, le dieu perce la nymphe du Pénée. De l’autre, il blesse les moelles d’Apollon, en passant par l’os. Tout de suite l’un aime, l’autre fuit le mot aimer. Dans les cachettes des forêts, dans les dépouilles des bêtes capturées, elle se plaît, égale de Phœbé la non-mariée. Une bandelette serre ses cheveux en désordre. Beaucoup la désirent, elle tourne le dos aux désirs, ne supporte ni ne connaît les hommes, court dans les bois reculés. Qui est Hymen, Amour, qu’est-ce que le mariage ? Elle ne veut pas savoir. Souvent son père dit : « Tu me dois, ma fille, un gendre. » Souvent son père dit : « Enfant, tu me dois des petits-enfants. » Elle déteste comme un crime les feux des unions, baigne son beau visage d’une rougeur de honte et de ses bras blancs s’accroche au cou de son père : « Donne-moi, mon père adoré, dit-elle, de jouir de la virginité éternelle. Le père de Diane, autrefois, le lui a donné. » Il acquiesce. « Mais ton charme empêche qu’il en soit comme tu veux, ta beauté s’oppose à ton vœu. » Phœbus aime ; il désire s’unir à Daphné depuis qu’il l’a vue, il espère ce qu’il désire : ses oracles le trompent. Comme les tiges légères brûlent quand on a ôté les épis, comme les haies s’enflamment quand un voyageur de hasard en approche sa torche ou en laisse brûler le feu en plein jour, ainsi le dieu se laisse aller aux flammes, ainsi dans sa poitrine il brûle et nourrit, avec espoir, un amour impossible. Il regarde les cheveux sauvages descendre dans le cou, et : « Oh, s’ils étaient coiffés ! » Il voit, palpitant de feu, comme des étoiles, les yeux, il voit la bouche, la voir n’est pas assez ; il loue les doigts, les mains, les avant-bras, les bras nus plus qu’à moitié et, ce qui est caché, il le croit plus beau. Elle fuit plus vive que la brise légère. Elle ne s’arrête pas quand il l’appelle : « Nymphe, je t’en prie, arrête ! Ce n’est pas un ennemi qui te suit, nymphe, arrête ! L’agnelle fuit le loup, la biche le lion, et la colombe, d’une aile frissonnante, l’aigle ! Chacune son ennemi ; moi c’est par amour que je te suis ! Pauvre de moi, si tu tombais, si les ronces marquaient tes jambes indignes de blessures, si je te causais de la douleur ! Ils sont escarpés, les lieux où tu cours : doucement, je t’en prie, retiens ta fuite, je te suivrai doucement. Apprends à qui tu plais : je n’habite pas les montagnes, je ne suis pas berger, je ne garde ni troupeau ni bétail, je ne suis pas une brute. Tu ne sais pas, folle, tu ne sais pas qui tu fuis, c’est pour ça que tu fuis. La terre de Delphes est à moi, elle veille sur Claros, Ténédos et le royaume de Patara ; Jupiter est mon père ; par moi ce qui sera, a été, est, se dévoile ; par moi les chants s’accordent à la lyre. Elle est sûre, ma flèche, mais il y en a une plus sûre que la mienne. Qui a blessé mon cœur vide. J’ai inventé la médecine : dans le monde on m’appelle sauveur et les pouvoirs des herbes me sont soumis. Malheur à moi, aucune herbe ne soigne l’amour. Ils ne servent pas leur maître, mais les autres, mes talents. » Il va parler encore, mais la fille du Pénée à la course craintive fuit, le laisse là, lui et ses mots inachevés. Elle est toujours aussi belle ; les vents dénudent son corps, les souffles en face font palpiter sa robe et, légère, la brise lui pousse les cheveux en arrière. La beauté grandit dans la fuite. Le jeune dieu ne supporte plus de se perdre en douceurs et, comme le lui conseille l’Amour, d’un pas déchaîné il la suit à la trace. Comme le chien de Gaule sur une plaine libre voit un lièvre, à toutes jambes l’un cherche la proie et l’autre le salut ; l’un semblable à qui croque déjà, déjà espère tenir et serre les traces en tendant le museau, l’autre ne sait pas s’il est pris, aux morsures s’arrache et laisse la gueule qui l’accrochait. Ainsi le dieu et la fille : lui mû par l’espoir, elle par la peur. Il la poursuit encore, aidé des ailes d’Amour, il est plus rapide, refuse le repos, au dos de la fugitive touche, souffle sur la chevelure couvrant les épaules. La fille n’a plus de forces, toute pâle et vaincue de fatigue après la fuite vive, elle regarde les eaux du Pénée : « Aide-moi, mon père, dit-elle, si vous les fleuves, vous avez ce pouvoir. J’ai trop plu, perds ma figure, change-la5. » La prière à peine finie, une lourde torpeur envahit les bras, le sein doux est cerclé de fine peau, en feuillages les cheveux, en branches les bras poussent, le pied jadis si vif colle aux racines figées, la tête est la cime, une splendeur demeure en elle, Phœbus l’aime encore et, la main posée sur le tronc, il sent son cœur palpiter sous l’écorce nouvelle et embrasse les branches comme des bras ; de toute sa force il donne des baisers au bois et le bois renvoie les baisers. Alors : « Puisque tu ne peux pas être ma femme tu seras mon arbre, dit-il. Ma chevelure te portera toujours, laurier, ma cithare te portera, mon carquois te portera. Tu assisteras les chefs latins quand à leur triomphe une voix joyeuse chantera, quand le Capitole contemplera les longs cortèges. Aux portes d’Auguste, gardienne très fidèle, devant le seuil, tu te tiendras et protégeras le chêne du milieu. Comme ma tête, jamais rasée, reste jeune, toi aussi tu porteras l’honneur perpétuel de ton feuillage. » Paéan a fini. Le laurier, de ses branches juste formées, s’incline ; il a semblé qu’une tête s’agitait, à la cime. Io Il est un petit bois en Haémonie fermé de chaque côté par une forêt abrupte ; on l’appelle Tempé. Au milieu, le Pénée, qui sourd du pied du Pinde, se roule dans des eaux d’écume. D’un lourd remous il assemble les nuées qui agitent des fumées légères, du haut des forêts il fait tomber la pluie et fatigue de bruit son entourage et au-delà. Ici la maison, le siège, le repaire secret du grand fleuve. Ici, assis dans une grotte faite de pierres, aux eaux et aux nymphes qui habitent les eaux, il donnait des lois. Les fleuves se retrouvent ici, d’abord ceux du pays, qui ne savent s’ils doivent féliciter ou consoler un père, le Sperchios aux peupliers, l’infatigable Énipée, le vieil Éridan, le doux Amphrysos et Aéas et bientôt d’autres fleuves qui, où les emporte l’élan, conduisent les eaux épuisées par l’errance à la mer. Inachus seul est absent ; retiré au fond de son antre, il grossit de ses larmes les eaux. Triste de sa fille Io, il la pleure comme perdue. Il ne sait si elle vit ou si elle est chez les mânes ; il ne la trouve nulle part, il la pense nulle part et dans son cœur craint le pire. Jupiter l’a vue, revenant de chez son père le fleuve et : « Ô fille digne de Jupiter, qui par ton lit rendras heureux je ne sais qui, viens, dit-il, aux ombres des grands bois (et il lui montrait les ombres des bois), tant que le soleil brûle, tout en haut, au milieu de sa ronde. Si tu as peur de rentrer seule aux cachettes des bêtes féroces, protégée d’un dieu tu descendras dans le secret des bois. Et ce n’est pas n’importe quel dieu, c’est moi, qui tiens dans ma main les grands sceptres du ciel, c’est moi, qui envoie les foudres vagabondes. Ne fuis pas. » Elle fuyait. Déjà elle a quitté les pâturages de Lerne et les champs semés d’arbres du Lyrcée quand le dieu, d’un large brouillard, cache les terres et la tient et lui ôte fuite et pudeur. Cependant Junon inspecte les campagnes. Que des nuages volants fassent un visage de nuit au jour brillant l’étonne : les nuages ne viennent pas du fleuve, elle le voit, ni ne sont renvoyés par la terre humide. Son époux, où est-il ? Elle cherche partout, car les tromperies de son mari, si souvent pris sur le fait, elle les connaît. Après qu’elle ne l’a pas trouvé au ciel : « Ou je me trompe ou je suis trompée », dit-elle. Elle glisse du haut de l’Éther, se pose sur la terre et ordonne aux nuages de reculer. Jupiter avait deviné la venue de sa femme et en radieuse génisse avait changé la fille d’Inachus. En vache aussi elle était belle ; la fille de Saturne, à contrecœur, reconnaît l’éclat de la bête et fait tout pour savoir : de qui, d’où, de quel troupeau est-elle ? Elle feint de ne pas savoir la vérité. Jupiter ment : elle est engendrée de la terre. Il veut qu’on cesse d’en chercher l’auteur. La fille de Saturne la veut en cadeau. Que faire ? Cruel d’abandonner ses amours. Ne pas la donner est suspect. D’un côté la honte le conseille, de l’autre l’amour. La honte serait vaincue par l’amour mais, si à sa compagne de lit, à sa sœur, il refusait ce petit cadeau, la vache, on croirait que ce n’est pas une vache… La rivale est donnée, mais la déesse a encore peur, se méfie de Jupiter, s’inquiète d’une tromperie et finit par offrir la vache à Argus, fils d’Arestor. Argus Argus avait une tête ceinte de cent yeux. Deux par deux, à tour de rôle, les yeux prenaient du repos. Les autres veillaient et restaient à leur poste. Où qu’Argus se posât, il regardait Io. Devant les yeux, même de dos, il avait Io. De jour il la laisse paître. Quand le soleil est sous la terre profonde il l’enferme, cercle de chaînes ce pauvre cou. De feuillage d’arbres et d’herbe amère elle se nourrit, comme oreiller elle a la terre, pas toujours du gazon, la malheureuse, et elle boit des eaux fangeuses. Quand elle veut, suppliante, tendre les bras vers Argus, elle n’a pas de bras à tendre vers Argus. Elle essaie de se plaindre, sort de sa bouche des mugissements et s’effraie des sons – sa propre voix la terrorise. Elle vient aux rives où elle avait habitude de jouer, les rives d’Inachus, et regarde dans l’eau ses cornes nouvelles : elle s’effraie, étrangère à elle-même, recule, fuit. Les naïades ne la reconnaissent pas, Inachus ne la reconnaît pas, qui est-elle ? Mais elle suit son père et elle suit ses sœurs et se laisse toucher et s’offre à ceux qui l’admirent. Le vieil Inachus lui tend les herbes qu’il a cueillies, elle lèche la main du père, donne des baisers dans sa paume, ne retient pas ses larmes ; si les mots suivaient, elle supplierait, à l’aide !, dirait son nom et son histoire. Les lettres, au lieu des mots, qu’elle trace du pied dans la poussière, révèlent avec tristesse son corps changé. « Que je suis malheureux ! » crie le père, Inachus, et aux cornes de sa fille gémissante, au cou de la génisse de neige, il s’accroche, « que je suis malheureux, répète-t-il, toi, cherchée par toutes les terres, tu es ma fille ? Je ne te trouvais pas, je t’ai trouvée : mon chagrin était plus léger avant. Tu te tais, à mes paroles tu n’en réponds aucune. Juste tu pousses, de ta profonde poitrine, des soupirs ; tu ne peux que ça, tu mugis à mes mots. Ignorant, je préparais ton lit, les torches nuptiales, j’avais en premier espoir un gendre ; en second, des petits-enfants. Dans un troupeau tu prendras un homme ; dans un troupeau, un fils. Mes grandes douleurs ne peuvent finir avec la mort : hélas je suis dieu, la porte du trépas, qui m’est fermée, croît en un temps sans limite mes chagrins. » Argus étoilé d’yeux repousse le pleureur, arrache au père la fille et dans divers pâturages la traîne. Il s’installe au plus haut de la cime d’une montagne et, de là, assis, guette de tous côtés. Le chef des dieux ne supporte plus les grands maux de Io. Il appelle son fils6, que l’étincelante Pléiade a fait naître, lui ordonne de faire mourir Argus. Un petit moment et les ailes à ses pieds, la baguette qui endort dans sa main puissante, le casque sur les cheveux, le fils de Jupiter prépare tout, du palais du père il saute sur la terre. Là, il enlève le casque et pose les plumes. Il garde la baguette. Il conduit, comme un berger, à travers les campagnes écartées, les chèvres qu’il amène et chante sur des roseaux joints. Le gardien de Junon, pris par la voix nouvelle et par l’art : « Qui que tu sois, tu peux t’asseoir avec moi sur ce rocher », dit Argus, et : « Pour le troupeau l’herbe n’est meilleure nulle part ailleurs ; vois cette ombre, bonne aux bergers. » Le petit-fils d’Atlas s’assied, parle beaucoup, tient sous le discours le jour qui fuit, fait chanter les roseaux attachés pour vaincre les yeux qui veillent. L’autre se bat contre les sommeils mollissants. Si la torpeur prend quelques-uns de ses yeux, d’autres restent éveillés. Il demande (la flûte vient d’être inventée) comment elle a été inventée. Alors le dieu : « Dans les montagnes glacées d’Arcadie, plus célèbre que les hamadryades de Nonacris, il y avait, jadis, une naïade. Les nymphes l’appelaient Syrinx. Plus d’une fois elle a évité les satyres qui la suivaient et tout ce qu’il y a comme dieux dans la forêt ombrageuse et la campagne féconde. Avec ardeur, dans sa virginité, elle adorait la déesse Ortygie7. Elle portait une ceinture à la mode de Diane, on aurait pu s’y tromper, la croire fille de Latone, si elle n’avait pas eu un arc de corne au lieu d’un arc d’or. On s’y trompait quand même. Elle descend la colline du Lyrcée, Pan la voit, il a la tête ceinte du pin pointu et il lui dit… » Il restait à Mercure à dire la suite, que la nymphe, après prières vaines, fuit aux lieux écartés, qu’au fleuve tranquille du Ladon sablonneux la voici arrivée. Devant les flots qui empêchent sa course, elle prie que ses sœurs d’eau la changent ; Pan, qui pense qu’il presse contre lui Syrinx, tient, au lieu de la nymphe, le roseau des marais. Il souffle dedans, les vents qui vibrent dans la flûte font un son léger, semblable à une plainte ; le dieu est pris par l’art nouveau de cette voix, par son charme : « Ce sera notre conversation à toi et moi », dit-il ; il joint par de la cire des roseaux de tailles différentes ; il garde le nom de la fille. Le dieu du Cyllène allait dire cela, mais il voit que tous les yeux sont tombés, que les paupières sont couvertes de sommeil. Il se tait tout de suite et confirme la torpeur en caressant, de sa baguette de soin, les paupières lourdes. Sans attendre, de son épée courbe, il blesse Argus l’endormi près du cou, à la tête. Tête qu’il jette, ensanglantée, du haut du rocher : elle tache de sang la falaise escarpée. Argus, tu es par terre : ce que tu avais de lumière dans tes lumières est éteint ; la nuit occupe tes cent yeux. La fille de Saturne les ramasse, sur les ailes de son oiseau les pose ; elle garnit la queue des pierres étoilées. La déesse enflammée ne fait pas attendre sa colère, elle pose l’horrible Érinye devant les yeux et l’esprit de sa rivale argienne, dans son cœur elle place d’aveugles aiguillons, l’effraie, la fait fuir par toute la terre. Tu devais être, Nil, le bout de son immense peine. Lorsqu’elle te touche, les genoux posés au bord de la rive, elle se prosterne et, haute, cou renversé, lève ce qu’elle peut vers les étoiles – la tête. Dans un gémissement, des larmes, un mugissement de chagrin, elle se plaint, croit-on, à Jupiter ; elle prie pour la fin de ses maux. Lui, il entoure de ses bras le cou de son épouse et lui demande la fin du châtiment. « N’aie plus peur, elle ne sera plus pour toi, dit-il, cause de chagrin, celle-là. » Il ordonne que les marais du Styx l’entendent. La déesse s’adoucit, l’autre reprend son premier visage, devient ce qu’elle était ; le poil fuit le corps, les cornes diminuent, le rond de l’œil se serre, la bouche se contracte, les épaules et les mains reviennent, le grand ongle, séparé en cinq, s’évanouit, de la vache il ne reste rien, mais la blancheur de sa beauté la voici. La nymphe, contente de se servir de ses deux pieds, se dresse, craint de parler de peur de mugir en génisse ; elle essaie timidement la parole jusque-là perdue. Phaéthon et Épaphus Maintenant une foule très nombreuse, vêtue de lin8, la célèbre, maintenant elle a un fils, né de la semence du grand Jupiter, dit-on, Épaphus : dans les villes voisines, près de ceux de sa mère, il possède des temples. De même esprit et de même âge que lui : Phaéthon, né du Soleil. Un jour celui-ci parlait beaucoup, se vantait, tout orgueilleux de son père Phœbus. Épaphus ne supporte plus : « Ta mère, tu la crois sur parole, espèce de fou, gonflé de l’image d’un faux père ! » Phaéthon rougit, réprime la colère sous la honte, puis raconte à Clymène, sa mère, l’insulte d’Épaphus. « Ça fait mal, ma mère, mais moi, libre, moi, fougueux, je me suis tu. J’ai trop honte : on a pu me traiter, je n’ai pas pu nier. Si je suis vraiment de souche céleste, donne-moi la marque de ma naissance, attache-moi au ciel. » Il dit. Il enlace le cou de sa mère, et, sur sa tête, sur celle de Mérops, sur les noces de ses sœurs, la supplie de lui offrir le signe d’un véritable père. On ne sait si ce sont les prières de Phaéthon ou la colère de l’accusation portée contre elle qui émeuvent le plus Clymène : au ciel elle tend les bras et regarde la lumière du soleil : « Par cet astre aux rayons qui tremblent merveilleusement, par lui qui nous entend et nous voit, enfant, je te le jure, de lui que tu regardes, de lui qui tempère le monde, le Soleil, tu es fils. Si je dis des mensonges, qu’il m’empêche de voir ; que cette lumière dans mes yeux soit la dernière. Ce n’est pas un gros effort de connaître le foyer de ton père. La maison d’où il se lève est voisine de la nôtre. Si tu le veux, va, apprends par toi-même. » Il s’élance aussitôt, joyeux des paroles de sa mère, Phaéthon ; en pensée il possède le ciel. Par les terres d’Éthiopie, par celles de l’Inde, posées sous les feux de l’astre, il passe et il arrive, infatigable, au lieu d’origine de son père.