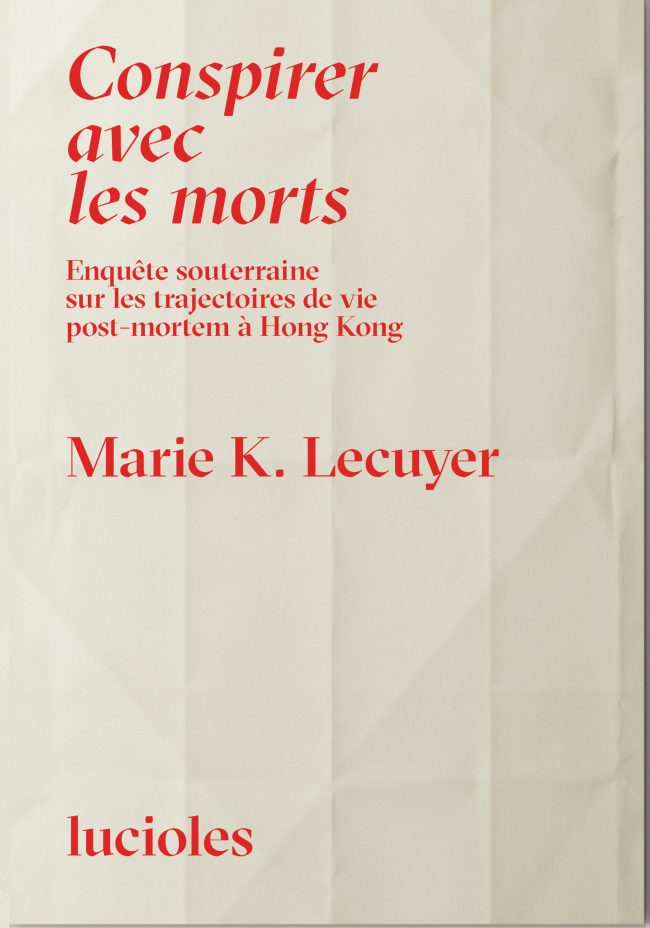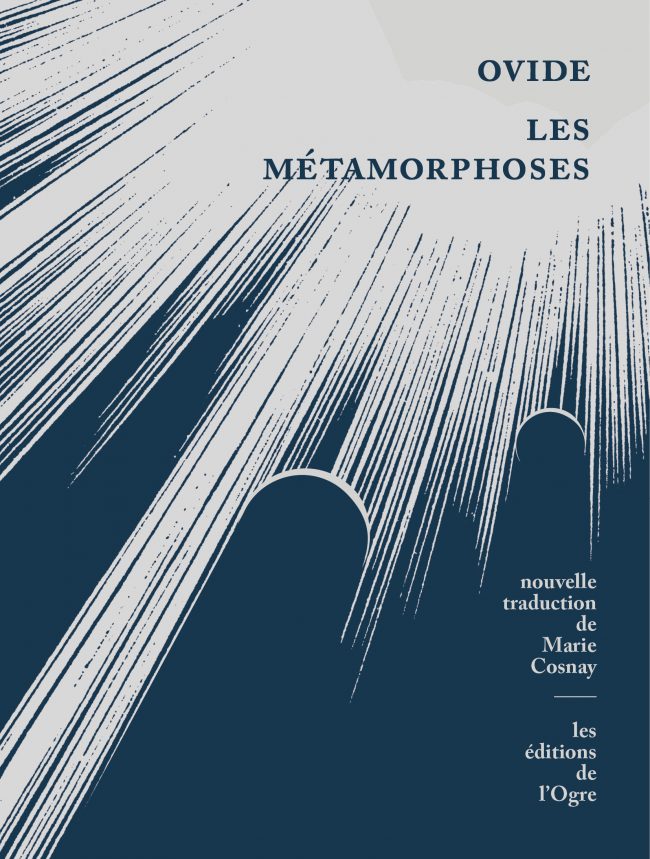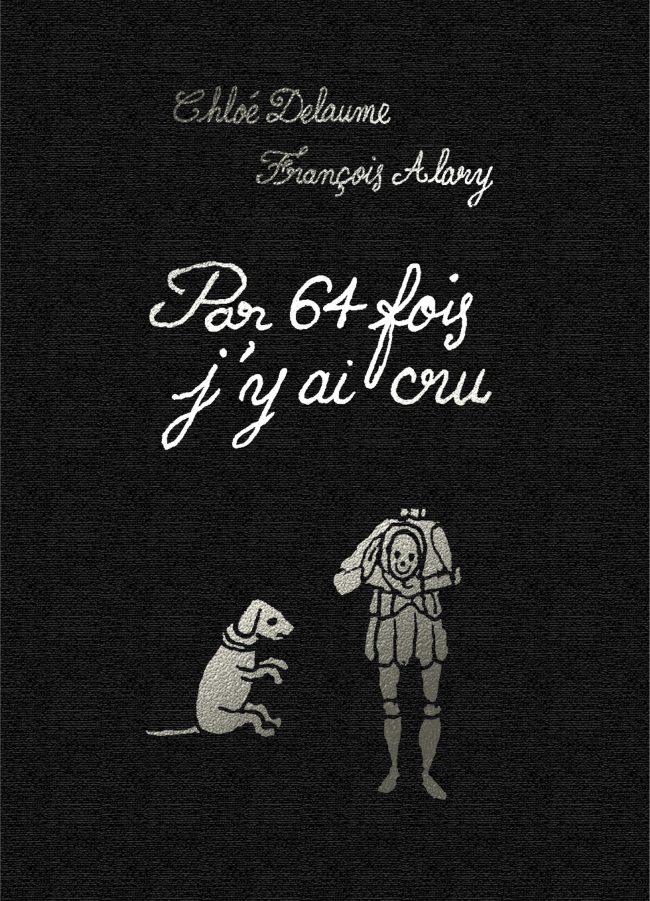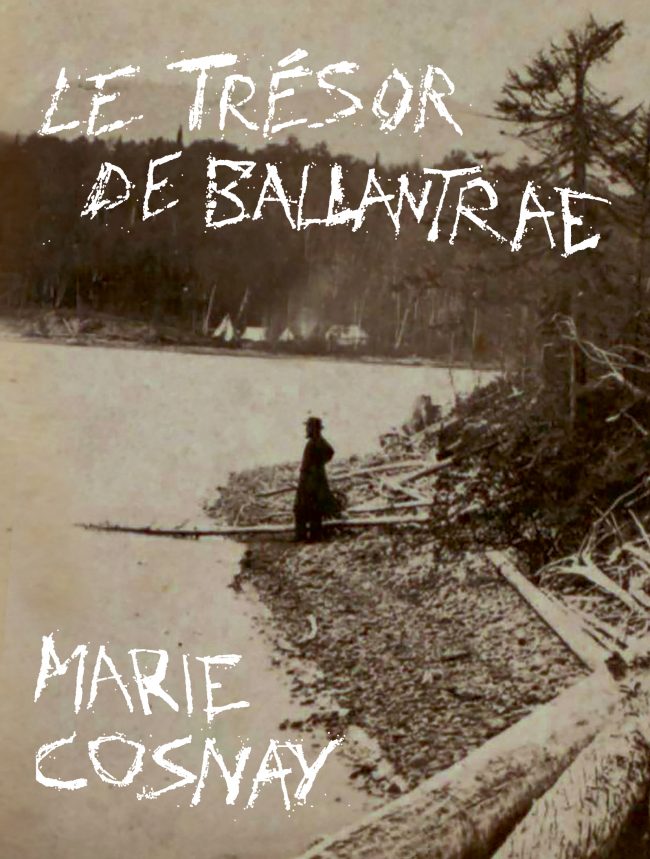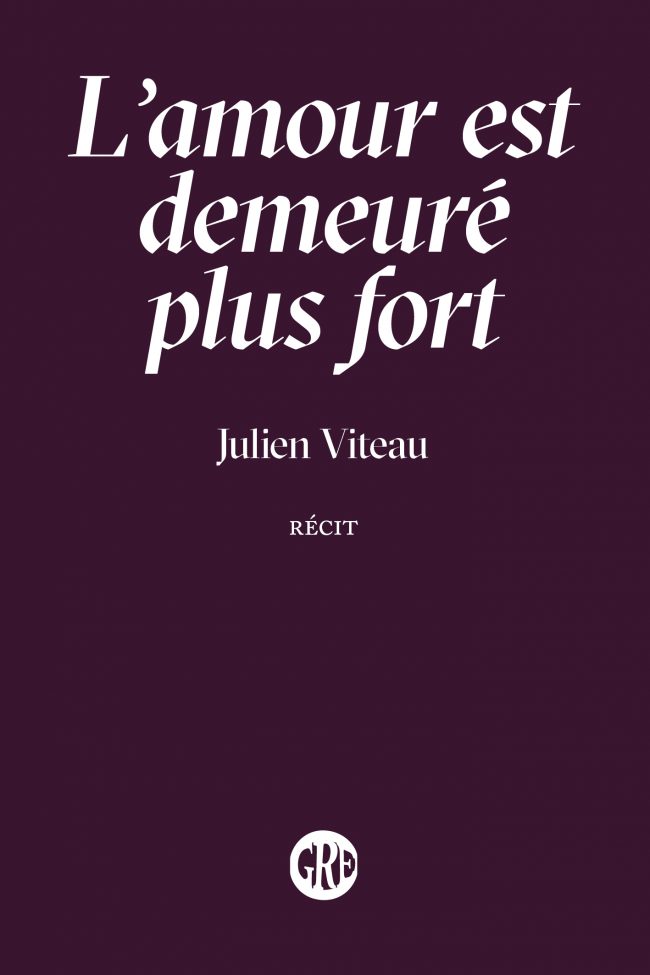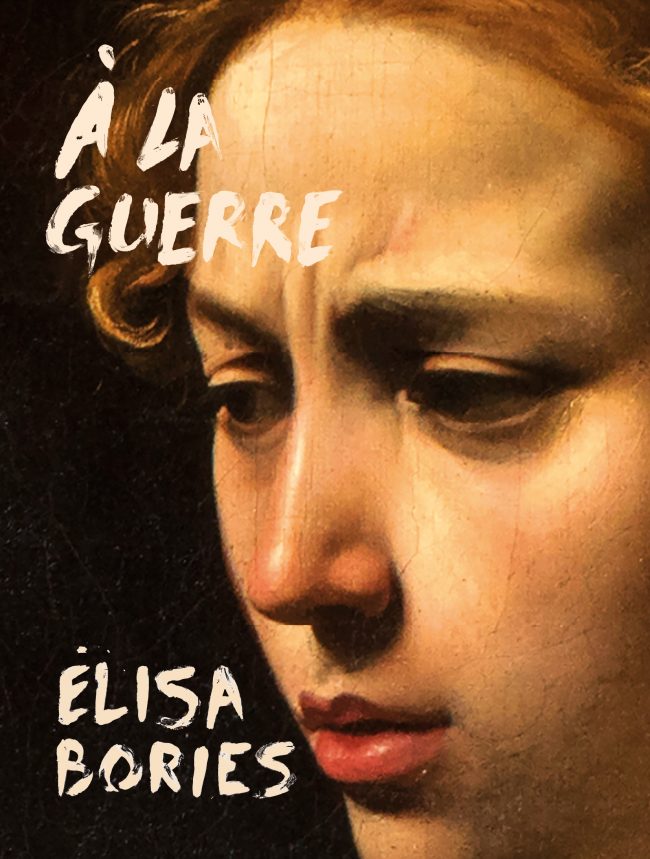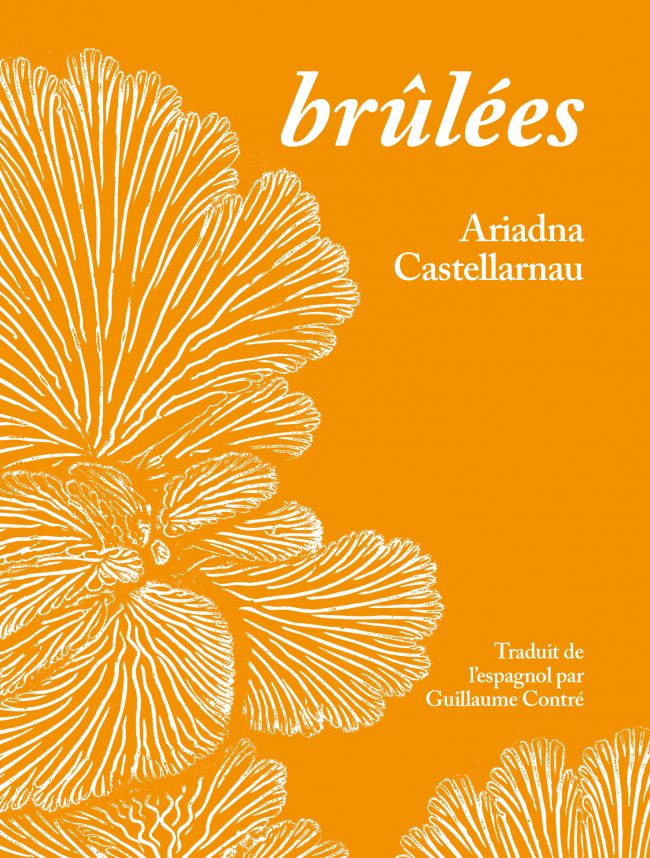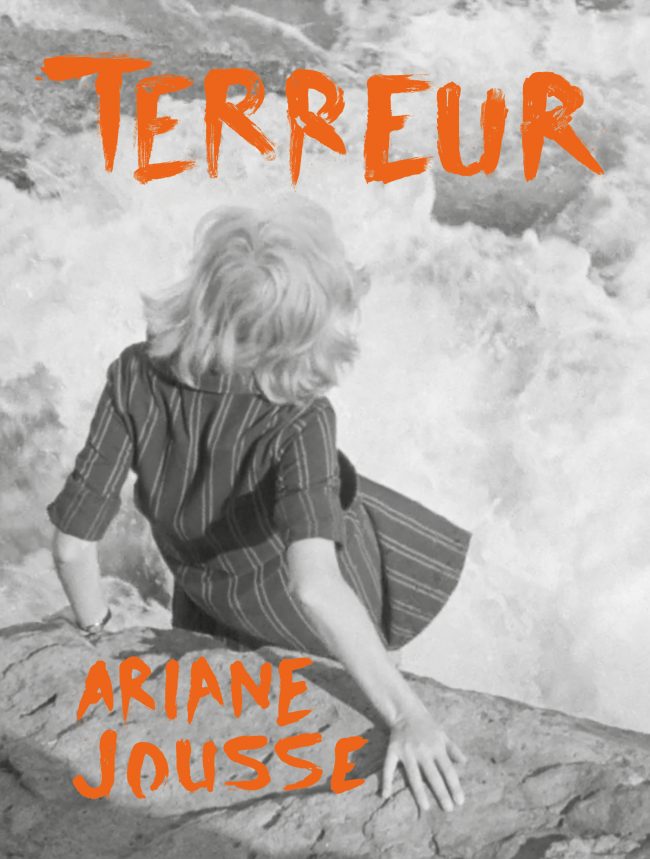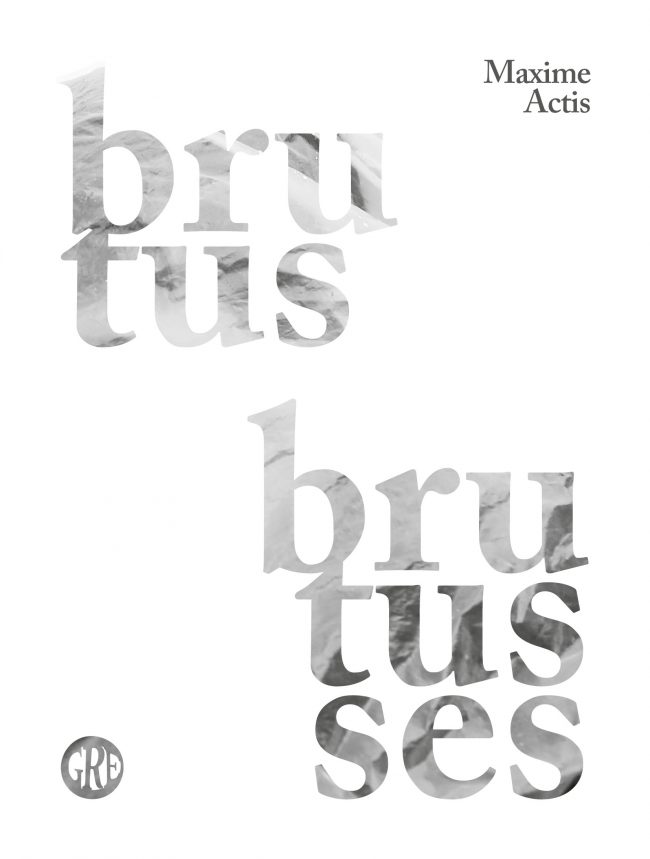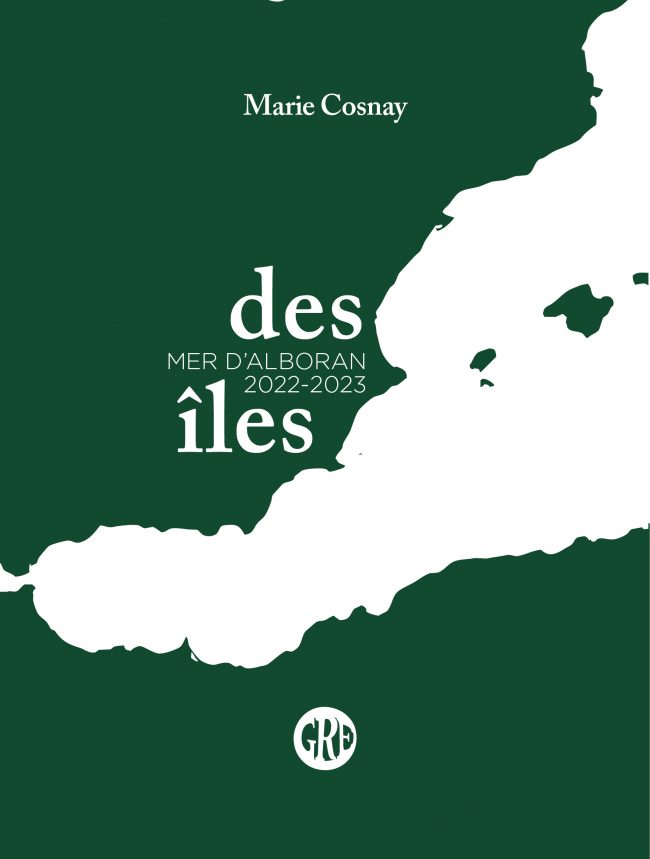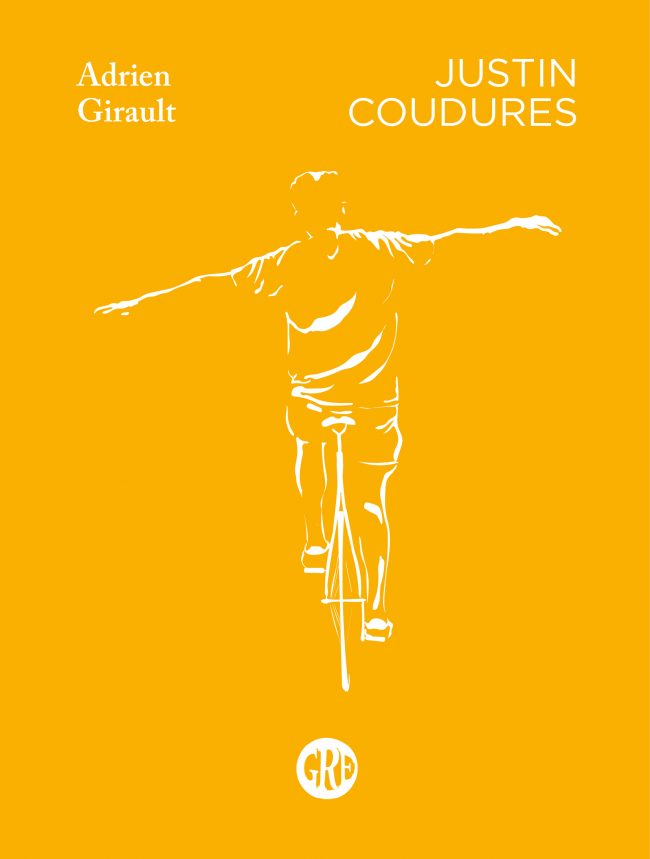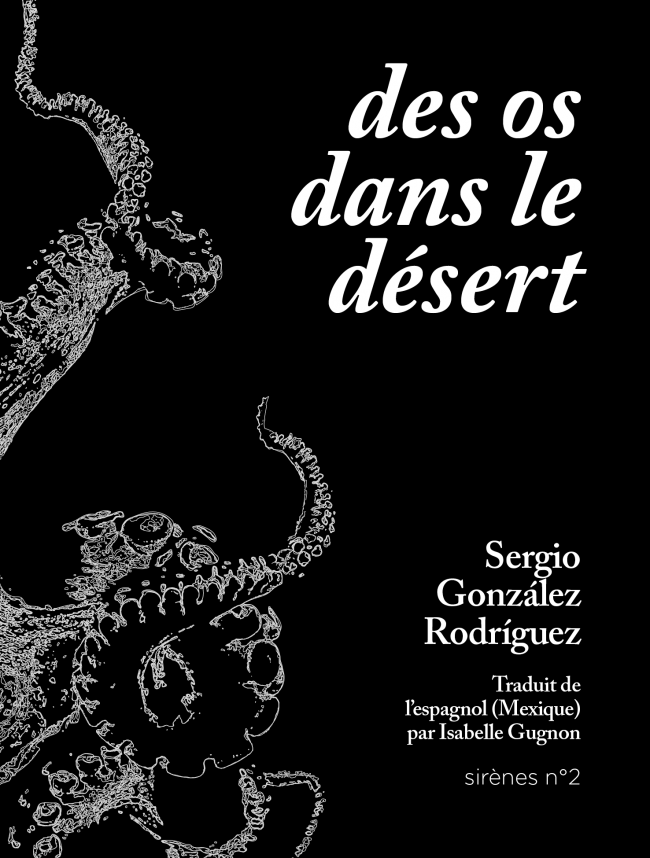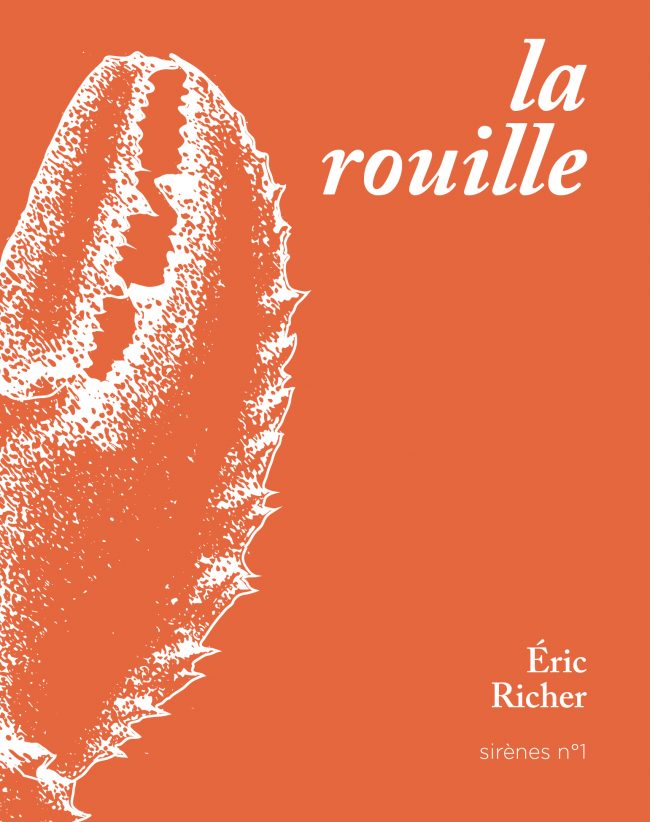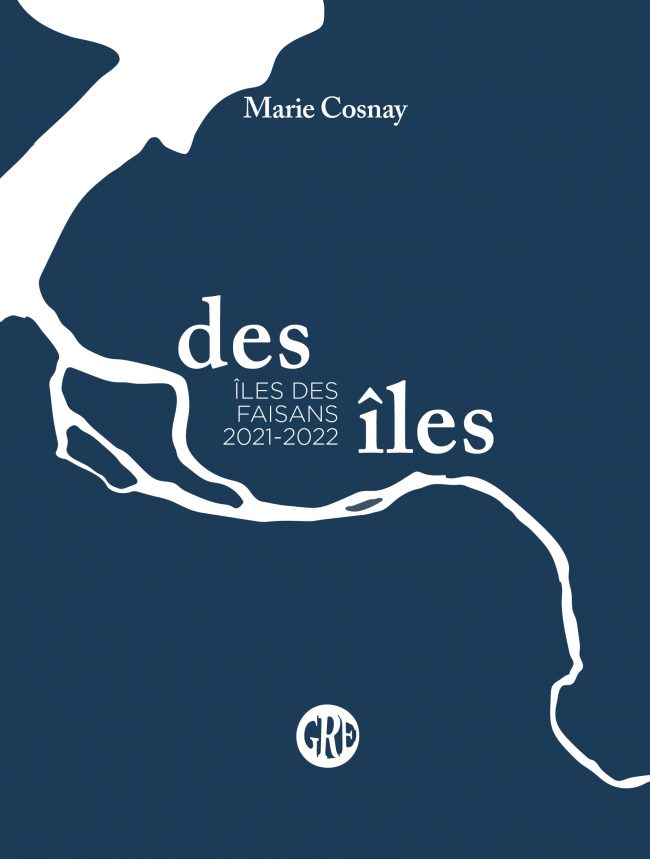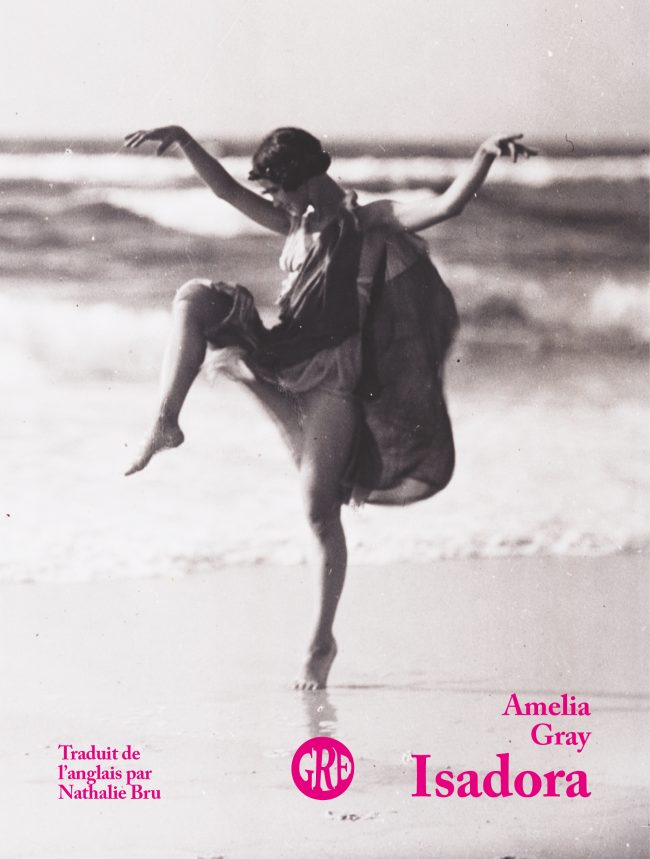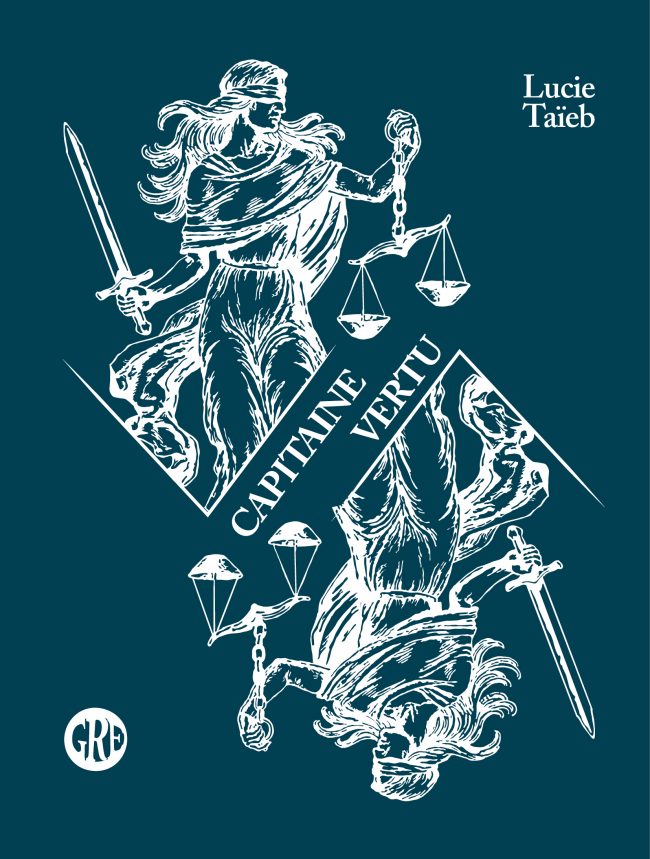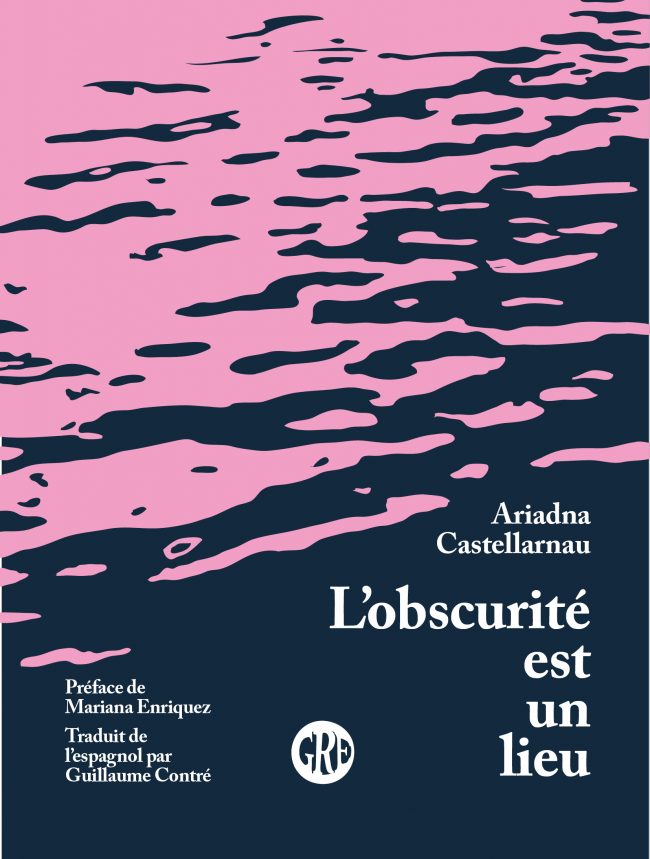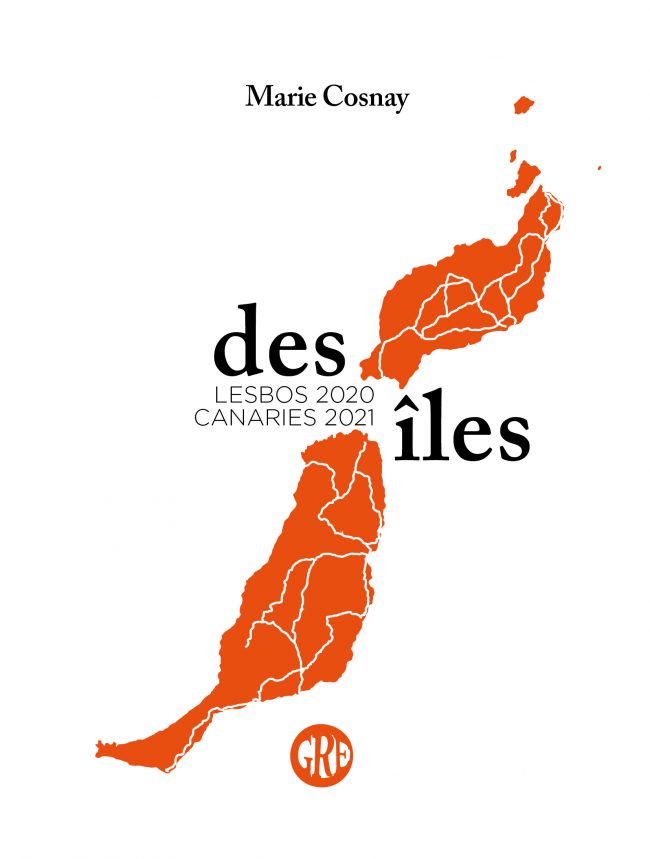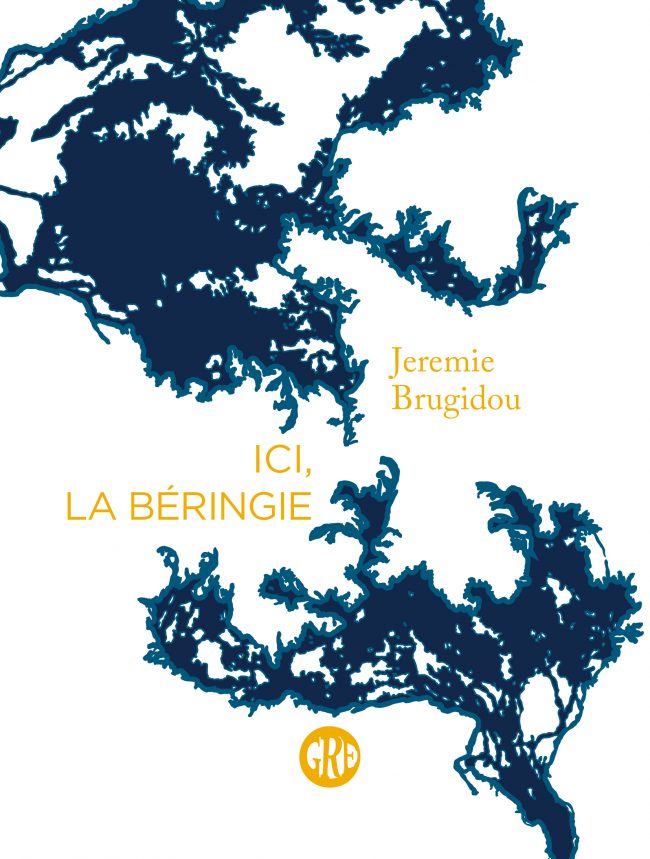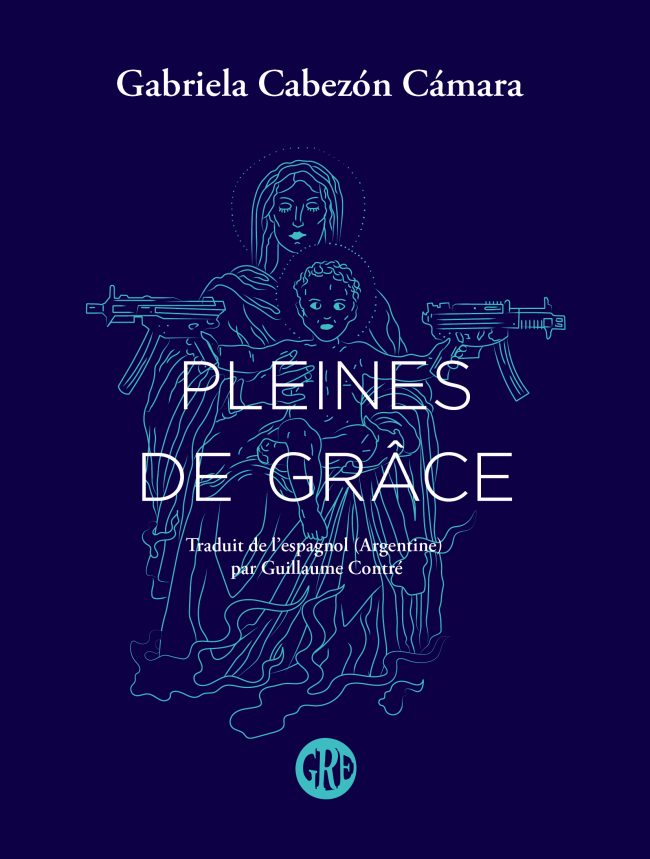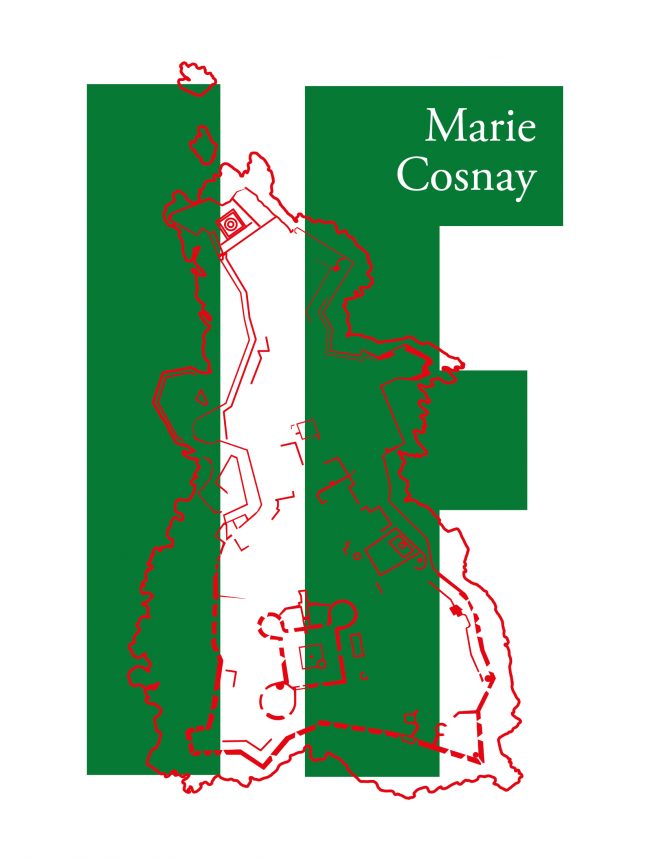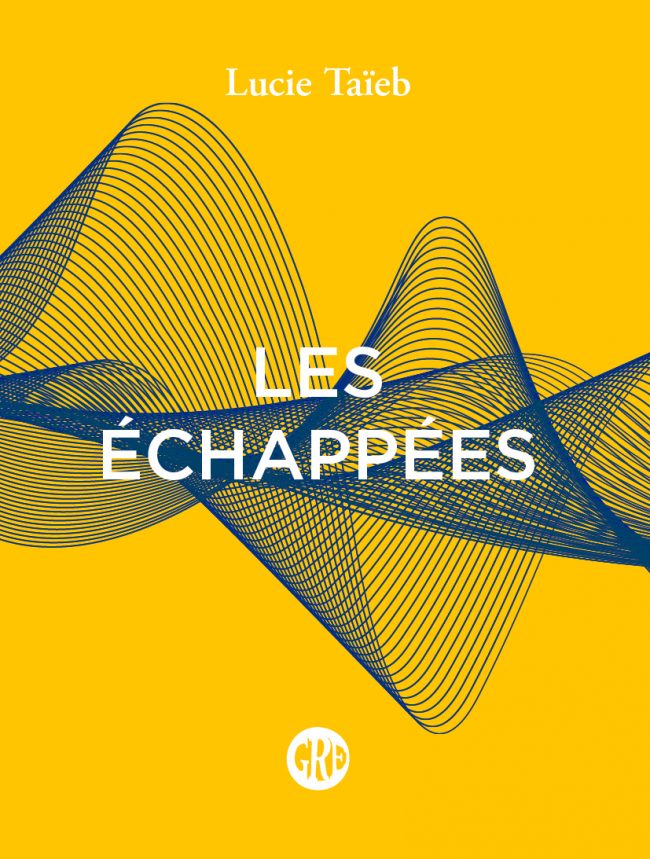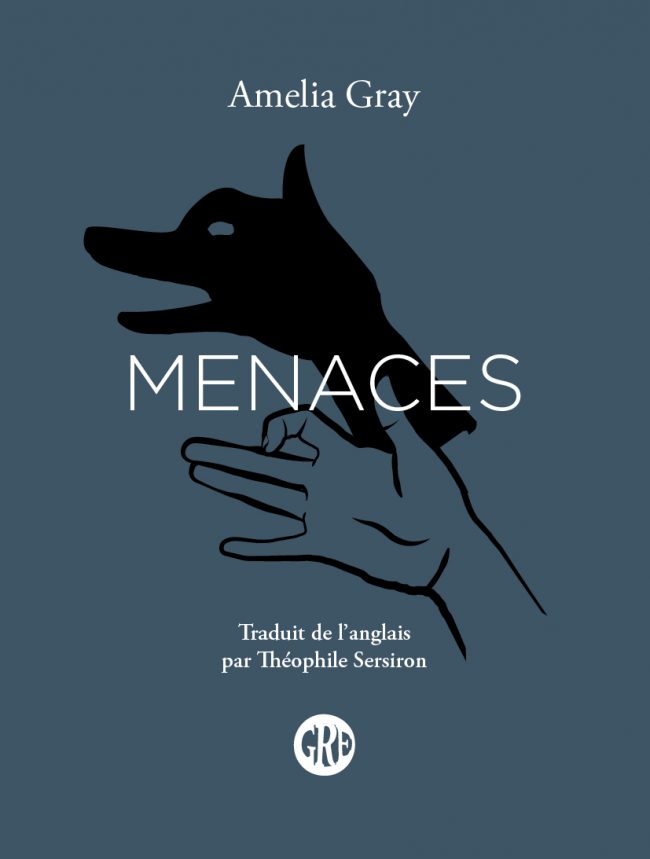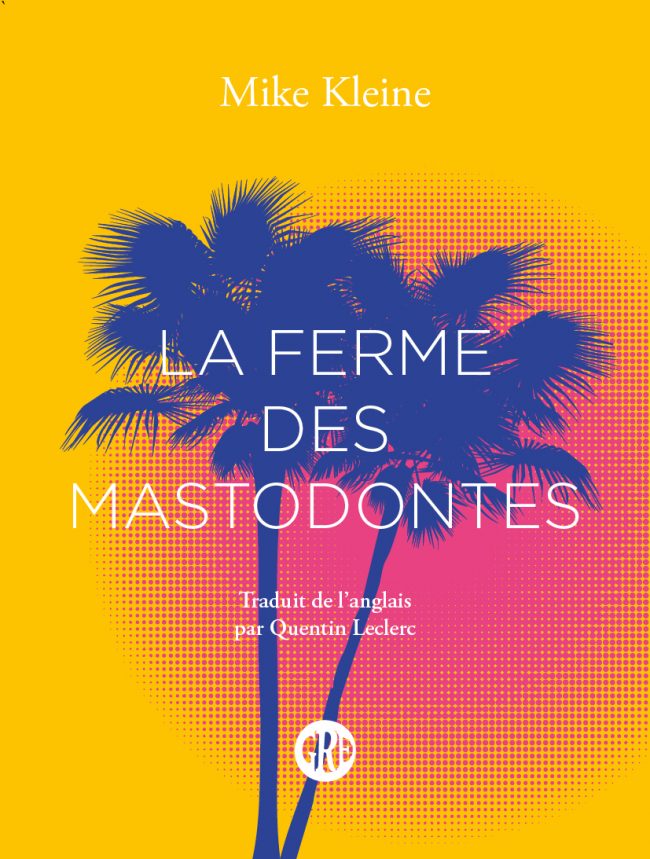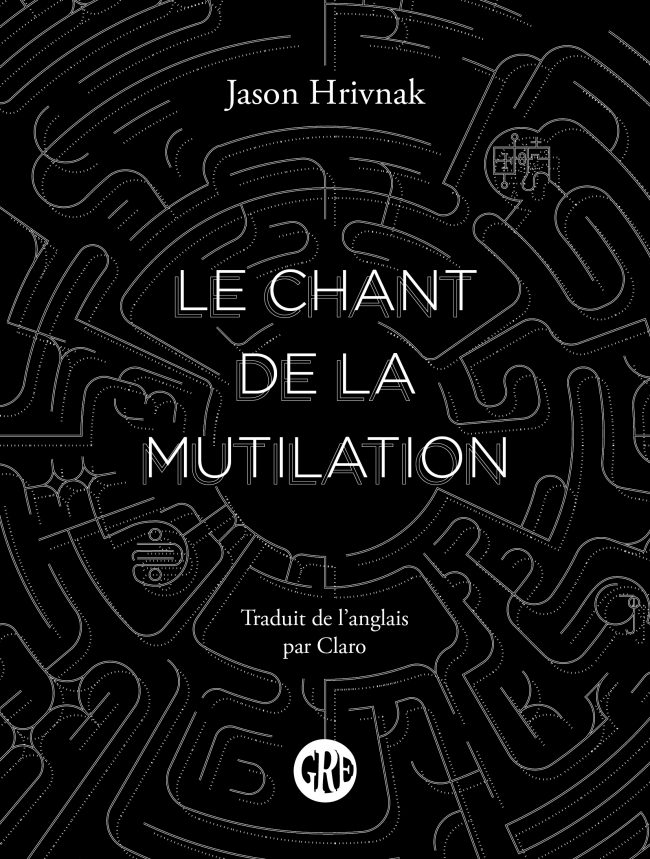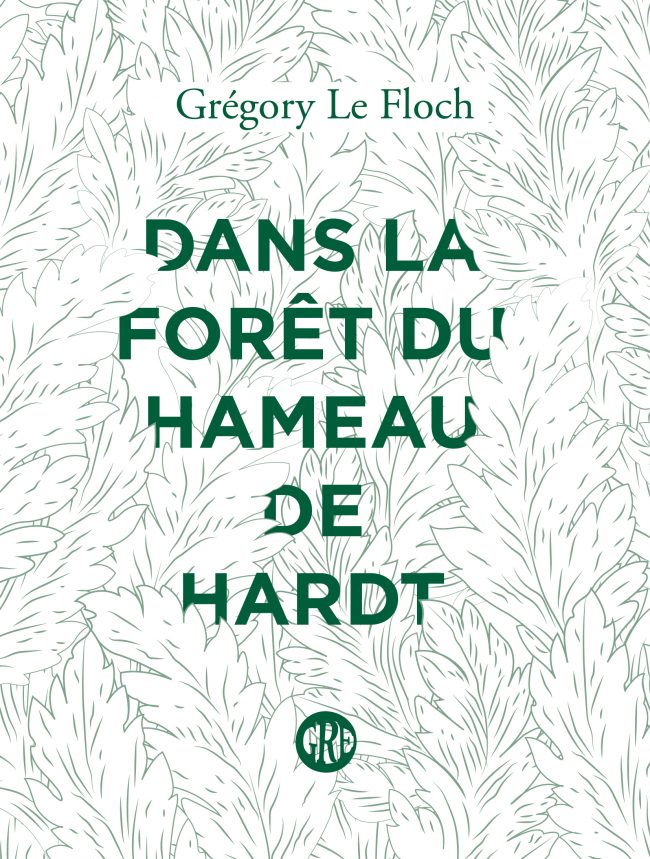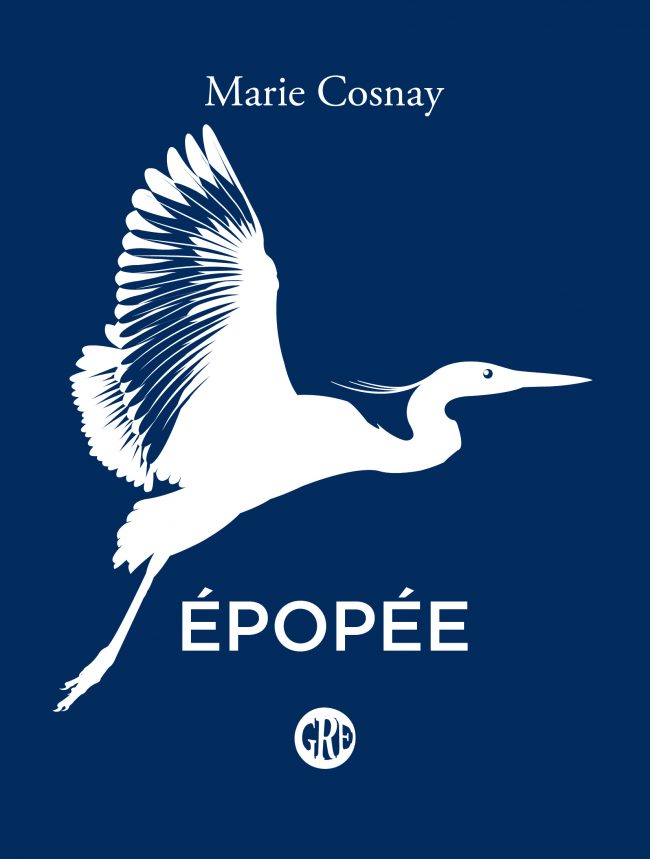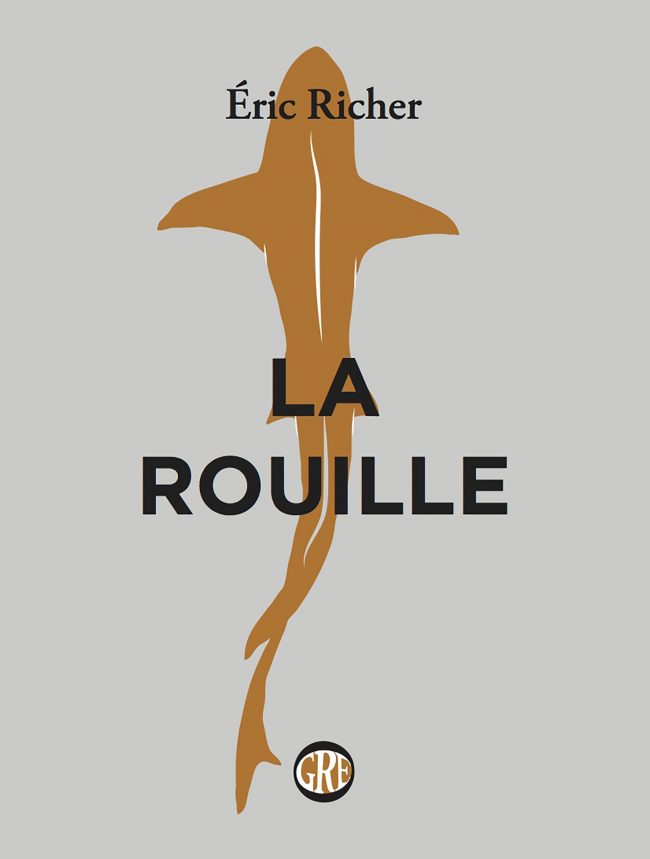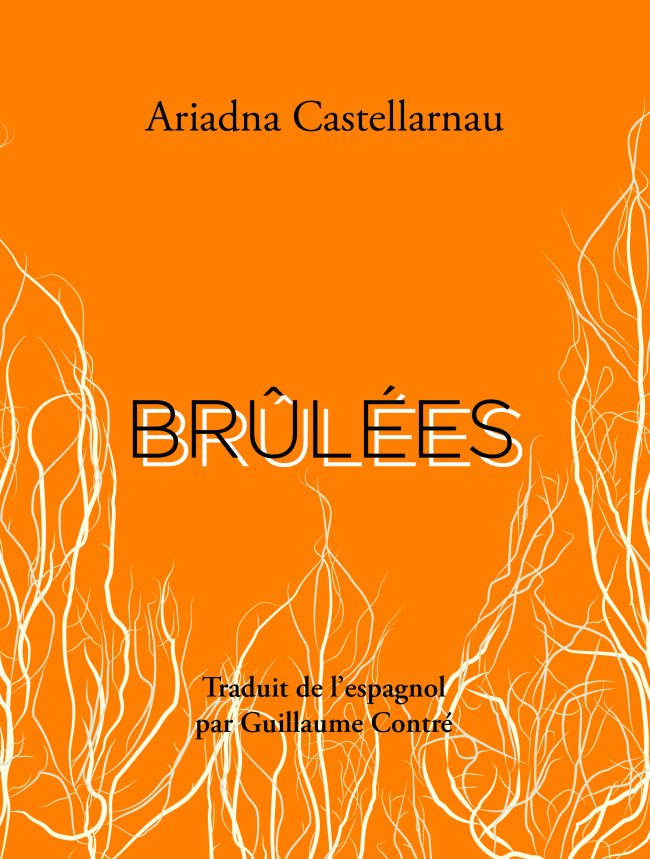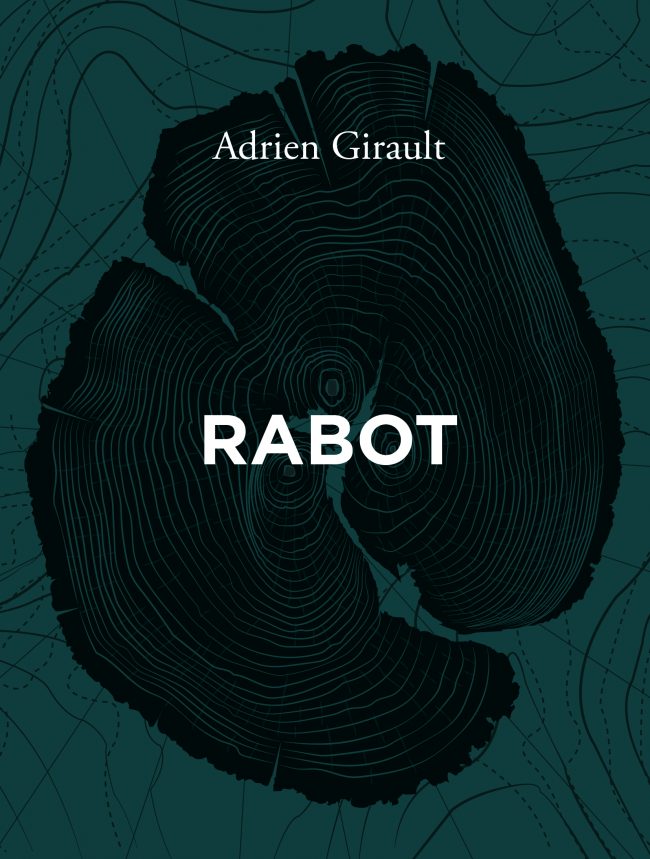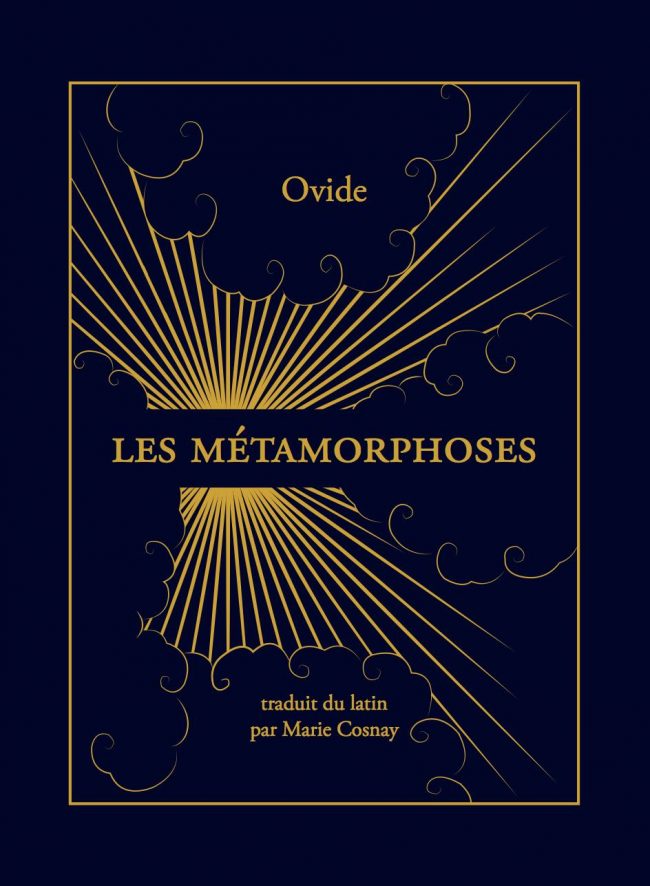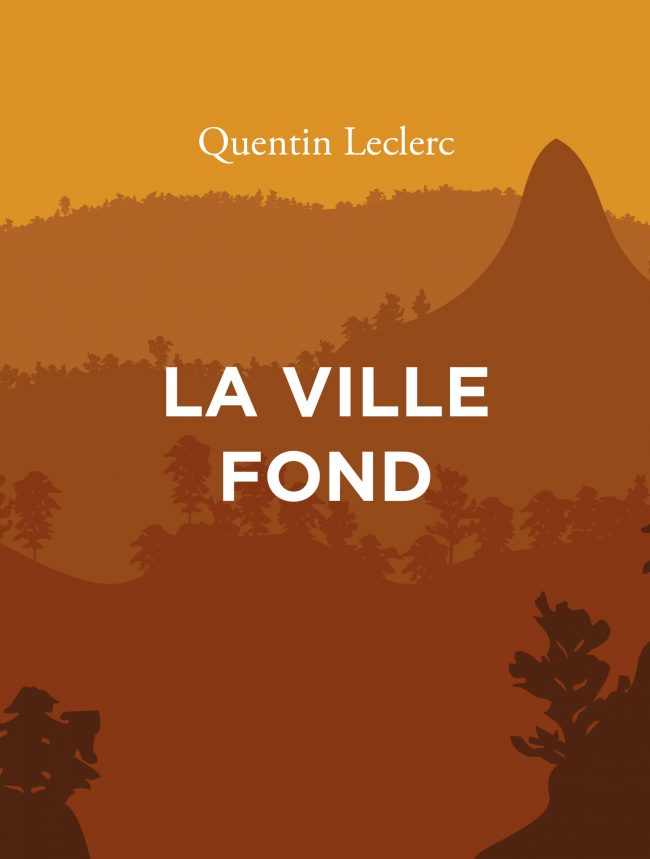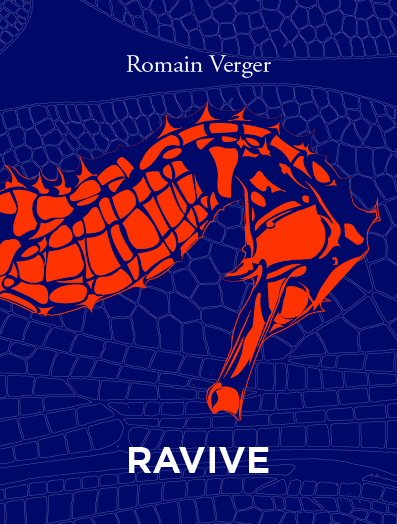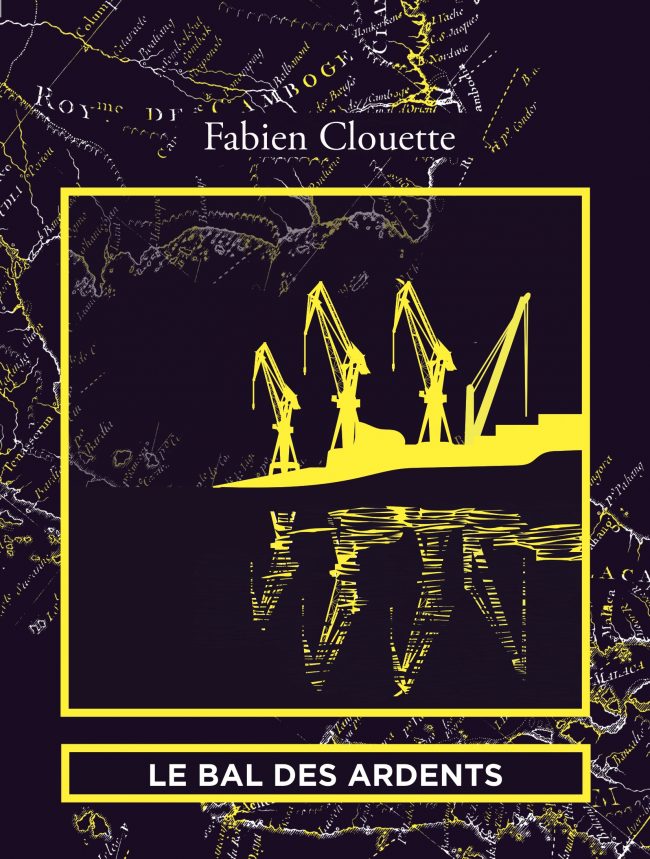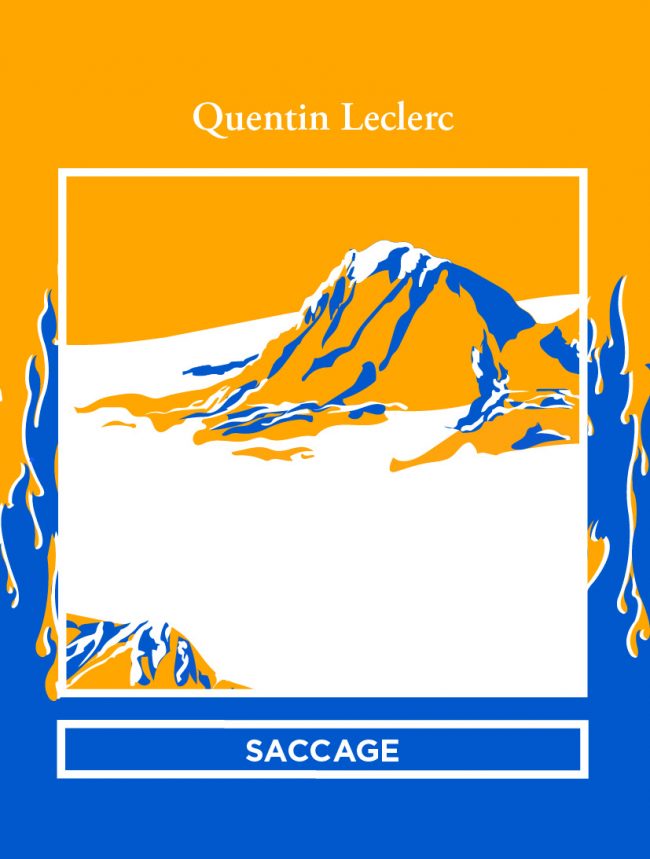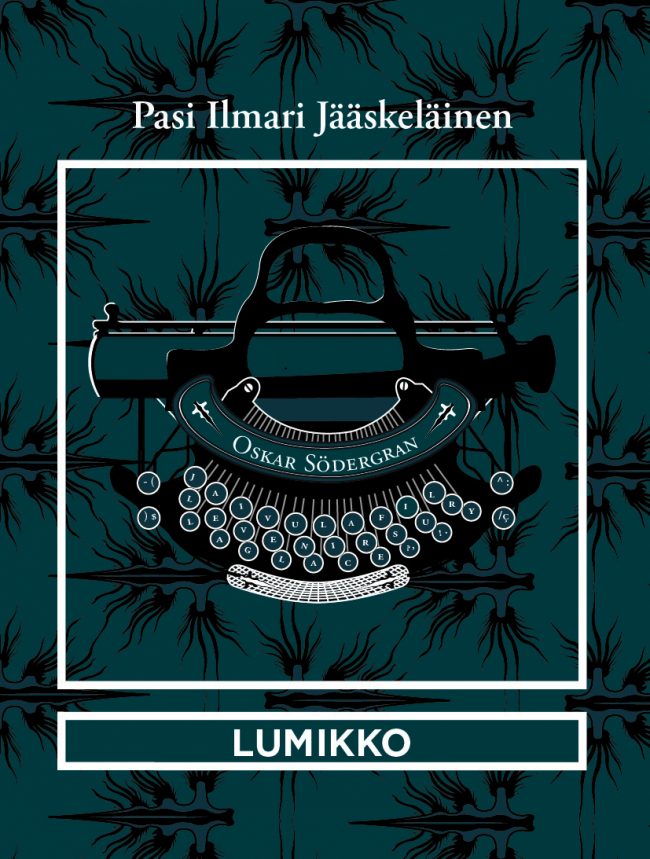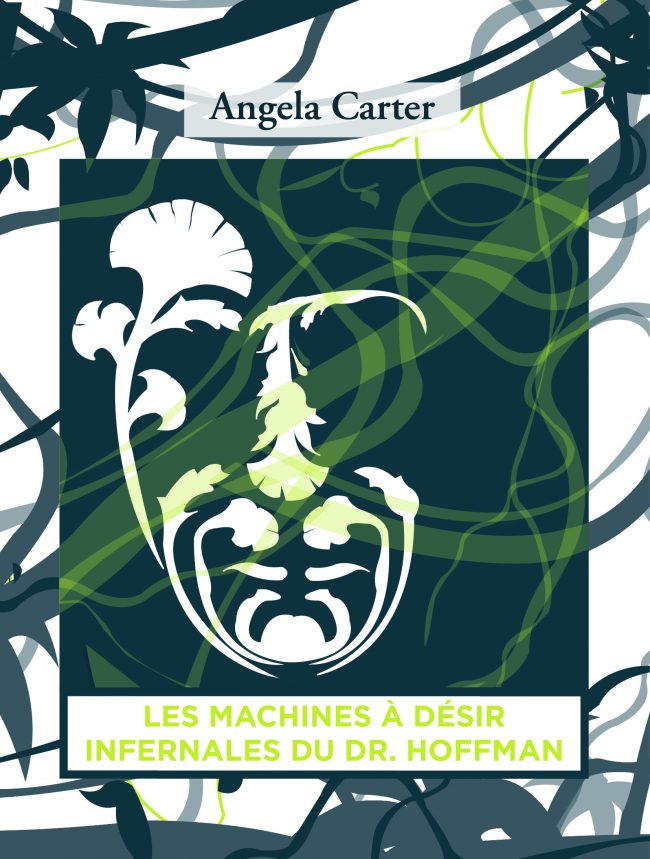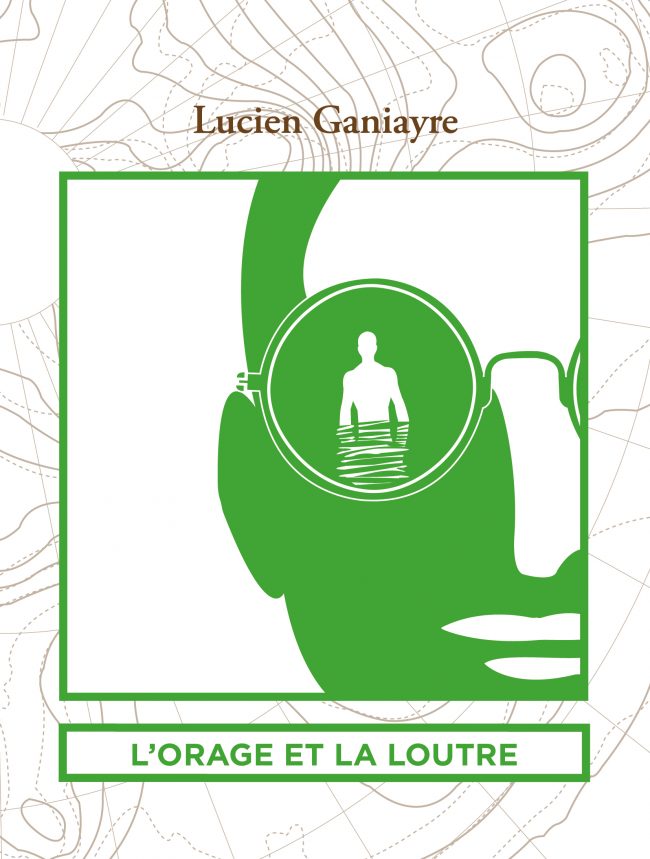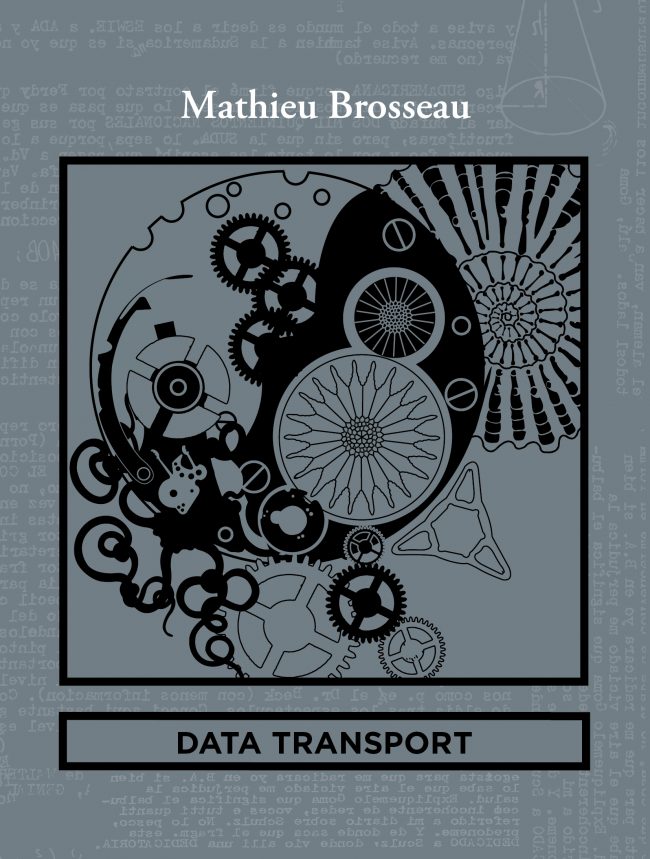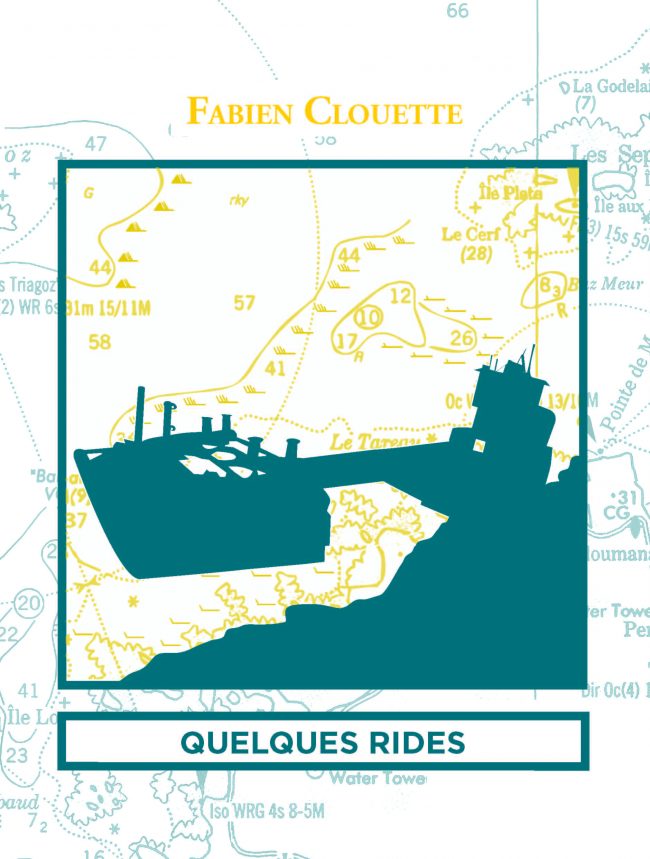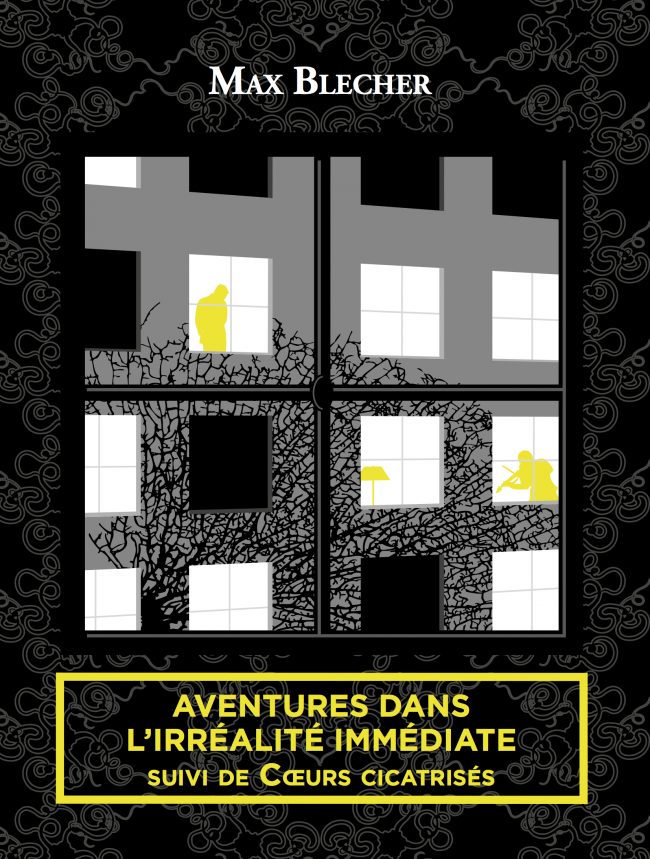Elle entend la sirène de la voiture de police. L’ambulance. Ziad ne répond pas. Une petite fille habillée de rose et de rouge s’approche. Dimanche après-midi, Zelda rate la manif des filles de Belleville. Sa colère prend, peu à peu mais sûrement, Ziad pour cible, parce qu’il ne répond pas.
Les filles ne manifestent pas, en fait. Elles bossent à l’écart. Quelqu’un dit : les macs sont pas loin. Sur l’estrade, les prises de parole se succèdent, c’est la même violence, dit une femme joliment voilée : m’obliger à ôter mon voile à l’université et forcer quelqu’un à le porter.
Que nos corps nous appartiennent.
Féministes voilées non voilées.
Imperméable beige, de petite taille, cravate nouée de travers, un homme s’approche d’une grande femme noire qui porte un écriteau revendiquant le droit des trans. L’homme dit qu’il est arménien.
Les Arméniens avec nous, crie une femme qui ne fait que passer.
Les Arméniens.
On scande un moment : les Arméniens.
Le monsieur rit.
Les voitures de police hurlent. C’est le semi-marathon de Paris et le premier soleil de l’année. Zelda a beaucoup attendu. Il y a un petit mouvement de foule mais pas grand-chose et les sirènes se taisent tout de suite. La police scientifique installe les rubans jaunes. Deux petites filles s’appuient au ruban qui gèle la scène. Robes de poupées et petites vestes à dentelles. Juste à côté, le manège tourne et la sono dans le ventre de la camionnette ouverte diffuse des musiques orientales. De la bouche du métro en face du périmètre qu’on définit sortent des femmes aux youyous victorieux. Il fait chaud. La manifestation commence. Personne ne s’intéresse à la scène de crime.
Le sourire est avenant. Tous les deux vont boire un Campari en terrasse. Le groupe s’est éloigné derrière le camion qui diffuse des discours et des musiques. Il reste du monde sur la place. Quelques curieux que Zelda à bout de nerfs a éloignés, avant la proposition de Campari. Qu’elle a saisie, balle au bond. Le mort attendra. Le portable vibre dans la poche de son jeans mais elle ne le regarde pas, par politesse.
L’homme dit qu’on ne pouvait pas savoir, ce matin, qu’on serait là, dans le soleil parisien, tous les deux. Il dit qu’on n’est jamais seul mais jamais avec les autres non plus. C’est quelque chose d’intermédiaire, c’est entre les deux, ce que tu es, dis, fais, c’est toujours par rapport à l’autre, à un autre. Quel qu’il soit, bon ou mauvais, bien ou mal : l’homme n’hésite pas avec le bien et le mal.
Oui, dit Zelda qui soudain le sait, elle a le temps.
C’est son deuxième Campari. Le téléphone vibre, maintenant ce n’est plus un effort de ne pas regarder, l’homme dit : sans vous déranger.
La première fois j’ai pleuré, la sangle me déchirait la peau, je me suis arrêté et j’ai pleuré. C’est un art d’être porteur de piano, dit l’homme, un art qui te casse le dos. Tu hisses les pianos dans les appartements de ceux qui ont l’amour du piano. Tout ce monde dans l’immeuble pour m’aider à pousser le cul du piano. La patronne m’a gardé – heureusement, parce que je venais d’arriver. En même temps c’est dur, porteur de piano. En même temps quatorze ans après je peux rien prouver de tout ce boulot et du mal de dos.
Mais hop, Vincennes, quand tu craques.
Rires, rires.
J’espère que t’es pas flic.
Zelda fait un clin d’œil.
Remarque il y a flic et flic, il y a les flics qui ont pitié. De temps en temps, petite pause au centre de Vincennes, ça tombe toujours quand je suis fatigué, c’est pas si mal quand t’es fatigué. Et puis tu vas pas mourir de pas manger : c’est pas vrai ? Rien que les poubelles. Regarde-moi un peu, tu dirais que je manque ? Il y a les poubelles. Les poubelles et les associations. Même si tu penses à tes trucs, rien qu’à tes trucs à toi, on est là. Ce que tu es maintenant, ça dépend de moi. Qu’on le veuille ou non. C’est le contrôle des flux, dommage, le contrôle des flux, parce que j’ai jamais revu ma mère, je lui envoyais les sous des pianos mais elle a dit : n’envoie plus rien mon fils, fais ta vie et on se reverra là-bas. Là-bas, en haut.
La journée file, 17 heures et la manif qui doit être arrivée à Pigalle. Le téléphone de Zelda vibre.
Moi c’est Mamadou, reprend le monsieur. Pas facile de s’appeler Mamadou, mais pour de bon, c’est le nom que ma mère m’a donné, c’est pas facile parce que les musulmans, parce qu’aujourd’hui les musulmans. Tu peux m’appeler Traoré.
Le ton du commissaire au téléphone est tranchant.
Pas de quoi rigoler ni se croire dimanche.
Le mort de tout à l’heure.
Je t’accompagne un brin. C’est un dimanche sans piano, dit Traoré.
Devant le manège, trois jours après le crime. Il y avait un stand de bonbons très colorés, il a changé de place. Une petite fille vêtue de rouge, son va-et-vient agaçant.
Zelda se rendait compte, au chevet du mort, que les prostituées chinoises n’étaient pas de la fête. Elle accueillait les policiers sur la scène de crime, aussitôt ils installaient les cordons de sécurité, elle échangeait un mot avec le légiste puis rencontrait Traoré.
Aujourd’hui, on la regarde quand on sort du métro. Elle s’accroupit là où était le mort. La victime : sexe masculin, trente-cinq / quarante ans, type asiatique.
Belleville, la fille rousse, inspectrice de police, accroupie sur le goudron du boulevard de la Villette, à la sortie du métro. Levant les yeux elle découvre une colonne, un éléphant, deux pattes, une femme gothique, lèvres peintes de noir, peau très blanche en contraste, cheveux jusqu’aux fesses. Dans ses bras, l’énorme femme tient un tout petit homme qu’elle embrasse goulûment. Entre chaque baiser, la femme reprend son souffle ; elle en profite pour regarder Zelda, jeune inspectrice de police accroupie sur le boulevard de la Villette, à deux pas de la bouche du métro, entre le manège et le restaurant Le Président. Qui furète le nez au sol pour trouver des traces.
Moi les histoires d’amour c’est mort : dès que je m’emballe je perds un usage, l’usage d’un bras, de mes jambes, de la parole. Il n’y a pas que les histoires d’amour pour vivre, d’ailleurs, tu vois, maintenant ça y est, jamais plus je regarde un mec ni une fille. Je suis sexless. Une fois j’ai perdu la main droite, une fois le bras entier, une fois les deux jambes. La musique ? Finie, la musique. Un amour qui survient ? La perte d’un usage.
Paris-Irún, jour d’affluence. Clotilde Keppa, à son voisin de train, aux cheveux d’un blanc soigné. Où se niche la vieillesse ? Pas dans ses yeux, vifs comme ceux de personne à la ronde. Clotilde Keppa adresse la parole au vieil homme.Contre l’angoisse, ou par provocation.
Un enfant pleure comme les enfants pleurent dans les trains, la campagne est inondée, le ciel s’affadit dangereusement, on pense qu’on va tomber, on est déjà très bas. Le très vieil homme écoute sans un mot la jeune fille sexless. Il pianote sur son téléphone de temps en temps, s’excusant poliment.
Les conversations autour d’eux sont étouffées. Un homme corrige des copies, s’interrompt pour raconter : il est géorgien, elle ukrainienne, ils ne veulent plus dormir au 115, ils se mettent en colère contre moi maintenant, c’est plein de Noirs et d’Arabes, ils disent.
Les gens de l’Est, dit le voisin de celui qui raconte.
Celui qui raconte secoue la tête, droite, gauche.
La femme au gilet gris parle très fort dans son téléphone, explique les problèmes qu’elle a eus pour prendre le train, elle s’est trompée de voiture, etc.
L’enfant hurle, la mère chuchote c’est fini, c’est fini, puis c’est pas possible, c’est pas possible – sans s’énerver.
Clotilde somnole. Elle est devant une termitière gigantesque et le train est arrêté en pleine voie. Un homme immense se tient devant la voiture 16 du TGV. Il fait des signes. Il a les cheveux blancs de son voisin de train. Il se débat, secoue les bras, ouvre et ferme la bouche à cadence régulière. On n’entend rien. On redémarre, le train traverse bientôt une ville, ralentit déjà, la campagne est grise maintenant et sont oubliées les termitières, comme les hommes qui appellent au secours.
Clotilde a mis ses genoux entre ses bras, a posé la tête dessus, les termitières défilent. L’homme à côté d’elle est impassible. Bientôt, il parle. L’homme inattendu raconte une histoire un peu dingue et si Clotilde s’inquiète au début (il a perdu la tête ?), ça ne dure pas.
Clotilde est d’accord. L’homme lui tend une page de son carnet, il y a écrit prénom et numéro de téléphone, le « A » bien dessiné, à l’ancienne. Alban, ça lui va bien. Un prénom fabriqué de toutes pièces ? Après tout, qu’est-ce qui ne se fabrique pas ? Elle n’est pas à ça près. On dirait qu’Alban du TGV en connaît à la pelle, des histoires. Saint-Jean-de-Luz – Ciboure, la gare. Le numéro de téléphone du bel Alban, vieux comme on ne peut pas dire, dans la poche.