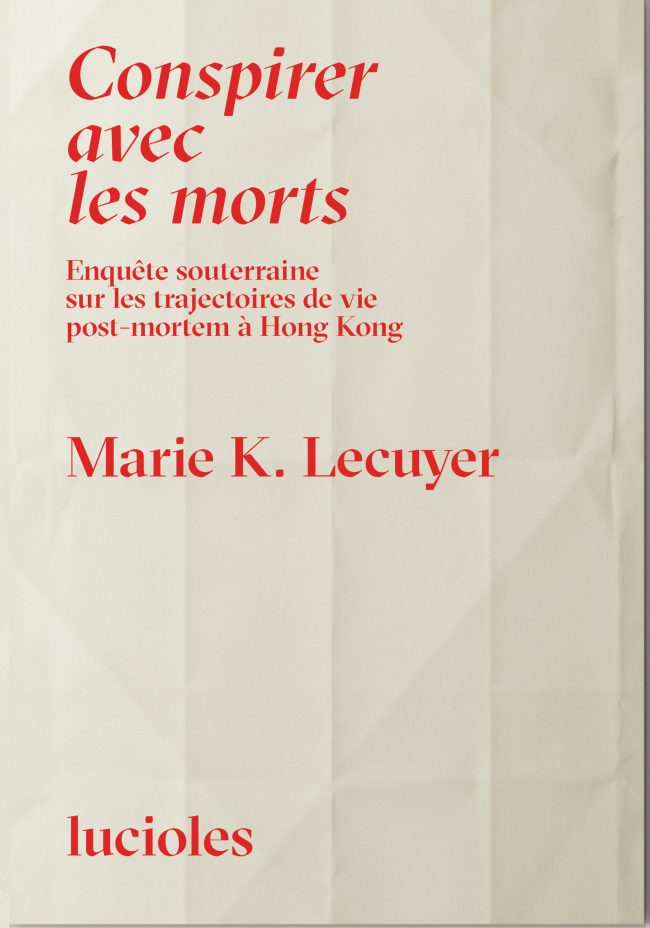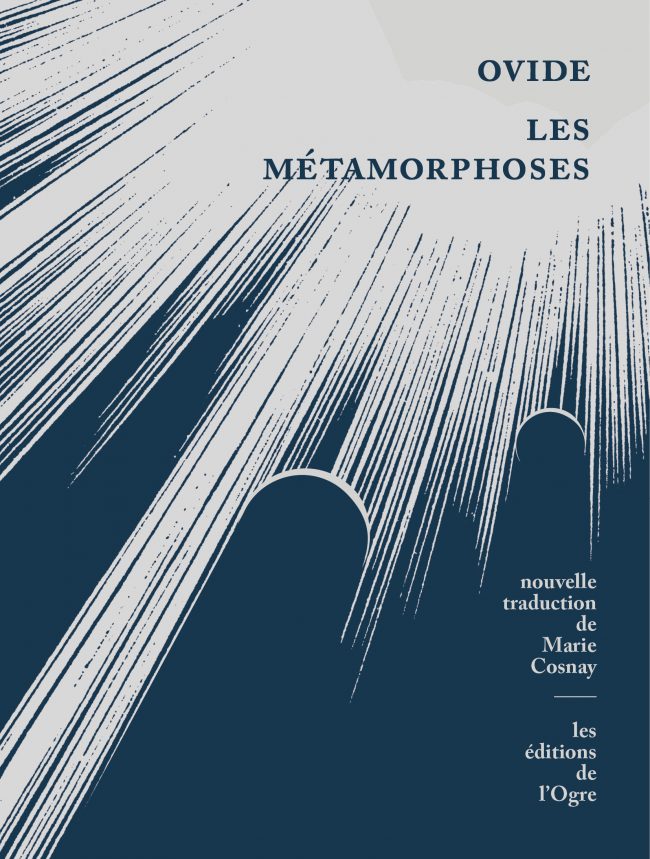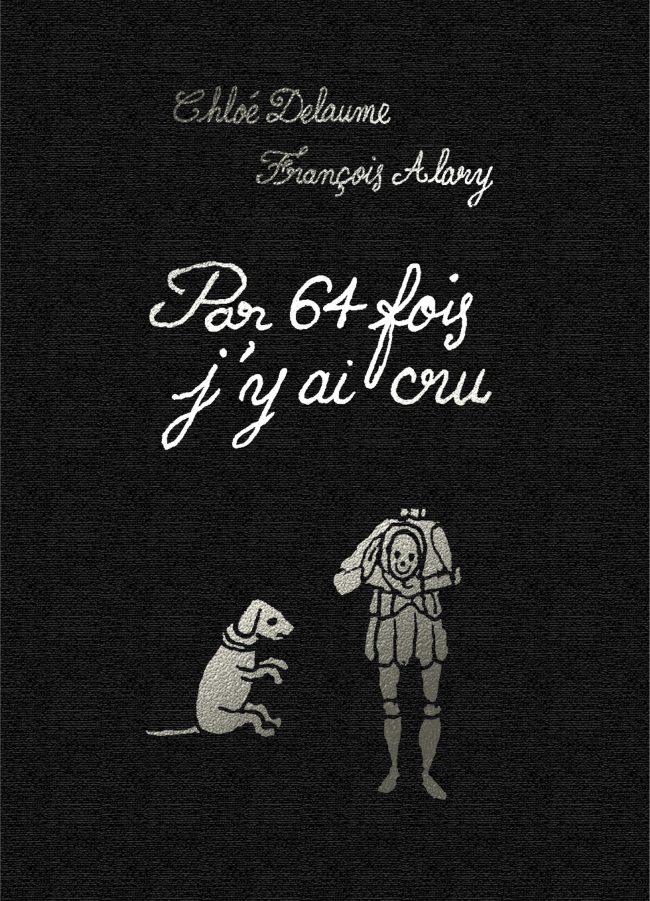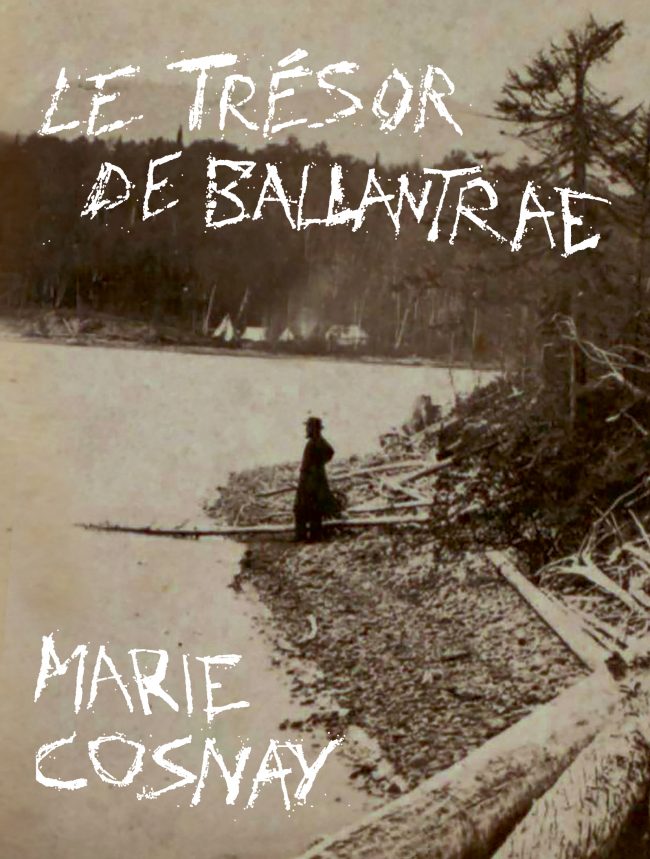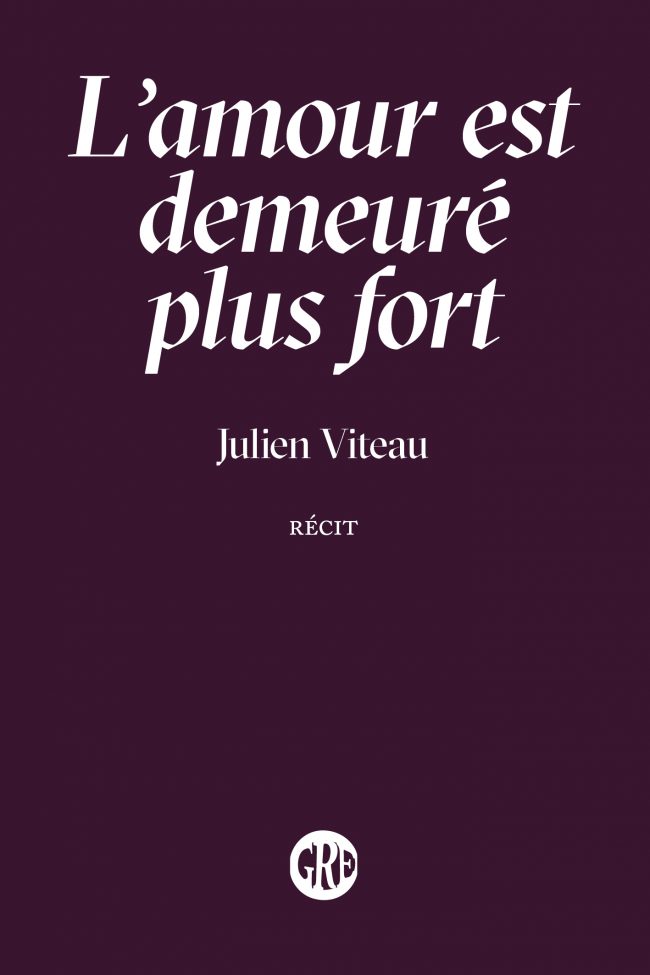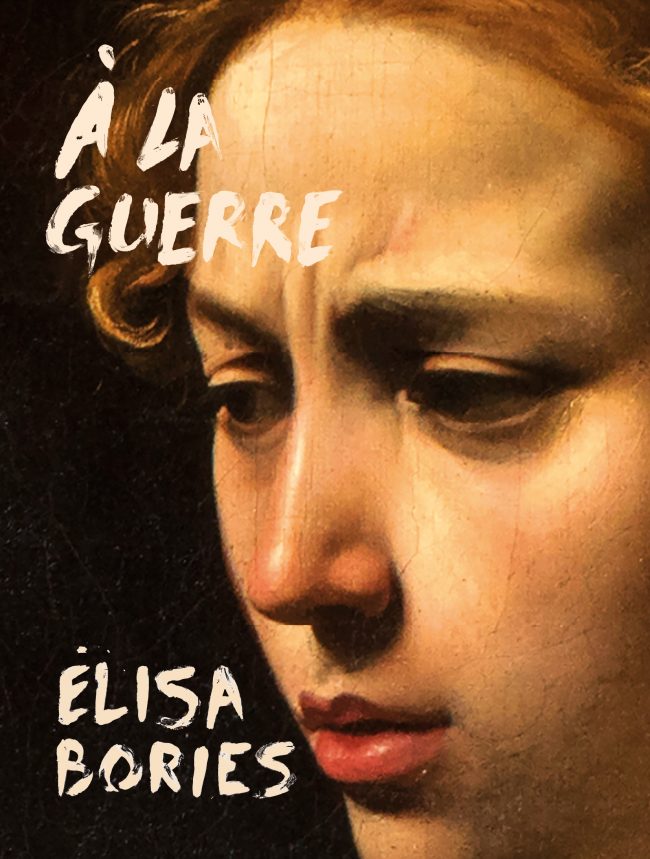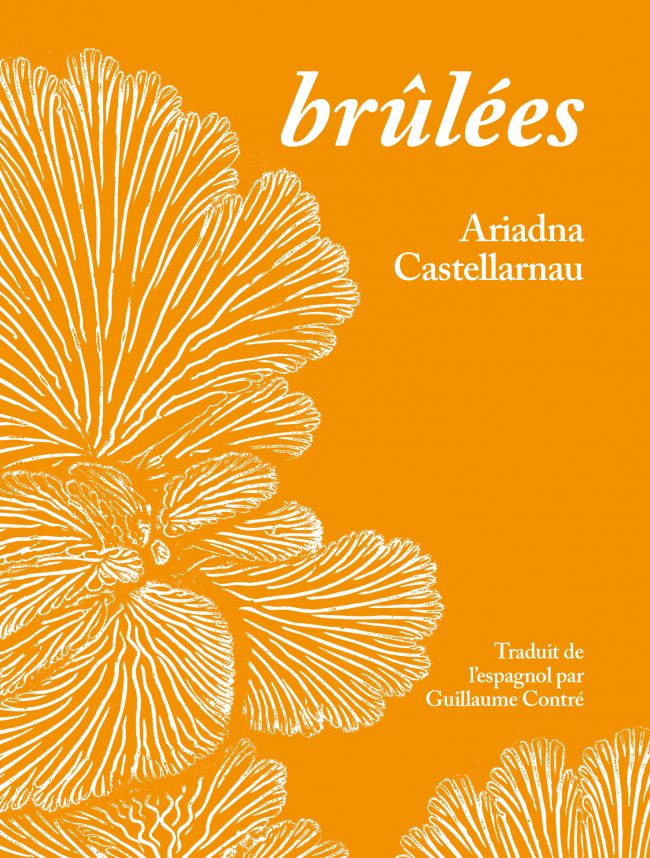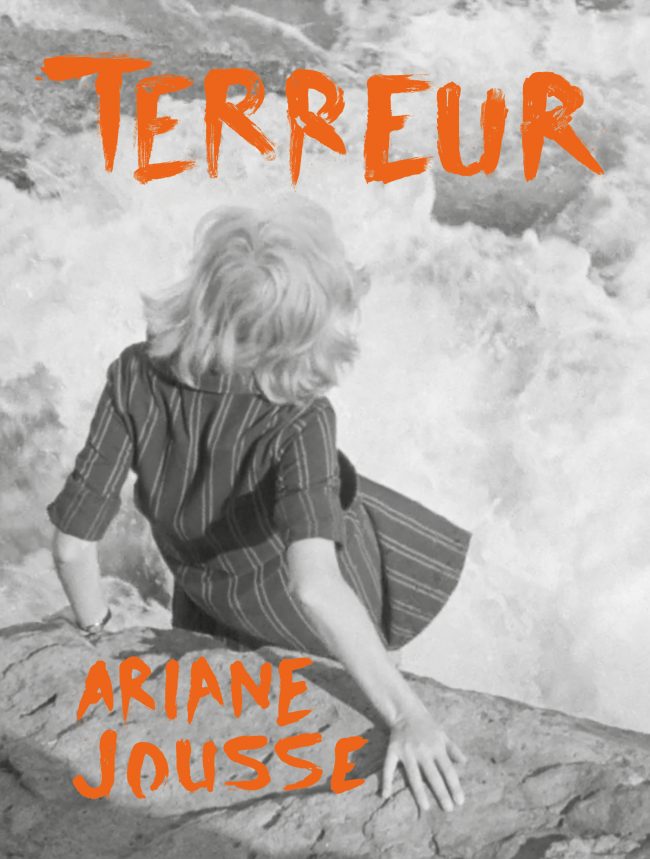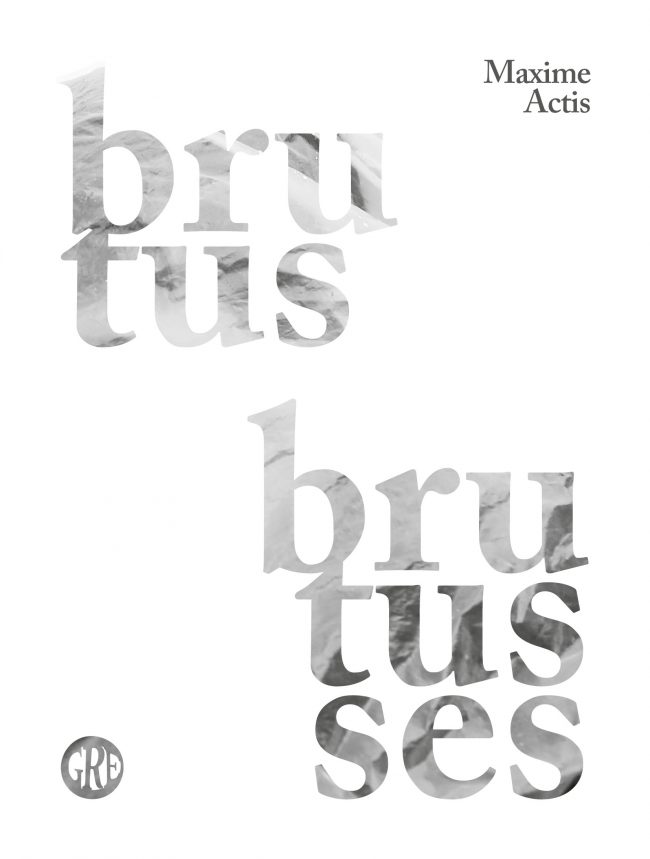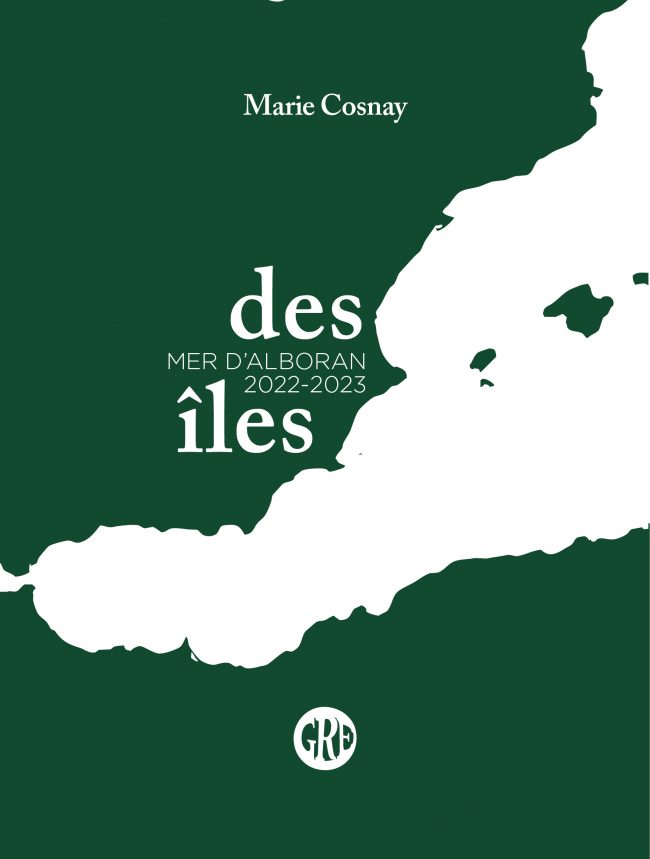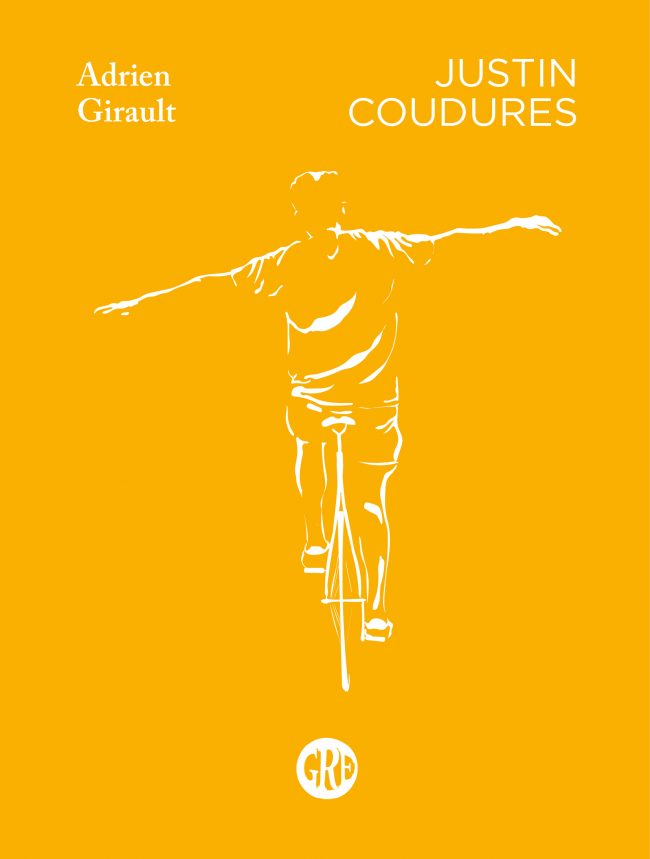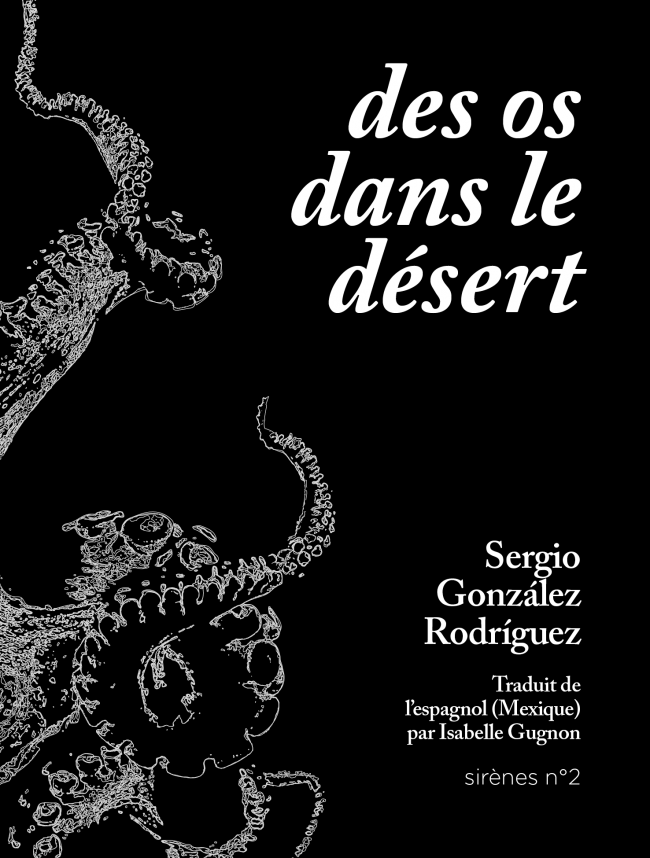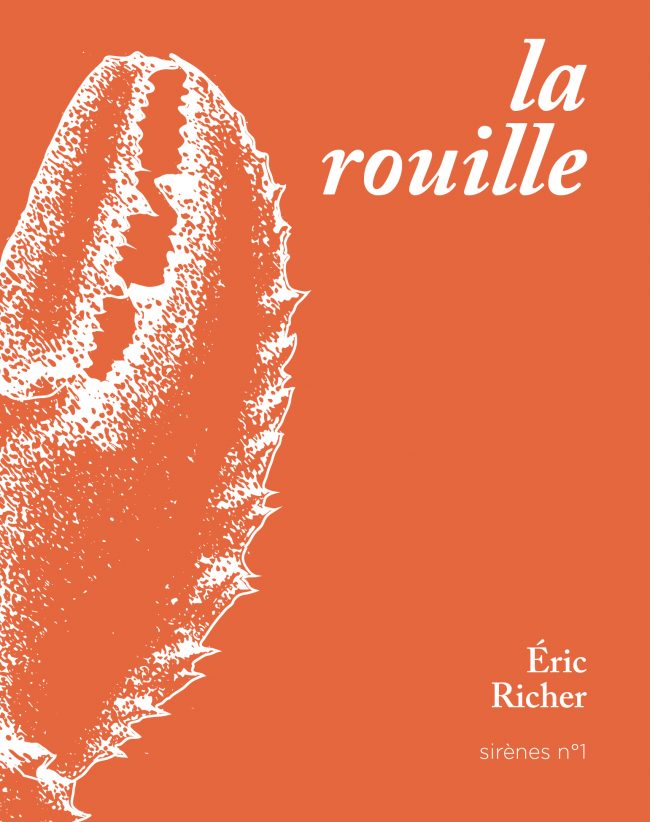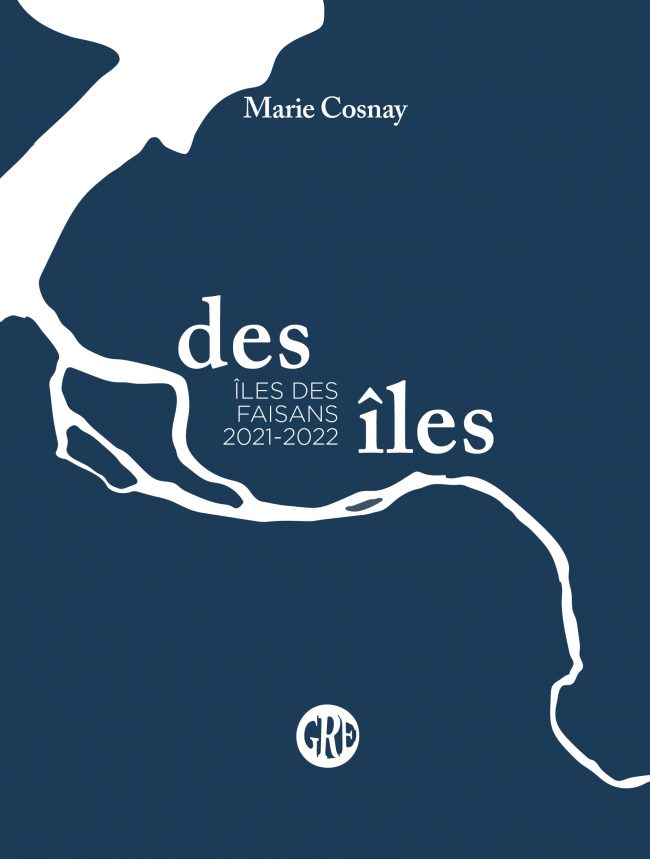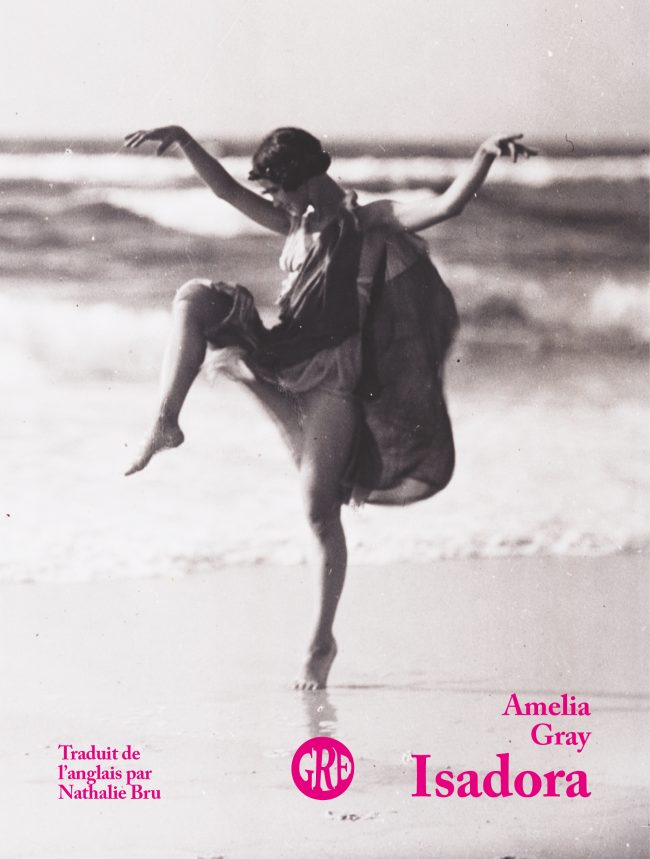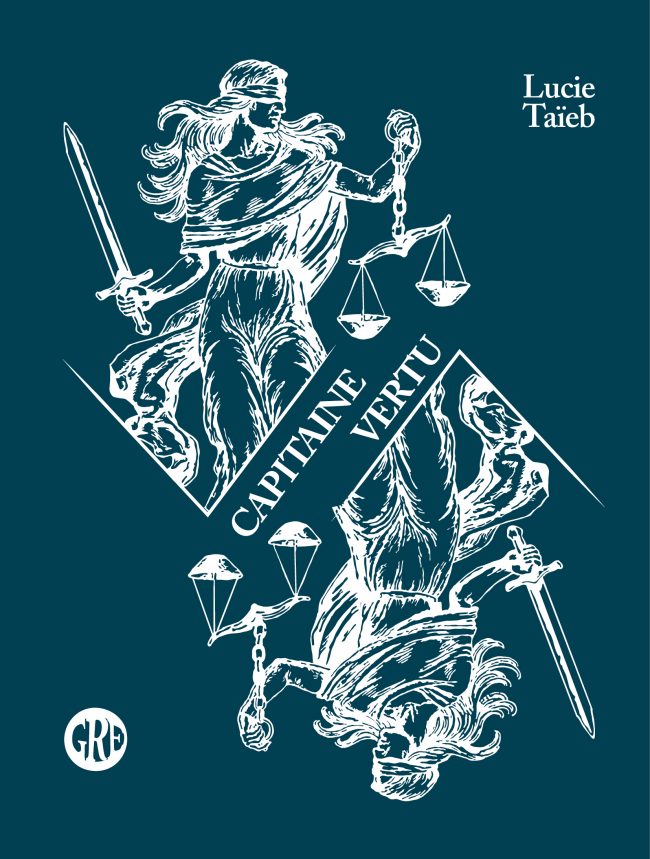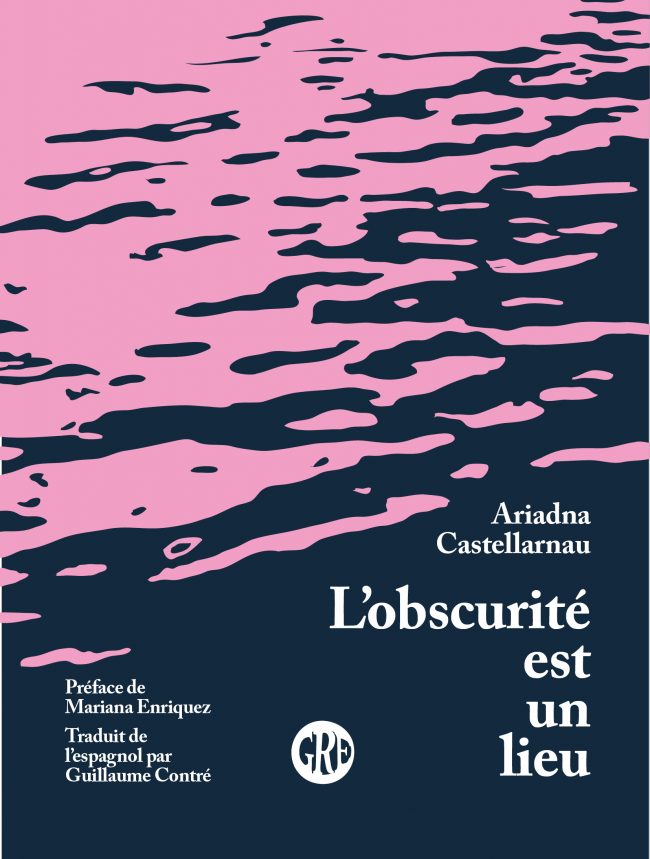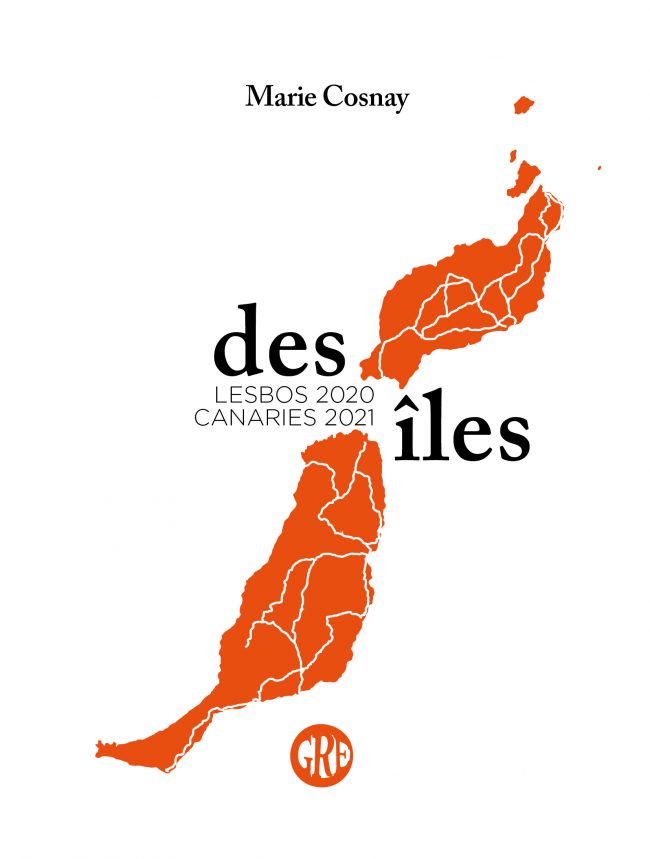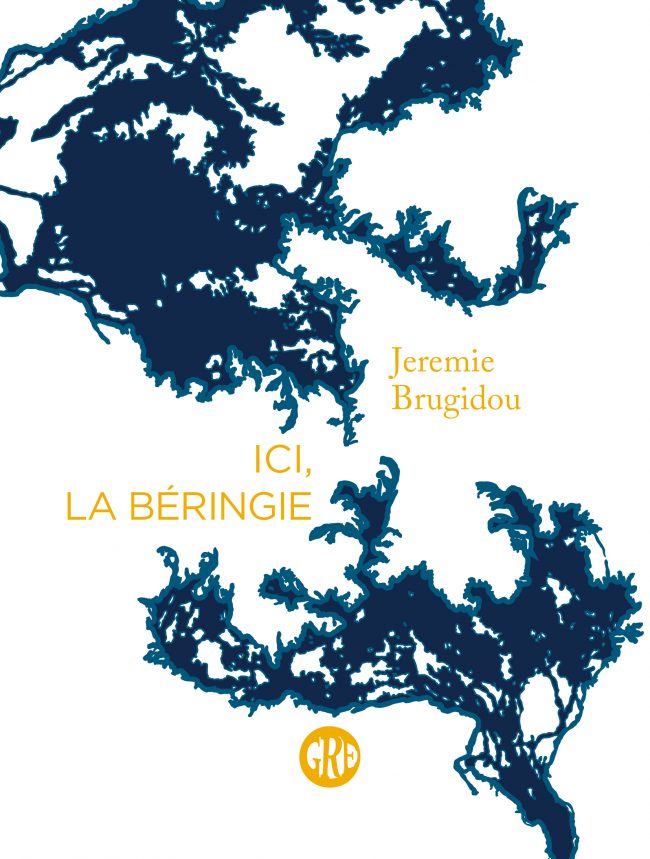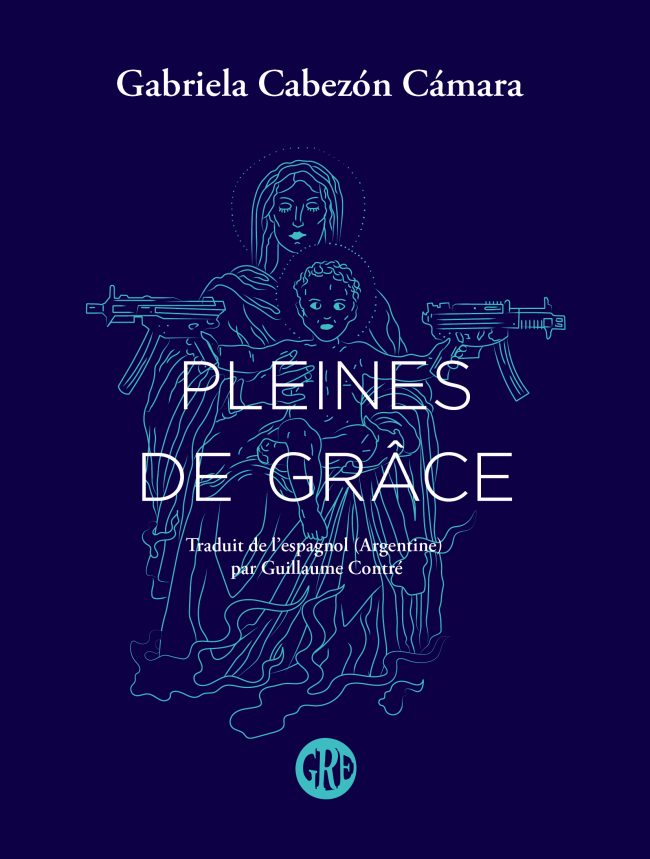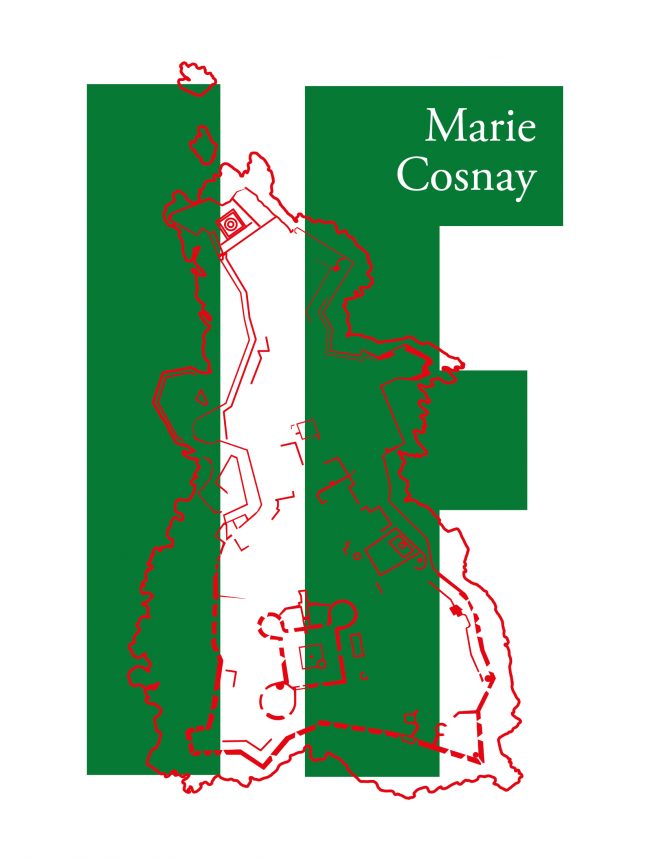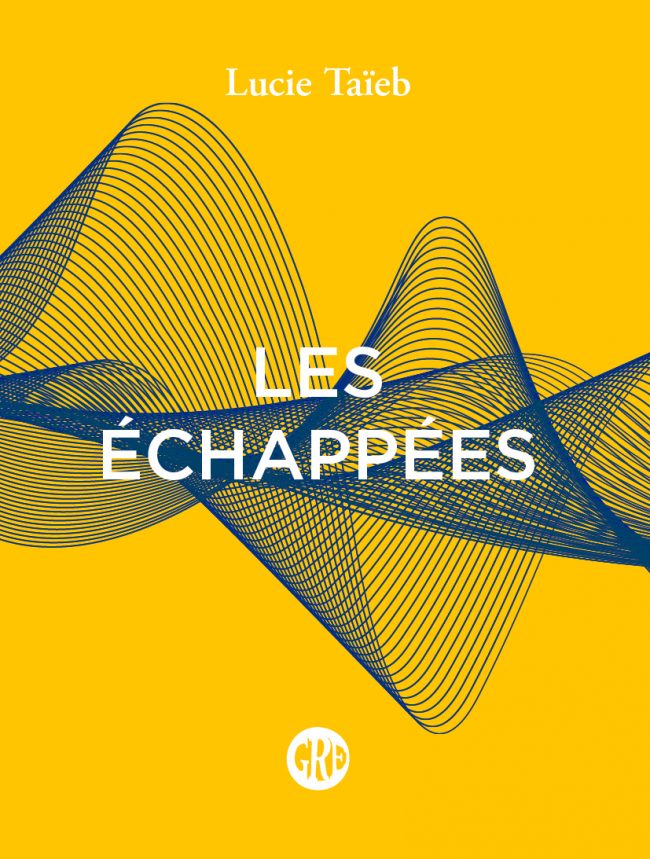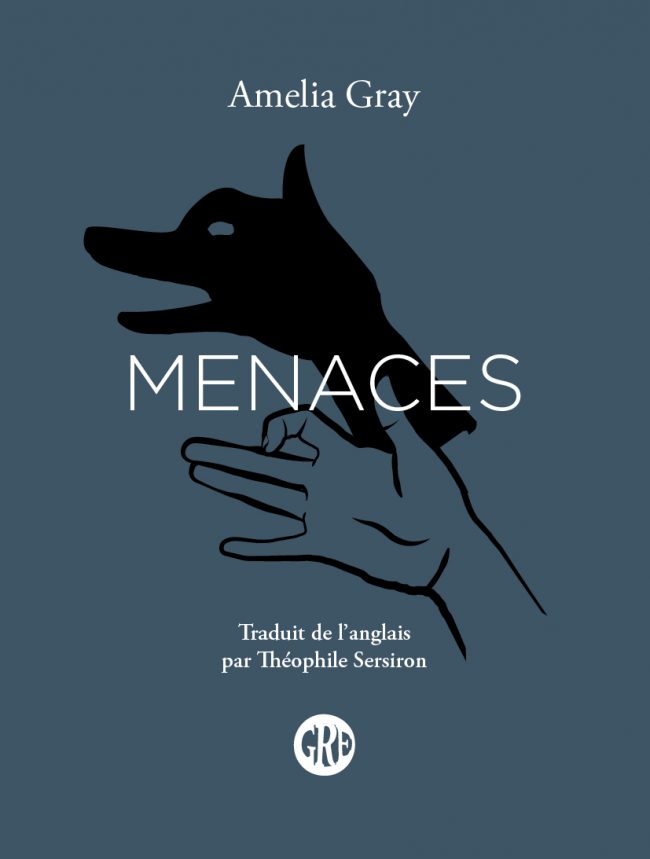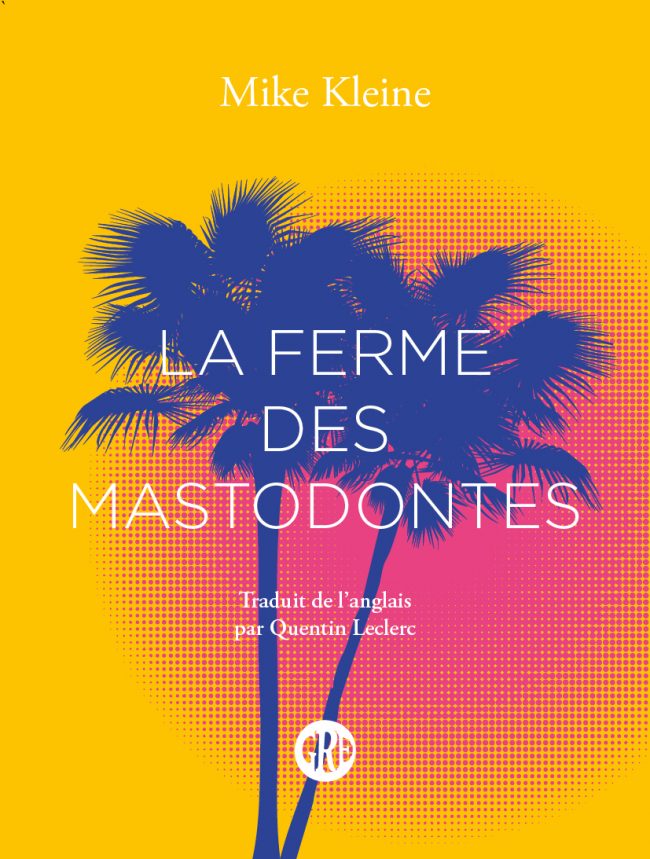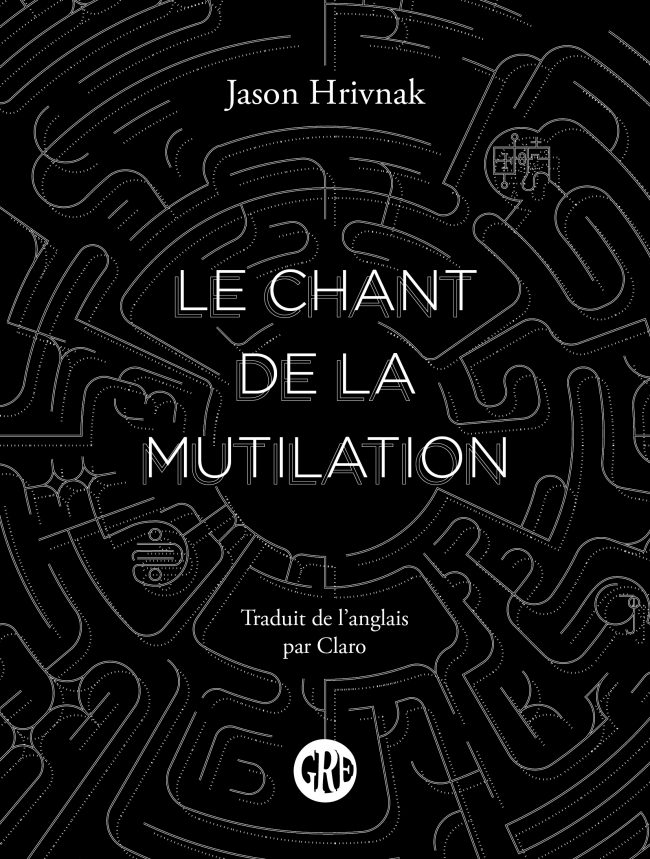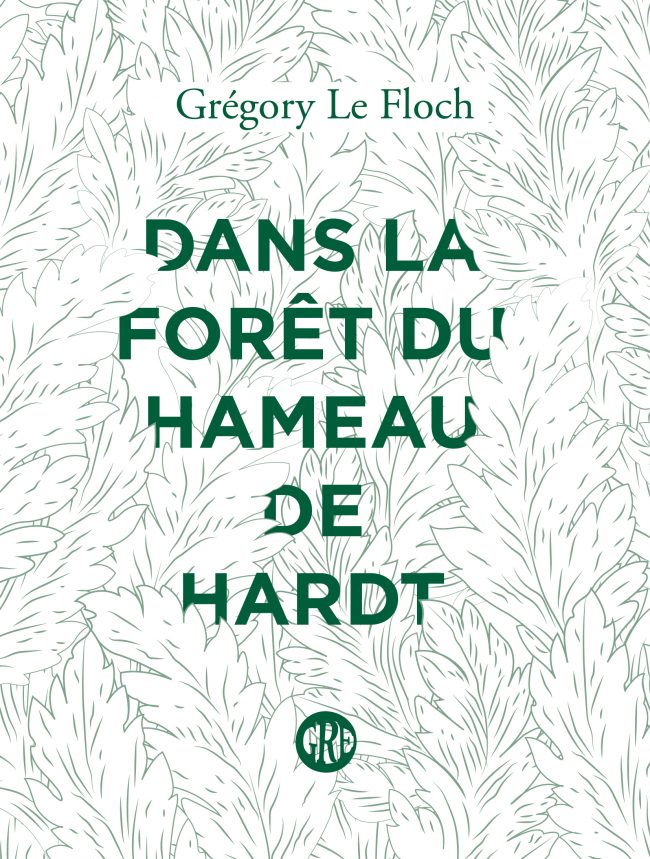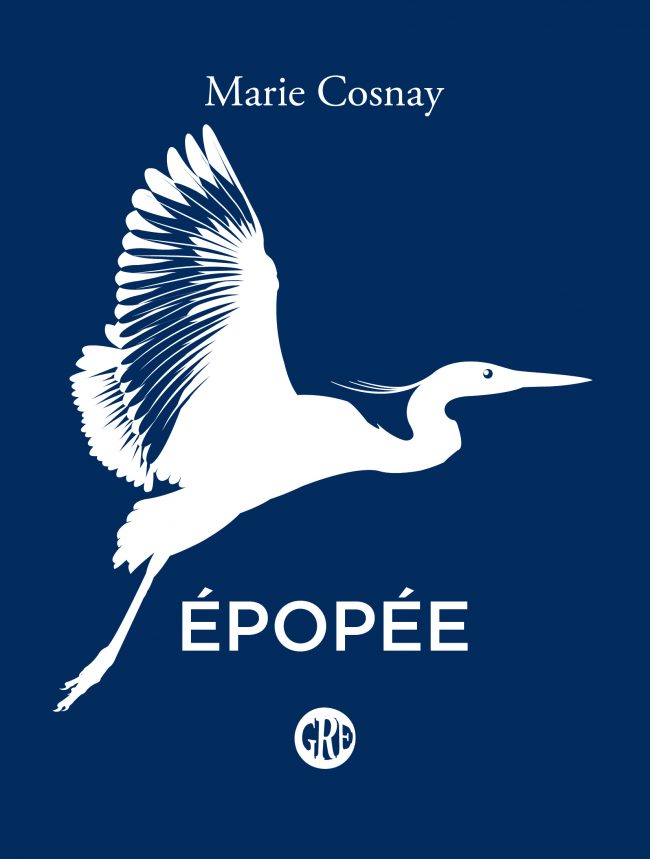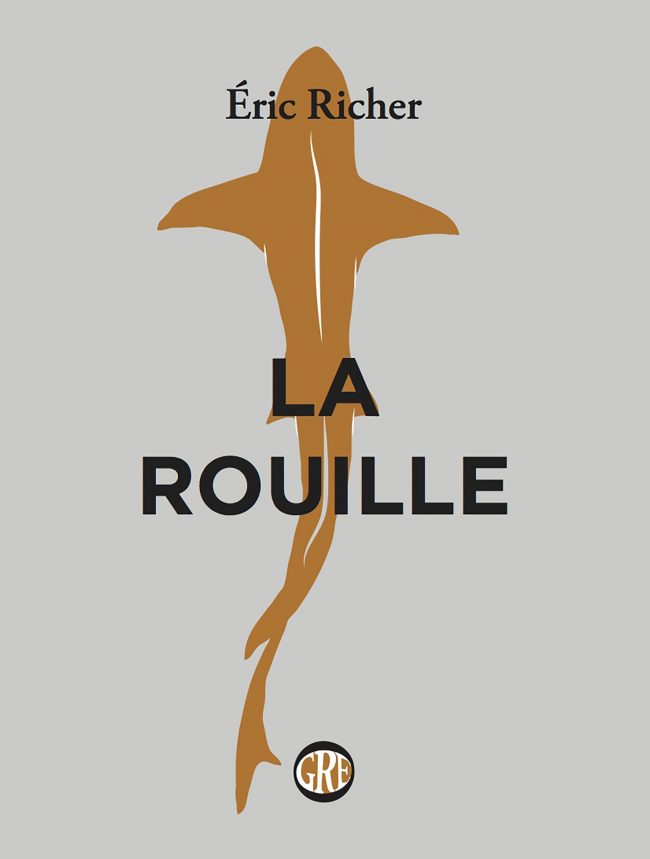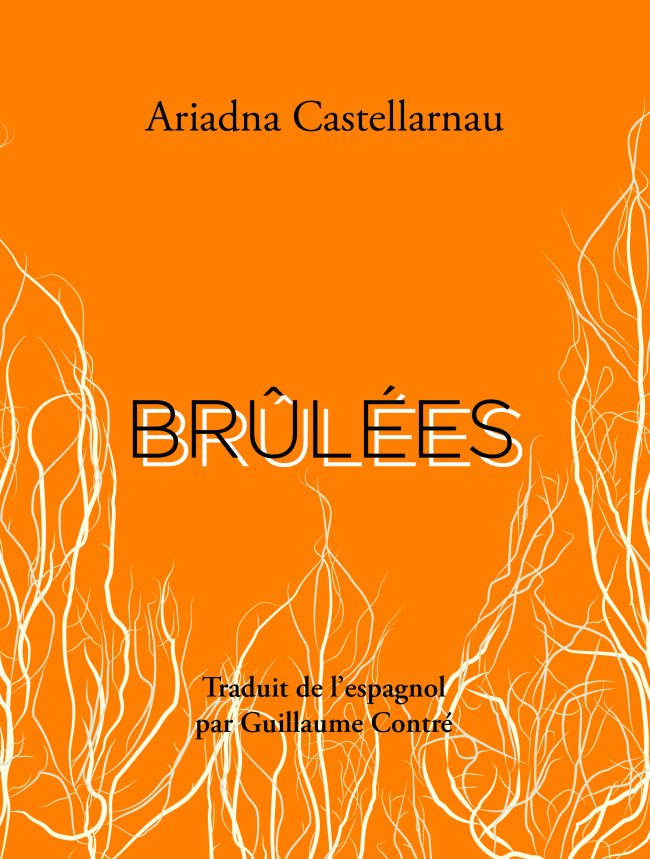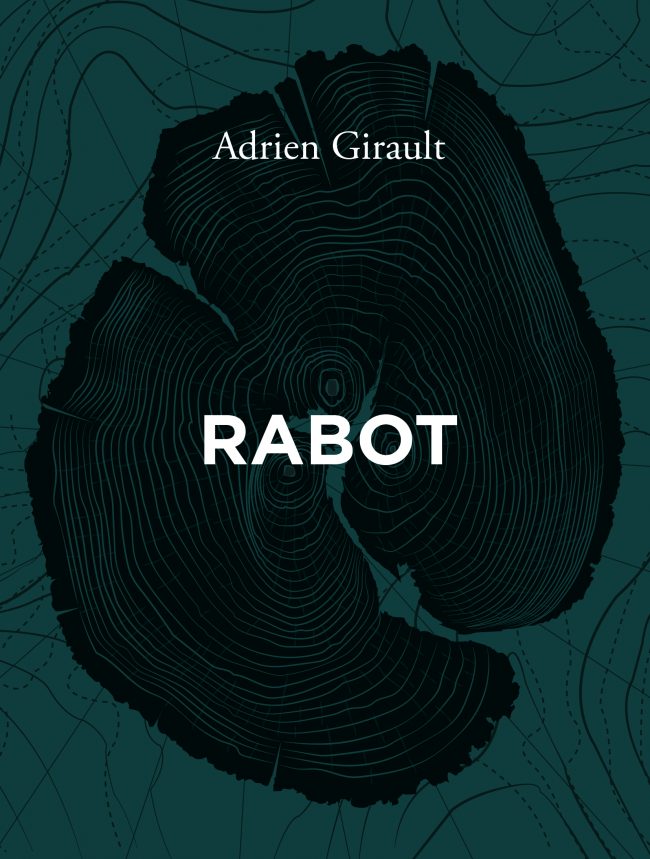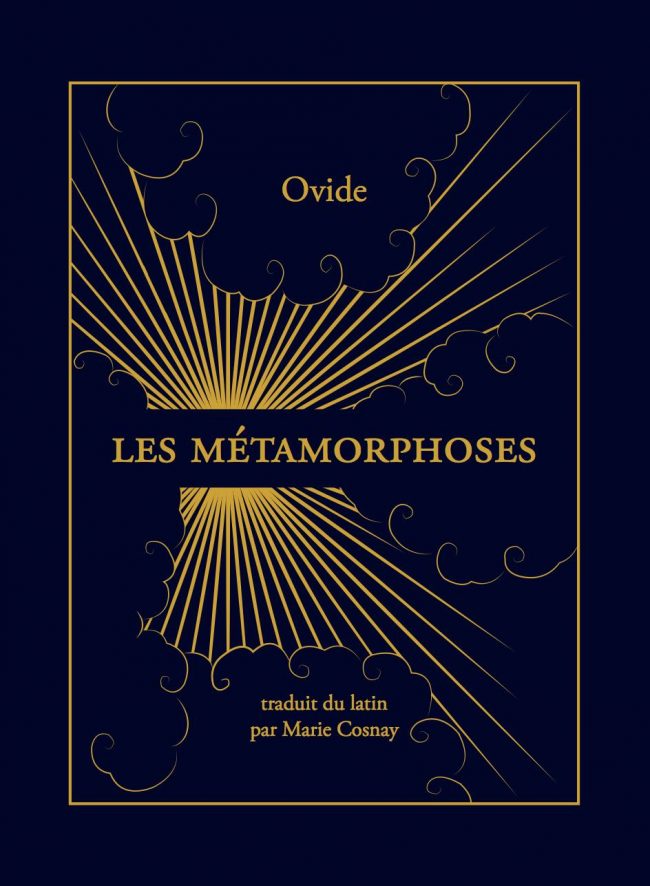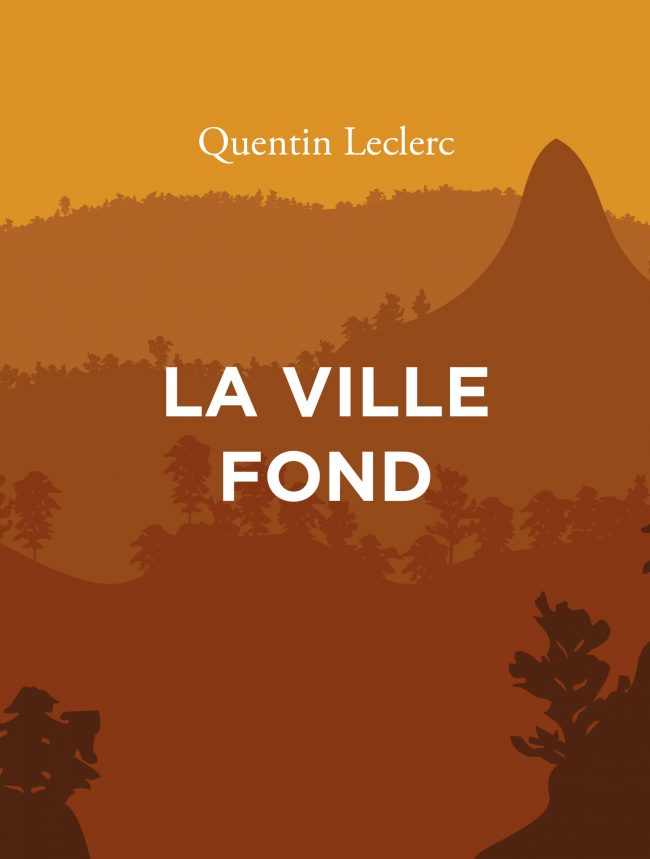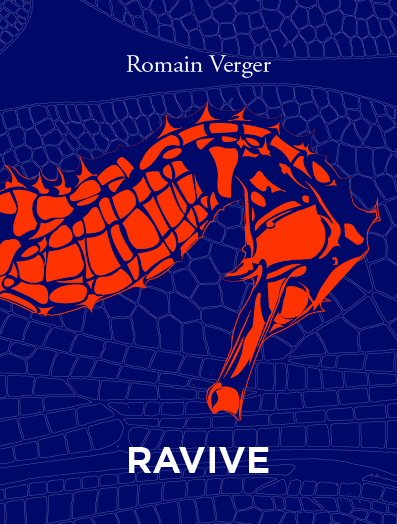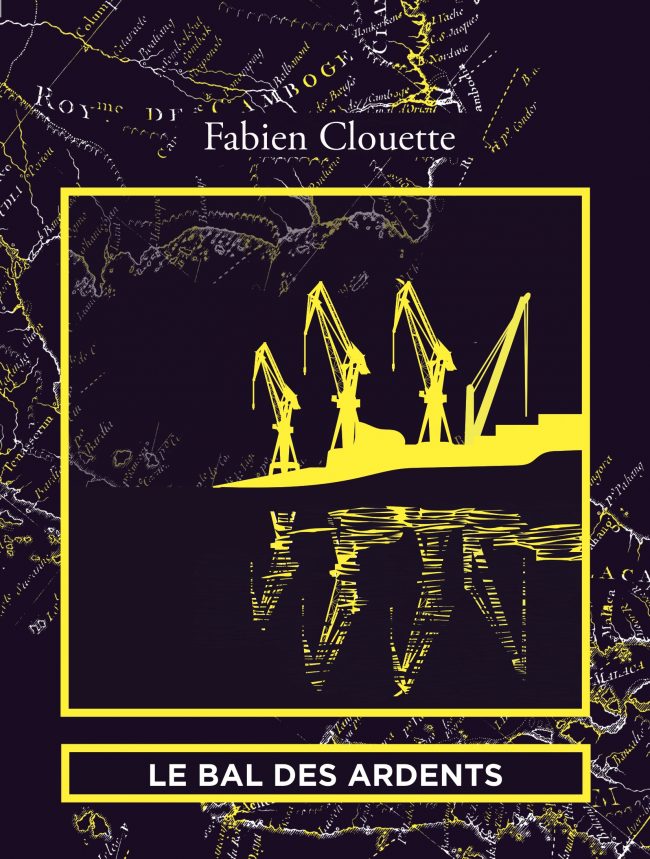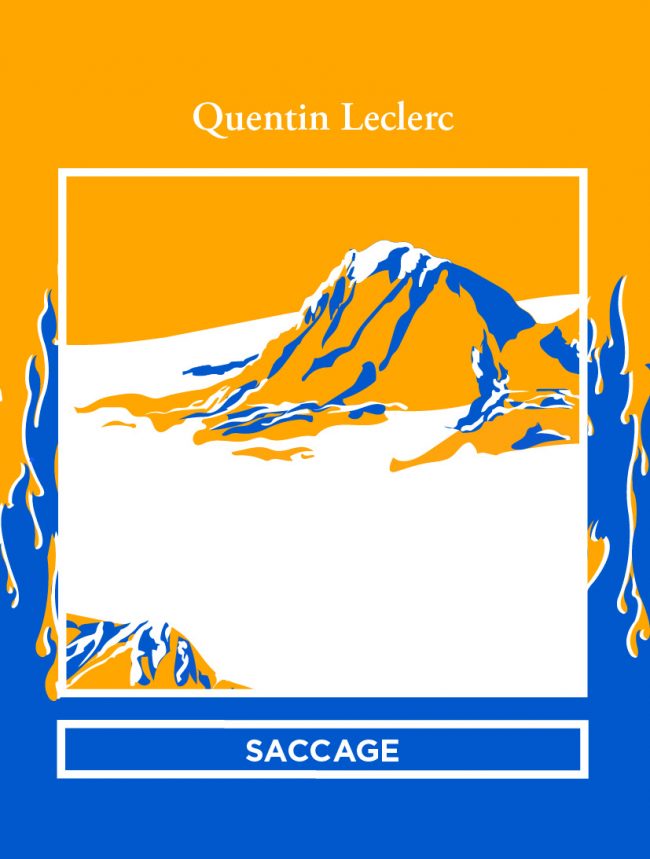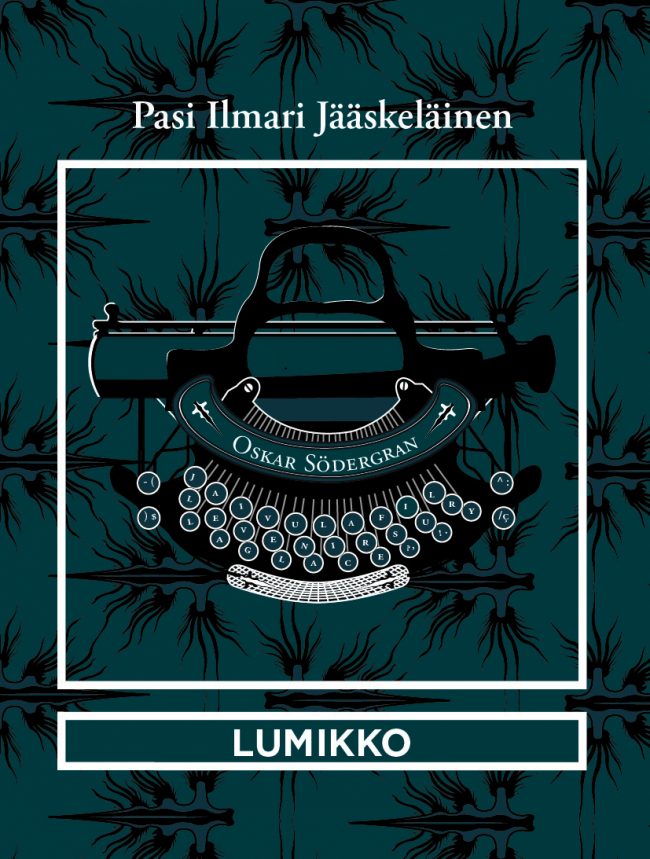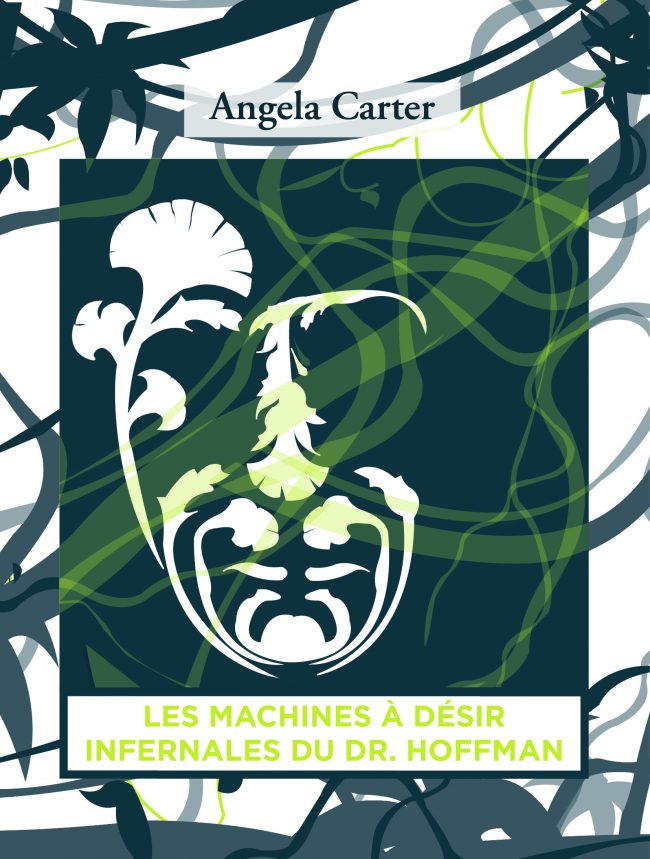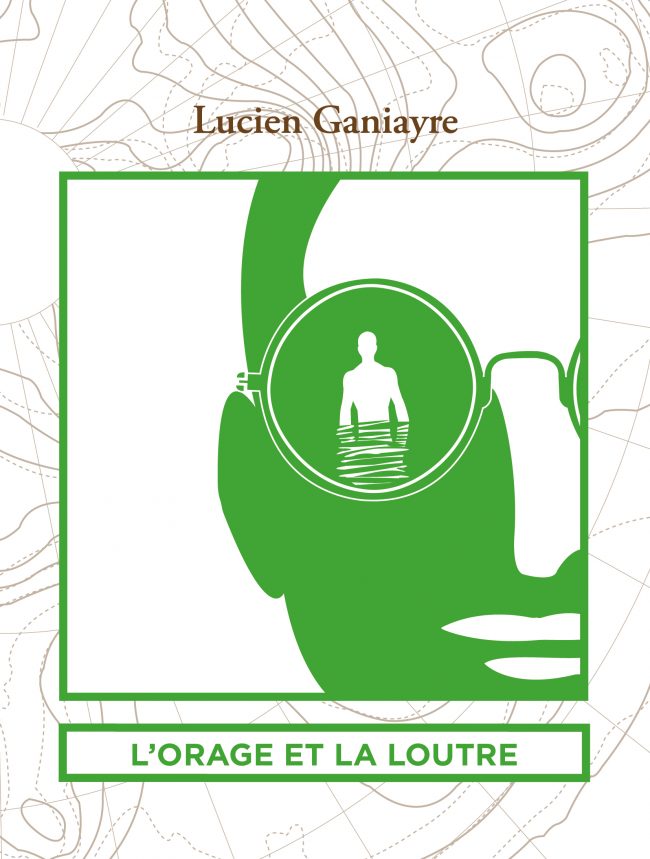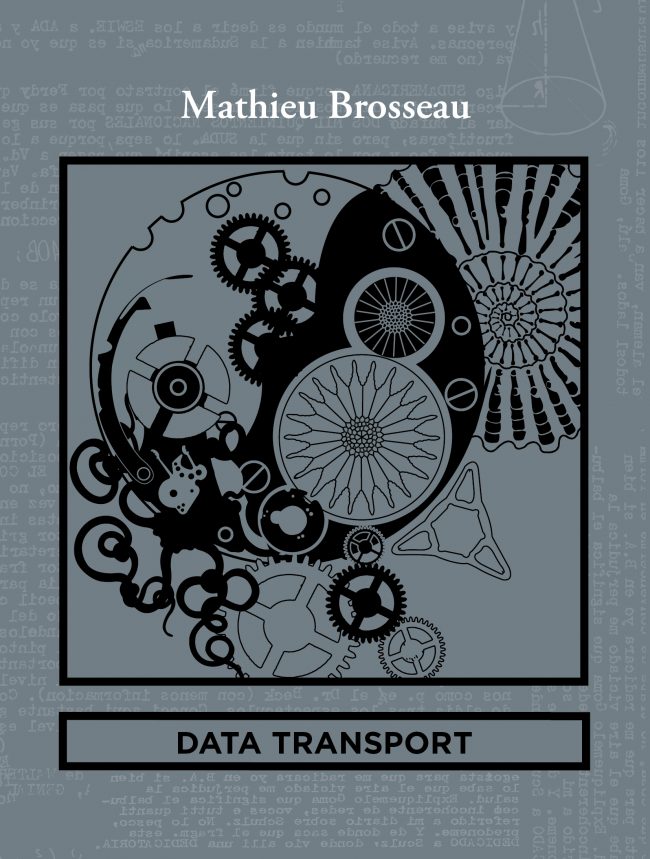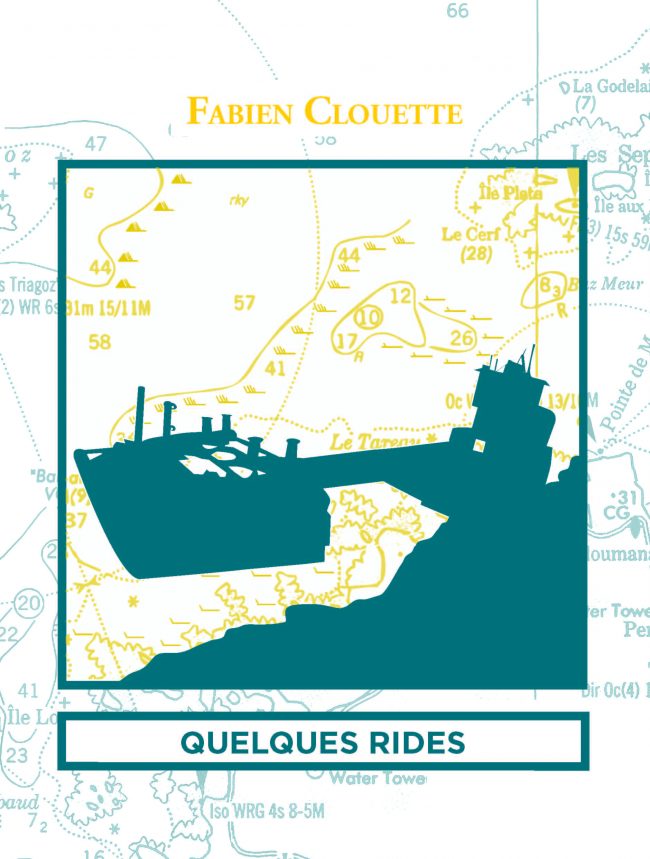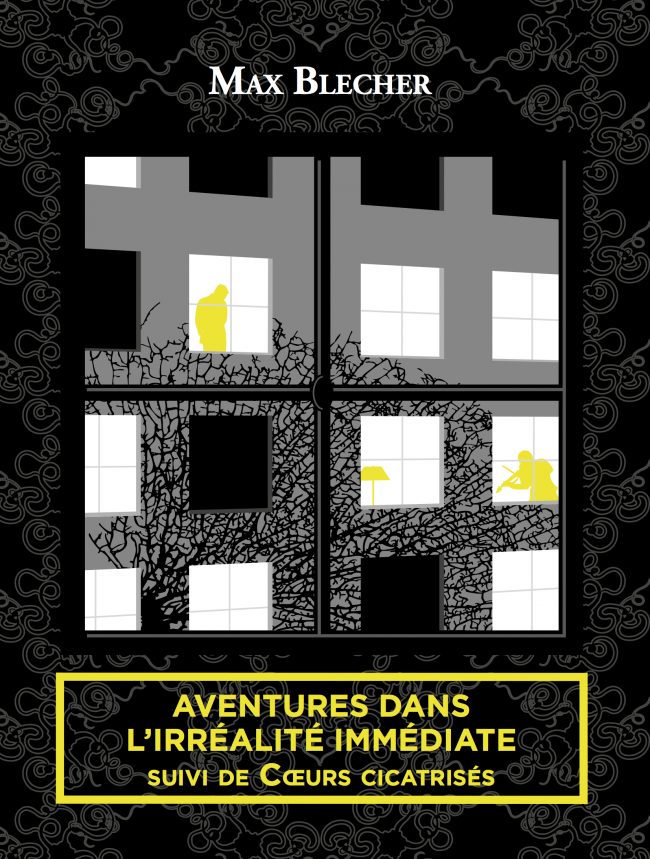Data transport
OGRE N°5 – Mathieu Brosseau
Data Transport
mardi 05 mai 2015
Taille : 14//18,5 mm – 230p. – 16€
ISBN : 979-10-93606-10-1
Quand M. est un beau jour repêché par un cargo en pleine mer, ni lui ni personne ne sait qui il est, ni ce qui l’a mené ici. Muet et amnésique, il trouve un emploi dans un service de courriers non adressés à la poste et semble progressivement recouvrer la mémoire ainsi que le langage par l'intermédiaire des lettres qu'il lit et classe toute la journée. Cette découverte de lui-même, de son histoire, celle d’un être confronté à la difficulté d’incarner à la fois son corps et son verbe, et condamné dès sa naissance à une mystérieuse seconde de retard, va le mener jusqu'à la source de ses crimes – réels ou illusoires – et de sa propre disparition.
Dans un univers éthéré et poétique, et avec une précision poétique chirurgicale, Mathieu Brosseau interroge dans Data Transport ce que la langue fait au corps. Comment reprendre corps, mémoire et langue ? Comment distinguer ce qui, dans cette reconquête de la langue et de la mémoire, appartient à l’identité ou aux lettres que lit M., sorte de Bartleby qui serait passé de l’autre côté du miroir.
LA PRESSE
« Traversée. Dans quels états le « je » erre-t-il ? », par Marianne Dautrey, Le Monde des Livres, 18 juin 2015 : À travers le récit d’un homme qui perd son langage et son histoire, puis reconquiert mémoire et parole en empruntant les mots des autres, placés au rebut, le roman semble demander qui, du langage ou de la réalité, fait le monde et le sujet. Si les objets parlent, les mots prennent corps eux aussi. La question des causes premières ne suscite aucune réponse mais un tourbillon logique qui dévore son propre texte et son héros au lieu même de leur naissance. Data Transport est le roman d'une spéculation poétique parfaitement jubilatoire.
« Papiers d'identité », par Chloé Brendlé, Le Matricule des Anges, 12 juillet 2007 : Premier roman d'un poète, Data Transport joue des genres littéraires et des mots ordinaires pour dire le besoin, intime, collectif, de douter et de se dérober. […] Si le « nous » est devenu impossible, le « on » irresponsable, le « je » trop ambitieux, le « il » et la fiction restent peut-être le plus sûr détour pour raconter l'histoire vraie d'un homme qui rêve et ne disparaît pas tout à fait, et faire au passage l'autobiographie de tout le monde. Il est grand temps, avec humour et maladresse, de se baigner dans le poème, et de retirer son couvre-chef.
« Les lettres naufragées et l'écrivain sauvé des eaux », par Alain Nicolas, L'Humanité, 9 juillet 2015 : Data Transport demande au lecteur de faire un pas vers une aventure au cœur du langage, mais aussi un monde terriblement incarné, où les objets, les corps, les amours mêmes sont d'autant plus présents qu'il est difficile de les dire. Venu de la poésie, Mathieu Brosseau fait mieux que « passer au roman », il réalise un projet ancestral, unir roman et poésie.
« N'habite pas à l'adresse indiquée », par Natacha Andriamirado, La Nouvelle Quinzaine Littéraire, 15 juillet 2015 : Ecrire à partir de quoi ? A qui ? Pour quoi ? Pour qui ? C'est le sujet même de ce splendide roman/poème qui ouvre, grâce à des associations d'idées défiant toute logique, à la dimension illusoire de toute vérité. (…) Data Transport est un livre heureux, où écrire et lire procèdent de la même ambition créatrice : l'attachement à ce monde, fût-il de cendres.
EN PARLE
« Data Transport (Mathieu Brosseau) », par Lucien Raphmaj, Latérature, le 13 janvier 2018 : Il y a dans les pages de Data transport des pages que l’on pourrait arracher, non pas parce qu’elles seraient « élevées à la puissance du ciel étoilé » comme le rêvaient Mallarmé et Valéry, non, des pages dont les mots se défont pour laisser la nuit se faire. Des images qui s’endorment et veillent en nous.
« Notes de lecture : Data Transport », par Hugues Robert, Charybde 27 : le Blog, 30 octobre 2015 : Rarement un personnage de roman aura vu peser sur lui, qui se voudrait toute insignifiance et légèreté, de telles responsabilités : déchiffrer la trame du réel, saisir la béance des interstices qui sont la substance des rêves, réinventer le langage qui puisse convenir au monde et à soi.
« Data Transport », par Jean-Philippe Cazier, blog Mediapart, 16 juin 2015 : Le récit ne cesse de se disséminer, de fuir. C’est finalement le livre lui-même qui est inséparable d’un mouvement de dissémination, c’est d’abord cette dissémination, ce mouvement répété de fuite qui constitue le livre. D’où son étrangeté, le fait que le roman se déplace sans cesse, évite tout sol trop fixe, tout genre arrêté, toute signification dernière, toute « fin de l’histoire ».
« Mathieu Brosseau – Data Transport », par Philippe Di Meo, Poezibao, 12 juin 2015 : Bavard impénitent, enclin à l’abstraction. Non sans logique, une autre logique, M. dégoise de choses essentielles : du temps, du tout et du rien. Du mouvement cosmique, surtout. En se gardant bien d’enfiler les oripeaux usés jusqu’à la trame du romanesque. Un discours subtil que le sien se prévalant de l’étymologie ou, encore, de la paronomase pour se reproduire, de volute en volute. Mais qu’on y prenne garde, ce tout plural est solidaire. Muybridge, le chronophotographe dûment cité, fédère symboliquement et un tant soit peu clandestinement toutes les miettes.
« Mathieu Brosseau, Data Transport », par Romain Verger, Membrane, 10 juin 2015 : Connu jusqu’ici pour sa poésie, Mathieu Brosseau signe avec Data Transport son premier roman, un texte très personnel, de transition, qui s'essaie au genre tout en se jouant de lui, maintenant tout du long en tension récit et poésie. Il serait bien sûr idiot de vouloir réduire M. – personnage-initiale tout en esquisse et en esquive – à un double autobiographique de l'auteur, mais la trajectoire de M., de sa naissance à sa vaporisation, est bien celle d'un poète, d'une figure se construisant dans et par les mots, dans un environnement de lettres, entendues dans les deux sens du terme : signes et correspondance. Au fil du récit et de la formation du personnage, une vocation se dessine, fruit d'une interaction poétique et sensible avec le monde, faite de porosité maladive et de mimétisme. […] Data Transport est la biofiction poétique d'un fascinant ectoplasme.
« Mathieu Brosseau – Data Transport », par Fabrice Thumerel, Libr-Critique, 21 mai 2015 : M comme mer, méduse, méditation… M comme Mathieu ? Non, pas vraiment, ou alors son double – dont la voix n’est pas sans rappeler celle des proses poétiques, et en particulier La Confusion de Faust, UNS et Ici dans ça. Nulle autofiction ici : Toutes les histoires privées sont dégueulasses à raconter.
« Naître avec une seconde de retard », par Natacha Margotteau, nonfiction.fr, 23 mai 2015 : Lire ce roman, c’est prendre le risque de la dissolution, celle du récit, celle de son personnage et peut-être même de la sienne. Puisque le narrateur précise que les commentaires ont de tels effets corrosifs sur M qu’ils accentuent dangereusement sa porosité, et qu’il vous invite dans le même temps à regarder par la fenêtre le temps du récit se fondre, perdre sa lucidité.
« La Fin de la fin signe le retour du réel », par Pierre Ménard, Liminaire, 14 mai 2005 : Data Transport est l’histoire de cette échappatoire, de cette absence et de ce manque salvateurs, et c’est la force et la belle réussite de ce texte poétique de Mathieu Brosseau qui parvient avec intensité, dans un travail subtil de la matière même de la langue, tout en écarts et tensions, à nous entraîner dans le récit de cette quête faite de folie et de fulgurance, pour retrouver le langage.
« Ce qui fait communauté réside dans notre commune subjectivité… », entretien entre Mathieu Brosseau et Armand Dupuy, Remue.net, 13 mai 2015 : Dans Data Transport, qui est là un roman, j’ai composé une fable dont l’histoire, qui n’est pas la mienne, tente de dire des choses qui la dépassent. Une histoire dont la structure fait état d’une vision du monde mais qui reste perplexe. Dans ce roman, je mets en scène un personnage né avec une malheureuse seconde de retard et qui, à l’instar du lapin d’Alice, va tenter de courir après celle-ci. Cette seconde en moins aura des conséquences majeures et décisives sur la suite de son existence.
Il est clair que tu retrouveras des motifs proches dans Ici dans ça, motifs qui me hantent et sont le nerf de mon travail d’écrivain, comme l’identité, le temps, la disparition, le signe, le désir, la mémoire, etc. Ces livres ont la même source, ils ne sont pour autant pas faits de la même manière, ni totalement de la même matière. Les personnages de tous les romans sont des figures détournées de l’auteur, pour autant ils ne sont pas l’auteur lui-même (d’ailleurs, qui est-il ?) et c’est ce qui distingue, entre autres choses, fiction et poésie.
Enfin, non, je ne crois pas être un écrivain pointilliste, a priori. Ou bien je ne le fais pas exprès. Le cadre, la forme, la manière ne priment pas, ils ne peuvent pas être un postulat, ils ne sont que les habits de ce qui se dit. La réalité n’est pas un tableau figé et une représentation découpée par des points, un plan séquence de 24 images/seconde, elle est un flux total, uni. Je veux écrire de la réalité. Un tableau est une scène. Une narration est une scène. Il faut la mettre en tension et sentir ce qui déborde, en creux, ce qui se dit entre les lignes. Je ne suis donc d’aucune école formelle. L’idée est de vivre l’écriture telle qu’elle me traverse plutôt que de faire l’effort laborieux et rétrospectif de décrire, de travailler le trait selon telle ou telle méthode acquise, je veux de l’ivresse, je veux être dans la parole qui est en train de se dire plutôt que dans la traduction travaillée a posteriori d’émotions ou histoires passées ou déjà vécues. Je veux que la réalité habite la forme forcément imparfaite du livre, ses trous, qu’elle se dise et se révèle par ses creux. Et ce, même dans un roman. Et ce, surtout dans un roman.
« L'art de la dissolution selon Mathieu Brosseau », par Claro, Le Clavier Cannibale, 7 mai 2015 : La prose de Brosseau (…) cherche à devenir corps sans organe, à déterritorialiser la langue, à déplacer des blocs d’être. Ce que le roman perd en romanesque, il le gagne ici en intensité, comme si l’entreprise poétique se voulait virus, catastrophe – livre rythmé implacablement, féroce jusqu’en ses virgules, où les fulgurances secouent le lecteur.
« Mathieu Brosseau – Data Transport », par Teddy Lonjean, Un dernier livre avant la fin du monde, 4 mai 2015 : Un texte résolument contemporain, inventif dans son écriture et difficilement définissable. Un ovni littéraire empruntant autant à l’exercice de style, qu’à la poésie contemporaine où le récit navigue entre son passé, son présent et les lettres ouvertes et lues de ci de là par M.
Data Transport est assurément un texte des plus intéressant et intrigant à lire, même si la sensation d’être perdu par moments peut rebuter quelques lecteurs, la beauté du texte, la précision des mots choisis et le rythme imposé révèlent un texte fin et intelligent. La narration devient secondaire et l’on se surprend à relire certains passages d’admiration devant cette finesse d’écriture.
Assurément l’Ogre fait un démarrage sans faute avec ses choix de publications, mais l’Ogre avec Data Transport de Mathieu Brosseau porte sur le devant de la scène un auteur capable de se hisser au niveau d’un Eric Chevillard ou d’un Olivier Saison. Une belle révélation.
EXTRAIT
Un cargo commercial UVM 5, fin et long, étrangement baptisé Data Transport, le ramasse alors qu’il danse dans l’eau, jeune grenouille débutante qu’il est, se débattant dans une mer peu hospitalière.
Une échelle lui est aussitôt lancée et c’est difficilement qu’il grimpe à bord, sur cette anguleuse montagne ferrugineuse. La fatigue le gagne avec une telle force qu’il tombe dans un coma de sommeil lourd et vertigineux. Sa tête est dure, courbaturée de douleur, les muscles cervicaux semblent reproduire sous son crâne les mouvements d’une méduse et ses poumons aqueux rejettent continûment de la salive blanche, mousseuse et salée.
L’équipage prend soin de cet étrange homme au teint si pâle, dont on spécule qu’il est français sans en avoir la ferme certitude. Il n’avait pas dit un seul mot qui puisse le révéler. Cette étrange personne, comme projetée d’un rêve, arrivée entièrement nue sur le navire, en état avancé d’hypothermie, avait répété à l’envi, tout en se tortillant par spasmes reptiliens, une seule et unique lettre : B.
Il se réveille plus tard dans une chambre d’hôpital. Ses membres endoloris lui pèsent mais cette pesanteur, au fond, lui est très agréable car son corps paraît reprendre peu à peu une consistance sereine. Assez en tous cas pour qu’il réussisse à marcher et à sortir de là, rapidement. Il le souhaite. Des infirmières et infirmiers viennent à lui pour le raser, le laver, le couvrir, l’alimenter.
Peu à peu, il recouvre l’impression et l’émotion du corps : un corps qui perçoit successivement, au rythme de la conscience et de son flux, mais il réalise qu’il ne peut plus parler. Qu’aucun son ne parvient à sortir de sa bouche et cela depuis son réveil. Ses lèvres bougent mais aucun bruit n’en sort, pas même un cri, pas même un râle. Cela ne l’inquiète pas outre mesure car il n’a pas l’impression que ses phrases auraient pu dire quoi que ce soit. Certes, il sent les souvenirs remonter peu à peu, par vagues, lentement, mais n’ayant pas de vue d’ensemble précise sur son histoire, il ne sait pas pourquoi il est là ni qui il est. Quelle action, quelle menace, quelle culpabilité l’auraient ainsi forcé à plonger dans le néant massif de l’absence de mémoire, dans le trop-plein d’une mer noire dans laquelle il faillit se noyer ?
Tous les médecins qui l’entreprennent ne réussissent pas à lui faire cracher le moindre mot. Pas un. Seulement quelques gestes plus ou moins spectaculaires arrivent à grand-peine à signifier sa pensée pour peu qu’il en ait, si bien que certains, peu empathiques, le prennent pour un fou.
C’est avec ses mains, quelques gesticulations maxillaires et quelques mouvements oculaires qu’il explique aux infirmiers autant qu’au personnel administratif qu’il se sent mieux et qu’il doit quitter les lieux, qu’il se sent non seulement capable mais éprouve le besoin impérieux de sortir de cet établissement.
Le seul mot – qui n’est pas un mot – qu’il se souvient avoir dit est B. Il le prononça sur le cargo commercial pour la dernière fois, juste avant de tomber froidement dans un sommeil durant lequel il ne rêva pas. Ses pensées, sans pouvoir s’étayer sur des souvenirs, demeurent très pauvres, bien peu élaborées, primaires en quelque sorte. Il est, comme peut l’être un nourrisson, dans un état presque animal, guidé par ses seuls instincts et par de très riches impressions corporelles.
Il ne parle plus mais il est là, bien là et ses pensées étant rares et lentes, il n’en perçoit que mieux la réalité du monde extérieur, sa chair. Les odeurs, les matières, les sons et musiques, les couleurs, tout, absolument tout est relevé, comme épicé ou poivré et prend un relief particulier. La nature est là, avec lui, tout autour, même dans la grisaille du ciel ou dans la brique rouge de tel ou tel immeuble noirci de pollution.
Il est là et revient de loin, sans savoir d’où. En géométrie, on désigne généralement les extrémités d’un segment par A et B. Faudrait-il comprendre qu’il est arrivé à une destination, à un point B de son existence, par un seul mouvement et sans retour possible ?
Non seulement il a perdu la langue durant son voyage jusqu’au cargo mais le besoin d’écrire a disparu, lui aussi. En effet, la seule idée d’une feuille blanche posée devant lui, devant son stylo, devant le fait même de son amnésie muette, de sa pensée blanche, l’écœure tant la mémoire est habituellement source de la création. Et si elle n’en est pas précisément son origine, elle en est au moins son cadre nécessaire.
Quelques jours passent, il séjourne sous un pont, sans tracas, à côté d’un large fleuve, le climat est doux dans cette ville, sa clémence offre de généreuses touches de soleil chaud, même si les branches des arbres témoignent, par l’absence de feuilles, que l’hiver est là. Il n’a pas même besoin de couverture ni de vêtements supplémentaires. Ses pensées sont creuses et réceptives, sans mots ; il ne plonge pas pour autant dans quelque gouffre anxieux, une sérénité a été retrouvée dans l’imposition du silence, de son poids blanc. Même sans avoir grand-chose à déjeuner, sans avoir grand-chose à faire, à lire, sans avoir grand-chose à ressentir, même sans cela, il jubile, il réussit à jubiler des moindres détails perçus de la réalité environnante. L’eau passe à côté de lui, calmement sur son lit, l’odeur du limon, le bruit du doux clapotis, ses sens s’en repaissent.
Mais il faut gagner quelques sous, au moins pour que ce corps ayant tout juste retrouvé couleurs et textures, force et énergie, puisse vivre ; il s’agit de boire et de manger, de faire fonctionner toute l’économie interne de ses organes, de leurs mouvements vitaux. Il doit maintenant partir en quête d’un travail. Il lui faut de l’argent pour faire vivre ce corps, pour assurer sa pérennité, sa durée.
Malheureusement, il sait par avance qu’il lui sera difficile de convaincre un employeur de sa capacité de travail, de sa droiture et de sa loyauté. Comment le pourra-t-il, aujourd’hui muet ? Comment séduire quelque patron que ce soit, avec pour seules expressions de désespérés mouvements de bouche et de bras ?
Malgré cette difficulté, il se rend chez un fleuriste, le premier qu’il trouve, là, entre une bouche de métro et un cimetière. Il aime les fleurs, pressent qu’il les a toujours aimées, mais le patron de la boutique le considère avec hauteur tout en le scrutant, inquiet, comme on surveillerait un illuminé mettant les pieds dans son intimité, sans doute parce qu’il le voit caresser – de ses doigts affamés et de ses lèvres tremblantes – quelques pétales de rose et tulipe dont la matière soyeuse paraît aussi sensuelle que du velours à grain fin.
Encore un de ceux qui prennent les végétaux pour des remèdes contre la vieillesse, ou comme des sources d’extase, se dit le fleuriste avant d’inviter impérieusement notre homme à sortir.
Il se produit ainsi dans de nombreux magasins, mais jamais ne convainc. Selon toute vraisemblance, les expressions du corps ne donnent pas confiance, elles effraient. La bienséance voudrait que seuls les sons, invisibles et ainsi mieux acceptés, expriment les pensées. En société, le corps est un secret, une cachotterie, une invitation silencieuse à satisfaire le désir animal – plus tard et ailleurs, en cachette, chambre fermée et lumières éteintes. Lui n’avait que son corps de chair, de salive et de suc, intolérable pour les autres – et sa pensée était pauvre et primaire, sans mémoire.
Il ne veut pourtant rien de mal, il ne veut provoquer aucun désordre, il ne cherche à proposer ses services que pour de modestes tâches manuelles ne nécessitant pas la parole. Il n’ennuierait personne.
Ce matin, son corps et son ventre commencent à lui faire mal, il n’a pas mangé depuis quelques jours. Il a toujours été relativement trapu et bien bâti mais le manque de nourriture, surtout en milieu urbain, l’avait allégé de beaucoup de sa graisse. Naturellement voûté, il le paraît davantage aujourd’hui tant la fatigue pèse massivement sur son dos. Encore quelques jours sans se nourrir et ses cheveux blond paille commenceraient à tomber par paquets, même si une désagréable calvitie lui avait fauché le dessus du crâne les trente ans échus et qu’il ne lui restait alors sur la tête qu’une touffe amoindrie et désorganisée.
Errant et après plusieurs longues heures de marche, traînant encore les frusques trouées qu’on lui avait données à l’hôpital, il se rend dans une poste, un bâtiment qui y ressemble, dans une banlieue éloignée de l’effervescence du centre-ville. Une bâtisse immense, type colonial.
Ce doit être un monumental centre de tri, tout fait de tôle et de briques grises et rouges, à l’anglaise. Dans quelle ville a-t-il pu échouer d’ailleurs ? Il ne sait pas. Il ne se sent pas perdu pour autant. Il est persuadé d’être sur une île. Cette idée le rassérène. Oui, le plus important à ses yeux est qu’il se croit sur un morceau de terre, entouré d’eau, d’océans gigantesques. Il aime cette hypothèse géocentrique, il aime se sentir, comme Robinson, au centre de tout et de nulle part, il savoure l’idée de s’être échoué sur un bout de terre sans sens et sans mémoire, comme lui. L’anxiété n’a jusqu’alors pas encore siégé en son crâne, ni assiégé sa conscience évidée du moindre souvenir. Il arrive à jouir du vide, sans doute parce qu’il ne doute pas de son corps, cette enveloppe sans désir élaboré, sans pensée savante.
Il pénètre dans le hall du centre postal, toujours à la recherche d’un menu travail, même payé à la journée, même pour quelques pauvres sous ; il ne discutera pas, il est bien trop affamé, il sait que pour vivre, ou survivre, il faut se donner, donner de son organisation, donner des parts de vie quitte à se perdre soi‑même. Il le sait, comme primitivement.
Un homme s’approche avec bienveillance, son regard est doux et les mouvements de sa bouche sont calmes. Cet endroit doit manquer de personnel car il y règne un silence ecclésiastique. Par tous les moyens, il s’agit de lui faire comprendre l’urgence de sa situation, il deviendra bête agonisante si personne ne l’embauche. L’homme donne de son temps pour tenter de comprendre son désir, fait de mimiques, de grincements de dents, de main à la bouche. Il a faim. L’homme est immense, filaire, rouge écarlate, osseux, une tête étrange, tout d’angles et de traits clownesques.
Avec ses mains, ses bras, ses yeux, avec toute la détresse de son corps tordu par la douleur de la faim, il réussit à faire comprendre à l’homme – assez facilement semble-t-il – qu’il a impérieusement besoin d’un travail pour subvenir à ses besoins, se nourrir surtout.
L’homme doit être coutumier des difficultés des muets, des aphasiques, des incompris car il demeure dans un silence respectueux, calme et circonspect, il paraît de bonne volonté et à l’écoute.
D’un geste lent et aimable, il lui propose de venir avec lui, de l’accompagner. Par là-bas, vers cette grande porte en bois.
Après avoir traversé des antichambres, des vestibules, des pièces sans emploi précis, ils parviennent tous deux à une sorte d’entrepôt gigantesque où s’étalent pêle-mêle des milliers et des milliers de lettres, certaines ouvertes, d’autres pas ; ils s’arrêtent et se regardent d’un air curieux. L’homme, qui n’avait pas encore dit un seul mot, qui n’avait fait qu’écouter et regarder son interlocuteur gesticulant, qui n’avait fait qu’acquiescer de la tête pour signifier sa compréhension respectueuse, l’homme respire maintenant aussi longuement que lentement, avec concentration, et commence une phrase sans l’achever :
– Bé-bé-bé-bé…
L’homme du tri postal est complètement bègue.
– Bien. Voi-voici le ce-ce-centre où ne son-sont pas encore ar-ar-ar-archivés les NNNN PPPP AAAA IIII (N’habite Pas à l’Adresse Indiquée), envoi-voyés vo-vo-volontairement-ment ou pa-pa-pas.
Il observe le Bègue attentivement, surtout dans les temps longs séparant chaque syllabe.
– Il, il, fau, faudra, les cla-cla-sser, par grand grand thème : les envo-envoyeurs sont, sont, sans, sans, sans imp-importance.
Il ne sait quoi lui répondre. Il est enfin là, arrivé, au milieu de milliers de traces et d’absences sans personne d’autre que lui pour les voir.
– Si vous commencez à, à, à, tra-travailler main-maintenant, vous av, aurez un temps d’a, d’a, d’a-d’a-vance.
Surpris par ce propos sibyllin qui fait remonter en lui de vieux souvenirs non verbaux, juste des impressions, il se retourne, pivote, comme cherchant des yeux quelque chose dans l’immense pièce entièrement faite de tôle grise.
Il s’assied sur une chaise en chêne très xixe, proche d’un meuble de même style, et le Bègue qui semble avoir saisi l’urgence de sa faim, sans doute à la vue de sa faiblesse, lui apporte des fruits, du pain et de la viande cuite. Il en pleurerait.
Il ouvre ensuite un premier courrier sur lequel ses yeux tombent absolument par hasard dans l’océan gigantesque de piles de papiers. Dans l’enveloppe, un étrange poème manuscrit, non signé.
Facile l’esprit
Sauf que l’anguille est fuyante, ce n’est pas qu’il y a dédoublement, c’est juste que la main ne saisit pas et l’os de l’œil se fracture
L’aveugle (cécité par peur) ne perçoit aucun détail, et vit comme cochon d’Inde ou souris du désert chantant la lune, ses oreilles se ferment, la lettre de l’esprit fait mouche
Ou trace
Cécité par cœur est plus évoluée, c’est connu, car elle dégage un espace pour l’autre mais elle s’arrête à lui, la mélancolie
Dessine
Le paysage de la promenade
L’idée (pour quitter l’idée) serait de voir
Et la lettre et l’esprit sans que l’un implique l’autre
Y aurait-il raison meurtrie ?
Le rapport sauverait la raison, c’est ce qu’ordonne l’actualité
Vivre l’esprit
Quel qu’il soit
Sauverait l’esprit (ou l’anguille)
Quel qu’il soit
Mais le « Qu’importe » est simplement dangereux, annonce l’anguille
Le soufflet ranime les braises périssables quand la lettre est trouvée
Le mot important est « trouvée »
Car il n’est pas
Trace
Même si le mot fait mouche
Trouvée dans la foire aux détails,
On y vend, on y achète, on y troque
Tous les détails
Qu’ils fassent paysage ou pas,
Quel que soit l’aveuglement de l’aveugle,
Quel que soit son arrêt,
La lettre glisse entre les mains,
C’est l’anguille, la bonne,
Cette fois-ci, trouvée
C’est-à-dire imprononçable
C’est pourquoi les bègues
L’esprit de la lettre apporte une autre lettre, dans sa fuite, et fuite encore, ça bouge, ça bouge encore et dit l’esprit ; par cœur, l’espace est formé mais si l’aveugle ne peut voir que le paysage, il ne pourra prendre avec lui son corps pour d’autres territoires, c’est chose dite, et arrêtée. Il sera l’amoureux du monde pendulairement arrêté.
En fait, tout dépend de l’ouverture, faudrait toujours laisser une évacuation
« Faudrait » mais je ne me permettrais pas de juger le monde
Pour que l’eau coule et que l’anguille passe, faudrait laisser un interminable trou
« Interminable », voudrait dire que
Celui qui écrit ces mots n’est pas
Pas plus que ceux qui les liront
Or le monde est fait de telle sorte que l’esprit croit en la langue
C’est-à-dire son arrêt et les canalisations se bouchent dès lors que l’on prend « trouvée » pour ce qu’il n’est pas
Car ce n’est pas parce que l’anguille a un corps qu’elle ne fuit pas
Le corps de la fuite est une belle chose
À étudier
La pensée a un corps, fait comme une lettre
Fait comme un chiffre dans mon cas,
La lettre 23
« Trouvée » sur le nombril de l’origine
Le détail est une figure floue
Le seul conseil que je vous donnerais
Serait de ne pas laisser la mouche s’y poser
Car le corps de l’anguille s’épaissirait
Et le monde apparaîtrait
Ce qui ne peut laisser la fuite indifférente
Il replie délicatement l’étrange lettre, la range dans son enveloppe, sans destinataire ni expéditeur. Il répète en lui la phrase : « Il sera l’amoureux du monde pendulairement arrêté. » Il la trouve très belle. Cette phrase l’éblouit.
Il lève les yeux vers les montagnes de papiers qui l’entourent. Il laisse sa pensée archaïque et pauvre se déployer au gré de l’atmosphère aérienne du lieu, au gré de l’esprit qu’il inspire.
« Autant d’ojets qui n’arrivent pas… et n’arriveront jamais nulle part », pense-t-il librement, retrouvant des mots, des formules de pensées, même confuses, comme oniriques, « c’est comme un lieu tiers, une sorte de nulle part réalisé ». Comme une île.
« Ah, c’est un bel ojet que cet entrepôt, un beau lieu pour les pensées.
Comme libres. »
Il lève la tête vers le plafond, ses paupières presque refermées, à demi, le regard se perd dans le gris de la tôle.
Hébété et sans grand sentiment, il se prend à rêver, comme perdu, divaguant, avec des mots qui ressemblent à des images, avec des images qui se font pensées.
C’est ainsi qu’il avance dans l’obscurité du souvenir, peu à peu levée, étranger à toute responsabilité, à toute culpabilité, d’être ou de ne pas être là où il faudrait, ou ce qu’il faudrait.
Comme un enfant exécrant tous les scandales. Comme un enfant haïssant toutes les histoires car elles ont toutes une fin, portent en elles le germe de leur propre fin.