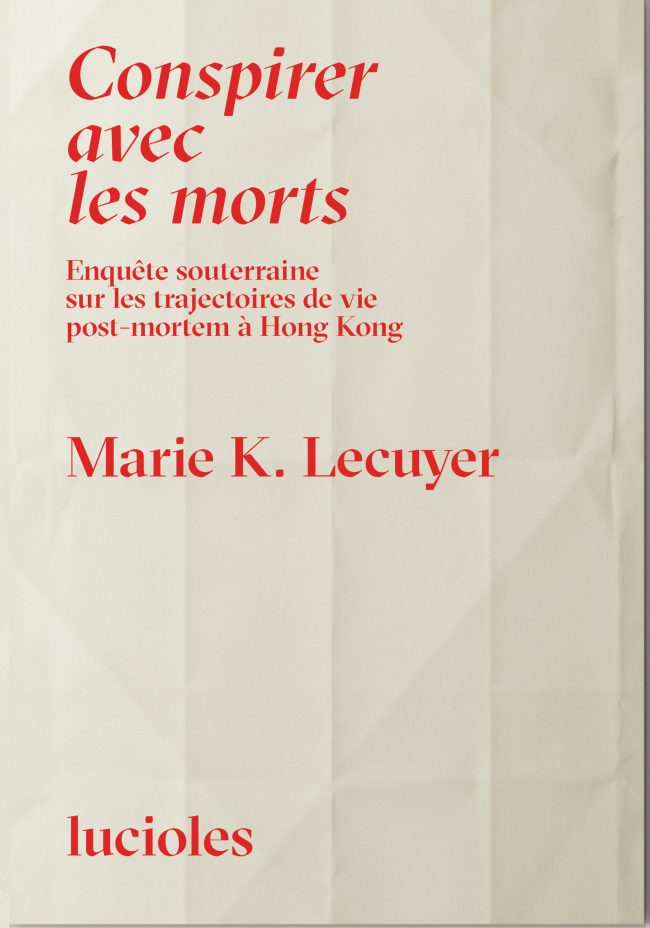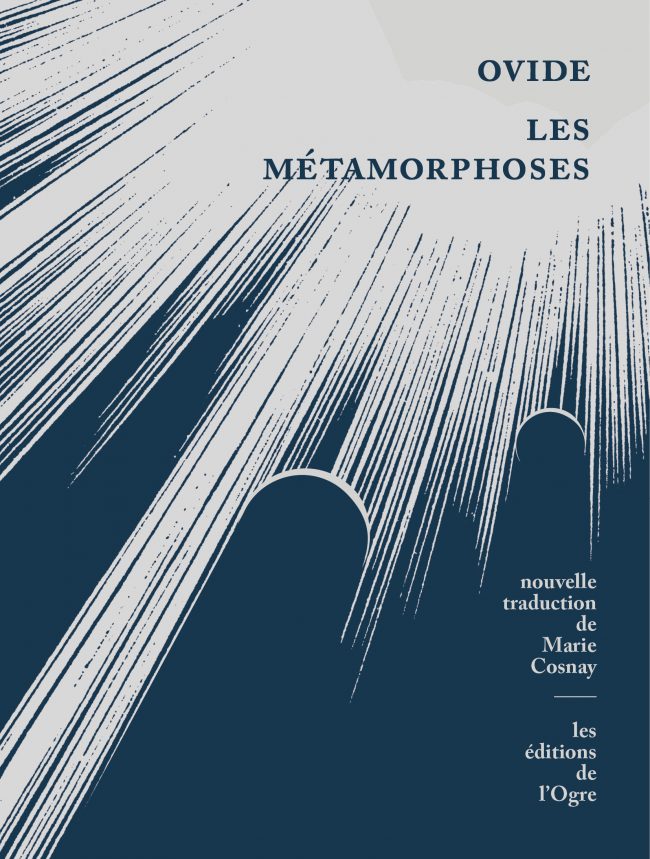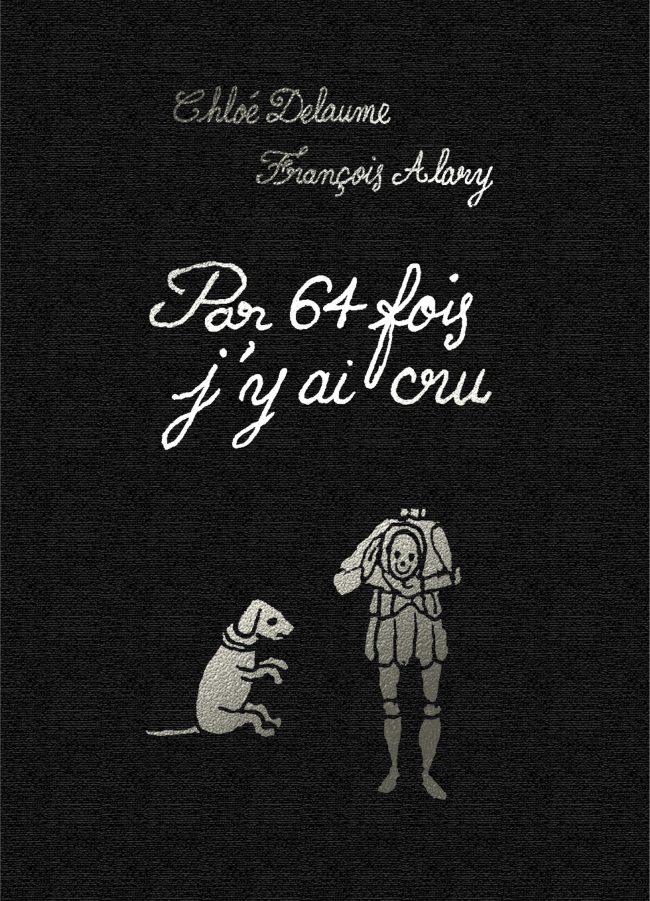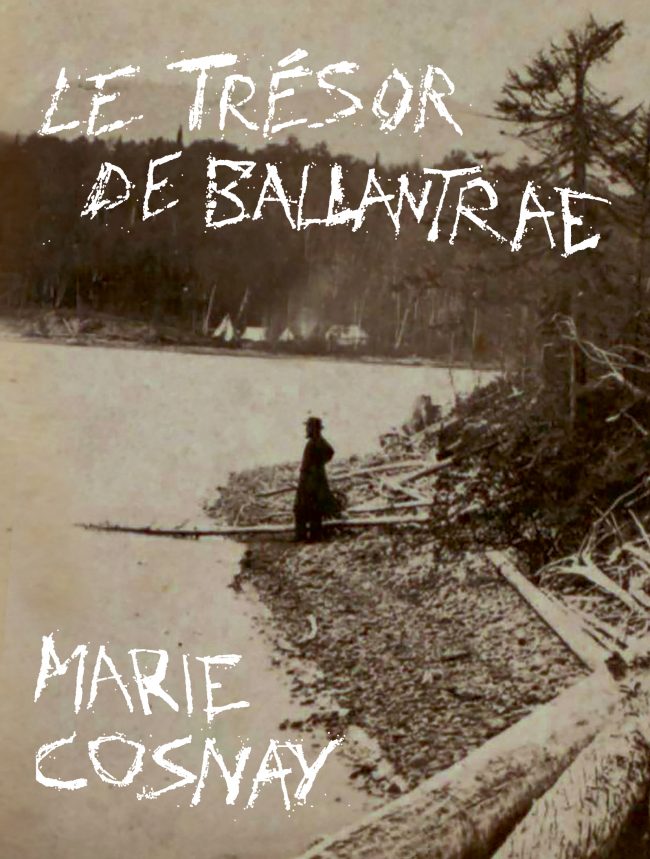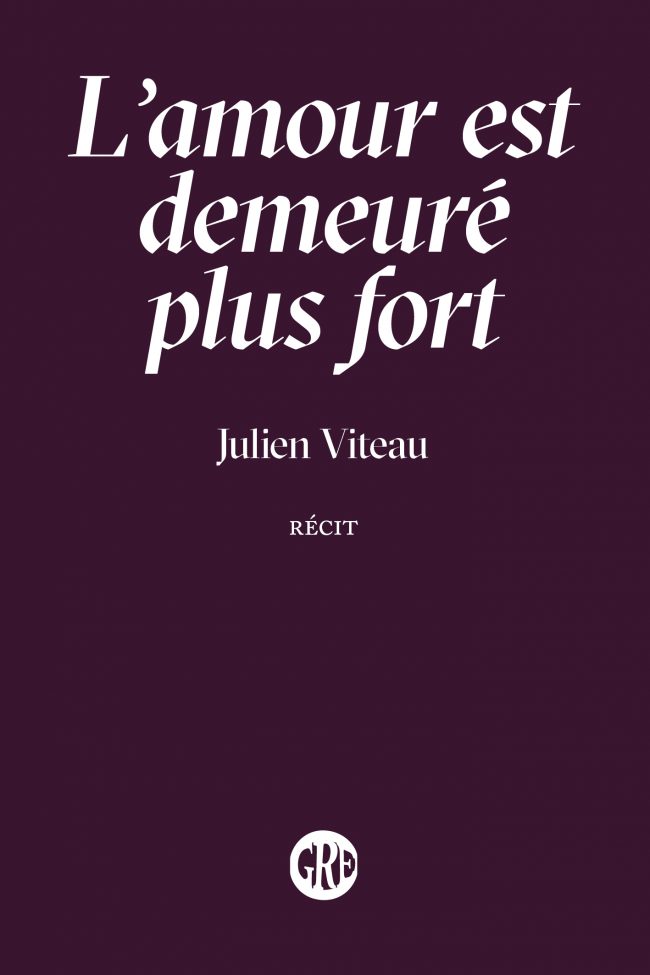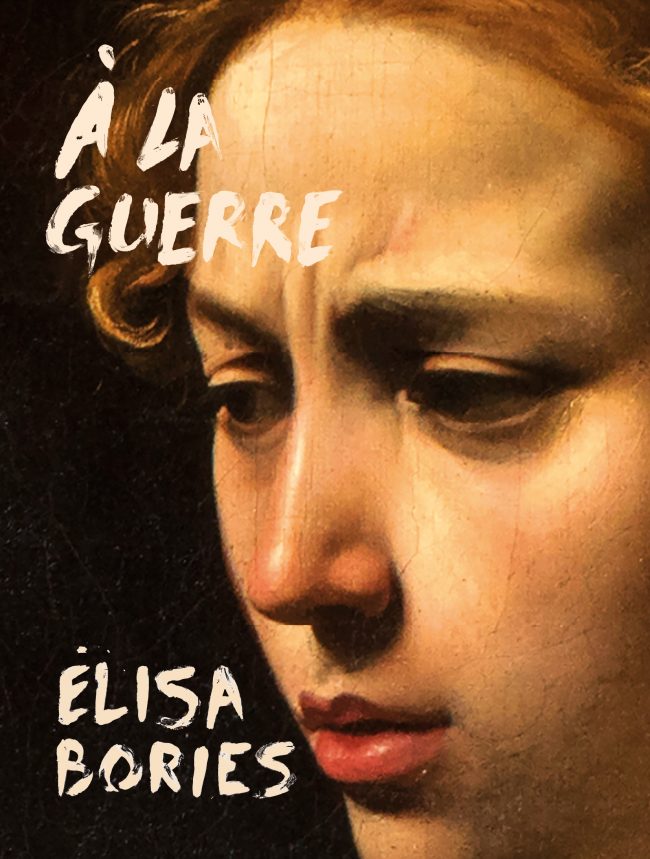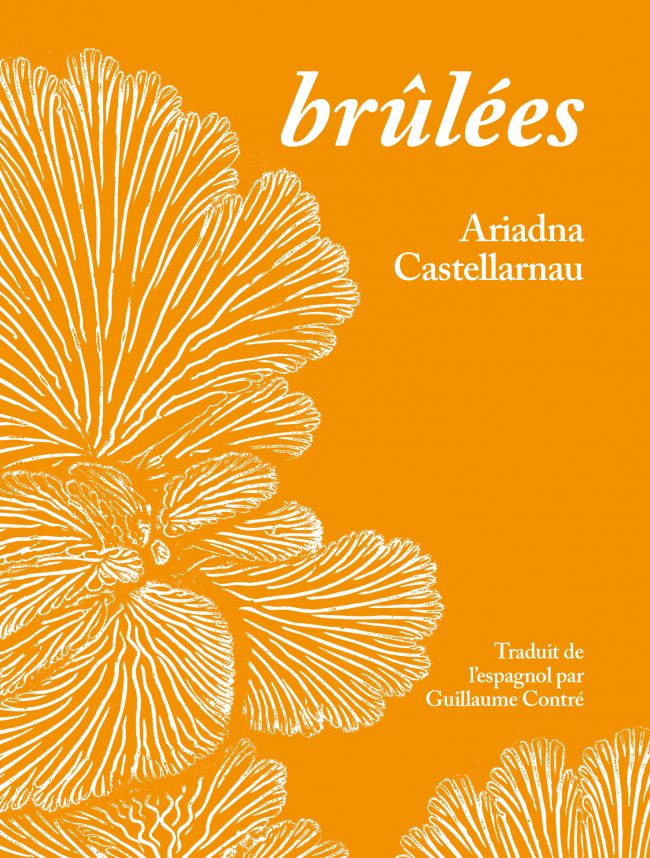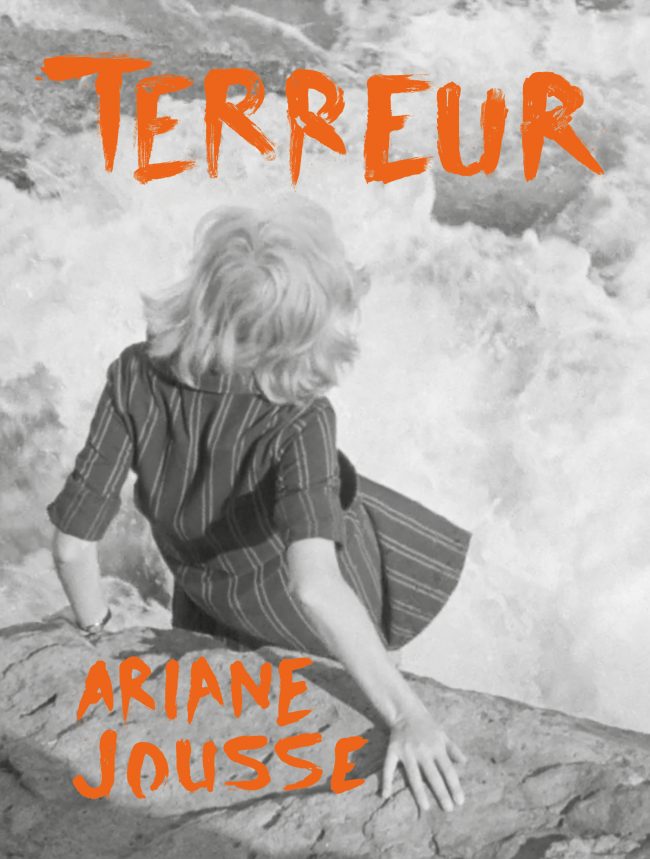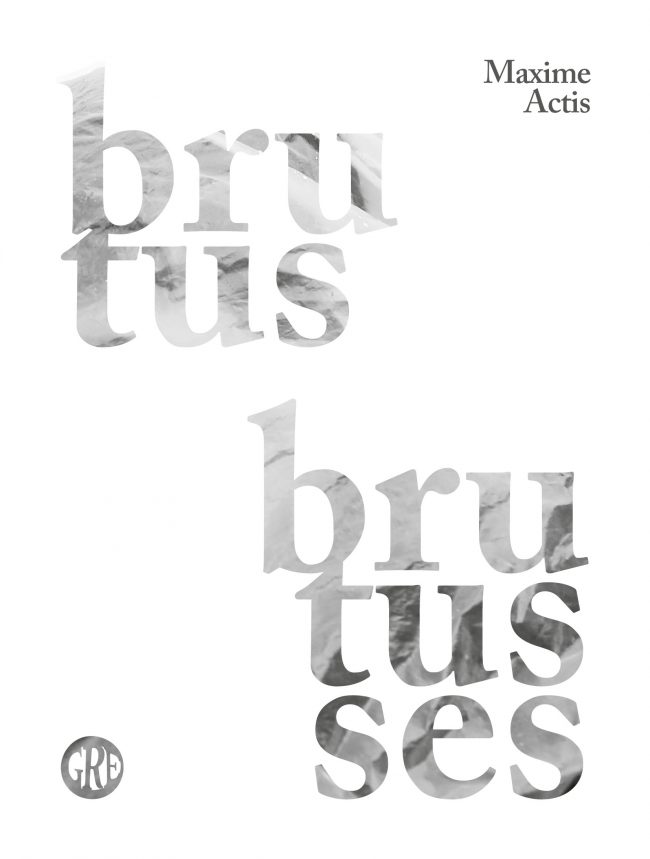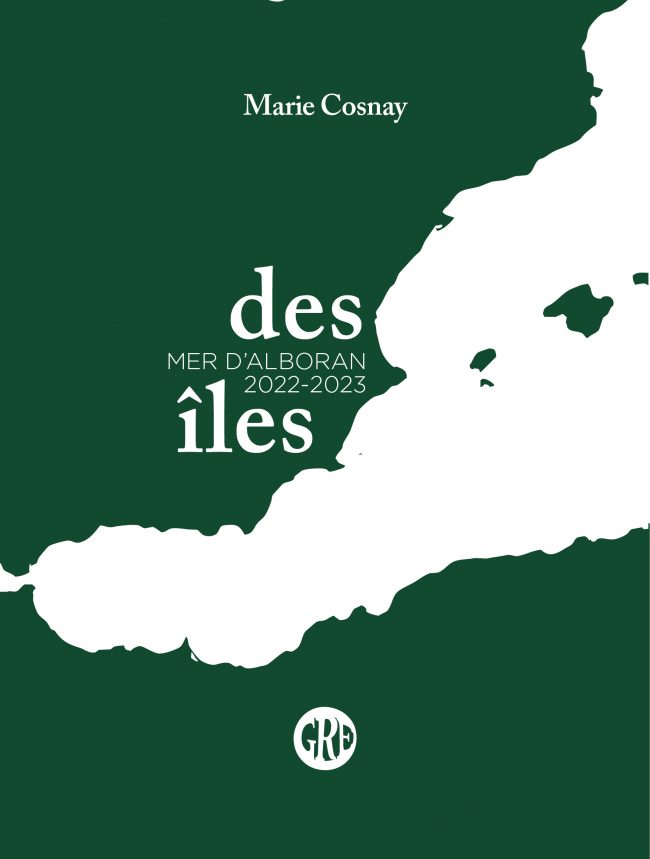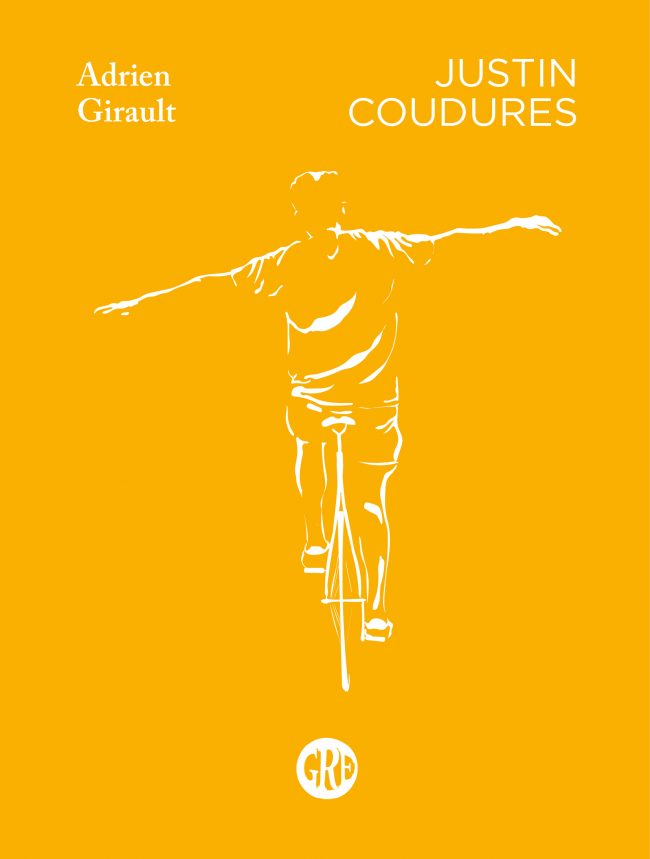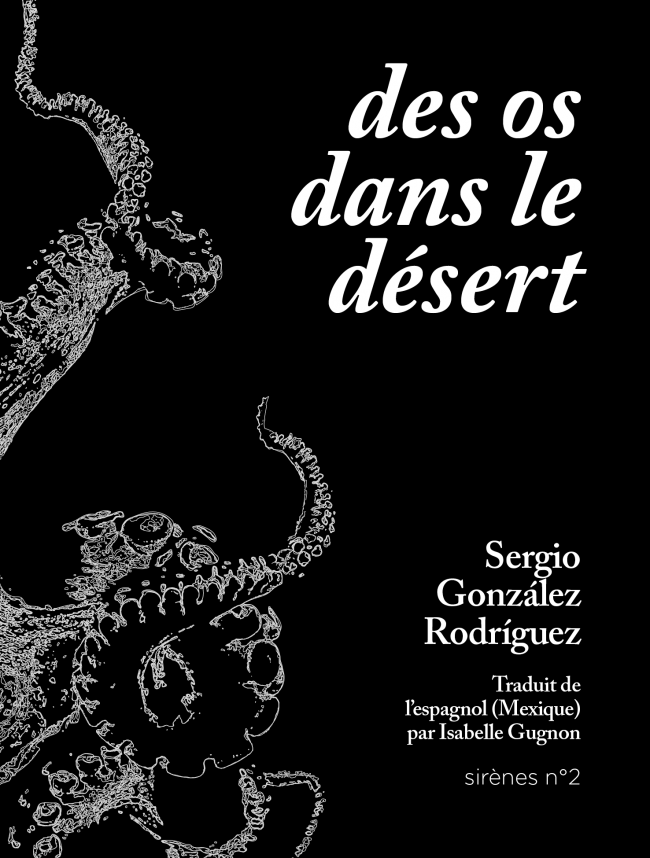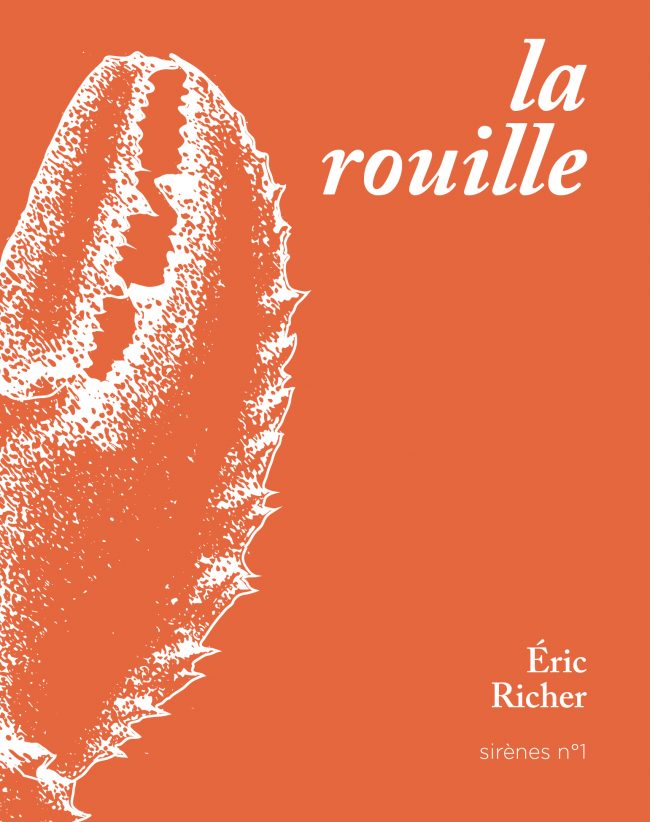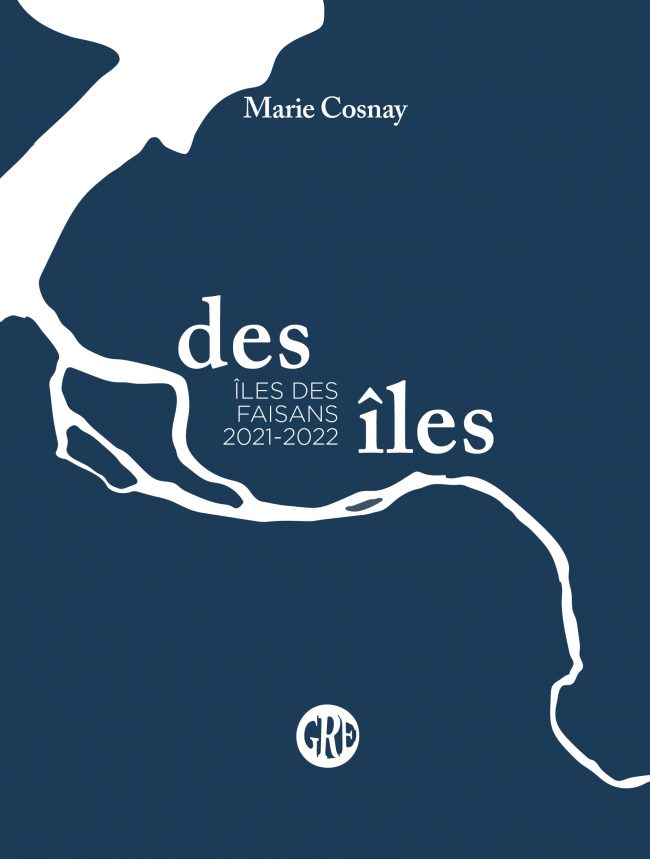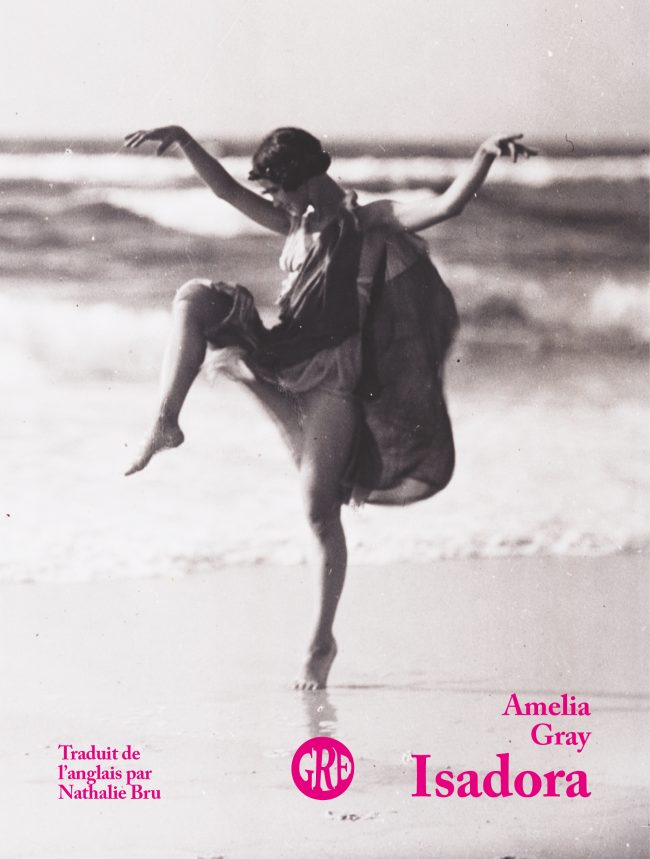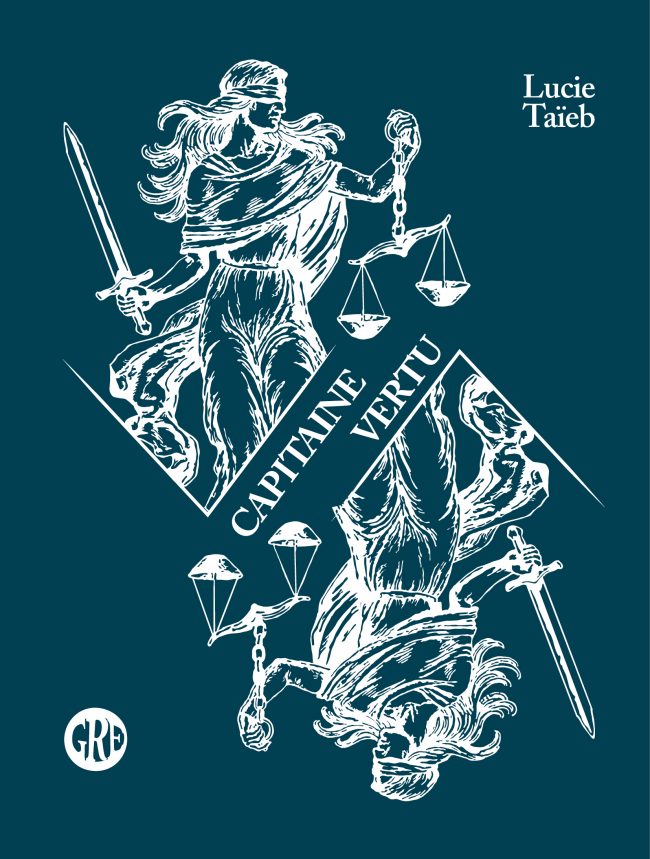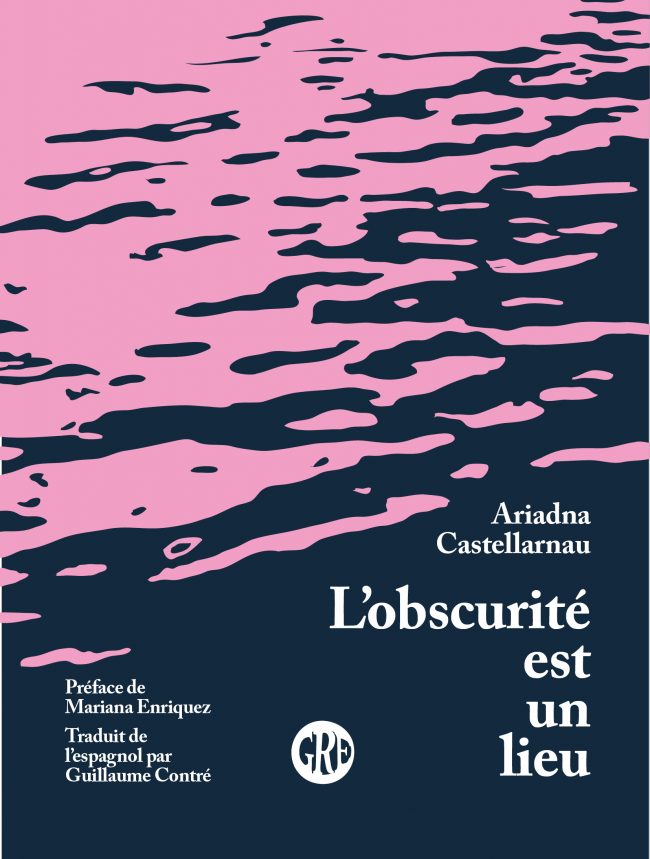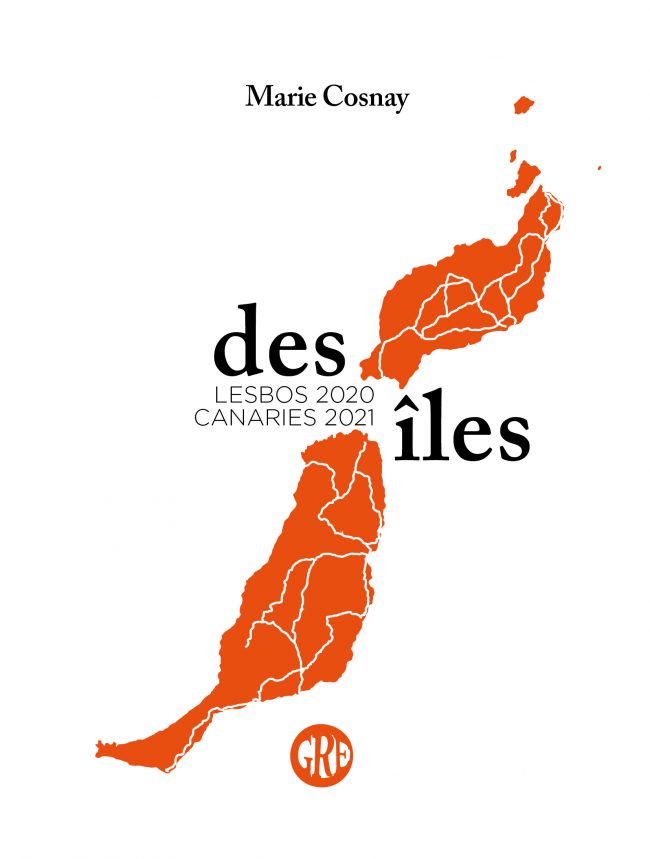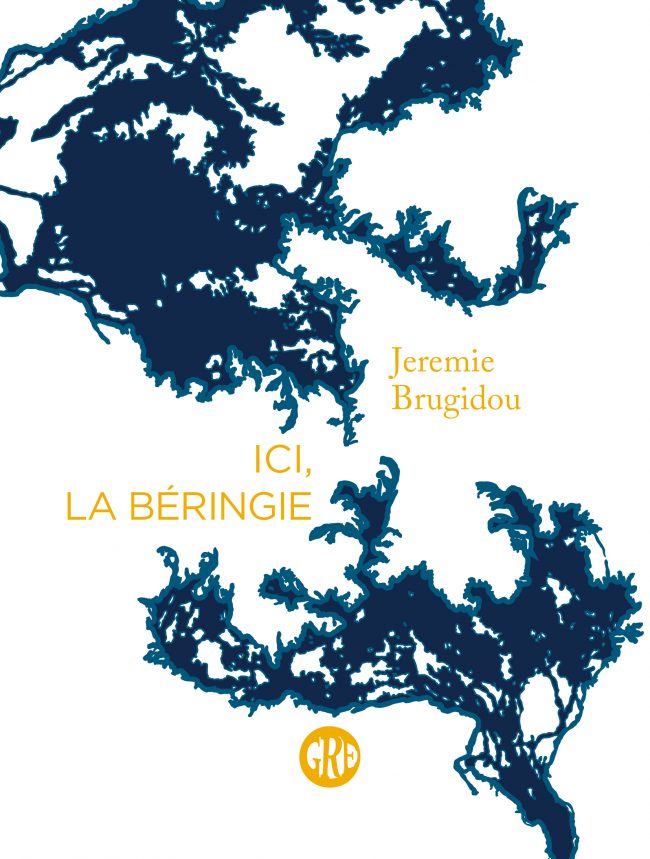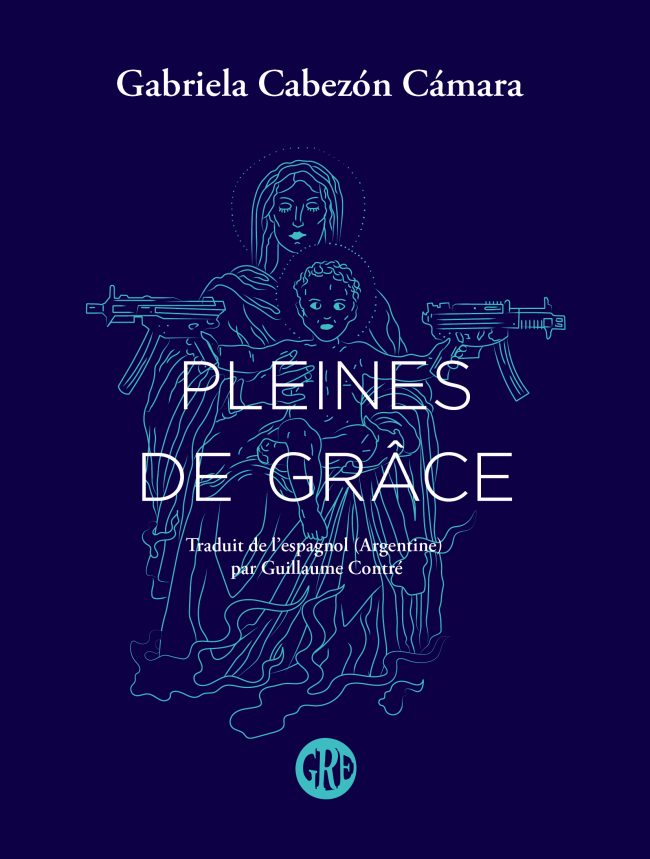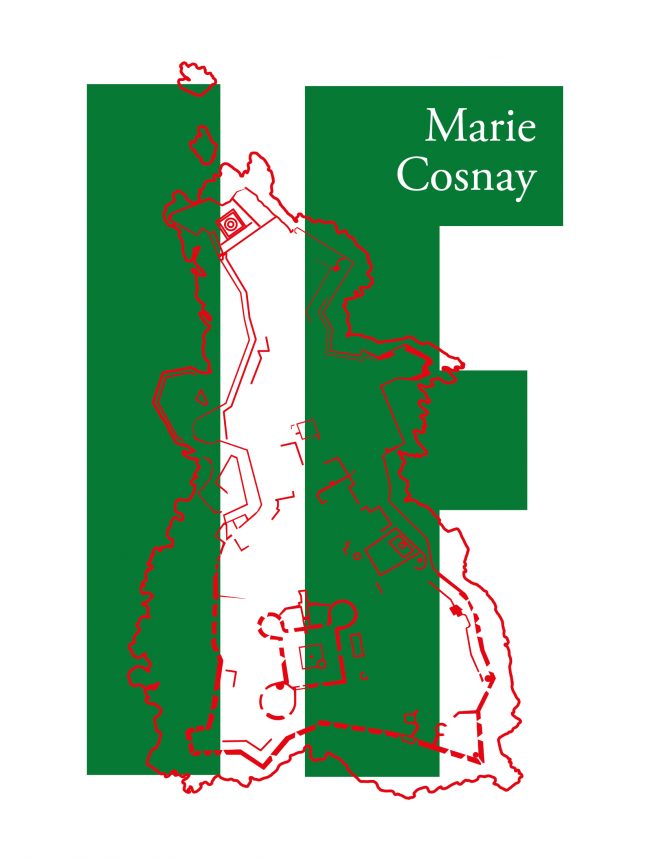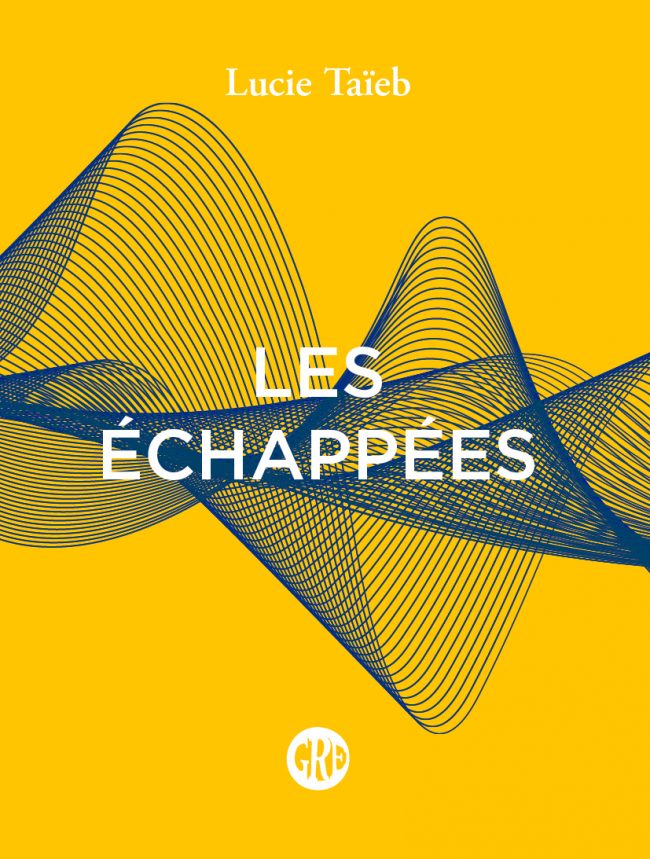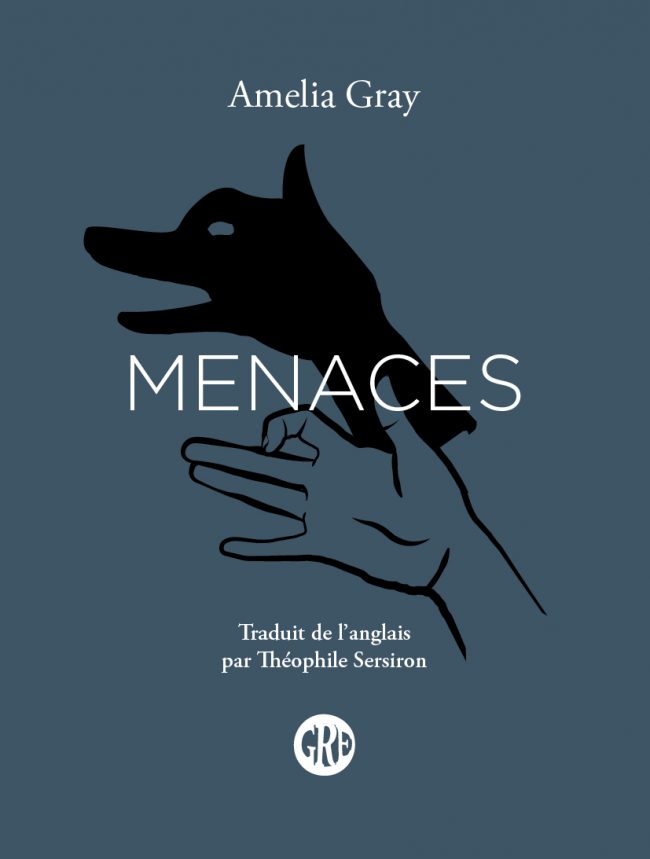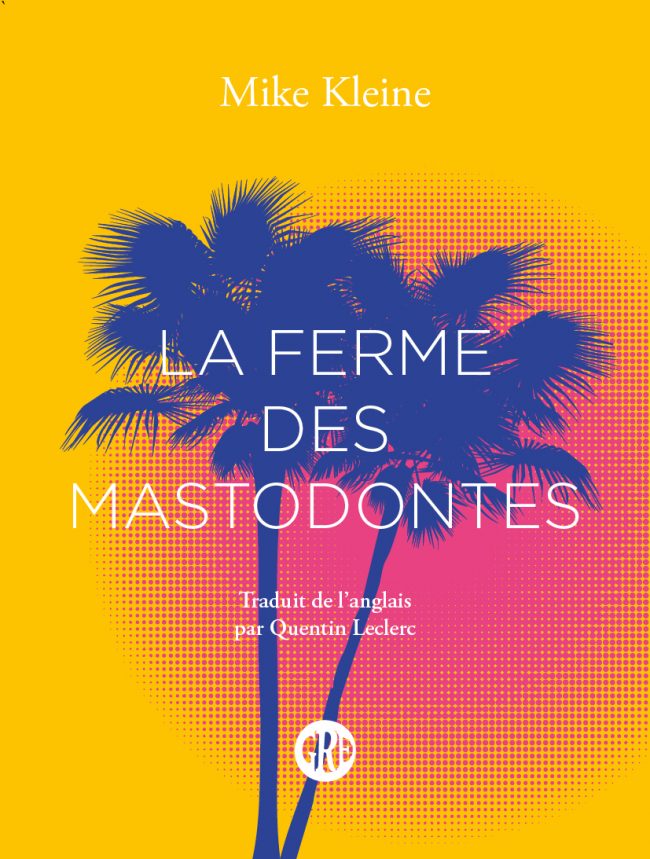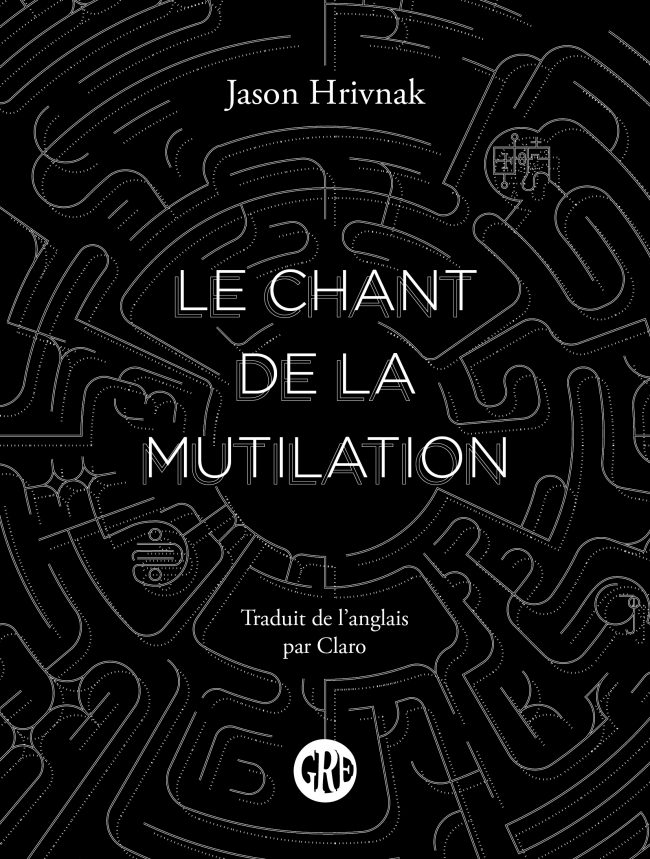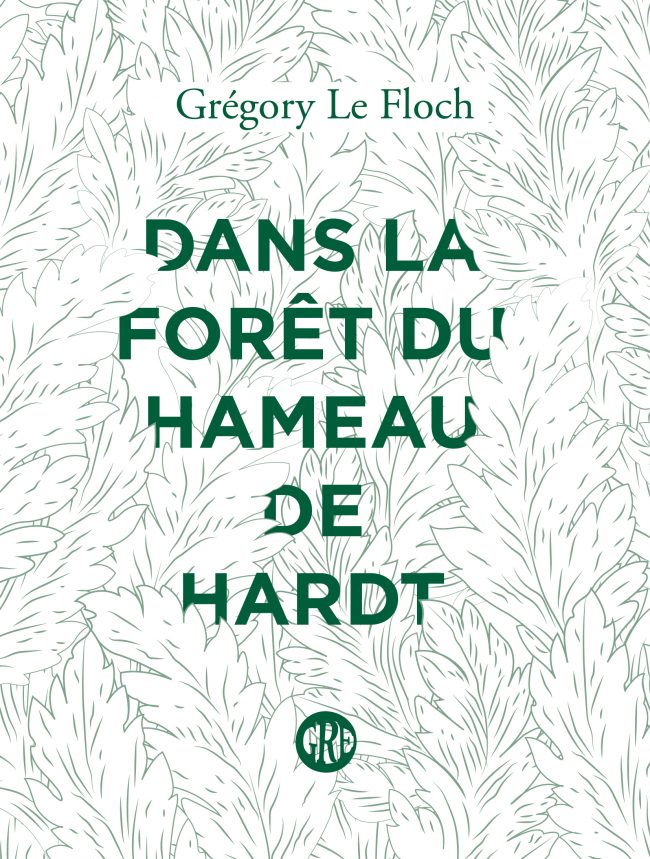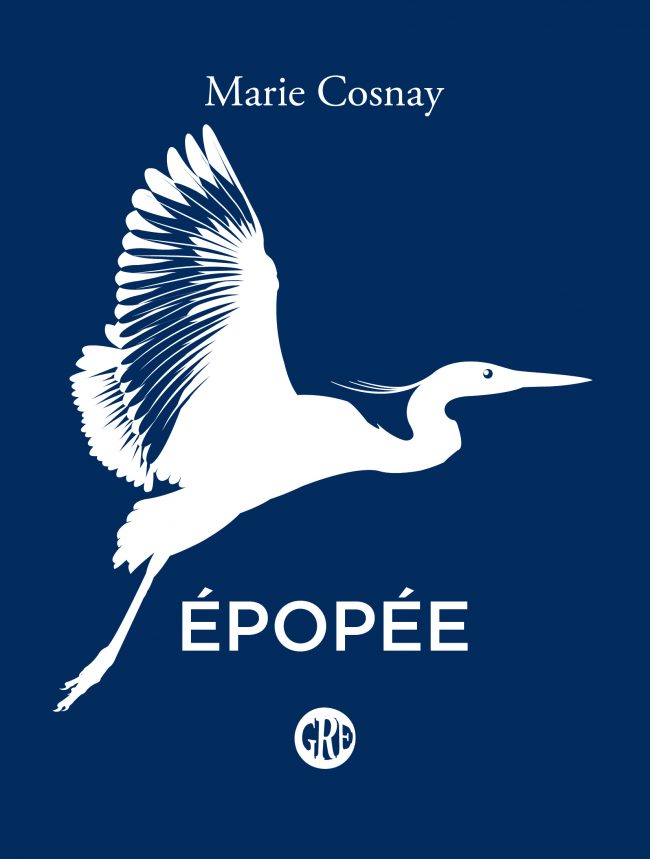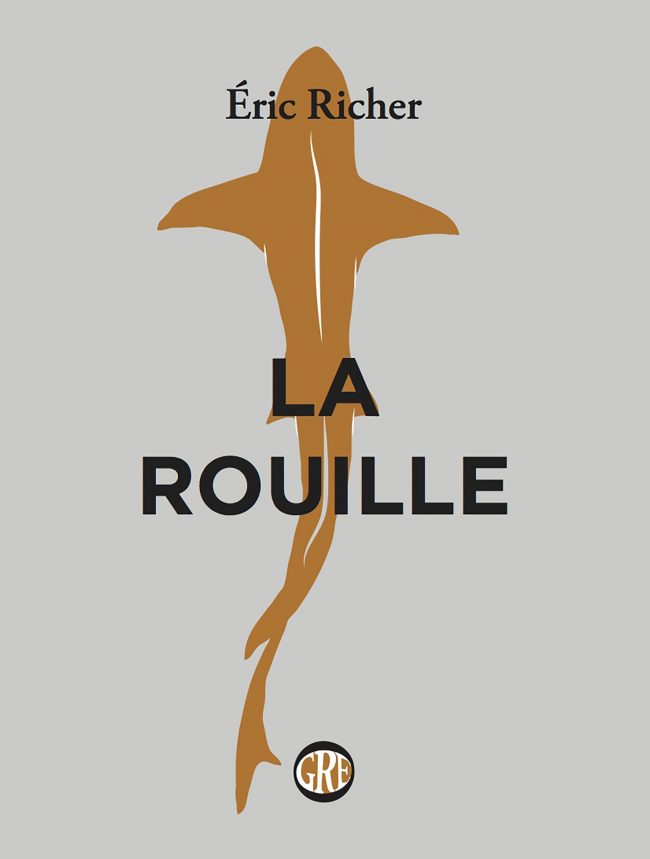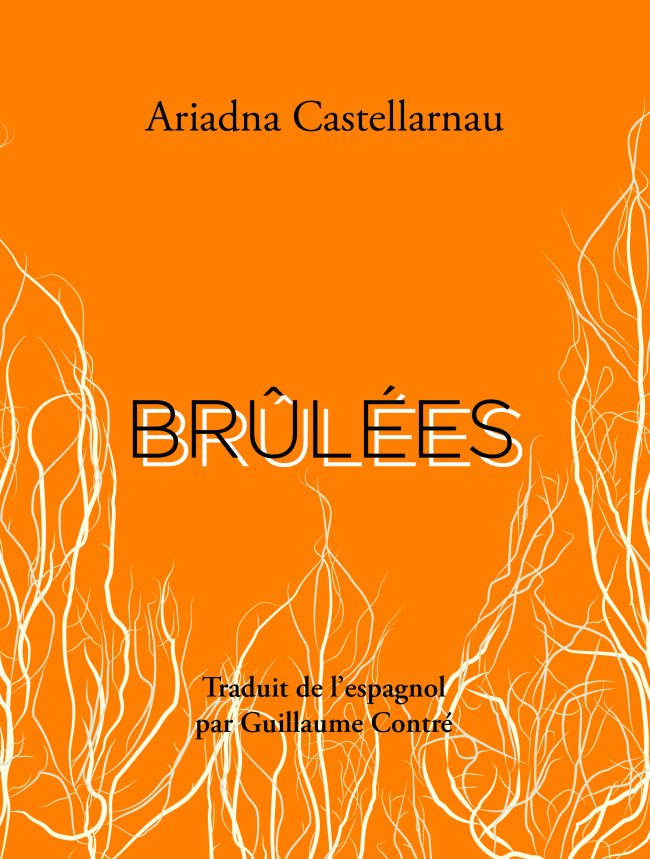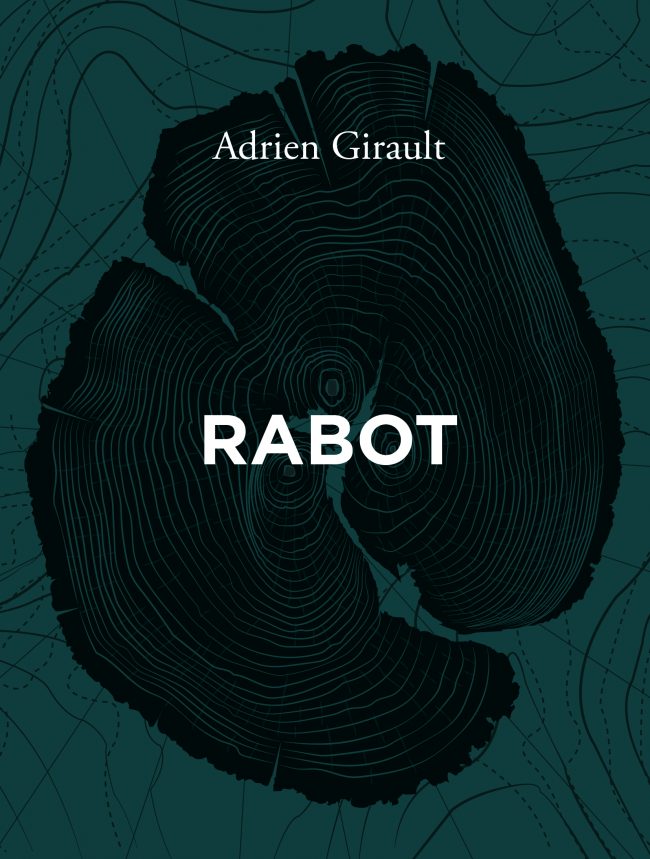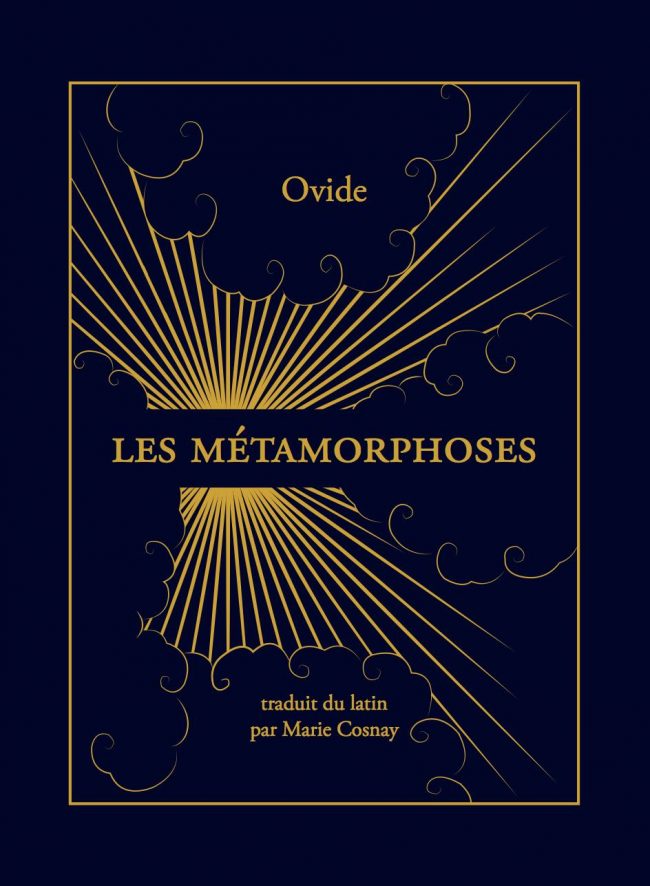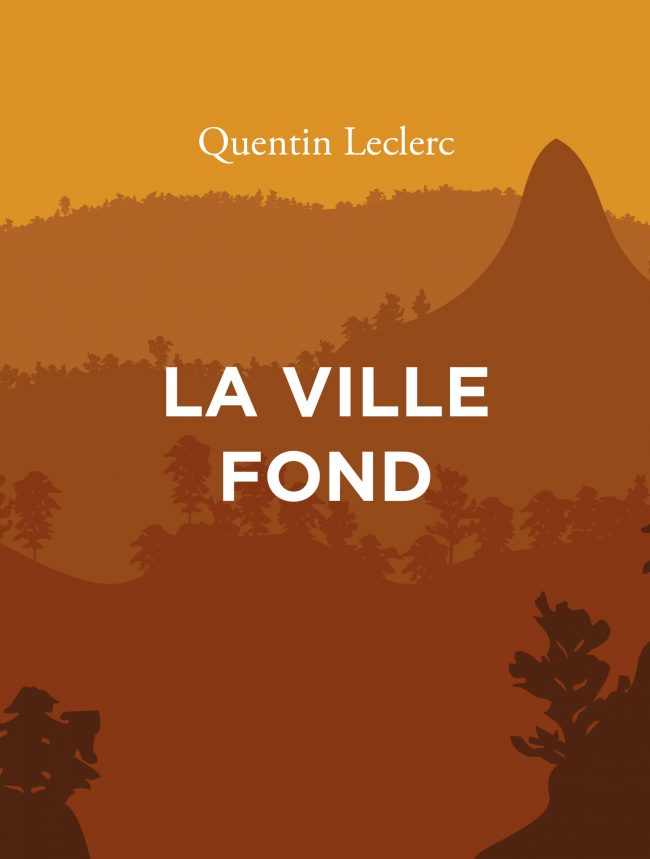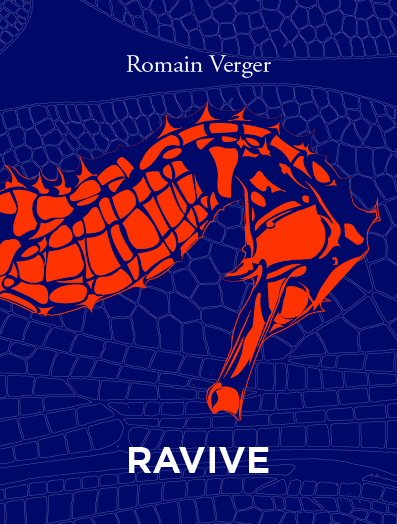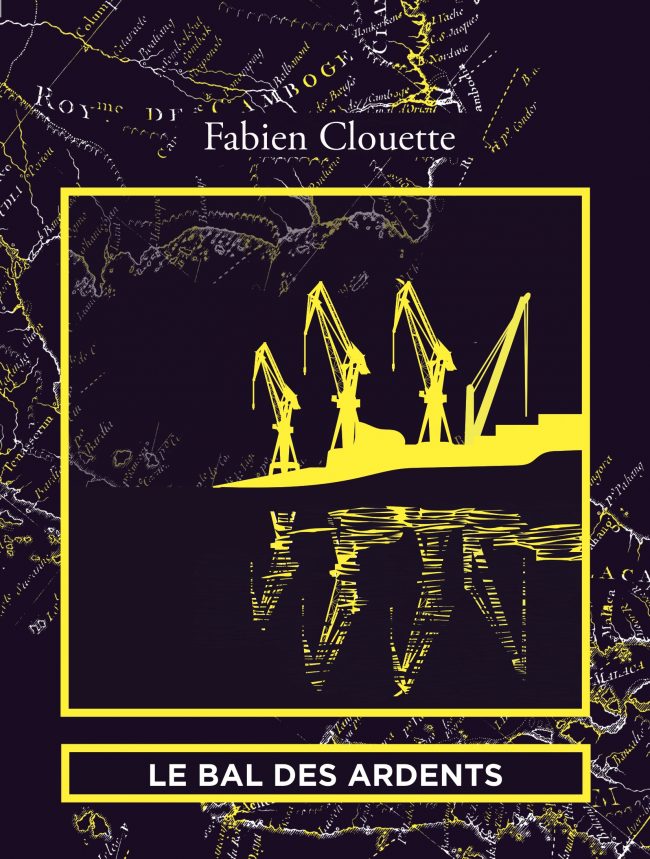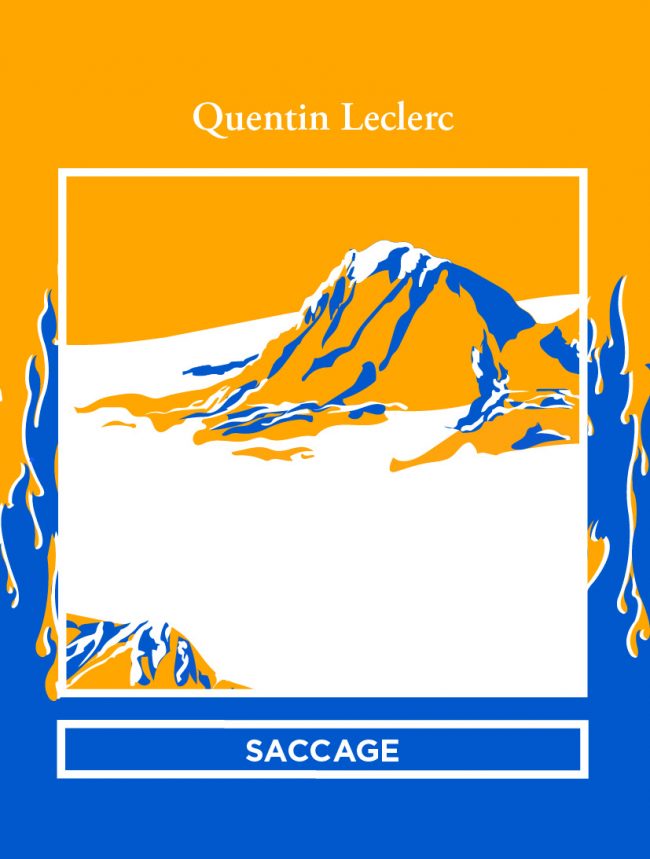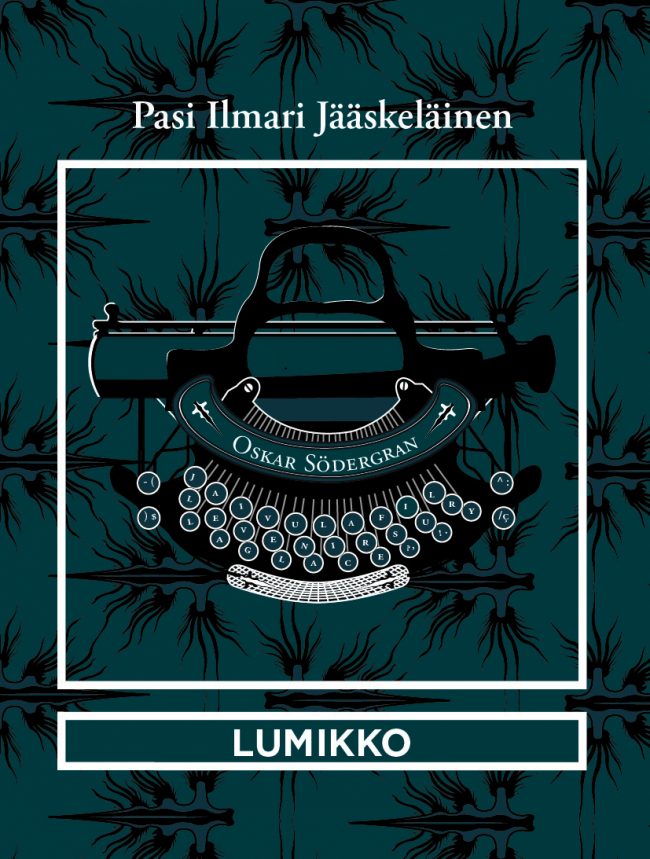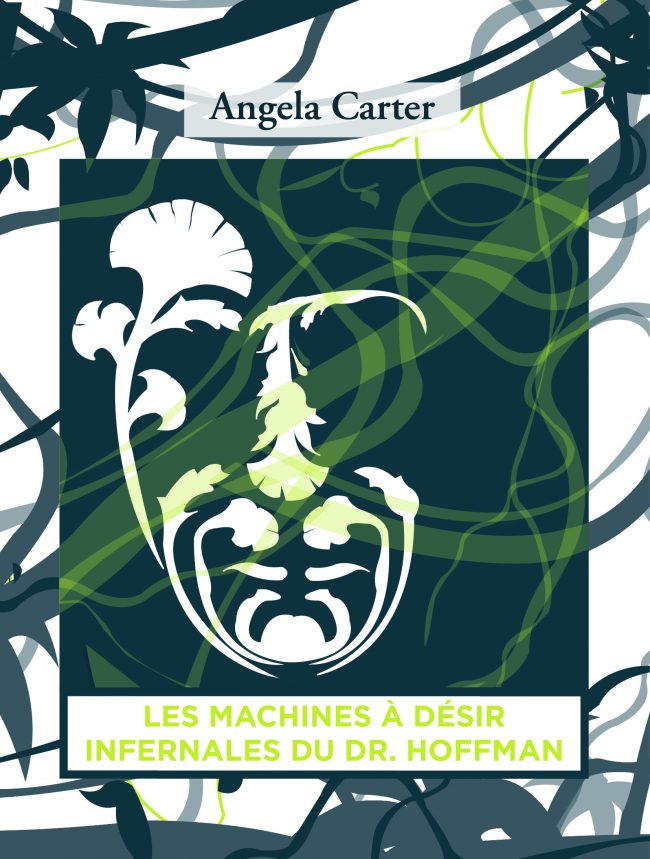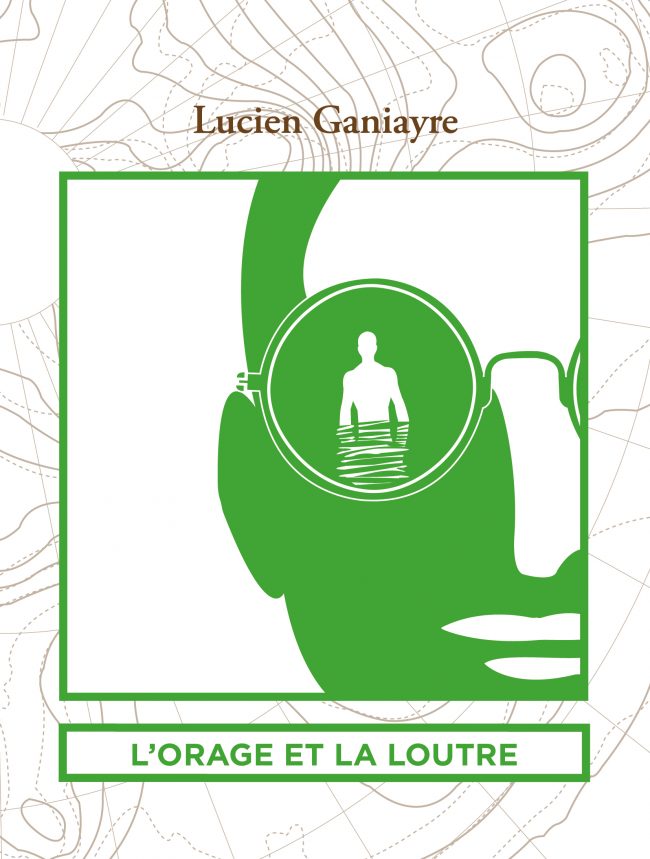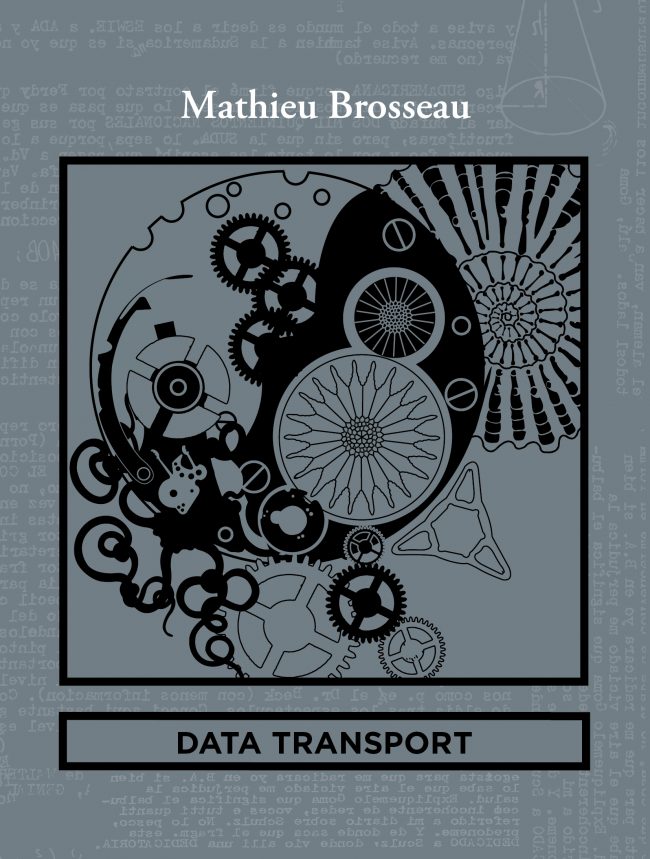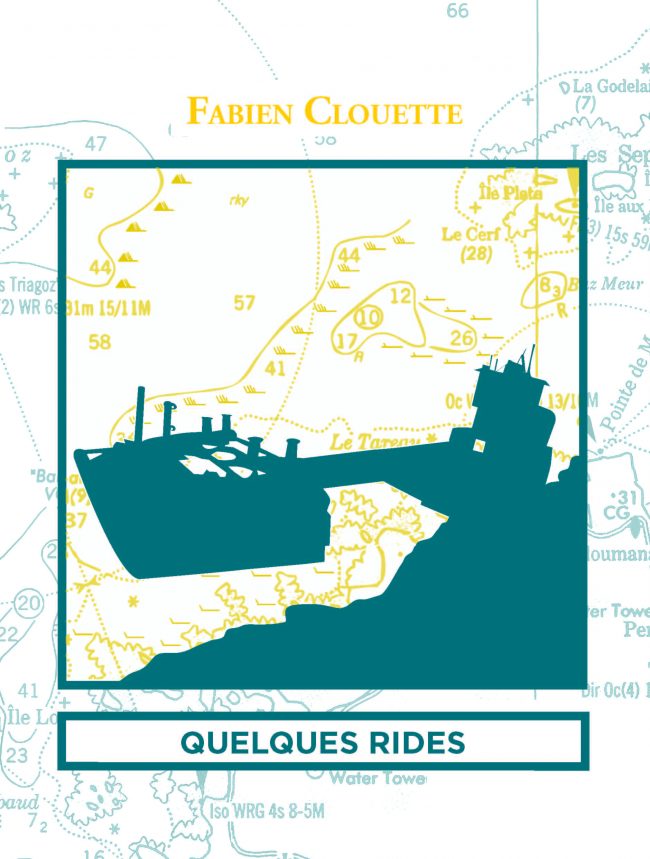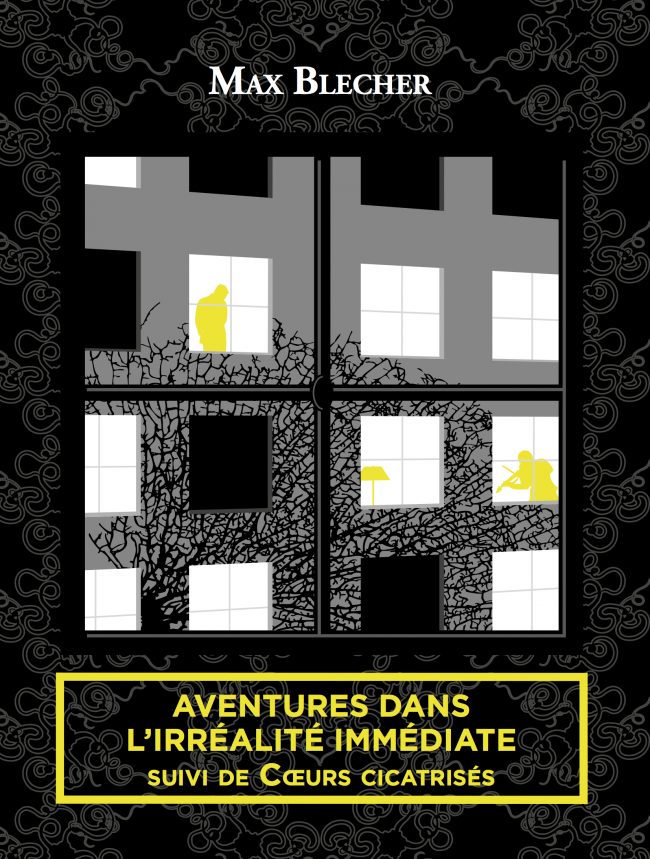Dans la maison qui recule
OGRE N°3 – Maurice Mourier
Dans la maison qui recule
jeudi 05 mars 2015
Taille : 14/18,5 mm – 250p. – 19€
ISBN : 979-10-93606-02-6
Dans un futur proche, dans une région incertaine (mais évoquant fortement les Cévennes), un jeune journaliste – le Jeune Homme Blet – cherche à pénétrer une communauté fermée, une forteresse, pour y rencontrer le Saint, prétendu guide spirituel qui a su préserver ce lieu du monde extérieur. Chemin faisant, il rencontrera une foule de personnages qui joueront avec son esprit et ses nerfs, sans le rapprocher une seule fois de ce Saint qui semble terriblement absent de leur vie quotidienne : le docteur Rubbe, monsieur Loyal versé dans la pétomanie, Evelyne, pré-adolescente surdouée et nymphomane, Faux-Derche, Noir haut placé dans la mystérieuse hiérarchie du groupe et imitant à la perfection l’accent antillais, ou encore Bellétron, malheureux éditeur transformé en cheval.
Tandis que le jeune journaliste s’épuise physiquement et nerveusement, balloté par les manipulations, mensonges et mises en scène de cette étrange communauté, le lecteur se retrouve sans cesse confronté à une terrible question : cette communauté qui a su radicalement renouveler son rapport à la connaissance et au sexe relève-t-elle de l’utopie ou de la contre-utopie, ou, pour le dire en des termes résonnant plus directement avec l’ouvrage, le pauvre journaliste pénètre-t-il dans le Château (de Kafka) ou dans l’Abbaye de Thélème (de Rabelais) ?
Avec Dans la maison qui recule, Maurice Mourier propose une relecture grotesque, absurde et souvent hilarante du Château de Kafka, servie par une langue follement inventive qui emprunte autant à la langue de Lewis Carroll qu’à l’imaginaire de Rabelais. Truffé de références et d’allusions littéraires dissimulées aussi bien dans la langue que dans la trame narrative, ce texte permet plusieurs niveaux de lectures, de la plus naïve à la plus érudite.
PRESSE
« Jusqu'au Trou du gnou », par Gabrielle Napoli, La Nouvelle Quinzaine littéraire, 2 mai 2015 : Dans la maison qui recule est l’œuvre d’un esprit érudit et plein d’humour, qui n’écrase pas son lecteur mais au contraire le rend à chaque page plus intelligent, joyeux de saisir au vol les innombrables jeux de mots, de se délecter de poésie, et de reconnaître des échos de textes qui lui sont familiers. L’ironie de Maurice Mourier réside là aussi : passeur d’un patrimoine culturel immense, il se moque des savoirs livresques tout en déplorant leur progressive disparition au profit de discours ineptes.
« Dans la Maison qui recule, Maurice Mourier », par Patryck Froissard, La Cause Littéraire, 22 mai 2015 : On est à la fois dans le théâtre de Guignol et dans la folie géniale d’Antonin Artaud.
Le lecteur qui se laissera tourbillonner dans la dérive du discours déchaîné, dans l’excessif, dans l’incorrect, dans l’impertinent, dans la pétulance, dans l’absurde, dans le salace, dans l’enfilade époustouflante des jeux de mots, calembours et calembredaines irrésistiblement hilarants, dans la succession des pitreries, des facéties, des coq-à-l’âne des acteurs… accomplira un voyage euphorique qui sera à la fois un bienfaisant retour vers une enfance où tous les imaginaires et les illogismes sont ouverts et une étourdissante course à la débauche lexicale sur un impétueux torrent d’amoralité, dans une sorte de nouvelle nef des fous.
Ce livre hors genre peut se consommer de deux façons : de celle d’un gourmand qui l’avalerait d’une seule et longue goulée ou de celle d’un gourmet qui le dégusterait à petits traits.
Quel qu’en soit le mode, la lecture en sera forcément, fortement, jouissive.
« À chacun son château… », par Rachel Lauthelier, Parution.com, 20 mars 2015 : Tout ne serait donc qu’illusion et fantasmagorie ? Mascarade et théâtre ? Un rêve peut-être ? On ne sait pas très bien. Une chose est certaine, on ne se laisserait pas porter par ce « château bateau » – qui ressemble à s’y méprendre à une de ces allégories animées dont Hayao Miyazaki est si friand – si le récit ne nous tenait pas en haleine. Cet univers romanesque dominé par l’absurde nous happe dans un tourbillon qui n’est pas sans rappeler celui de l’existence.
« Maurice Mourier – Dans la maison qui recule », par Teddy Lonjean, Un dernier livre avant la fin du monde, 20 mars 2015 : Bon autant le dire tout de suite, ce livre est dingue, imaginez une sorte de Don Quichotte ou d’Alice au pays des merveilles version Terry Gilliam (Brazil, L’imaginarium du docteur Parnassus). C’est diablement tordu et on n’a pas fini de marcher sur la tête à la lecture de ce roman.
Mais cette folie nous entraîne aussi dans une multitude de références plus ou moins discrètes à des œuvres littéraires. Ici le château de Kafka, là du Rabelais, un petit clin d’œil à Lolita etc… Un jeu littéraire au service d’une histoire farfelue et drôle.
LES LIBRAIRES AUSSI
Librairie Atout livre (Paris) : Vous êtes dans la maison qui recule. Laissez vos repères à l’arrière. Prenez sur votre dos Lewis Carroll, Rabelais, Queneau et Kafka (rien que ça… ) et tournez sans fin dans cette ronde foutraque et poétique !
EXTRAIT
« Silence ! », répéta la voix, une voix désagréablement criarde, accompagnée de raclements de gorge, essoufflée, une de ces voix d’emphysème, encombrée de mucus, dont on a toujours l’impression qu’elles vont se résoudre en toux graillonneuse, et puis non, ça repart au milieu d’efforts pour s’empêcher d’éructer, et ça dit à nouveau : « Silence ! nom de Dieu ! Vous recommencerez plus tard vos jacasseries. Maintenant, on s’arrête, on écoute, on regarde. »
Nous, on ne demandait pas mieux, depuis trois heures qu’on était entrés dans ce trou, par une porte du fond de la cour, près des écuries, et qu’on avançait dans des couloirs creusés jadis par l’eau de ruissellement dans le calcaire tendre, et mal éclairés, de‑ci de-là, par une applique étanche à laquelle accédait un gros fil d’alimentation pendouillant du plafond bas. Mais comme il y avait foule, sûrement – pas commode de jeter un coup d’œil par-dessus son épaule pour s’en assurer, vu l’étroitesse du boyau où plus ça descendait, plus on pataugeait dans des flaques –, il a fallu encore un bon moment pour que les derniers invités débouchent dans l’espèce de grotte ronde aménagée en salle de projection, gradins d’un côté, simplement taillés dans la glaise et recouverts d’un banc continu de plastique noir rembourré, écran géant de l’autre.
On était tous assis, maintenant. Les lumières se sont éteintes (ne subsistait qu’une loupiote rouge indiquant l’issue du couloir par lequel nous étions entrés). Il faisait moite. Le calme était absolu, souligné par le chuintement sporadique et léger d’une eau lointaine, fille de celle qui avait mis des milliers d’années pour aménager ce réseau sous le Château, enfin le Château n’existait pas depuis si longtemps, bien sûr, et l’eau n’avait rien aménagé du tout, elle s’était frayé un chemin, tout simplement, en grignotant la roche petit à petit, merde, il faudrait refaire toute la phrase, enfin peu importe : ce réseau, cette vaste cavité souterraine et bien d’autres, disséminées à l’aplomb du plateau, dont on nous avait laissé entendre l’existence, sans nous les montrer jamais.
Puis ça a commencé : pour être honnête, on avait un peu de mal à suivre l’action, vu qu’il n’y avait ni paroles ni musique et que, dans les films de ce temps-là, tout va tellement vite, il y a tellement d’allusions que franchement on se demande comment faisaient les gens, ils étaient peut-être plus malins que nous. Enfin, c’était d’abord un homme à la stature frêle qui se promenait dans une immense pièce, l’air désemparé, un candélabre à la main. De temps en temps, il s’asseyait à une table et commençait à jouer aux cartes avec des fantômes qui le désignaient tous du doigt. Puis un caractère japonais ou chinois – mais ça, c’était peut-être avant, le film est très long – s’inscrivait sur une autre table devant un vieillard à barbe blanche et, quand il redressait la tête d’un coup, pour fixer le spectateur, on voyait qu’il avait des yeux très particuliers, très clairs, qui brillaient dans son visage comme des éclats de verre. Une voiture roulait à toute allure à travers la forêt, en pleine nuit. De chaque côté de l’image, d’une écriture tremblée et sautillante, apparaissait en surimpression ce mot : melior, ou peut-être melchior, enfin quelque chose de ce genre. Des policiers donnaient l’assaut à un immeuble et le criminel s’enfuyait par une trappe, mais il se faisait cueillir en bas, après une séquence qui ressemblait à une hallucination : ses propres murs bougeaient et se retournaient contre lui. Quant au grand personnage sec, décharné, un bâton à la main, sur le dos une sorte de toge grise et flottante, au-dessus de sa tête la lune éclatante et blanche, toute ronde, occupant la moitié du ciel, c’était sans doute dans un autre film, la séance était si longue qu’on s’y noyait plus ou moins, et personne ne nous avait prévenus de rien à l’avance, comme toujours, et on a attendu en vain ce qu’on nous avait demandé d’écouter, tout était muet, encore une manie du Saint, peut-être après tout que c’était seulement le silence, ou pour se moquer de nous ; les anciens, ça ne peut guère les déranger, on est habitués, mais les nouveaux… Quand on est sortis, finalement, après encore longtemps dans ce labyrinthe humide, avec ce petit ru à traverser – il valait mieux avoir pris ses précautions, et aller carrément nu-pieds – et partout, sur les parois, des stalactites, ou stalagmites je ne sais pas, dans le couloir de remontée, il y en avait qui essayaient de bâiller avec discrétion derrière leur poing fermé, mais nous les anciens, on voyait bien qu’ils bâillaient et ça nous faisait rigoler en douce, ça nous rappelait le bon vieux temps de l’arrivée, et comment on s’était connus et tout ça, et tout ce qu’on traînait de préjugés du dehors. Oui, ça nous plaisait bien de les voir déboucher dans la cour du Château, qui est si chaude et lumineuse, clignant des yeux comme des hiboux, et bien désorientés, il faut le dire, par cette plongée dans l’espace d’un autre temps.
Ama atque fuge , telle est la devise que j’avais oublié de noter hier soir en bouclant ma chronique du jour, c’est embêtant parce que, avec le travail que j’ai par ailleurs, il ne faudrait pas que j’empiète trop du compte rendu de la veille sur celui du lendemain, ça me déphaserait vite rapport au calendrier, et qui est-ce qui se ferait engueuler après, c’est bibi, le Saint aime bien que tout soit en ordre quand il fait son inspection, registres et tout, et que rien ne manque, surtout pas quelque chose d’aussi important qu’une devise nouvelle, gravée à grands frais sur le mur, juste avant d’entrer dans la salle de cinéma que j’ai dite. La maison est pleine d’inscriptions d’ailleurs ; je n’en comprends aucune, même quand on me les explique, mais mon devoir est de les transcrire toujours bien exactement sur le registre et je m’efforce d’être soigneux.
Vous croyez vraiment que ça a une importance, vous, la personnalité de celui qui tient la plume ? Moi non, je ne crois pas. Quand le Saint m’a enlevé aux cuisines pour me mettre scribe, j’ai pensé il se fout de moi, mais il m’a dit : tu dois assumer, alors j’assume. C’est un homme, celui-là, on ne peut pas beaucoup lui résister. Il a la sainteté, d’abord, et puis, comment dire ?, quand on est fils de quelqu’un, qui est fils de quelqu’un d’autre, et on remonte comme ça peut-être dix générations, et tous des saints authentiques, il n’y a pas à discuter, ça impose. J’étais bon cuisinier pourtant, il ne l’a pas nié. Panier percé, ça oui, mais ici on a tout à gogo. J’avais fait ma demande pour le chenil, je me retrouve à l’écritoire. Enfin, c’est vrai qu’il n’y a plus qu’un vieux chien. D’un côté j’aurais eu moins à trimer, à courir, parce qu’il y en a du passage, ici, et quand il faut consigner tout,… mais on s’habitue à force aux responsabilités, comme dit Faux‑Derche « c’est valowisant ». Et puis le passage peut épargner de la peine aussi, quand on voit arriver un journaliste comme ce Jeune Homme Blet, par exemple, qui s’est amené ce matin et qui me confie les notes griffonnées pour son propre compte, un reportage payé par son canard. Eh bien !, avant de les passer à Faux-Derche pour qu’il les envoie, je peux en copier un bout, ça change, ça met un peu d’animation, un autre style, et puis ça bourre les trous, je remplis mon espace plus facilement et le Saint n’a rien à y redire, c’est dans mon contrat. Il faut quand même que je garde du temps pour tout le reste du boulot, il le sait bien, il n’est pas fou, sans compter que j’écris lentement, ça n’est pas mon métier, moi. Aussi, le Saint me donne des leçons, mais gentiment. Quand il m’a dit : la scène de cinéma, tu en as parlé au passé, ça ne va pas du tout, il faut tout donner au présent, eh bien !, il a fait ça gentiment, et j’ai compris. C’est seulement pour le Saint que le passé existe, le sens de la vie, quoi, pour le scribe n’existe que la vie, qui va, qui s’écoule, dépourvue de sens. Du présent tout cru, du tout venant, pas de la durée. Il m’a dit aussi : efface-toi un peu, bonhomme, ne ramène pas tout le temps ta fraise, alors, là aussi j’ai pris de bonnes résolutions. Tout ce que je vais raconter maintenant, ce sera comme si je n’étais pas là, et je ne suis pas là, en fait. Je tiens la plume. On ne peut pas être à la foire et au moulin, « à la poiwe et au fwometon », comme dit Faux-Derche, celui-là il nous fera toujours rire. Mais j’ai intérêt à me dépêcher, avec tout ce que j’ai à écrire encore, toute l’arrivée du Jeune Homme Blet, ça me fait un paquet, et ma chandelle qui se consume, il est trop tard pour aller en demander une au magasin, surtout que l’Adjudant-Gardien n’est pas aimable, il ne peut piffer personne, voilà la vérité. Ah ! c’est difficile d’être un bon scribe, j’ai dit cent fois qu’on change l’ampoule de ma cellule, mais ici il ne faut pas être pressé, ça va, ça vient, le Saint s’en balance, de l’intendance, tiens ! ça rime, ça ! Il a sa mission, il n’est presque jamais là, une grande maison comme ça, ça ne peut pas tourner tout seul. Enfin j’arrête, je vais pisser un coup, boire un godet, me rincer l’œil à la fenêtre des petites si j’ose descendre en chaussons pour les surprendre, avec ça qu’elles ne s’y attendent pas, d’ailleurs, et puis roulez jeunesse, et tout au présent, comme il m’a dit. Le présent, ça va me frustrer, en un sens. Pas moyen de faire des beaux effets, et moi j’aurais bien voulu les apprendre, les effets, mais le Saint, ça ne lui plaisait pas, les fioritures, il se les garde pour ses vieux jours, moi je suis seulement l’aide-mémoire, et j’en suis fier, si vous voulez le savoir, même si ses mots à lui je n’en ai pas beaucoup à transcrire, et ses faits et gestes n’en parlons pas, c’est un homme qui brille par son absence, et quand il est là par hasard, l’activité et lui ça fait deux. Mais je me rattraperai avec les bouts volés au Jeune Homme Blet. Lui, il a appris dans les écoles, et je m’en vais employer sa copie sans en sauter une ligne, il ferait beau voir que je sois obligé de lui changer tous ses verbes, à celui-là, où serait le bénéfice ? Double travail plutôt, pour harmoniser tout ensemble, vérifier dans le dictionnaire, je n’en aurais jamais fini. Et puis foutre! là, c’est dit, je descends voir les petites. Liane aura laissé la lumière allumée, elle le fait toujours. Elles sont bien gentilles, elles aussi. Elles pensent au pauvre scribe, tout seul dans sa cagna, tout en haut de la tour qui donne sur la garrigue déserte, aux cuisines je voyais du monde, heureusement qu’il me reste un peu de besogne en dehors d’ici, je suis un homme de grand air, moi, pas comme tous ces messieurs-dames toujours confinés, je descends, foutre ! Quand j’y songe, il aurait pu donner ce travail-là à n’importe qui de qualifié, il n’en manque pas, qui traînent toute la journée et qui sont instruits, foutre !
« Stop !, crie l’Adjudant-Gardien, plus personne, du balai ! ». En même temps, il décharge par deux fois son fusil de chasse dans la direction du type, qui s’arrête, effrayé par le bruit du petit plomb retombant en averse serrée sur les touffes de buis. En cette saison, tout l’été leur a passé dessus, elles sont couleur de cuivre roux et semblent lourdes et sans éclat. Il en monte un parfum dense. Le sentier des garrigues serpente au milieu et se faufile vers le mur de pierres sèches. Dans l’épaisseur du mur est construite la cahute de l’Adjudant-Gardien. La tête de l’Adjudant-Gardien se voit derrière un lucarneau découpé dans l’empilement très régulier des pierres qui constituent ce qu’ils appellent ici une « borie », ils aiment se compliquer la vie, avec les noms, à côté il y a le canon du fusil de chasse, bronzé noir de guerre.
Immobile dans la vallée minuscule, sans visibilité aucune, une sente plutôt, une rigole sans eau, encombrée par endroits de pierraille grise et plate chue des blocs de calcaire effrité, clivé, qui gisent pêle-mêle, le type a l’air décontenancé. Il hume vaguement les hauts buis d’un jaune vert. Leurs petites feuilles rondes, dures et vernissées, lui cachent en partie la cahute et l’Adjudant-Gardien, et peut-être ne sait-il pas d’où sont venus les coups, il peut y avoir des chasseurs dans le coin, qui ont tiré au jugé, comme ils font toujours, sur quelque chose qu’ils ont cru voir, mais bientôt l’Adjudant-Gardien se montre, juché sur le haut du mur éboulé à droite de la sente qui grimpe rudement jusqu’à lui. Il est sans couleur ni forme, entre deux âges, tassé sous son béret.
« Eh ! vous là, dit le type aussi fort qu’il le peut. C’est comme ça que vous accueillez les gens, dans ce pays !
– On n’accueille personne, dit l’Adjudant-Gardien calmement. On chasse.
– J’ai été annoncé, dit le type après une seconde d’hésitation, puis il répète sur un ton plus ferme : j’ai été annoncé, c’est mon journal qui m’envoie.
– Vous avez un laissez-passer ? dit l’Adjudant-Gardien d’une voix dubitative, ou interrogative, ou ironique. »
L’autre ne répond pas, mais de toute façon l’Adjudant‑Gardien n’a pas attendu la réponse. Il est rentré dans sa cahute où l’on entend crachoter un talkie-walkie, sans qu’aucune parole en émane. Après un temps assez long, où il ne se passe rien de notable, il reparaît en haut du mur. Le talkie-walkie, accroché à un passant de sa grosse ceinture de cuir, pousse à intervalles réguliers un couinement glaireux, mais il n’y prête pas attention. Pivotant sur le mur, il met ses mains en porte-voix et, sans beaucoup hausser le ton, comme s’adressant à la partie haute des garrigues au-dessus de sa tête : « Dis donc, Planteur, fait-il, il y a là un Jeune Homme Blet qui dit qu’on l’attend. Qu’est-ce que tu en penses, au juste ? »
Il s’écoule bien trois ou quatre minutes, puis une autre voix, également calme, arrive de nulle part : « Attends », dit-elle. L’Adjudant-Gardien s’assied sur le mur, aussi confortablement que le lui permet la déclivité de l’éboulis.
« Qu’est-ce que je fais, moi ?, demande le type.
– Rien, dit l’Adjudant-Gardien. Le Planteur est allé aux ordres. » Puis il sort de la poche de son battle dress pisseux un oignon pelé et mord dedans.
Une heure passe. Le ciel est toujours aussi lumineux. Des abeilles volent autour des buis. Le type paraît s’être résigné. Il s’est couché parmi les pierres, sur une mousse très courte et sèche, à l’ombre également courte des buis.
Plus tard arrive une sorte d’appel lointain, indistinct, quelque chose comme « Hon ! Hon ! », puis, plus rien. À la ceinture de l’Adjudant-Gardien, le talkie-walkie a cessé d’émettre son clapotis de gargouille. L’Adjudant-Gardien rentre dans sa cahute. Le type se redresse, lentement se lève et, avançant avec circonspection, il monte ce qui reste du sentier jusqu’au mur. Rien ne bouge. Il finit par pénétrer dans la borie. L’Adjudant-Gardien est assis à terre, sur un rond de sable fin où il trace des figures géométriques avec une brindille de buis.
« Et alors ? dit le type.
– Alors quoi ? dit l’Adjudant-Gardien.
– Ils ont dit quelque chose ?
– Vous n’avez pas entendu ? dit l’Adjudant-Gardien. La voie est libre, mon vieux.
– Quelle voie ? dit le type ». L’Adjudant-Gardien ne répond pas. Du pouce, il désigne le mur au-dessus de lui. Le type ressort de la cahute, hésite, escalade le mur dans les pierrailles blanches et grises qui roulent sous ses pieds. De l’autre côté, il n’y a rien, pas une barrière. Seulement des masses plus ou moins rondes de thym gris sur gris dans la lumière intense qui avale toutes les couleurs. Le type n’a rien de mieux à faire que de mettre un pied devant l’autre sur le plateau couvert d’un inégal damier de surfaces sèches, caillouteuses, où ni le thym ni d’autres herbes odoriférantes ne poussent bien haut, chacune des cases du damier étant délimitée, sur les quatre côtés, par des murs de pierres sèches écroulées, ou parfois des chemins blancs de calcaire.
Au bout de deux ou trois cents mètres sans obstacle autre que des petits murs qu’il faut sauter de temps en temps, le type entend le bruit régulier d’une houe qui frappe le sol. Dans un mouchoir de poche d’argile sèche sertie de cailloux, quelqu’un travaille. Le type s’approche du grand rouquin maigre qui s’acharne, un vieux feutre cabossé lui protégeant les yeux, à côté de lui une botte d’arbrisseaux tout secs serrés dans un tour de ficelle grossière.
« Ainsi, c’est vous, le Jeune Homme Blet, dit le grand maigre sans se retourner vers le type, sans s’arrêter un seul instant de jeter son outil la pointe contre le sol, avec comme seul résultat, semble-t-il, de l’écorcher en surface et de faire jaillir de minces nuages d’une poussière ocre. Je vous salue.
– Et vous, c’est le Planteur, sans doute, dit le Jeune Homme.
– J’Hop d’un Œil, c’est mon vrai nom, répond le maigre. Le Planteur n’est qu’un surnom. J’aime planter.
– Et vous plantez quoi ? dit le Jeune Homme avec un intérêt poli.
– Pour le moment, des cerisiers, dit J’Hop d’un Œil. Je suis passablement en avance. Mieux vaut planter en plein automne. Il y a bien moins à arroser.
– Alors, pourquoi le faire maintenant ? dit le Jeune Homme.
– On ne fait pas toujours ce qu’on veut, dit J’Hop d’un Œil, ainsi vous, vous aimeriez bien voir le Saint pour l’interroger, pas vrai ? Pour qu’il vous dise des choses qu’il n’a jamais dites à personne, pas même aux anciens comme moi, hein ? hein ?
– À vrai dire, commence le Jeune Homme d’une voix embarrassée, je ne sais pas trop… Je n’ai jamais rêvé… Vous voyez, mon journal m’accrédite seulement…
– Eh bien !, vous ne pourrez pas, dit J’Hop d’un Œil triomphalement. Et non pas parce qu’on vous en veut personnellement, mais le Saint n’est pas là, c’est un fait, vous feriez mieux de vous en retourner.
– Mais je ne suis pas pressé, dit le Jeune Homme. Mon journal m’a laissé toute liberté, il est question de semaines, de mois peut-être, mes patrons tiennent beaucoup trop à ce reportage pour le voir échouer, et si vous-même pouvez m’aider, nul doute qu’une forme de reconnaissance de leur part, quelque chose de matériel, s’entend… »
J’Hop d’un Œil continue son travail avec le plus grand calme. Un petit trou s’est finalement ouvert dans le sol presque aussi dur que de la terre cuite. Il s’arrête. Le Jeune Homme distingue un grand nez sous le rebord du chapeau qui descend très bas, mais le regard n’apparaît pas.
« Le cerisier est un végétal excellent, note sentencieusement J’Hop d’un Œil, quand on arrive à le faire fructifier, ce qui ici n’est guère facile. Franchement, s’ils ne m’avaient pas, je me demande ce qu’ils pourraient réussir, au Château.
– Ça m’en a tout l’air, dit le Jeune Homme pour être aimable.
– À vrai dire, mon vieux, vous n’en savez absolument rien, dit J’Hop d’un Œil, et c’est bien ainsi. Chacun son métier, et les vaches seront bien gardées. » Puis, sans transition : « C’est par là, dit-il en agitant vers l’ouest un pouce très noir. Vous ne pourrez pas manquer la maison, ça non, vous ne pourrez pas la manquer. Elle est vide, malheureusement. » Et il se remet à gratter la terre comme un furieux.
Le Jeune Homme commence à s’éloigner. Quand il est déjà à une cinquantaine de mètres mais encore à portée de voix, J’Hop d’un Œil, le Planteur, prend son élan et beugle, littéralement, comme si l’autre était au bout de l’horizon : « Quand vous verrez Évelyne, dites-lui de passer me voir. Moi, je n’ai guère le temps d’aller m’amuser au Château, foutre non !
– Je le ferai, c’est promis ! » Le Jeune Homme s’efforce de lancer sa réponse avec autant de vigueur que le Planteur, pour se mettre à l’unisson de son interlocuteur et recueillir, peut-être, un remerciement, mais J’Hop d’un Œil, tout occupé à creuser son trou, ne manifeste en rien, par un geste quelconque, qu’il ait seulement entendu.
Devant le Jeune Homme s’étend un nouvel espace, du même type que le précédent : des amoncellements ruiniformes de pierres blanches ou grises, qui ont pu être des murs il y a très longtemps, des zones de végétation courte où abondent le thym, la sauge, le romarin, et où, par places, on trouve aussi de vieux ceps de vigne couverts d’une guenille d’écorce noire, morts, à demi déracinés, victimes déjà anciennes d’un incendie. Mais pas de bâtiment en vue, rien de repérable, vers la droite une ligne de chênes verts clairsemés. Le Château est peut-être au-delà de la colline pelée que le sentier raye de blanc jaunâtre, là-bas dans un creux. C’est ce que doit supposer le visiteur qui hâte le pas. Lentement, l’éclat du soleil a faibli. À mesure que, de très loin, le crépuscule se prépare, la différence de couleur entre les pierres du chemin, gris de fer ou ocre clair, souvent creusées de multiples trous, rainures et rigoles, et celles des anciens murs écroulés, blanches, incrustées de coquillages fossiles, s’accuse. Il y a parfois des genévriers géants, couverts de grosses boules vert tendre, qui marquent, à gauche et à droite, les limites du sentier et qu’on appelle ici des « cades » on se demande pourquoi. Pas de fleurs, mais des mousses roussies par l’été, des feuilles de chêne sèches et recroquevillées, peu d’oiseaux, aucun autre animal visible.
En son point le plus haut, là où il franchit la croupe de la médiocre colline où la pierre affleure, le sentier fait vers la gauche un coude brusque et l’on découvre enfin, tout contre l’horizon de l’ouest, dans les rayons du soleil couchant, les formes massives de quelques bastides carrées et, en avant de ce qui doit être un village, égaillées en divers points du site, très éloignées les unes des autres, d’autres bastides dont rien ne laisse supposer qu’elles soient groupées en un ou même en plusieurs hameaux. Bientôt, le Jeune Homme arrive à un carrefour où le chemin se divise en plusieurs branches, sans aucun poteau indicateur. Mais là, sur une sorte de dolmen bas, un peu en retrait des chemins partant vers la droite, un homme est assis, d’un certain âge, vêtu d’un costume gris d’une élégance tout urbaine, cravaté malgré la chaleur. Il est en train d’écrire quelque chose dans un calepin, ou d’y dessiner, avec calme, le buste légèrement penché vers les genoux, et dit sans lever la tête : « Belle journée, n’est-ce pas ?, pour une promenade, ou plutôt, n’est-ce pas ?, belle soirée, si l’on veut être absolument exact et il le faut, il le faut.
– J’aimerais vous remercier d’abord, dit le Jeune Homme. Vous êtes la première personne aimable que je rencontre depuis mon arrivée.
– Vous voulez sans doute dire depuis que vous avez commencé à diriger vos pas chancelants encore que juvéniles de ce côté-ci de l’horizon… Appelez-moi Professeur, ce sera plus correct. Vous pourriez être mon étudiant, n’est-ce pas ?
– Oui, Monsieur le Professeur, dit le Jeune Homme soudain un peu intimidé.
– « Professeur » suffit amplement, dit le Professeur avec bienveillance, « Monsieur le » est de trop, restons simples, voulez-vous ? Et qui donc avez-vous rencontré sur la route, qui vous ait ainsi froissé, et vilainement, à voir votre petite mine ?
– Froissé ? dit le Jeune Homme avec aigreur. On m’a tiré dessus, pour commencer, voilà la vérité. Ce cochon de Garde m’a manqué de peu.
– Ah ! Ah !, dit le Professeur, voilà qui est amusant en diable. Ce n’est pas un Garde, c’est l’Adjudant-Gardien. Il s’est fixé ici, il travaille un peu pour le Promoteur, de façon bénévole, je crois. Il n’a absolument aucun droit sur la propriété. Il a agi tout à fait de son propre chef, je vais noter cela, c’est tout à fait divertissant, non dépourvu de conséquences, toutefois. Il avait abattu tout un groupe de touristes une année, ce devait être en 75, comme le canon sans recul. » Et là-dessus, il se met à rire, plié en deux sur son calepin.
« Abattu ?, dit le Jeune Homme avec horreur. Mais qu’a-t-on fait ?
– Rassurez-vous, dit le Professeur, notre ami J’Hop d’un Œil, qui est hollandais, les a enterrés très proprement. La garrigue est pleine de trous, c’est très commode. Les Hollandais n’aiment pas ce qui traîne. Ils ont un sens inné de la propreté, presque incroyable. Ah ! Ah ! quand J’Hop d’un Œil, qu’est-ce que je fais de l’autre, n’est-ce pas ?, on est en droit de se le demander.
– Je n’avais pas compris tout de suite que vous plaisantiez, dit le Jeune Homme, j’ai rencontré Monsieur J’Hop d’un Œil, en effet, il n’est pas très causant, mais il m’a paru bien inoffensif.
– La plaisanterie n’est pas mon fort, dit le Professeur, mais enfin je vous pardonne. Quand on ne connaît pas les gens, n’est-il pas vrai, mon cher J’Hop ?
– Il faudra se débarrasser de cet Adjudant, dit J’Hop, qui surgit de derrière un bouquet de chênes verts proche du dolmen, tout à fait comme un personnage de dessin animé. Du Promoteur aussi, d’ailleurs. Ils n’ont rien à faire ici ni l’un ni l’autre.
– En les noyant dans le bassin ? dit le Professeur intéressé.
– Plutôt en les flanquant dans un puits quelconque, dit J’Hop. Ce plateau est un gruyère.
– Karst, dit le Professeur. Karstique, de toute évidence, les caractéristiques mêmes du karst.
– Pour sûr, vous êtes sarcastique aujourd’hui, dit J’Hop.
– Sâr Karstique, si vous voulez, dit le Professeur avec satisfaction, c’est là un titre que je porterais volontiers, en sus des autres. » Puis il ajoute sans transition, ne s’adressant à personne en particulier : « Notre jeune ami s’étendra sous le dolmen, c’est un lieu idéal pour bivouaquer en cette saison et à cet âge, hélas ! hélas !, le bel âge, je le conduirai demain au Château, ce soir j’ai à faire, malheureusement. Il faut que cette tournée de conférences soit réglée, le Saint m’attend.
– Mais si vous allez auprès du Saint, pourquoi ne pas m’emmener avec vous ? dit le Jeune Homme. C’est justement lui que je veux voir, mon journal me l’a demandé et je n’ai pas beaucoup de temps. »
Mais personne ne répond. La nuit est tout à fait tombée. On entend le coassement lointain de grenouilles, ce qui, en ce lieu qui semble si sec, produit une impression un peu étrange. En tâtonnant, le Jeune Homme se glisse sous le dolmen et s’allonge sur le sol couvert d’un sable très fin. En s’arc-boutant et se poussant des coudes, pour poser avec précaution sa tête sur la partie bombée d’une des deux pierres dressées, qui forme une espèce de coussin sans rudesse, vu le grain presque imperceptible du calcaire, tendu comme une peau, il rencontre à sa main droite une pomme. Comme il doit être assoiffé et affamé par sa journée d’attente, il la croque et s’endort aussitôt, bien avant le lever de la lune.
Je suis sorti de mon premier sommeil à une heure que je ne puis déterminer avec précision, réveillé par une clarté à la fois intense et louche. Les rayons de la lune, venus de l’horizon de gauche et tamisés d’abord par la masse oblongue d’un genévrier de haute taille, pénétraient peu à peu jusqu’à moi par le rectangle de pierre et de sable que délimitaient les deux piles et le tablier du dolmen d’une part, et, de l’autre, le sol sur lequel je m’étais couché. Il n’y avait plus un seul bruit. Les grenouilles, tout à l’heure présentes, s’étaient tues.
La lumière de la lune n’avance pas, ne progresse pas. On ne la voit pas arriver, elle ne prévient pas. Elle coule exactement comme une eau, et remplit l’espace dont elle abolit les saillies, les angles, si bien qu’on ne peut plus se la représenter autrement qu’en creux : une succession de trous d’eau, de vasques qui se rempliraient peu à peu et finiraient par déborder, par darder doucement vers vous leurs langues blanches et bleues. Ainsi monte la mer dans les anfractuosités calmes, loin du large, un à un, conquérant tous les îlots, inexorable et froide.
L’impression d’une attente s’imposait à moi. Une attente singulière. J’espérais la lune, sans trop y croire. Elle vint au bout d’un temps très long. Mon cœur battait sans cause. Il me semblait que j’avais douze ans encore. N’étais-je pas un peu endormi ? En train de remuer des rêves ? Démasquée par la panse noire du genévrier, elle fut là soudain. De ma position allongée, dans le grand axe du dolmen, la tête au nord, les bras strictement allongés le long des flancs, les deux mains posées à plat, paumes au contact du sable, je la voyais s’encadrer entre le pilier sud, à mi-hauteur, et la quenouille ronde de l’arbre, dans sa plénitude vieil or, rayonnant d’une lumière sans stridence aucune, bleutée.
Je me demandais qui l’avait contemplée ainsi, à ma place, dans les temps anciens, quel pèlerin de Saint-Jacques, quel vagabond du temps des Armagnacs, quel berger. Personne, sans doute, le dolmen devait être resté enfoui des siècles, depuis l’époque perdue où il servait aux festivités lunaires. Malheur ! j’avais besoin d’aller vers le présent, cette lune superbe me tirait tout entier au passé, à la cuve sans fond de l’inconnu. Car le passé est plus mystérieux que l’avenir ; infiniment. Chaque seconde, un peu plus, le repousse. Je fermai les yeux. Quand je les rouvris, l’astre avait disparu du cadre limité de ma fenêtre. Je songeai que je ne le verrais jamais plus comme ce soir, dussé-je passer tout le reste de ma vie à cette place. Une année, ce serait le jour que je manquerais, la minute précise. Une autre, le temps brouillé voilerait le ciel de nuages. La lune avait lui pour moi, ici, une seule fois. Je sentis la durée dont je disposais peut-être encore se recroqueviller comme un poing qu’on serre.
Le silence, écrasant, me sertissait de toutes parts. Par poussées fulgurantes de ma volonté, j’essayais d’esquisser un geste quelconque, qui pût éveiller un bruit, si léger fût-il, si ténu, si futile. Une sorte de paralysie m’en empêchait, et cette lumière dépourvue d’éclat, dans ce paysage où même les rocs, massifs et mats, absorbent placidement tout rayon chu et le digèrent.
J’avais les yeux ouverts et je dormais. Avec méthode, la lune investissait le plateau. Je la sentais qui se retirait de moi sur la pointe des pieds, me laissant seul.